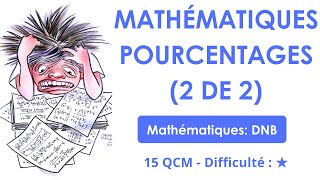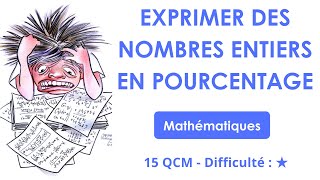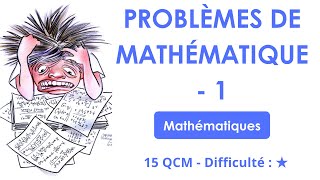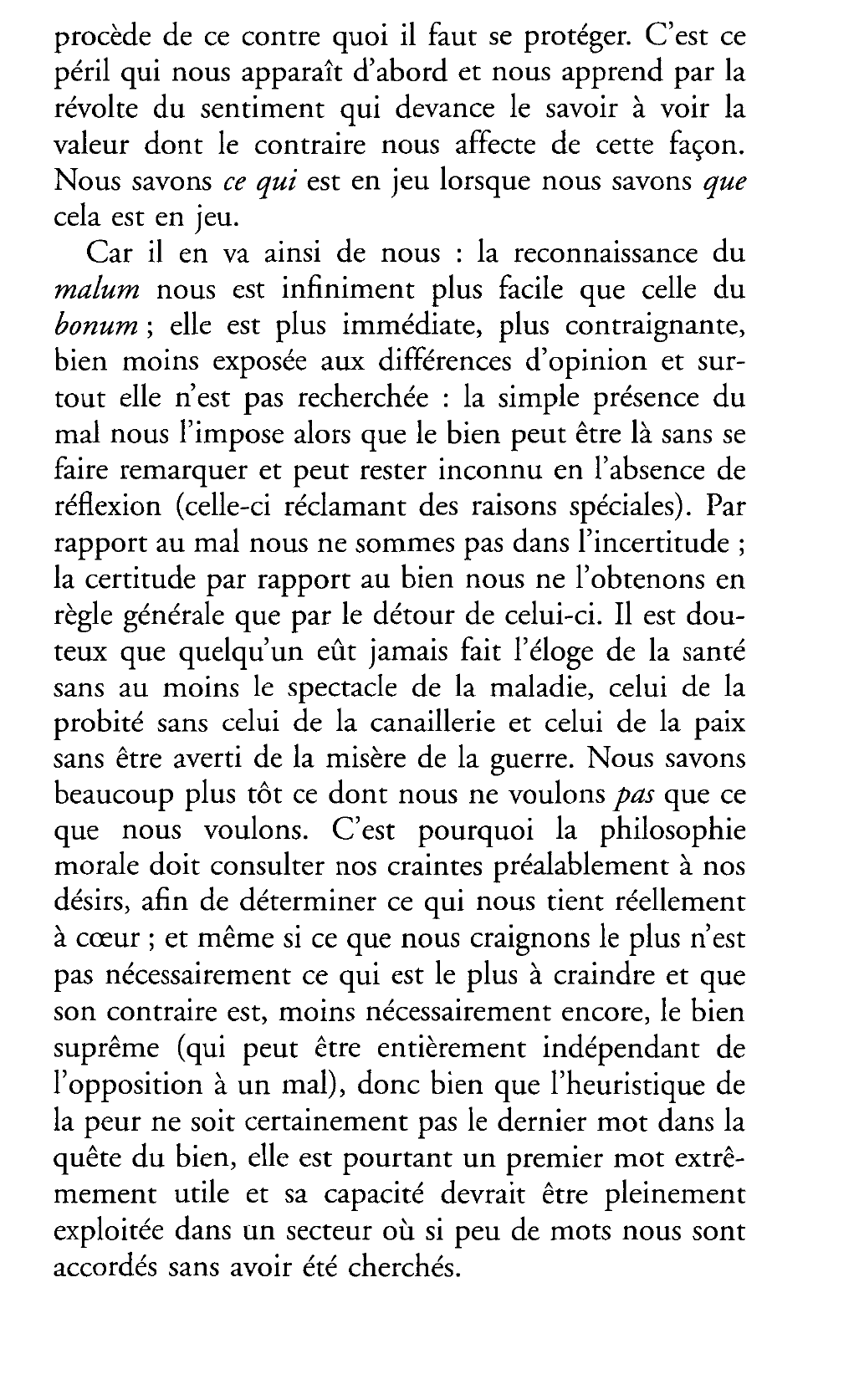Anthologie philosophique: L'ECOLOGIE
Publié le 25/03/2015
Extrait du document

EXTRAITS
1. Heuristique de la peur
Hans Jonas, Le Principe responsabilité [1979],
trad. Jean Greisch, Paris, Flammarion,
« Champs essais «, II, p. 65-67.
De même que nous ignorerions le caractère sacré de la vie si l'on ne tuait pas, et que le commandement « Tu ne tueras pas « ne ferait pas apparaître ce caractère sacré ; et que nous ignorerions la valeur de la véracité s'il n'y avait pas de mensonge, la liberté s'il n'y avait pas d'absence de liberté et ainsi de suite, de même aussi dans notre cas d'une éthique encore à chercher de la responsabilité à longue distance qu'aucune transgres-sion actuelle n'a déjà révélée maintenant dans la réalité, c'est seulement la prévision d'une déformation de l'homme qui nous procure le concept de l'homme qu'il s'agit de prémunir et nous avons besoin de la menace contre l'image de l'homme — et de types tout à fait spécifiques de menace — pour nous assurer d'une image vraie de l'homme grâce à la frayeur émanant de cette menace. Tant que le péril est inconnu, on ignore ce qui doit être protégé et pourquoi il le doit : contrairement à toute logique et toute méthode le savoir à ce sujet
procède de ce contre quoi il faut se protéger. C'est ce péril qui nous apparaît d'abord et nous apprend par la révolte du sentiment qui devance le savoir à voir la valeur dont le contraire nous affecte de cette façon. Nous savons ce qui est en jeu lorsque nous savons que cela est en jeu.
Car il en va ainsi de nous : la reconnaissance du malum nous est infiniment plus facile que celle du bonum ; elle est plus immédiate, plus contraignante, bien moins exposée aux différences d'opinion et sur¬tout elle n'est pas recherchée : la simple présence du mal nous l'impose alors que le bien peut être là sans se faire remarquer et peut rester inconnu en l'absence de réflexion (celle-ci réclamant des raisons spéciales). Par rapport au mal nous ne sommes pas dans l'incertitude ; la certitude par rapport au bien nous ne l'obtenons en règle générale que par le détour de celui-ci. Il est dou-teux que quelqu'un eût jamais fait l'éloge de la santé sans au moins le spectacle de la maladie, celui de la probité sans celui de la canaillerie et celui de la paix sans être averti de la misère de la guerre. Nous savons beaucoup plus tôt ce dont nous ne voulons pas que ce que nous voulons. C'est pourquoi la philosophie morale doit consulter nos craintes préalablement à nos désirs, afin de déterminer ce qui nous tient réellement à cœur ; et même si ce que nous craignons le plus n'est pas nécessairement ce qui est le plus à craindre et que son contraire est, moins nécessairement encore, le bien suprême (qui peut être entièrement indépendant de l'opposition à un mal), donc bien que l'heuristique de la peur ne soit certainement pas le dernier mot dans la quête du bien, elle est pourtant un premier mot extrê-mement utile et sa capacité devrait être pleinement exploitée dans un secteur où si peu de mots nous sont accordés sans avoir été cherchés.
2. Le gouvernement par la peur
Machiavel, Le Prince [1513], trad. Yves Lévy,
Paris, GF-Flammarion, xvii, p. 137-138.
Il faut [...] qu'un prince ne se soucie pas d'avoir le mauvais renom de cruel, pour tenir ses sujets unis et fidèles : car avec très peu d'exemples il sera plus pitoyable que ceux qui, par excès de pitié, laissent se poursuivre les désordres, d'où naissent meurtres et rapines ; car ceux-ci d'ordinaire nuisent à une collecti¬vité entière, et les exécutions qui viennent du prince nuisent à un particulier. Et parmi tous les princes, c'est au prince nouveau qu'il est impossible d'éviter le nom de cruel, parce que les États nouveaux sont pleins de périls. [...]
Toutefois, il ne doit pas croire ni agir à la légère, ni se faire peur à lui-même, et procéder d'une façon tem¬pérée par la sagesse de l'humanité, de peur que trop de confiance ne fasse de lui un imprudent, que trop de défiance ne le rende intolérable.
De là naît une dispute : s'il est meilleur d'être aimé que craint, ou l'inverse. On répond qu'on voudrait être l'un et l'autre ; mais comme il est difficile de les marier ensemble, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, quand on doit manquer de l'un des deux. Des hommes, en effet, on peut dire généralement ceci : qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimu¬lateurs, ennemis des dangers, avides de gain ; et tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi, t'offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants, comme j'ai dit plus haut, quand le besoin est lointain ; mais quand il s'approche de toi, ils se dérobent. Et le prince qui s'est entièrement reposé sur leurs paroles, se trou
vant dénué d'autres préparatifs, succombe ; car les ami-tiés qui s'acquièrent à prix d'argent, et non par grandeur et noblesse d'âme, on les paye, mais on ne les possède pas, et quand les temps sont venus, on ne peut les dépenser. Et les hommes hésitent moins à nuire à un qui se fait aimer qu'à un qui se fait craindre ; car l'amour est maintenu par un lien d'obligation qui, parce que les hommes sont méchants, est rompu par toute occasion de profit particulier ; mais la crainte est maintenue par une peur de châtiment qui ne t'aban-donne jamais.
3. Le principe d'utilité
Jeremy Bentham, Traités de législation civile
et pénale [1802], t. I, Paris, Rey et Gravier, 1830,
« Principes de législation «, I, p. 3-6.
La nature a placé l'homme sous l'empire du plaisir et de la douleur. Nous leur devons toutes nos idées ; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie. Celui qui prétend se sous-traire à cet assujettissement ne sait pas ce qu'il dit : il a pour unique objet de chercher le plaisir, d'éviter la douleur, dans le moment même où il se refuse aux plus grands plaisirs, et où il embrasse les plus vives douleurs. Ces sentiments éternels et irrésistibles doivent être la grande étude du moraliste et du législateur. Le principe de l'utilité subordonne tout à ces deux mobiles.
« Utilité « est un terme abstrait. Il exprime la pro-priété ou la tendance d'une chose à préserver de quelque mal ou à procurer quelque bien. « Mal «, c'est peine, douleur ou cause de douleur. « Bien «, c'est plai-sir ou cause de plaisir. Ce qui est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'un individu, c'est ce qui tend à augmen¬ter la somme totale de son bien-être. Ce qui est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'une communauté, c'est ce qui tend à augmenter la somme totale du bien-être des individus qui la composent. [...]
La logique de l'utilité consiste à partir du calcul, ou de la comparaison des peines et des plaisirs dans toutes les opérations du jugement, et à n'y faire entrer aucune autre idée.
Je suis partisan du principe de l'utilité, lorsque je mesure mon approbation ou ma désapprobation d'un acte privé ou public sur sa tendance à produire des
peines et des plaisirs ; lorsque j'emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, mauvais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines peines et de certains plaisirs, sans leur donner aucun autre sens : bien entendu que je prends ces mots, peine et plaisir, dans leur signification vulgaire, sans inventer des définitions arbitraires pour donner l'exclusion à certains plaisirs ou pour nier l'existence de certaines peines. Point de subtilité, point de métaphysique ; il ne faut consulter ni Platon ni Aristote. Peine et plaisir, c'est ce que chacun sent comme tel, le paysan ainsi que le prince, l'ignorant ainsi que le philosophe.
Pour le partisan du principe de l'utilité, la vertu n'est un bien qu'à cause des plaisirs qui en dérivent : le vice n'est un mal qu'à cause des peines qui en sont la suite. Le bien moral n'est bien que par sa tendance à produire des biens physiques : le mal moral n'est mal que par sa tendance à produire des maux physiques ; mais quand je dis « physiques «, j'entends les peines et les plaisirs de l'âme, aussi bien que les peines et les plaisirs des sens. J'ai en vue l'homme tel qu'il est dans sa constitu¬tion actuelle.
Si le partisan du principe de l'utilité trouvait, dans le catalogue banal des vertus, une action dont il résultât plus de peines que de plaisirs, il ne balancerait pas à regarder cette prétendue vertu comme un vice ; il ne s'en laisserait point imposer par l'erreur générale ; il ne croirait pas légèrement qu'on soit fondé à employer de fausses vertus pour le maintien des véritables.
S'il trouvait aussi dans le catalogue banal des délits quelque action indifférente, quelque plaisir innocent, il ne balancerait pas à transporter ce prétendu délit dans la classe des actes légitimes ; il accorderait sa pitié aux prétendus criminels, et il réserverait son indignation pour les prétendus vertueux qui les persécutent.
4. L'hypothèse Gaïa
James Lovelock, La Terre est un être vivant.
L'hypothèse Gaïa [1979], Paris, Flammarion,
« Champs essais «, 1993, Préface, p. 16-17.
Le concept de la Terre Mère, ou Gaïa, ainsi que les Grecs la baptisèrent autrefois, est l'un des plus impor¬tants parmi ceux que l'homme a formulé tout au long de son histoire. Sur lui s'est fondée une croyance dont les grandes religions sont encore porteuses. L'accumula¬tion d'informations relatives à l'environnement naturel et le développement de la science de l'écologie nous ont amenés à spéculer que la biosphère pourrait être plus que l'ensemble de tous les êtres vivants évoluant dans leur habitat naturel : terre, eau, air. Lorsque les astronautes peuvent contempler de visu le spectacle de la Terre se détachant dans toute sa splendeur sur les ténèbres profondes de l'espace, ils éprouvent un indi¬cible émerveillement, une intense émotion — que nous pouvons partiellement partager grâce aux moyens de télécommunication : en cette émotion, n'est-ce pas la fusion, la synthèse de la foi antique en la Terre Mère et du savoir astrophysique qui s'accomplit ? Or cette sensation, aussi puissante soit-elle, ne prouve toutefois pas que la Terre Mère vit. Il s'agit, à l'instar d'un dogme religieux, d'une donnée qu'il est impossible de prouver de manière scientifique et qui n'autorise donc aucune rationalisation ultérieure.
Les voyages spatiaux firent plus que modifier notre perception de notre Terre. Ils fournirent une informa¬tion relative à son atmosphère et à sa surface qui favo¬risa une compréhension nouvelle des interactions entre les parties vivantes et inorganiques de la planète. De
celle-ci est née l'hypothèse suggérant que la matière organique, l'air, les océans, et la surface terrestre de la Terre forment un système complexe susceptible d'être appréhendé comme un organisme unique et ayant le pouvoir de préserver les caractéristiques vitales de notre planète.
5. L'homme, partie intégrante de la nature
James Lovelock, La Terre est un être vivant.
L'hypothèse Gaïa [1979], ibid., Épilogue,
p. 170-171.
Si nous faisons partie de Gaïa, il devient intéressant de se demander : « Dans quelle mesure notre intelli-gence collective est-elle aussi partie de Gaïa ? Est-ce qu'en tant qu'espèce nous constituons un système ner-veux gaïen et un cerveau capable d'anticiper consciem-ment les modifications de l'environnement ? «
Que cela nous plaise ou non, nous commençons déjà à fonctionner ainsi. Considérons, par exemple, une de ces mini-planètes, telles qu'Icare, qui ne mesure qu'un mile environ de diamètre et dont l'orbite irrégu-lière coupe celle de la Terre. Un jour les astronomes sont susceptibles de nous avertir que l'une d'entre elles risque d'entrer en collision avec la Terre et que l'impact est censé se produire disons dans quelques semaines. Le dommage potentiel d'une telle rencontre risque de s'avérer grave, même pour Gaïa. La Terre a probable-ment connu ce type d'accident par le passé et a subi une dévastation majeure. Notre technologie nous per-mettra peut-être de nous prémunir, ainsi que notre pla-nète, contre un tel désastre. Il ne fait aucun doute que nous disposons de la capacité d'envoyer des objets dans l'espace sur de vastes distances et d'exercer un contrôle à distance de leurs mouvements avec une précision quasi miraculeuse. Des calculs ont établi qu'en utilisant certaines de nos bombes à hydrogène transportées par des fusées nous serions en mesure d'infléchir la trajec¬toire d'un planétoïde tel qu'Icare de manière telle qu'une collision certaine soit évitée. Si cela paraît rele
ver de la science-fiction nous devrions nous souvenir que la science-fiction d'hier est devenue, en l'espace d'une vie d'homme, la science d'aujourd'hui.
Il se peut également que les progrès réalisés en matière de climatologie révèlent l'approche d'une époque glaciaire particulièrement grave. Nous avons vu [.. .] que bien qu'une nouvelle ère glaciaire risque d'être un désastre à notre niveau, elle constituerait un pro-blème relativement mineur pour Gaïa. Cependant, si nous acceptons notre rôle en tant que partie intégrante de Gaïa, notre inconfort est également ressenti par cette dernière et la menace de glaciation constitue donc un danger partagé. Une action possible, et qui entre dans l'ordre de possibilité de notre industrie, consiste¬rait à libérer dans l'atmosphère de grandes quantités de fluorocarbones. Si ces substances controversées, pré¬sentes à l'heure actuelle dans l'atmosphère à raison d'une part pour mille millions, étaient portées à une concentration de plusieurs parts pour mille millions, elles formeraient, à l'instar du dioxyde de carbone, un « effet serre « qui empêcherait la fuite de chaleur de la Terre vers l'espace. Leur présence serait susceptible d'inverser complètement le début d'une glaciation, ou tout au moins d'en diminuer considérablement la gra¬vité. Qu'elles engendrent pendant un certain temps quelque dommage à la couche d'ozone paraîtra alors un problème mineur en comparaison du désastre évité.
Ce qui précède ne constitue que deux exemples de mesures d'urgence à grande échelle que nous pourrions être amenés à prendre un jour pour aider Gaïa. Encore plus importante est l'implication du fait que l'évolution de l' homo sapiens, avec son inventivité technologique et son réseau de communication de plus en plus subtil, a considérablement accru le champ de perception de Gaïa. Grâce à nous elle est désormais éveillée et
consciente d'elle-même. Elle a vu le reflet de son beau visage à travers les yeux des astronautes et des caméras de télévision des vaisseaux spatiaux en orbite. Il ne fait aucun doute qu'elle partage nos sensations d'émer-veillement et de plaisir, notre capacité à penser et à spéculer de manière consciente et notre curiosité insa-tiable. Cette nouvelle relation entre l'homme et Gaïa n'est pas encore pleinement établie ; nous ne sommes pas encore une espèce vraiment collective, enfermée et domptée, partie intégrante de la biosphère, comme nous le sommes en tant que créatures individuelles. Il se peut que la destinée de l'humanité soit d'être appri-voisée, de sorte que les forces féroces, destructrices et cupides du tribalisme et du nationalisme se fondent en un besoin compulsif d'appartenir à la communauté de toutes les créatures qui constituent Gaïa. D'aucuns ver-ront dans cette évolution une soumission, mais je crois que les récompenses, se manifestant sous la forme d'un sentiment accru de bien-être et de plénitude, engen-drées par le fait de savoir que nous sommes une partie dynamique d'une entité beaucoup plus grande, com-penseraient largement la perte de la liberté tribale.
6. Le contrat naturel
Michel Serres, Le Contrat naturel [1990], Paris,
Flammarion, « Champs essais «, 1992, p. 62-67.
Les philosophes du droit naturel moderne font par¬fois remonter notre origine à un contrat social que nous aurions, au moins virtuellement, passé entre nous pour entrer dans le collectif qui nous fit les hommes que nous sommes. Étrangement muet sur le monde, ce contrat, disent-ils, nous fit quitter l'état de nature pour former la société. À partir du pacte, tout se passe comme si le groupe qui l'avait signé, en appareillant du monde, ne s'enracinait plus que dans son histoire.
On dirait la description, locale et historique, de l'exode rural vers les villes. Elle signifie en clair qu'à partir de là nous avons oublié ladite nature, désormais lointaine, muette, inerte, retirée, infiniment loin des cités ou des groupes, de nos textes et de la publicité. Entendez par ce dernier mot l'essence du public qui fait désormais celle des hommes.
Les mêmes philosophes appellent droit naturel un ensemble de règles qui existeraient en dehors de toute formulation ; parce que, universel, il découlerait de la nature humaine ; source des lois positives, il suit de la raison en tant qu'elle gouverne tous les hommes.
La nature se réduit à la nature humaine qui se réduit soit à l'histoire, soit à la raison. Le monde a disparu. Le droit naturel moderne se distingue du classique par cette annulation. Reste aux hommes suffisants leur his¬toire et leur raison. Curieusement celle-ci acquiert dans le domaine juridique un statut assez voisin de celui qu'elle avait acquis dans les sciences : elle a tous les droits parce qu'elle fonde le droit.
Nous avons célébré, en France, le bicentenaire de la Révolution, et, par la même occasion, celui de la Déclaration des droits de l'homme, expressément issus, dit son texte, du droit naturel.
Comme le contrat social, elle ignore et passe sous silence le monde. Nous ne le connaissons plus parce que nous l'avons vaincu. Qui respecte les victimes ? Or ladite déclaration fut prononcée au nom de la nature humaine et en faveur des humiliés, des misérables, de ceux qui, exclus, vivaient dehors, à l'extérieur, plongés corps et biens dans les vents et sous la pluie, dont le temps de la vie qui s'écoule se pliait au temps qu'il fait, de ceux qui ne jouissaient d'aucun droit, des perdants à toutes les guerres imaginables et qui ne possédaient rien.
Monopolisée par la science et l'ensemble des tech-niques associées au droit de propriété, la raison humaine a vaincu la nature extérieure, dans un combat qui dure depuis la préhistoire, mais qui s'accéléra de façon sévère à la révolution industrielle, à peu près contemporaine de celle dont nous célébrons le bicente¬naire, l'une technique, l'autre politique. Une fois de plus, il nous faut statuer sur les vaincus, en écrivant le droit des êtres qui n'en ont pas.
Nous pensons le droit à partir d'un sujet de droit, dont la notion s'étendit progressivement. N'importe qui, jadis, ne pouvait y accéder : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen donna la possibilité à tout homme en général d'accéder à ce statut de sujet du droit. Le contrat social, du coup, s'achevait, mais se fermait sur soi, laissant hors-jeu le monde, collection énorme de choses réduites au statut d'objets passifs de l'appropriation. Raison humaine majeure, nature exté-rieure mineure. Le sujet de la connaissance et de l'action jouit de tous les droits et ses objets d'aucun.
Ils n'ont encore accédé à aucune dignité juridique. Ce pour quoi, depuis, la science a tous les droits.
Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les choses du monde à la destruction. Maîtrisées, possé-dées, du point de vue épistémologique, mineures dans la consécration prononcée par le droit. Or, elles nous reçoivent comme des hôtesses, sans lesquelles, demain, nous devrons mourir. Exclusivement social, notre contrat devient mortifère, pour la perpétuation de l'espèce, son immortalité objective et globale.
Qu'est-ce que la nature ? D'abord l'ensemble des conditions de la nature humaine elle-même, ses contraintes globales de renaissance ou d'extinction, l'hôtel qui lui donne logement, chauffage et table ; de plus elle les lui ôte dès qu'il en abuse. Elle conditionne la nature humaine qui, désormais, la conditionne à son tour. La nature se conduit comme un sujet. [...]
Il faut donc procéder à une révision déchirante du droit naturel moderne qui suppose une proposition informulée, en vertu de laquelle l'homme, individuelle¬ment ou en groupe, peut seul devenir sujet du droit. [.. .] La Déclaration des droits de l'homme a eu le mérite de dire : « tout homme « et la faiblesse de penser : « seuls les hommes « ou les hommes seuls. Nous n'avons encore dressé aucune balance où le monde entre en compte, au bilan final.
Les objets eux-mêmes sont sujets de droit et non plus simples supports passifs de l'appropriation, même collective. [...] Si les objets eux-mêmes deviennent sujets de droit, alors toutes les balances tendent vers un équilibre.
Il existe un ou plusieurs équilibres naturels, décrits par les mécaniques, les thermodynamiques, la physiolo¬gie des organismes, l'écologie ou la théorie des sys¬tèmes ; les cultures ont inventé de même un ou
plusieurs équilibres de type humain ou social, décidés, organisés, gardés par les religions, les droits ou les poli-tiques. Il nous manque de penser, de construire et de mettre en oeuvre un nouvel équilibre global entre ces deux ensembles.
Car les systèmes sociaux, compensés en eux-mêmes et fermés sur eux, pèsent de leur poids nouveau, de leurs relations, objets-mondes et activités, sur les sys¬tèmes naturels par eux-mêmes compensés, de même qu'autrefois les seconds faisaient courir des risques aux premiers, à l'âge où la nécessité l'emportait en puis¬sance sur les moyens de la raison.
Aveugle et muette, la fatalité naturelle négligeait alors de passer contrat exprès avec nos ancêtres écrasés par elle : nous voici, à ce jour, assez vengés de cet archaïque abus par un abus moderne réciproque. Il nous reste à penser une nouvelle balance, délicate, entre ces deux ensembles de balances. Le verbe penser, proche de compenser, ne connaît pas, que je sache, d'autre origine que cette juste pesée. Voilà ce qu'aujour¬d'hui nous nommons pensée. Voilà le droit le plus général pour les systèmes les plus globaux.
Dès lors, dans le monde reviennent les hommes, le mondain dans le mondial, le collectif dans le physique, un peu comme à l'époque du droit naturel classique, mais avec pourtant de grandes différences, qui tiennent toutes au passage récent du local au global et au rap¬port renouvelé que nous entretenons désormais avec le monde, notre maître jadis et naguère notre esclave, toujours notre hôte en tous cas, maintenant notre symbiote.
Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute
admirative, la réciprocité, la contemplation et le res-pect, où la connaissance ne supposerait plus la pro-priété, ni l'action la maîtrise, ni celles-ci leurs résultats ou conditions stercoraires. Contrat d'armistice dans la guerre objective, contrat de symbiose : le symbiote admet le droit de l'hôte, alors que le parasite — notre statut actuel — condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite sans prendre conscience qu'à terme il se condamne lui-même à disparaître.
Le parasite prend tout et ne donne rien ; l'hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose se définit par réciprocité : autant la nature donne à l'homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit.
7. Fonder une nouvelle éthique
Hans Jonas, Le Principe responsabilité [1979]
op. cit., Préface, p. 15-17.
Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confere des forces jamais encore connues et l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malé¬diction pour lui. La thèse liminaire de ce livre est que la promesse de la technique moderne s'est inversée en menace, ou bien que celle-ci s'est indissolublement alliée à celle-là. Elle va au-delà du constat d'une menace physique. La soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné par la démesure de son succès, qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même, le plus grand défi pour l'être humain que son « faire « ait jamais entraîné. Tout en lui est inédit, sans comparaison possible avec ce qui précède, tant du point de vue de la modalité que du point de vue de l'ordre de grandeur : ce que l'homme peut faire aujourd'hui et ce que par la suite il sera contraint de continuer à faire, dans l'exercice irrésistible de ce pouvoir, n'a pas son équivalent dans l'expérience passée. Toute sagesse héritée, relative au comportement juste, était taillée en vue de cette expérience. Nulle éthique traditionnelle ne nous instruit donc sur les normes du « bien « et du « mal « auxquelles doivent être soumises les modalités entièrement nouvelles du pouvoir et de ses créations possibles. La terre nouvelle de la pratique collective, dans laquelle nous sommes entrés avec la technologie de pointe, est encore une terre vierge de la théorie éthique.
Dans ce vide (qui est en même temps le vide de l'actuel relativisme des valeurs) s'établit la recherche présentée ici. Qu'est-ce qui peut servir de boussole ? L'anticipation de la menace elle-même ! C'est seule-ment dans les premières lueurs de son orage qui nous vient du futur, dans l'aurore de son ampleur planétaire et dans la profondeur de ses enjeux humains, que peuvent être découverts les principes éthiques, desquels se laissent déduire les nouvelles obligations correspon¬dant au pouvoir nouveau. Cela, je l'appelle « heuris¬tique de la peur «. Seule la prévision de la déformation de l'homme nous fournit le concept de l'homme qui permet de nous en prémunir. Nous savons seulement ce qui est en jeu, dès lors que nous savons que cela est en jeu. Mais comme l'enjeu ne concerne pas seulement le sort de l'homme, mais également l'image de l'homme, non seulement la survie physique, mais aussi l'intégrité de son essence, l'éthique qui doit garder l'un et l'autre doit être non seulement une éthique de la sagacité, mais aussi une éthique du respect.
La fondation d'une telle éthique, qui ne reste plus liée au domaine immédiatement intersubjectif des contemporains, doit s'étendre jusqu'à la métaphysique, qui seule permet de se demander pourquoi des hommes doivent exister au monde : donc pourquoi vaut l'impératif inconditionnel de préserver leur exis¬tence pour l'avenir. L'aventure de la technologie, avec ses risques extrêmes, exige ce risque de la réflexion extrême. Une telle fondation est tentée ici, à l'encontre de la résignation positiviste-analytique de la philoso¬phie contemporaine. Du point de vue ontologique sont déployées à nouveau les vieilles questions du rapport de l'être et du devoir, de la cause et de la finalité, de la nature et de la valeur, afin d'enraciner dans l'être, par
delà le subjectivisme des valeurs, le nouveau devoir de l'homme qui vient d'apparaître.
Mais le véritable thème est ce devoir nouvellement apparu lui-même que résume le concept de responsabi¬lité. Sans doute n'est-ce pas un phénomène nouveau dans la moralité. La responsabilité n'a pourtant jamais eu un tel objet, de même qu'elle a peu occupé la théorie éthique jusqu'ici. Le savoir, aussi bien que le pouvoir, étaient trop limités pour incorporer l'avenir plus loin¬tain dans la prévision, bien plus, pour inclure la planète entière dans la conscience de la causalité personnelle. Plutôt que de deviner vainement les conséquences tar¬dives, relevant d'un destin inconnu, l'éthique se concentrait sur la qualité morale de l'acte momentané lui-même, dans lequel on doit respecter le droit du pro¬chain qui partage notre vie. Sous le signe de la techno¬logie par contre, l'éthique a affaire à des actes (quoique ce ne soient plus ceux d'un sujet individuel), qui ont une portée causale incomparable en direction de l'avenir et qui s'accompagnent d'un savoir prévisionnel qui, peu importe son caractère incomplet, déborde lui aussi tout ce qu'on a connu autrefois. Il faut y ajouter le simple ordre de grandeur des actions à long terme et très souvent également leur irréversibilité. Tout cela place la responsabilité au centre de l'éthique, y compris les horizons d'espace et de temps qui correspondent à ceux des actions.

«
70 1 PHILOSOPHIE DE l:ÉCOLOGIE
procède de ce contre quoi il faut se protéger.
C'est ce
péril qui nous apparaît d'abord et nous apprend
par la
révolte
du sentiment qui devance le savoir à voir la
valeur
dont le contraire nous affecte de cette façon.
Nous savons
ce qui est en jeu lorsque nous savons que
cela est en jeu.
Car il en va ainsi de nous : la reconnaissance du
malum nous est infiniment plus facile que celle du
bonum ; elle est plus immédiate, plus contraignante,
bien moins exposée aux différences
d'opinion et sur
tout elle n'est pas recherchée : la simple présence du
mal nous l'impose alors que le bien peut être là sans se
faire remarquer et peut rester inconnu en l'absence de
réflexion (celle-ci réclamant des raisons spéciales).
Par
rapport au mal nous ne sommes pas dans l'incertitude ;
la certitude par rapport au bien nous ne l'obtenons en
règle générale que par
le détour de celui-ci.
Il est dou
teux que quelqu'un eût jamais fait l'éloge de la santé
sans au moins
le spectacle de la maladie, celui de la
probité sans celui de la canaillerie et celui de la paix
sans être averti de la misère de la guerre.
Nous savons
beaucoup plus
tôt ce dont nous ne voulons pas que ce
que nous voulons.
C'est pourquoi la philosophie
morale doit consulter nos craintes préalablement à nos
désirs, afin de déterminer
ce qui nous tient réellement
à
cœur ; et même si ce que nous craignons le plus n'est
pas nécessairement ce qui est
le plus à craindre et que
son contraire est, moins nécessairement encore,
le bien
suprême (qui
peut être entièrement indépendant de
l'opposition à
un mal), donc bien que l'heuristique de
la
peur ne soit certainement pas le dernier mot dans la
quête
du bien, elle est pourtant un premier mot extrê
mement utile et sa capacité devrait être pleinement
exploitée dans
un secteur où si peu de mots nous sont
accordés sans avoir été cherchés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
- EXTRAITS STOÏCISME ANTHOLOGIE PHILOSOPHIQUE
- Anthologie philosophique: MARX
- Anthologie philosophique: Platon
- Anthologie philosophique: KANT