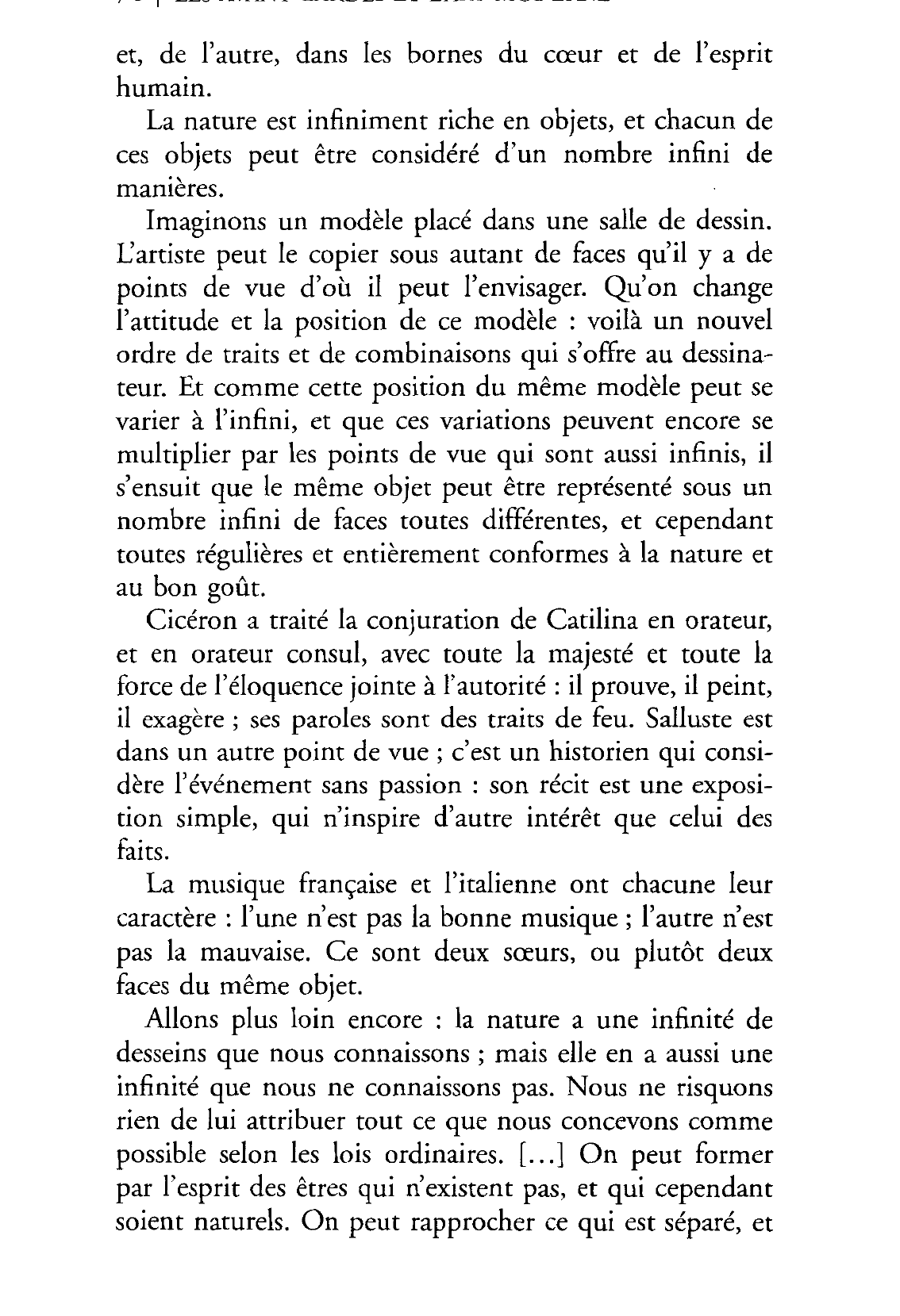Anthologie sur le jugement de gout
Publié le 01/04/2015
Extrait du document
EXTRAITS
1. « Qu'il n'y a qu'un bon goût en général, et
qu'il peut y en avoir plusieurs en particulier «
Abbé Charles Batteux, Les Beaux-Arts réduits
à un même principe [1746],
in Cours de Belles-Lettres ou Principes de littérature,
Paris, H. Casterrnan, 1861, p. 20-21.
La nature est le seul objet du goût : donc il n'y a qu'un seul bon goût, qui est celui de la nature. Les arts mêmes ne peuvent être parfaits qu'en représentant la nature : donc le goût qui règne dans les arts mêmes doit être encore celui de la nature. Ainsi il ne peut y avoir en général qu'un seul bon goût, qui est celui qui approuve la belle nature ; et tous ceux qui ne l'approuvent point ont nécessairement le goût mauvais.
Cependant on voit des goûts différents dans les hommes et dans les nations qui ont la réputation d'être éclairées et polies. Serons-nous assez hardis pour préférer celui que nous avons à celui des autres, et pour les condamner ? Ce serait une témérité et même une injus¬tice, parce que les goûts en particulier peuvent être diffé¬rents, ou même opposés, sans cesser d'être bons en soi. La raison en est, d'un côté, dans la richesse de la nature ;
et, de l'autre, dans les bornes du coeur et de l'esprit humain.
La nature est infiniment riche en objets, et chacun de ces objets peut être considéré d'un nombre infini de manières.
Imaginons un modèle placé dans une salle de dessin. L'artiste peut le copier sous autant de faces qu'il y a de points de vue d'où il peut l'envisager. Qu'on change l'attitude et la position de ce modèle : voilà un nouvel ordre de traits et de combinaisons qui s'offre au dessina¬teur. Et comme cette position du même modèle peut se varier à l'infini, et que ces variations peuvent encore se multiplier par les points de vue qui sont aussi infinis, il s'ensuit que le même objet peut être représenté sous un nombre infini de faces toutes différentes, et cependant toutes régulières et entièrement conformes à la nature et au bon goût.
Cicéron a traité la conjuration de Catilina en orateur, et en orateur consul, avec toute la majesté et toute la force de l'éloquence jointe à l'autorité : il prouve, il peint, il exagère ; ses paroles sont des traits de feu. Salluste est dans un autre point de vue ; c'est un historien qui consi¬dère l'événement sans passion : son récit est une exposi¬tion simple, qui n'inspire d'autre intérêt que celui des faits.
La musique française et l'italienne ont chacune leur caractère : l'une n'est pas la bonne musique ; l'autre n'est pas la mauvaise. Ce sont deux soeurs, ou plutôt deux faces du même objet.
Allons plus loin encore : la nature a une infinité de desseins que nous connaissons ; mais elle en a aussi une infinité que nous ne connaissons pas. Nous ne risquons rien de lui attribuer tout ce que nous concevons comme possible selon les lois ordinaires. [...] On peut former par l'esprit des êtres qui n'existent pas, et qui cependant soient naturels. On peut rapprocher ce qui est séparé, et
séparer ce qui est uni dans la nature ; elle se prête, à condition qu'on saura respecter ses lois fondamentales, et qu'on n'ira pas accoupler les serpents avec les oiseaux, ni les brebis avec les tigres. Les monstres sont effrayants dans la nature ; dans les arts ils sont ridicules. Il suffit donc de peindre ce qui est vraisemblable ; on ne peut mener un poète plus loin. [...]
Qu'il soit donc permis à chacun d'avoir son goût, pourvu qu'il soit pour quelque partie de la nature. Que les uns aiment le riant, d'autres le sérieux, ceux-ci le naïf, ceux-là le grand, le majestueux, etc. Ces objets sont dans la nature et s'y relèvent par le contraste. Il y a des hommes assez heureux pour les embrasser presque tous. Les objets mêmes leur donnent le ton du sentiment : ils aiment le sérieux dans un sujet grave, l'enjoué dans un sujet badin ; ils ont autant de facilité à pleurer à la tragé¬die qu'ils en ont à rire à la comédie ; mais on ne doit point pour cela me faire, à moi, un crime d'être resserré dans des bornes plus étroites : il serait plus juste de me plaindre.
On voit que les goûts ne peuvent être différents, sans cesser d'être bons, que quand leurs objets sont différents : car, s'ils ont le même objet, et que, l'un l'approuve et l'autre le condamne, il y en aura un des deux qui sera mauvais ; et si l'un l'approuve ou le condamne jusqu'à un certain degré, et que l'autre aille au-delà ou reste en deçà de ce degré, il y en aura un des deux qui sera moins fin, moins étendu, moins délicat, et qui sera par consé¬quent mauvais, au moins par comparaison avec l'autre, qui est dans le point exquis.
2. Les caractéristiques du jugement
de goût d'après Kant
Kant, Critique de la faculté de juger [1790],
trad. Alain Renaut, GF-Flammarion, 1995, I,
Première section, V, § 32-33, p. 266-269.
[Première caractéristique] Le jugement de goût déter¬mine son objet du point de vue de la satisfaction (en tant que beauté) en prétendant à l'adhésion de chacun, comme s'il était objectif.
Dire : « Cette fleur est belle «, cela signifie tout aussi bien qu'elle prétend simplement à la satisfaction de chacun. Du caractère agréable de son parfum, elle ne tire aucun droit de ce genre. Car si ce parfum plaît à l'un, il monte à la tête de l'autre. Qu'en conclure, dès lors, si ce n'est que la beauté devrait être tenue pour une propriété de la fleur elle-même, qui ne se règle pas d'après la diffé¬rence des têtes et de sens si multiples, mais d'après laquelle au contraire ceux-ci doivent se régler s'ils veulent en juger ? Et pourtant, il n'en va pas ainsi. Car le juge¬ment de goût consiste précisément en ce qu'il ne nomme belle une chose que d'après la propriété selon laquelle elle se règle d'après notre manière de la saisir.
En outre, il est exigé de tout jugement devant prouver le goût du sujet que celui-ci juge par lui-même, sans qu'il lui soit nécessaire d'aller à tâtons, empiriquement, parmi les jugements des autres et de s'informer préalablement sur le plaisir ou le déplaisir qu'ils prennent au même objet : il doit par conséquent énoncer son jugement, non pas par imitation, parce qu'une chose plaît effectivement de manière universelle, mais a priori. Reste que l'on pourrait penser qu'un jugement a priori doit contenir un concept de l'objet et le principe permettant de connaître celui-ci ; toutefois, en fait, le jugement de goût ne se
fonde nullement sur des concepts et n'est en rien un juge¬ment de connaissance, mais seulement un jugement esthétique.
De là vient qu'un jeune poète ne se laisse pas dissuader par le jugement du public, ni par celui de ses amis, de la conviction que son poème est beau ; et s'il les écoute, ce n'est pas parce qu'il a maintenant modifié son apprécia¬tion, mais parce qu'il trouve dans son désir d'être applaudi des raisons de s'accommoder (fût-ce contre son propre jugement) de l'illusion commune, quand bien même (du moins de son point de vue) le public tout entier aurait mauvais goût. C'est seulement plus tard, quand sa faculté de juger aura été davantage aiguisée par l'exercice, qu'il prend délibérément ses distances avec son précédent jugement — en adoptant le même type d'atti¬tude qu'à l'égard de ceux de ses jugements qui reposent entièrement sur la raison. Le goût ne prétend qu'à l'auto¬nomie. Faire de jugements d'autrui le principe détermi¬nant du sien correspondrait à l'hétéronomie. [...]
[Seconde caractéristique] Le jugement de goût n'est absolument pas déterminable par des arguments démons-tratifs, exactement comme s'il était seulement subjectif.
Premièrement, quand quelqu'un ne trouve pas beau un édifice, un paysage, un poème, il ne se laisse pas imposer intérieurement l'assentiment par cent voix, qui toutes les célèbrent hautement. Il peut certes faire comme si cela lui plaisait à lui aussi, afin de ne pas être considéré comme dépourvu de goût ; il peut même commencer à douter d'avoir assez formé son goût par la connaissance d'une quantité suffisante d'objets de ce genre (de même que quelqu'un qui croit reconnaître au loin une forêt dans ce que tous les autres aperçoivent comme une ville doute du jugement de sa propre vue). Mais, en tout cas, il voit clairement que l'assentiment des autres ne constitue abso¬lument pas une preuve valide pour l'appréciation de la beauté ; et que d'autres peuvent bien voir et observer
pour lui, et que ce que beaucoup ont vu d'une même façon peut assurément, pour lui qui croit avoir vu la même chose autrement, constituer un argument démons¬tratif suffisant pour construire un jugement théorique et par conséquent logique, mais que jamais ce qui a plu à d'autres ne saurait servir de fondement à un jugement esthétique. Le jugement des autres, quand il ne va pas dans le sens du nôtre, peut sans doute à bon droit nous faire douter de celui que nous portons, mais jamais il ne saurait nous convaincre de son illégitimité. Ainsi n'y a-t-il aucun argument démonstratif empirique permettant d'imposer à quelqu'un le jugement de goût.
Deuxièmement, une preuve a priori s'énonçant selon des règles établies peut encore moins déterminer le juge¬ment sur la beauté. Si quelqu'un me lit son poème ou m'amène à un spectacle qui, en fin de compte, ne va pas convenir à mon goût, il pourra bien citer Batteux ou Lessing, voire des critiques du goût encore plus anciens et encore plus célèbres, et toutes les règles établies par eux, pour prouver que son poème est beau ; il se peut même que certains passages qui justement me déplaisent s'accordent de manière parfaite avec des règles de la beauté (telles qu'elles ont été fournies par ces auteurs et sont universellement reconnues) : je me bouche les oreilles, je ne puis entendre ni raisons ni raisonnements, et je préférerais considérer que ces règles des critiques sont fausses, ou du moins que ce n'est pas ici le lieu de leur application, plutôt que de devoir laisser déterminer mon jugement par des arguments démonstratifs a priori, puisqu'il doit s'agir d'un jugement du goût et non pas d'un jugement de l'entendement ou de la raison.
Il semble que ce soit là l'une des principales raisons pour lesquelles on a désigné ce pouvoir d'appréciation esthétique précisément par le nom de goût. Car quel-qu'un peut bien m'énumérer tous les ingrédients d'un mets et me faire observer que chacun d'eux m'est agréable
par ailleurs, et il peut bien par-dessus le marché vanter à bon droit le caractère sain de ce plat ; je reste sourd à toutes ces raisons, je goûte le mets avec ma langue et mon palais et c'est en fonction de cela (et non pas d'après des principes universels) que je prononce mon jugement.
En effet, le jugement de goût est prononcé absolument toujours comme un jugement singulier à propos de l'objet. L'entendement peut, par comparaison de l'objet, du point de vue de la satisfaction, avec le jugement d'autrui, pro¬duire un jugement universel, par exemple : toutes les tulipes sont belles ; toutefois, ce n'est pas dès lors un juge¬ment de goût, mais c'est un jugement logique qui, somme toute, fait de la relation d'un objet au goût le prédicat des choses d'un certain genre ; seul le jugement par lequel je trouve belle une tulipe singulière donnée, c'est-à-dire par lequel je trouve que la satisfaction que j'y prends possède une validité universelle, est le jugement de goût. D'un tel jugement, la caractéristique consiste en ceci que, bien que possédant une validité simplement subjective, il affirme cependant sa prétention vis-à-vis de tous les sujets, comme cela ne pourrait être le cas que s'il était un jugement objec¬tif reposant sur des principes de connaissance et susceptible de s'imposer par une preuve.
3. La solution kantienne de l'antinomie
du goût
Kant, Critique de la faculté de juger [1790], ibid., I, Deuxième section, § 57, p. 326-329.
Il se manifeste [...], du point de vue du principe du goût, l'antinomie suivante :
1. Thèse. Le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts ; car, sinon, il serait possible d'en disputer (de décider par des preuves).
2. Antithèse. Le jugement de goût se fonde sur des concepts ; car, sinon, il ne serait même pas possible, malgré la diversité qu'il présente, d'en jamais discuter (de prétendre à l'assentiment nécessaire d'autrui à ce jugement).
II n'y a pas d'autre possibilité, pour résoudre le conflit entre ces principes qui sont au soubassement de chaque jugement de goût [...], que de montrer que le concept auquel on rapporte l'objet dans ce genre de jugement n'est pas pris selon le même sens dans les deux maximes de la faculté de juger esthétique : ce double sens ou ce double point de vue de l'appréciation est nécessaire à notre faculté de juger transcendantale, mais l'apparence qui engendre la confusion de l'un avec l'autre est, en tant qu'illusion naturelle, elle aussi inévitable.
Il faut que le jugement de goût se rapporte à quelque concept ; car, sinon, il ne pourrait absolument pas pré-tendre à une validité nécessaire pour chacun. Mais il ne peut précisément pas être démontrable à partir d'un concept, pour cette raison qu'un concept peut être soit déterminable, soit, tout aussi bien, indéterminé en soi et en même temps indéterminable. De la première sorte est le concept d'entendement, qui est déterminable par des prédicats de l'intuition sensible qui peut lui corres¬pondre ; mais de la seconde sorte est le concept du supra¬sensible comme concept transcendantal de raison qui se trouve au fondement de toute intuition et qui ne peut donc être davantage déterminé dans le registre théorique.
Or, le jugement de goût porte sur des objets des sens, mais non pas pour en déterminer un concept à destination de l'entendement ; car ce n'est pas un jugement de connaissance. Il constitue donc, en tant que représenta¬tion intuitive singulière rapportée au sentiment de plaisir,
simplement un jugement personnel, et comme tel il serait donc limité, quant à sa validité, au seul individu qui prononce le jugement : l'objet est pour moi un objet de satisfaction, tandis que, pour d'autres, il peut en aller autrement — à chacun son goût.
Cependant, dans le jugement de goût, un élargisse¬ment de la représentation de l'objet (en même temps aussi du sujet) est sans nul doute contenu, sur quoi nous fondons une extension de cette sorte de jugements comme nécessaires pour chacun : en conséquence, il doit nécessairement y avoir un concept au fondement de ces jugements ; mais il doit s'agir d'un concept qui ne se peut aucunement déterminer par une intuition, un concept par lequel on ne peut rien connaître, et qui par conséquent ne peut fournir aucune preuve pour le juge¬ment de goût. Or, c'est à un tel concept que correspond le simple concept rationnel pur du suprasensible qui est au fondement de l'objet (et également du sujet qui juge) comme objet des sens, par conséquent en tant que phé¬nomène. Car, si l'on n'admettait pas un tel point de vue, il serait impossible de sauver la prétention du jugement de goût à une validité universelle ; si le concept sur lequel il se fonde n'était qu'un concept simplement confus de l'entendement, comme par exemple celui de perfection, auquel on pourrait faire correspondre l'intuition sensible du beau, il serait possible, du moins en soi, de fonder le jugement de goût sur des preuves — ce qui contredit la thèse.
Or, toute contradiction disparaît si je dis que le juge-ment de goût se fonde sur un concept (celui d'un fonde-ment en général de la finalité subjective de la nature pour la faculté de juger) à partir duquel toutefois rien, en ce qui concerne l'objet, ne peut être connu ni prouvé, parce qu'il est en soi indéterminable et impropre à la connais¬sance ; cependant, le jugement reçoit de ce concept en même temps de la validité pour tous (même si, chez
chacun, c'est un jugement singulier, accompagnant immédiatement l'intuition), parce que son principe déterminant se trouve peut-être dans le concept de ce qui peut être considéré comme le substrat suprasensible de l'humanité.
Seule importe, pour la résolution d'une antinomie, la possibilité que deux propositions se contredisant en appa¬rence ne se contredisent pas en fait, mais puissent coexis¬ter, quand bien même l'explication de la possibilité de leur concept dépasse notre pouvoir de connaître. Que cette apparence soit en outre naturelle et inévitable pour la raison humaine, de même que ce qui fait qu'elle est et reste inévitable, bien qu'après la résolution de la contra¬diction apparente elle cesse de tromper, cela se peut aussi, par là, rendre compréhensible.
Le concept sur lequel la validité universelle d'un juge¬ment doit se fonder, nous le prenons en effet selon une même signification dans les deux jugements qui se contredisent, et pourtant nous en énonçons deux prédi¬cats opposés. Dans la thèse, il faudrait dire les choses ainsi : le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts déterminés ; et dans l'antithèse : le jugement de goût se fonde pourtant sur un concept, bien qu'il s'agisse certes d'un concept indéterminé (à savoir celui du substrat suprasensible des phénomènes) — et dès lors il n'y aurait entre thèse et antithèse nulle contradiction.
Nous ne pouvons faire davantage que lever cette contradiction entre les prétentions antithétiques du goût. Donner un principe du goût qui soit déterminé et objec¬tif, d'après lequel les jugements de celui-ci pourraient être guidés, examinés et prouvés, est absolument impossible ; car il ne s'agirait plus dès lors d'un jugement de goût. Le principe subjectif, à savoir l'Idée du suprasensible en nous, peut seulement être indiqué comme l'unique clé permettant de résoudre l'énigme de ce pouvoir dont les
sources nous restent cachées à nous-mêmes, mais rien ne peut le rendre plus compréhensible.
Au fondement de l'antinomie ici construite et aplanie se trouve le concept exact du goût, à savoir celui d'une faculté de juger esthétique simplement réfléchissante ; et les deux principes qui se contredisent en apparence ont été réconciliés dans la mesure où les deux peuvent être vrais, ce qui suffit.
4. Du particulier à l'universel
les étapes du jugement réfléchissant
Kant, Critique de la faculté de juger [1790], ibid.,
Première introduction, V, p. 101-106.
La faculté de juger peut être considérée soit comme un simple pouvoir de réfléchir suivant un certain principe sur une représentation donnée, dans le but de rendre pos¬sible par là un concept, soit comme un pouvoir de déter¬miner, à l'aide d'une représentation empirique donnée, un concept pris comme sujet du jugement. Dans le pre¬mier cas, il s'agit de la faculté de juger réfléchissante, dans le second, de la faculté de juger déterminante. Or, réfléchir (examiner par la réflexion), c'est comparer et tenir ensemble des représentations données, soit avec d'autres, soit avec son pouvoir de connaître, en relation avec un concept rendu par là possible. La faculté de juger réflé-chissante est celle que l'on appelle aussi le pouvoir de porter des jugements appréciatifs (facultas dijudicandi).
L'acte de réfléchir (qui se manifeste même chez des ani¬maux, bien que ce ne soit que de manière instinctive, c'est-à-dire en relation, non pas à un concept qui se pour¬rait obtenir par ce moyen, mais à une inclination qui se
trouve à déterminer par là) requiert pour nous tout autant un principe que l'acte de déterminer, dans lequel le concept de l'objet qui est pris pour sujet du jugement prescrit la règle à la faculté de juger et joue donc le rôle du principe.
Le principe de la réflexion sur les objets donnés de la nature est celui-ci : pour toutes les choses de la nature se peuvent trouver des concepts empiriquement déterminés, ce qui signifie également que l'on peut toujours supposer dans ses produits une forme qui est possible selon des lois générale que nous pouvons connaître. Car, si nous ne pouvions procéder à cette supposition et si nous n'éta-blissions pas ce principe à la base de notre façon de traiter des représentations empiriques, tout acte de réflexion interviendrait seulement de manière aventureuse et aveugle, sans que par conséquent se puisse raisonnable-ment attendre un accord de cette réflexion avec la nature.
Pour ce qui concerne les concepts universels de la nature, sous la condition desquels en général un concept d'expérience (sans détermination empirique particulière) devient possible, la réflexion trouve déjà ce qui la guide dans le concept d'une nature en général, c'est-à-dire dans l'entendement, et la faculté de juger ne requiert nul prin-cipe particulier de la réflexion ; au contraire, c'est elle qui schématise a priori et applique à chaque synthèse empi-rique ces schèmes sans lesquels nul jugement d'expérience ne serait possible. La faculté de juger est ici, dans sa réflexion, en même temps déterminante et le schéma¬tisme transcendantal de la réflexion lui sert en même temps de règle sous laquelle sont subsumées des intui¬tions empiriques données.
Mais, pour ce qui est des concepts qu'il faut d'abord trouver pour des intuitions empiriques données et qui supposent une loi particulière de la nature, d'après laquelle seulement l'expérience particulière est possible, la faculté de juger requiert à destination de sa réflexion un
principe spécifique, également transcendantal, et on ne peut pas la renvoyer une fois encore à des lois empiriques déjà connues, ni non plus transformer la réflexion en une simple comparaison avec des formes empiriques pour lesquelles on possède déjà des concepts. Car la question se pose de savoir comment l'on pourrait espérer, par la comparaison des perceptions, arriver à des concepts empiriques de ce qui est commun aux diverses formes de la nature si la nature (comme il est cependant possible de le penser) y avait disposé, du fait de la grande diversité de ses lois empiriques, une si grande hétérogénéité que toute comparaison, ou du moins dans la plupart des cas, serait vaine pour chercher à dégager parmi ces formes une harmonie et un ordre hiérarchisé des espèces et des genres. Toute comparaison de représentations empiriques pour reconnaître dans les choses de la nature des lois empiriques et des formes spécifiques se soumettant à ces lois, mais aussi s'accordant génériquement, à la lumière de leur comparaison, avec d'autres, présuppose en tout cas que la nature a observé, même vis-à-vis de ses lois empi¬riques, une certaine économie adaptée à notre faculté de juger et une uniformité que nous sommes à même de saisir, et cette présupposition doit, comme principe de la faculté de juger a priori, précéder toute comparaison.
La faculté de juger réfléchissante procède donc à l'égard de phénomènes donnés, pour les ramener sous des concepts empiriques de choses naturelles détermi-nées, non pas schématiquement, mais techniquement, non pas pour ainsi dire de manière simplement mécanique, comme un instrument, sous la direction de l'entende¬ment et des sens, mais sur le mode de l'art, en se confor¬mant au principe universel, mais en même temps indéterminé, d'un agencement finalisé de la nature en un système, en quelque sorte au bénéfice de notre faculté de juger, dans l'appropriation de ses lois particulières (dont l'entendement ne dit rien) à la possibilité de l'expérience
comme constituant un système — supposition sans laquelle nous ne pourrions espérer nous y reconnaître dans le labyrinthe des lois particulières possibles en leur diversité. La faculté de juger se donne donc à elle-même a priori la technique de la nature pour principe de sa réflexion, sans toutefois pouvoir expliquer cette tech¬nique ni la déterminer plus précisément, ou sans disposer pour cela d'un fondement objectif de détermination des concepts universels de la nature (dérivant d'une connais¬sance des choses en elles-mêmes), mais au contraire elle se procure ce principe uniquement pour pouvoir réfléchir selon ses propres lois subjectives, selon son besoin, mais cependant, en même temps, en accord avec des lois de la nature en général.
Cela dit, le principe de la faculté de juger réfléchis-sante, grâce auquel la nature est pensée comme système d'après des lois empiriques, est seulement un principe pour l'usage logique de la faculté de juger : il s'agit certes d'un principe transcendantal quant à son origine, mais uniquement en vue de considérer a priori la nature comme possédant les qualités nécessaires à la constitution d'un système logique de sa diversité sous des lois empiriques.
La forme logique d'un système consiste simplement dans la division de concepts universels donnés (tel qu'est ici celui d'une nature en général), à la faveur de laquelle on pense selon un certain principe le particulier (ici, l'empirique), avec sa diversité, comme contenu sous l'universel. En relèvent, si on procède empiriquement et si on s'élève du particulier à l'universel, une classification du divers, c'est-à-dire une comparaison entre plusieurs classes dont chacune se range sous un concept déterminé et, quand elles sont complètes selon le caractère commun, leur subsomption sous des classes supérieures (les genres), jusqu'à ce que l'on arrive au concept qui contient en lui le principe de la classification tout entière
(et constitue le genre suprême). Si l'on part au contraire du concept universel pour descendre jusqu'au particulier à la faveur d'une division complète, la manière dont on procède s'appelle la spécification du divers sous un concept donné, étant donné que l'on progresse du genre suprême aux genres inférieurs (sous-genres ou espèces) et des espèces aux sous-espèces. On s'exprime avec plus d'exactitude si, au lieu de dire (comme dans l'usage ordi-naire de la langue) : il faut spécifier le particulier qui est subsumé sous un universel, on dit de préférence : on spécifie le concept universel en ramenant le divers sous lui. Car le genre (considéré logiquement) est en quelque sorte la matière ou le substrat brut que la nature, par détermi-nation plus poussée, élabore en espèces et sous-espèces particulières, et ainsi peut-on dire que la nature se spécifie elle-même selon un certain principe (autrement dit, l'Idée d'un système), par analogie avec l'usage de ce terme chez les juristes, quand ils parlent de la spécification de cer-taines matières brutes.
Or, il est clair que la faculté de juger réfléchissante ne pourrait entreprendre, d'après sa nature propre, de classi-fier la nature tout entière selon ses diversités empiriques, si elle ne présupposait pas que la nature spécifie elle-même ses lois transcendantales en suivant quelque principe. Cela étant, ce principe ne peut être autre que celui de l'adaptation au pouvoir que possède la faculté de juger elle-même de rencontrer dans l'incommensurable diver¬sité des choses, d'après des lois empiriques possibles, une affinité entre elles qui soit suffisante pour que l'on puisse les inscrire sous des concepts empiriques (classes), inscrire ceux-ci sous des lois plus générales (genres supérieurs) et parvenir ainsi à un système empirique de la nature. Or, de même qu'une semblable classification n'est pas une connaissance d'expérience commune, mais constitue une connaissance de l'ordre de l'art, de même la nature, en tant qu'on la pense comme se spécifiant d'après un tel
principe, est elle aussi considérée comme art, et la faculté de juger mobilise donc avec elle, a priori, un principe de la technique de la nature, qui est distinct de la nomothé-tique de cette nature selon des lois transcendantales de l'entendement en ceci que cette dernière peut faire valoir son principe comme loi, alors que la technique ne peut faire valoir le sien que comme supposition nécessaire.
Le principe propre de la faculté de juger est donc le suivant : La nature spécifie ses lois universelles en lois empi¬riques, conformément à la forme d'un système logique, à destination de la faculté de juger.
5. Nietzsche contre Socrate
Nietzsche, Crépuscule des idoles [1888],
trad. Patrick Wotling, GF-Flammarion, 2005,
« Le problème de Socrate «, § 5-12, p. 132-136.
5.
Avec Socrate, le goût grec connaît un revirement au profit de la dialectique : que se passe-t-il là au juste ? Avant tout, c'est un goût noble qui est ainsi vaincu ; avec la dialectique, la plèbe prend le dessus. Avant Socrate, dans la bonne société, on réprouvait les manières dialec-tiques : on les tenait pour de mauvaises manières, elles compromettaient. On mettait en garde la jeunesse à leur encontre. On se défiait aussi de toute cette façon de pré-senter ses raisons. Les choses honnêtes, comme les gens honnêtes, n'exhibent pas ainsi leurs raisons. Il est mal élevé de faire voir les cinq doigts en même temps. Ce qui doit d'abord être démontré ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité fait toujours partie des bonnes manières, où l'on ne « fonde pas en raison «, mais
ordonne, le dialecticien est une sorte de pitre : on s'en moque, on ne le prend pas au sérieux. — Socrate fut le pitre qui se fit prendre au sérieux : que s'est-il passé là au juste ? —
6.
On ne choisit la dialectique que lorsque l'on n'a pas d'autres moyens. On sait qu'avec elle, on suscite la méfiance, qu'elle convainc peu. Rien n'est plus aisé à balayer qu'un effet de dialecticien : l'expérience de toute assemblée où l'on débat le prouve. Elle ne peut être que légitime défense entre les mains de ceux qui n'ont plus d'autres armes. Il faut que l'on ait à arracher son droit par la force : avant d'en être là, on n'en fait pas usage. C'est pour cela que les Juifs furent dialecticiens ; Maître Renart l'était : comment ? et Socrate l'était aussi ? —
7.
— L'ironie de Socrate est-elle une expression de révolte ? du ressentiment de la plèbe ? jouit-il en opprimé de sa propre férocité à travers les coups de poignard du syllogisme ? se venge-t-il des nobles qu'il fascine ? — Dia¬lecticien, on a en main un instrument sans merci ; grâce à lui, on peut jouer au tyran ; on compromet en l'empor¬tant. Le dialecticien abandonne à son adversaire la charge de prouver qu'il n'est pas un idiot : il fait entrer en fureur, et en même temps laisse désemparé. Le dialecticien neu¬tralise l'intellect de son adversaire. — Comment ? La dia¬lectique n'est-elle chez Socrate qu'une forme de vengeance ?
8.
J'ai fait comprendre en quoi Socrate repoussait : il n'en reste que davantage à expliquer qu'il fascinait. — Qu'il ait découvert une nouvelle espèce d' agon 1, qu'il en ait été le
1. En grec, lutte, combat, joute ou rivalité.
premier maître d'armes pour les cercles nobles d'Athènes, c'est le premier point. Il fascinait en ce qu'il faisait vibrer l'instinct agonal des Hellènes, — il apportait une variante à la lutte entre les hommes jeunes et les éphèbes. Socrate fut aussi un grand érotique.
9.
Mais Socrate devina plus encore. Il vit clair dans ses Athéniens nobles ; il saisit que son cas, l'idiosyncrasie de son cas n'était déjà plus une exception. La même espèce de dégénérescence se préparait partout en silence : la vieille Athènes était en train de périr. — Et Socrate com¬prit que tout le monde avait besoin de lui, — de son moyen, de son traitement, de son astuce personnelle d'autoconservation... Partout les instincts étaient dans l'anarchie ; partout, on était à deux doigts de l'excès : le monstrum in animo était le danger général. « Les pul¬sions veulent jouer les tyrans ; il faut inventer un contre-tyran qui soit plus fort «... Quand ce physiognomoniste eut dévoilé à Socrate qui il était, un antre recelant tous les désirs ignobles, le grand ironique laissa encore filtrer une parole qui livre la clé de sa personne. « C'est vrai, dit-il, mais je me suis rendu maître de tous. « Comment Socrate se rendit-il maître de lui-même? — Son cas n'était en fin de compte que le cas extrême, simplement le plus aveuglant de ce qui commençait alors à devenir la misère générale : à savoir que plus personne n'était maître de soi, que les instincts se retournaient les uns contre les autres. Il fascinait pour être ce cas extrême — sa laideur terrifiante l'exprimait aux yeux de tous : il fascinait plus vivement encore, comme cela va de soi, en tant que réponse, en tant que solution, en tant qu'apparence de traitement de ce cas. —
1. Monstrum in fronte, monstrum in animo : en latin « monstre pour le visage, monstre pour l'âme «.
1 0 .
Quand on a besoin de transformer la raison en tyran, comme le fit Socrate, il faut que le danger ne soit pas mince que quelque chose d'autre joue les tyrans. Dans la rationalité, on devina alors l'instance salvatrice, ni Socrate ni ses « malades « ne furent libres d'être rationnels, —c'était de rigueur, c'était leur ultime moyen. Le fanatisme avec lequel toute la réflexion grecque se jette sur la ratio¬nalité trahit une situation d'urgence : on était en danger, on n'avait qu'un seul choix : périr ou être rationnel jusqu'à l'absurdité... Le moralisme des philosophes grecs à partir de Platon est conditionné pathologiquement ; de même leur appréciation de la dialectique. Raison = vertu = bon¬heur « veut dire en tout et pour tout : il faut copier Socrate et, contre les sombres désirs, instaurer en perma¬nence un grand jour — le grand jour de la raison. On doit être sage, clair, lumineux à tout prix : toute concession aux instincts, à l'inconscient, fait sombrer...
11
J'ai fait comprendre en quoi Socrate fascinait : il sem¬blait être un médecin, un sauveur. Est-il encore besoin de démontrer l'erreur sur laquelle reposait sa croyance à la « rationalité à tout prix « ? — C'est une tromperie de soi, de la part des philosophes et des moralistes, que d'échapper à la décadence en lui faisant la guerre. En sortir est au-delà de leurs forces : ce qu'ils choisissent comme moyen, comme recours salvateur, n'est à son tour de nouveau qu'une expression de la décadence — ils en altèrent l'expression, ils ne s'en débarrassent pas. Socrate fut un malentendu ; toute la morale de l'amélioration, la chrétienne aussi, fut un malentendu... Le jour le plus éblouissant, la rationalité à tout prix, la vie claire, froide, prudente, consciente, sans instinct, en résistance contre les instincts, cela même ne fut qu'une maladie, une autre maladie — et nullement un retour à la « vertu «, à la
« santé «, au bonheur... Devoir combattre les instincts —c'est la formule de la décadence : tant que la vie est ascen-dante, le bonheur est la même chose que l'instinct. —
12.
— A-t-il encore saisi cela, ce plus intelligent de tous les trompeurs de soi-même ? Finit-il par se le dire, dans la sagesse de son courage à mourir ?... Socrate voulut mourir : — ce n'est pas Athènes, c'est lui qui se donna la coupe empoisonnée, il contraignit Athènes à la coupe empoisonnée... « Socrate n'est pas médecin, se dit-il à mi-voix : seule la mort est ici médecin... Quant à Socrate, il ne fut que longtemps malade... «
BIBLIOGRAPHIE
Jean Clair, Considérations sur l'état des beaux-arts. Cri-tique de la modernité, Gallimard, 1996.
Luc Ferry, Homo testheticus, Grasset, « Le Collège de philosophie «, 1990 ; L'Invention de la vie de Bohème, Paris, Cercle d'art, 2012.
Albert Gleizes et Jean Metzinger, Du cubisme, Sisteron, Éditions Présence, « Vers une conscience plastique «, 1980.
Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, trad. Nicole Debrand et Berna¬dette du Crest, Gallimard, « Folio essais «, 1989.
Octavio Paz, Point de convergence. Du romantisme à l'avant-garde, Gallimard, « Les Essais «, 1987.
«
74 j LES AVANT-GARDES ET I.:ART MODERNE
et, de l'autre, dans les bornes du cœur et de l'esprit
humain.
La nature est infiniment riche en objets, et chacun de
ces objets peut être considéré d'un nombre infini de
.
' marneres.
Imaginons
un modèle placé dans une salle de dessin.
Lartiste
peut le copier sous autant de faces qu'il y a de
points de vue
d'où il peut l'envisager.
Qu'on change
l'attitude et la position de
ce modèle : voilà un nouvel
ordre de traits et de combinaisons qui s'offre au dessina
teur.
Et comme cette position du même modèle peut se
varier à l'infini, et que ces variations peuvent encore se
multiplier par les points de vue qui sont aussi infinis, il
s'ensuit que le même objet peut être représenté sous un
nombre infini de faces toutes différentes, et cependant
toutes régulières et entièrement conformes à la nature et
au bon goût.
Cicéron a traité la conjuration de Catilina en orateur,
et en orateur consul, avec toute la majesté et toute la
force de l'éloquence jointe à l'autorité :
il prouve, il peint,
il exagère ; ses paroles sont des traits de feu.
Salluste est
dans
un autre point de vue ; c'est un historien qui consi
dère l'événement sans passion : son récit est une exposi
tion simple, qui n'inspire d'autre intérêt que celui des
faits.
La musique française et l'italienne
ont chacune leur
caractère: l'une n'est pas la bonne
musique; l'autre n'est
pas la mauvaise.
Ce sont deux sœurs,
ou plutôt deux
faces
du même objet.
Allons plus loin encore : la nature a une infinité de
desseins que nous connaissons; mais elle en a aussi une
infinité que nous ne connaissons pas.
Nous ne risquons
rien de lui attribuer
tout ce que nous concevons comme
possible selon
les lois ordinaires.
[ ...
] On peut former
par l'esprit des êtres qui n'existent pas, et qui cependant
soient naturels.
On peut rapprocher ce qui est séparé, et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le jugement de gout (anthologie)
- Kant et le jugement de gout
- Un jugement de gout peut-il être moral ?
- Kant: le jugement de gout et le jugement d'agrément
- LES CARACTÈRES DU JUGEMENT DE GOUT