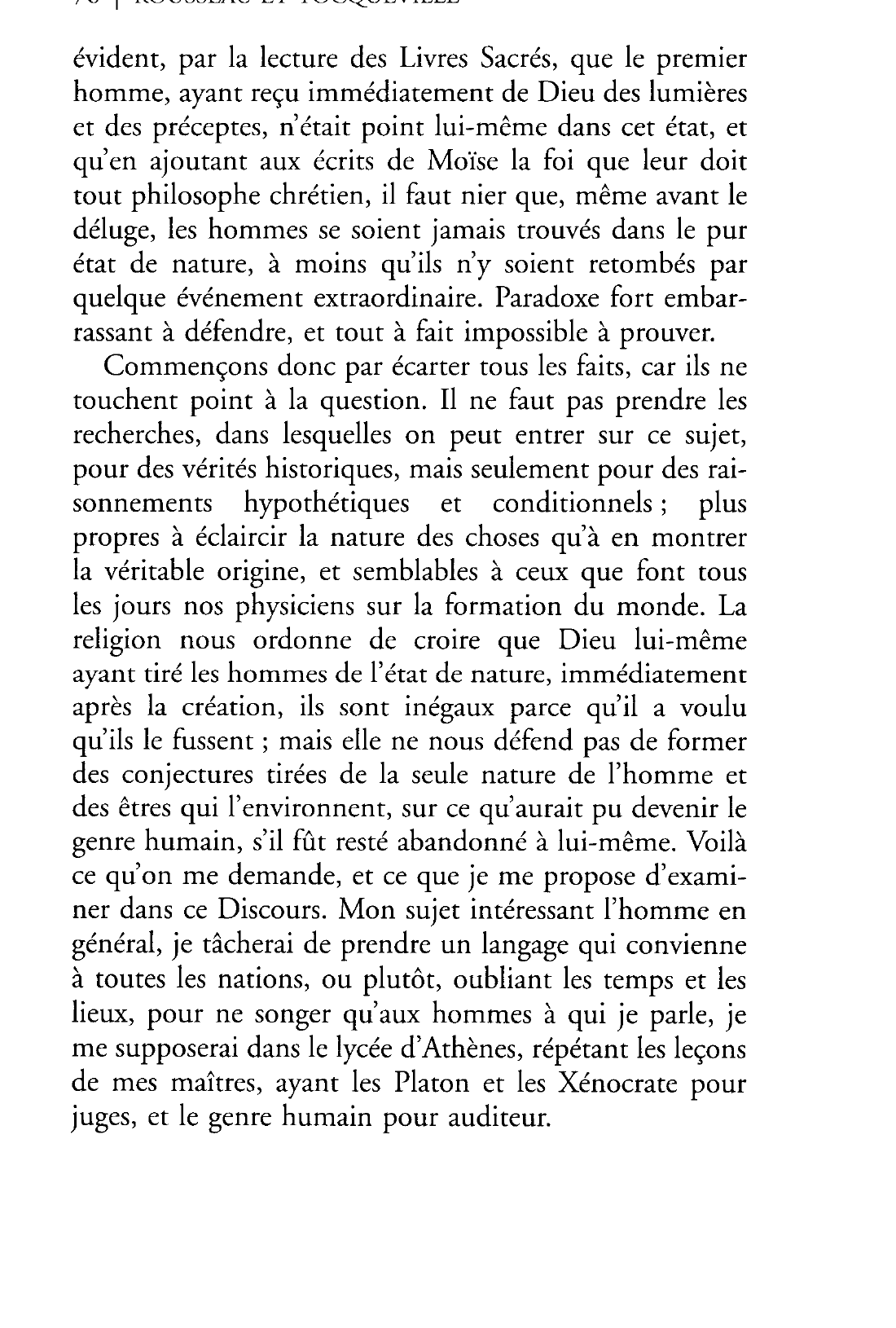Anthologie sur la philosophie de Karl Popper
Publié le 01/04/2015
Extrait du document

EXTRAITS
1. Abandonner la quête de la certitude
Karl Popper, La Connaissance objective,
trad. Jean-Jacques Rosat, Champs essais, 1998,
chap. II, p. 87-89.
Descartes fut peut-être le premier à dire que tout dépend du caractère assuré de notre point de départ. Pour rendre ce point de départ réellement assuré, il proposa la méthode du doute : n'accepter que ce qui est absolument indubitable.
Il partit donc de sa propre existence, qui lui semblait indubitable, puisque même le doute sur notre propre existence semble présupposer l'existence d'un douteur (d'un sujet qui doute).
Certes, je ne suis pas plus sceptique sur l'existence de mon propre moi que Descartes ne l'était au sujet du sien. Mais je pense également (comme Descartes) que je mourrai bientôt et que cela ne changera pas grand-chose dans le monde, sauf pour moi-même et deux ou trois amis. À l'évidence, ce qui touche à notre propre vie et à notre propre mort est d'une certaine importance, mais mon hypothèse (et je pense que Des¬cartes en conviendrait), c'est que ma propre existence touchera à sa fin sans que pour autant le monde touche à sa fin.
C'est une conception du sens commun, et c'est le prin¬cipe central de ce qu'on peut appeler « réalisme «. [...]
J'admets que la croyance en notre propre existence est très forte. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'elle puisse supporter le poids de quelque chose comme l'édifice cartésien ; comme base de départ, elle est beau¬coup trop étroite. Je ne pense pas non plus, soit dit au passage, qu'elle soit aussi indubitable que le croyait (avec quelque excuse) Descartes. Dans le merveilleux livre de Hugh Routledge, Everest 1933, on lit ceci à propos de Kipa, l'un des sherpas, monté plus haut que son organisme ne le lui permettait : « L'esprit hébété de notre pauvre Kipa s'accrochait toujours obstinément à l'idée qu'il était mort. « Je n'affirme pas que l'idée du pauvre Kipa relevait du sens commun, ni même qu'elle était raisonnable, mais elle jette un doute sur l'immé¬diateté et l'indubitabilité auxquelles prétendait Des¬cartes. En tout cas, je ne propose pas d'afficher pareille prétention à la certitude, même si, je l'admets volon¬tiers, il est sain et de bon sens commun de croire à l'existence de son propre moi pensant. Ce que je vou¬drais mettre en question, ce n'est pas la vérité du point de départ de Descartes ; c'est qu'il suffise pour l'usage que Descartes essaie d'en faire et, incidemment, qu'il soit aussi indubitable qu'il le prétend.
Locke, Berkeley, et même Hume le « sceptique «, ainsi que leur nombreux successeurs, en particulier Russell et Moore, partageaient avec Descartes la conception selon laquelle les expériences subjectives étaient particulièrement assurées et convenaient donc bien comme point de départ ou fondement solide ; mais ils s'appuyaient principalement sur des expé-riences de caractère observationnel. Et Reid, dont je partage l'adhésion au réalisme et au sens commun, pensait que nous possédions une sorte de perception
très directe, immédiate et assurée, de la réalité objec-tive extérieure.
Ma thèse au contraire est qu'il n'y a rien de direct ni d'immédiat dans notre expérience : il nous faut apprendre que nous avons un moi, qui dure dans le temps et continue d'exister même pendant notre som-meil et l'inconscience totale ; il nous faut aussi apprendre tout ce qui concerne notre propre corps et celui des autres. Il s'agit exclusivement de décodage ou d'interprétation. Nous apprenons si bien à décoder que tout devient pour nous « direct « ou « immédiat « ; mais il en va de même pour l'homme qui a appris le morse ou, pour prendre un exemple plus familier, pour celui qui a appris à lire un livre : le livre lui parle « directement «, « immédiatement «. Nous savons, néanmoins, qu'il s'agit du déroulement d'un processus complexe de décodage ; s'il semble direct et immédiat, c'est qu'il résulte d'un entraînement, comme pour jouer du piano ou conduire une voiture.
Nous avons tout lieu de conjecturer que nos apti-tudes au décodage ont une base héréditaire. En tout cas, nous faisons parfois des erreurs de décodage, sur-tout pendant la période d'apprentissage, mais aussi par la suite, surtout si nous nous trouvons dans des circon-stances inhabituelles. Le caractère immédiat ou direct du processus de décodage chez un individu bien entraîné ne garantit pas qu'il fonctionne sans faute ; il n'existe aucune certitude absolue, même si, jusqu'à présent, les choses semblent avoir fonctionné suffi-samment bien pour la plupart de nos besoins pratiques. Il faut abandonner la quête de certitude, d'une base assurée de la connaissance.
2. Le problème de l'induction chez Hume
Karl Popper, La Connaissance objective, ibid.,
chap. I, p. 41-45.
La théorie de la connaissance du sens commun (que j'ai surnommée également « la théorie de l'esprit-seau «), c'est la théorie qui est si célèbre sous forme de l'adage : « il n'y a rien dans notre entendement qui n'y soit entré auparavant par les sens «. (J'ai essayé de mon-trer que c'est Parménide qui formula pour la première fois cette conception — sur un mode satirique : la plu-part des mortels n'ont rien dans leur entendement égaré qui n'y soit entré par leurs sens égarés.)
Pourtant, nous avons effectivement des attentes, et nous croyons fortement en certaines régularités (lois de la nature, théories). Ce qui conduit au problème de l'induction selon le sens commun (que j'appellerai Cs) :
Cs comment ces attentes et ces croyances ont-elles pu prendre naissance ?
Le sens commun répond : par la répétition d'observa-tions faites dans le passé ; si nous croyons que le soleil se lèvera demain, c'est parce qu'il en a été ainsi dans le passé.
Dans la conception du sens commun, on tient sim-plement pour acquis (sans se poser aucun problème) que notre croyance dans les régularités se justifie par la répétition des observations qui sont causes de la genèse de cette croyance. (Genèse plus justification — toutes deux dues à la répétition —, c'est ce que les philosophes, depuis Aristote et Cicéron, ont appelé epagôgê, ou induction.)
Hume s'est intéressé au statut de la connaissance humaine ou, comme il pourrait l'avoir dit, à la ques
tion de savoir si nous pouvons justifier certaines de nos croyances — et lesquelles — par des raisons suffisantes.
Il a soulevé deux problèmes : un problème logique (HL) et un problème psychologique (H ps) . Une des dif¬ficultés majeures, c'est que ses deux réponses respectives à ces deux problèmes sont, d'une certaine manière, en contradiction l'une avec l'autre.
Le problème logique de Hume est le suivant :
HL sommes-nous justifiés à raisonner à partir de cas (répétés) dont nous avons l'expérience sur d'autres cas (les conclusions) dont nous n'avons pas l'expérience ?
La réponse de Hume à HL est : non, si grand que soit le nombre de répétitions.
Hume a également montré que la situation logique restait exactement la même si dans HL on insérait le mot « probables « après « conclusions «, ou si on remplaçait les mots « sur d'autres cas « par « sur la probabilité d'autres cas «.
Le problème psychologique de Hume est le suivant :
H ps pourquoi, néanmoins, tous les gens sensés s'attendent-ils à ce que les cas dont ils n'ont aucune expérience se conforment à ceux dont ils ont l'expé-rience, et pourquoi y croient-ils? Autrement dit : pour-quoi avons-nous des attentes dans lesquelles nous avons grande confiance ?
Hume répond à H p., : à cause de « la coutume ou habitude « ; c'est-à-dire parce que nous sommes condi-tionnés, par les répétitions et par le mécanisme de l'asso-ciation d'idées ; un mécanisme sans lequel, dit Hume, nous ne pourrions guère survivre.
Ces résultats ont fait que Hume lui-même — l'un des esprits les plus rationnels qui aient jamais existé —devint un sceptique et, du même coup, un croyant : un croyant en une épistémologie irrationaliste. Parvenu à ce résultat que la répétition, tout en dominant notre
vie cognitive ou notre « entendement «, n'a aucune espèce de pouvoir en tant qu'argument, il en vint à conclure que l'argumentation ou la raison ne jouent qu'un rôle mineur dans notre entendement. Notre « connaissance « ôte son masque et révèle sa nature : il s'agit non seulement d'une croyance, mais d'une croyance indéfendable d'un point de vue rationnel —d'une foi irrationnelle. [...]
Russell a énoncé la conclusion de Hume sur un mode encore plus énergique et désespéré, dans le cha¬pitre qu'il a consacré à Hume dans son Histoire de la philosophie occidentale, publiée en 1946 (trente-quatre ans après ses Problèmes de philosophie, qui contenaient un exposé admirablement clair du problème de l'induc¬tion sans référence à Hume). Russell dit, au sujet du traitement de l'induction par Hume : « La philosophie de Hume [...] représente la banqueroute du xviiie siècle raisonnable «, et « Il est donc important de découvrir s'il y a une réponse à faire à Hume à l'inté-rieur du cadre d'une philosophie qui est, entièrement, ou dans sa plus grande partie, empirique. Sinon, il n'y a pas de différence intellectuelle entre la folie et la raison. L'aliéné qui croit qu'il est un oeuf poché doit être condamné seulement sur le fait qu'il est une minorité
L...1 «
Russell poursuit en affirmant que si on rejette l'induction (ou le principe d'induction), « toute tenta¬tive pour arriver à des lois scientifiques générales, en partant d'observations particulières, est fausse, et un empiriste ne pourra pas échapper au scepticisme de Hume «.
3. Méthodologie de la quête de vérité :
conjectures et réfutations
Karl Popper, La Connaissance objective, ibid.,
chap. I, p. 55-60.
Je supposerai que le théoricien s'intéresse essentielle¬ment à la vérité et, particulièrement, à la découverte de théories vraies. Mais une fois qu'il a complètement digéré le fait que nous ne pouvons jamais justifier empiriquement — c'est-à-dire au moyen d'énoncés expérimentaux — l'affirmation qu'une théorie scienti¬fique est vraie, et que nous sommes donc toujours confrontés dans le meilleur des cas à la question de savoir quelles suppositions il convient, à titre d'essai, de préférer à d'autres, il est en droit, de son point de vue de chercheur de théories vraies, de se pencher sur les questions suivantes : quels principes de préférence devrions-nous adopter ? Certaines théories sont-elles « meilleures « que d'autres ?
Ces questions amènent les réflexions suivantes :
(1) La question de la préférence, c'est l'évidence, ne surgira principalement, et peut-être même unique-ment, que relativement à un ensemble de théories concurrentes ; autrement dit, de théories qui se pré-sentent comme des solutions à un même problème.
[. • .1
(2) Le théoricien qui s'intéresse à la vérité doit égale¬ment s'intéresser à la fausseté, car découvrir qu'un énoncé est vrai revient à s'apercevoir que sa négation est fausse. La réfutation d'une théorie présentera donc toujours un intérêt théorique. Toutefois, la négation d'une théorie explicative n'est pas, à son tour, une théo¬rie explicative (et elle n'a pas non plus, en général, le
« caractère empirique « de l'énoncé expérimental dont elle est dérivée). Si intéressante soit-elle, elle ne satisfait pas le souci du théoricien de découvrir des théories explicatives vraies.
(3) Pour le théoricien qui cherche une théorie expli-cative vraie, la découverte du point sur lequel une théo¬rie échoue ne donne pas seulement une information intéressante du point de vue théorique : cette décou¬verte pose un nouveau problème de taille à toute théorie explicative nouvelle. Toute théorie nouvelle ne devra pas seulement réussir là où la théorie réfutée qui l'a précédée a réussi, mais elle devra également réussir là où celle-ci a échoué ; c'est-à-dire là où elle a été réfutée. Si la nouvelle théorie réussit sur les deux tableaux, elle aura en tout cas mieux réussi que l'ancienne et sera par conséquent « meilleure « qu'elle.
(4) En outre, si un nouveau test n'a pas réfuté à l'instant t cette nouvelle théorie, celle-ci sera, du moins à l'instant t, « meilleure «, mais en un autre sens du mot, que la théorie réfutée. Car, non seulement elle expliquera tout ce que la théorie réfutée expliquait, et même davantage, mais il faudra également la considérer comme éventuellement vraie, puisque, à l'instant t, il n'aura pas été montré qu'elle est fausse.
(5) Mais si une nouvelle théorie de ce genre a de la valeur aux yeux du théoricien, ce n'est pas seulement à cause de ses réussites, ni seulement parce qu'il se peut qu'elle soit vraie, c'est aussi parce qu'il se peut bien qu'elle soit fausse : elle l'intéresse comme objet de nou¬veaux tests, autrement dit, de nouvelles tentatives de réfutations qui, si elles réussissent, n'établiront pas seu¬lement une nouvelle négation d'une théorie, mais sou¬lèveront en même temps un problème théorique nouveau pour la prochaine théorie à venir.
On peut résumer les points (1) à (5) de la manière suivante :
Le théoricien s'intéressera pour diverses raisons aux théories non réfutées, notamment parce qu'il se peut que certaines d'entre elles soient vraies. Il préférera une théorie non réfutée à une théorie réfutée, pourvu qu'elle explique les réussites et les échecs de la théorie réfutée.
(6) Mais la nouvelle théorie, comme toutes les théo-ries non réfutées, peut fort bien être fausse. Le théori-cien par conséquent fera tous ses efforts pour détecter toute théorie fausse, dans l'ensemble des théories non réfutées en concurrence ; il essaiera de « la coincer «. C'est-à-dire que, pour toute théorie non réfutée donnée, il essaiera d'imaginer des cas ou des situations où elle aura toute chance d'échouer, si elle est fausse. Il essaiera donc de construire des tests rigoureux, et des situations de test cruciales. Ce qui reviendra à construire une loi falsifiante ; autrement dit, une loi qui sera peut-être d'un niveau d'universalité si bas qu'elle pourra s'avérer incapable d'expliquer les succès de la théorie à tester, mais qui suggérera, néanmoins, une expérience cruciale : une expérience susceptible de réfuter, en fonction de son résultat, soit la théorie à tester, soit la théorie falsifiante.
(7) Grâce à cette méthode d'élimination, nous pou-vons tomber sur une théorie vraie. Mais en aucun cas la méthode n'est en mesure d'établir sa vérité, même si elle est vraie ; car le nombre de théories susceptibles d'être vraies demeure infini, à tout instant et après un nombre de tests cruciaux aussi grand qu'on voudra. (C'est une autre manière de formuler le résultat négatif de Hume.) Les théories effectivement proposées seront, bien entendu, en nombre fini ; et il peut fort bien arri
ver que nous les réfutions toutes, sans que nous soyons capables pour autant d'en imaginer une nouvelle.
D'autre part, au nombre des théories effectivement pro-posées, il se peut qu'il y en ait plus d'une qui ne soit pas réfutée à l'instant t, si bien qu'il est possible que nous ne sachions pas laquelle d'entre elles nous devrions préférer. Mais si, à un instant t, plusieurs théories continuent de se concurrencer de cette manière, le théoricien essaiera de découvrir comment on pourrait concevoir des expé¬riences cruciales qui fassent le partage entre elles ; c'est-à-dire des expériences qui puissent falsifier et donc éli¬miner certaines des théories en concurrence.
(8) La procédure ici décrite peut conduire à un ensemble de théories qui sont en « concurrence « au sens où elles proposent des solutions à un certain nombre au moins de problèmes communs, même si chacune offre en supplément des solutions à certains problèmes dont les autres ne traitent pas. Car, bien que nous exigions d'une nouvelle théorie qu'elle résolve a la fois les problèmes que la précédente a résolus et ceux sur lesquels elle a échoué, il peut évidemment toujours arriver que l'on propose deux ou plusieurs théories concurrentes qui soient telles que chacune satisfasse à ces exigences, et résolve en sus certains problèmes que les autres ne résolvent pas.
(9) À tout instant t, le souci du théoricien sera tout particulièrement de découvrir la mieux testable des théories en concurrence afin de la soumettre à de nou¬veaux tests. Comme je l'ai montré, c'est celle qui aura à la fois le plus grand contenu informatif et le plus grand pouvoir explicatif. Ce sera la théorie la plus digne d'être soumise à de nouveaux tests, bref : « la meilleure « des théories en concurrence à l'instant t. Si elle survit aux tests, elle sera également la mieux testée
de toutes les théories jusqu'à présent considérées, y compris toutes celles qui l'ont précédée.
(10) Dans ce qu'on vient de dire sur « la meilleure théorie «, on suppose qu'une bonne théorie n'est pas une théorie ad hoc. Les idées d'adhocité et de son contraire, que l'on peut peut-être appeler « l'audace «, sont très importantes. Les explications ad hoc sont des explications qui ne sont pas testables de manière indé-pendante ; c'est-à-dire qu'elles ne sont pas testables indépendamment de l'effet à expliquer. On peut en trouver autant qu'on veut, et elles n'ont guère d'intérêt théorique. J'ai traité la question des degrés d'indépen-dance des tests en divers endroits ; c'est un problème intéressant, et il est lié aux problèmes de la simplicité et de la profondeur. Depuis lors, j'ai également insisté sur la nécessité d'aborder ce problème de l'indépen¬dance des tests en fonction du problème d'explication que nous nous proposons de résoudre, et de le traiter relativement aux situations de problème en discussion, car toutes ces idées ont un rapport avec les degrés d'« excellence « des théories concurrentes. En outre, le degré d'audace d'une théorie dépend également de sa relation avec celles qui l'ont précédée.
Ce qu'il y a de plus intéressant ici, c'est que je suis parvenu, je crois, à fournir un critère objectif pour des degrés très élevés d'audace ou de non-adhocité : la nou-velle théorie, tout en devant expliquer ce que l'ancienne théorie expliquait, doit la corriger ; si bien qu'en réalité elle contredit l'ancienne théorie : elle contient l'ancienne théorie, mais sous forme d'une approximation seulement. J'ai ainsi fait observer que la théorie de Newton contredit à la fois celle de Kepler et celle de Galilée — tout en les expliquant —, puisqu'elle les contient comme approximations ; et de la même manière, la théorie d'Einstein contredit celle de
Newton, qu'elle explique pareillement, et qu'elle contient comme une approximation.
(11) La méthode ici décrite peut être appelée la méthode critique. C'est une méthode d'essai et d'élimi-nation des erreurs, qui consiste à proposer des théories et à les soumettre aux tests les plus rigoureux que nous puissions concevoir. Si, à cause de certaines supposi-tions limitatives, on ne considère comme possibles qu'un nombre fini seulement de théories concurrentes, cette méthode peut nous conduire à isoler, par élimina¬tion de toutes ses concurrentes, la théorie vraie. Mais normalement — autrement dit, dans tous les cas où le nombre des théories possibles est infini —, la méthode n'a pas le pouvoir de nous dire avec certitude laquelle des théories est vraie ; et aucune autre méthode non plus n'en est capable. Elle demeure applicable, mais elle n'est pas conclusive.
(12) L'enrichissement des problèmes, qui se fait grâce à la réfutation des théories fausses, et aux exi-gences énoncées en (3), nous donne la certitude que, par rapport à toute théorie nouvelle, et de son point de vue de théorie nouvelle, celle qui l'aura précédée aura constitué une approximation de cette théorie nou-velle. Rien, évidemment, ne peut nous garantir que, pour toute théorie qui aura été falsifiée, nous en trouve¬rons une nouvelle qui soit un « meilleur « successeur ou qui constitue une meilleure approximation — une théorie qui satisfasse ces exigences. Il n'existe aucune assurance que nous serons en mesure de progresser vers des théories meilleures.
4. L'hypothèse ad hoc
Karl Popper, La Connaissance objective, ibid.,
chap. v, p. 297-300.
Le but de la science, c'est de découvrir des explica¬tions satisfaisantes de tout ce qui nous étonne et paraît nécessiter une explication. Par explication (ou explica-tion causale), on entend un ensemble d'énoncés dont l'un décrit l'état de choses à expliquer (l'explicandum), tandis que les autres, les énoncés explicatifs, constituent « l'explication « au sens le plus étroit du terme (l'expli-cans de l'explicandum).
On peut admettre que, en règle générale, on sait, plus ou moins bien, que l'explicandum est vrai ; ou on présume qu'il l'est. Car il n'y a guère de sens à chercher l'explication d'un état de choses qui risque de se révéler entièrement imaginaire. (On en a un bon exemple avec les soucoupes volantes : ce qui nécessite une explica¬tion, ce ne sont vraisemblablement pas tant les sou¬coupes volantes, que les témoignages à leur sujet ; mais, dans le cas où les soucoupes volantes existeraient, aucune explication supplémentaire de ces témoignages ne serait alors requise.) L' explicans, de son côté, qui est l'objet de notre recherche, sera, en règle générale, inconnu : il faudra le découvrir. Par conséquent, l'expli-cation scientifique, chaque fois qu'il s'agira d'une découverte, sera l'explication du connu par l'inconnu.
Pour être satisfaisant (la satisfaction pouvant être une affaire de degrés), l'explicans doit remplir un certain nombre de conditions. Tout d'abord, il doit avoir l'explicandum pour conséquence logique. Ensuite, l'explicans devrait être vrai, bien qu'en général on ne sache pas s'il l'est ; en tout cas, il doit n'être pas connu
pour faux, même après l'examen critique le plus rigou¬reux. Quand on ne sait pas s'il est vrai (ce qui sera généralement le cas), il doit y avoir des preuves indé¬pendantes en sa faveur. Autrement dit, il doit être tes¬table de manière indépendante ; et il sera considéré comme d'autant plus satisfaisant que les tests indépen¬dants auxquels il aura survécu auront été plus rigoureux.
Il me faut maintenant clarifier l'emploi que je fais du terme « indépendant « à l'aide de ses contraires : ad hoc, et (dans les cas extrêmes) « circulaire «.
Soit a un explicandum, dont on sait qu'il est vrai. Puisque, de façon triviale, a est une conséquence logique de a lui-même, on pourrait toujours proposer a comme explication de lui-même. Mais ceci serait extrêmement peu satisfaisant, même s'il est exact que, dans ce cas, nous saurions que l'explicans est vrai et que l'explicandum en est une conséquence logique. Nous devons donc exclure les explications de ce genre à cause de leur circularité.
Mais le genre de circularité à quoi je pense ici est affaire de degrés. Considérez le dialogue suivant : « Pourquoi la mer est-elle si agitée aujourd'hui ? « —« Parce que Neptune est très en colère. « — « Quelle preuve pouvez-vous donner à l'appui de votre énoncé : "Neptune est très en colère" ? « — « Oh ! Ne voyez-vous pas à quel point la mer est agitée ? Et n'est-elle pas tou¬jours agitée quand Neptune est en colère ? « Si nous trouvons cette explication insatisfaisante, c'est que (tout comme dans le cas de l'explication complètement circulaire) la seule preuve en faveur de l'explicans, c'est l'explicandum lui-même. Le sentiment d'extrême insa¬tisfaction que produisent les explications ad hoc ou quasi circulaires de ce genre, et l'exigence qui en découle de devoir les éviter, comptent, j'en suis
convaincu, parmi les principales forces qui motivent le développement de la science : la non-satisfaction compte parmi les premiers fruits de la démarche cri¬tique ou rationnelle.
Pour n'être pas ad hoc, l' explicans doit avoir un contenu riche : il doit comporter diverses conséquences testables, parmi lesquelles, notamment, des consé¬quences testables qui diffèrent de l' explicandum. C'est à ces conséquences testables différentes que je pense quand je parle de tests indépendants, ou de preuves indépendantes.
Bien que ces remarques puissent contribuer sans doute à élucider un peu l'idée intuitive d'un explicans testable de manière indépendante, elles demeurent tout à fait insuffisantes pour caractériser une explication satisfaisante et testable de façon indépendante. Car, si a est notre explicandum — soit a de nouveau « la mer est agitée aujourd'hui « —, nous avons toujours alors la possibilité de fournir un explicans extrêmement insatis¬faisant qui soit complètement ad hoc, même s'il a des conséquences testables de façon indépendante. Nous pouvons toujours choisir ces conséquences à notre guise. Nous pouvons choisir, disons, « ces prunes sont juteuses « et « tous les corbeaux sont noirs «. Soit b leur conjonction. Nous pouvons alors tout simplement prendre pour explicans la conjonction de a et b : elle satisfera toutes les exigences que nous avons posées jus¬qu'à présent.
Ce n'est que si nous exigeons que les explications fassent usage d'énoncés universels ou de lois de la nature (complétées par des conditions initiales) que nous serons en mesure de progresser vers la compré¬hension de l'idée d'explications indépendantes, d'expli¬cations qui ne soient pas ad hoc. Car les lois universelles de la nature peuvent être des énoncés dotés d'un
contenu riche, de sorte qu'elles peuvent être testées de manière indépendante en tout temps et en tout lieu. Si donc on les emploie comme explications, elles peuvent n'être pas ad hoc, car elles peuvent nous permettre d'interpréter l' explicandum comme un exemple d'un effet reproductible. Tout ceci n'est vrai, cependant, que si nous nous en tenons aux lois universelles qui sont testables, c'est-à-dire falsifiables.
5. Le perspectivisme nietzschéen
Nietzsche, Le Gai Savoir, trad. Patrick Wotling,
GF-Flammarion, 2007, § 374, p. 340-341.
Notre nouvel « infini «. — Savoir jusqu'où s'étend le caractère perspectiviste de l'existence ou bien si elle a encore un autre caractère, si une existence sans inter-prétation, sans « sens « ne devient pas justement un « non-sens «, si, d'autre part, toute existence n'est pas essentiellement une existence interprétante — voilà qui ne peut être tranché, comme il est juste, même par l'analyse et l'examen de soi les plus acharnés et les plus minutieusement consciencieux de l'intellect : puisqu'en menant cette analyse, l'intellect humain ne peut éviter de se voir lui-même sous ses formes perspectivistes et seulement en elles. Nous ne pouvons contourner notre angle du regard : c'est une curiosité désespérée que de vouloir savoir quelles autres espèces d'intellect et de perspective il pourrait y avoir : par exemple si d'autres êtres peuvent percevoir le temps de manière régressive ou bien de manière alternativement progressive et régressive (ce qui produirait une autre direction de vie et un autre concept de cause et d'effet). Mais je pense que du moins nous sommes loin, aujourd'hui, de la présomption ridicule consistant à décréter depuis notre angle que l'on ne peut légitimement avoir de perspective qu'à partir de cet angle-là. Le monde nous est bien plutôt devenu, une fois encore, « infini « : dans la mesure où nous ne pouvons pas écarter la possibilité qu'il renferme en lui des interprétations infinies. Le grand frisson nous saisit une nouvelle fois — mais qui aurait donc envie de recommencer d'emblée à diviniser ce monstre de monde inconnu à la manière ancienne ? Et
d'adorer désormais cette chose inconnue comme « t'être inconnu « ? Ah, cette chose inconnue comprend trop de possibilités d'interprétation non divines, trop de dia-blerie, de sottise, de bouffonnerie d'interprétation, — notre propre interprétation humaine, trop humaine même, que nous connaissons...
6. Trois thèses sur l'épistémologie sans sujet
connaissant
Karl Popper, La Connaissance objective, op. cit.,
chap. III, p. 182-189.
Sans prendre trop au sérieux les mots « monde « ou « univers «, nous sommes en droit de distinguer les trois mondes ou univers suivants : premièrement, le monde des objets physiques ou des états physiques ; deuxièmement, le monde des états de conscience, ou des états mentaux, ou peut-être des dispositions com¬portementales à l'action ; et troisièmement, le monde des contenus objectifs de pensée, qui est surtout le monde de la pensée scientifique, de la pensée poétique et des oeuvres d'art.
Certes ce que j'appelle « le troisième monde « a ainsi beaucoup à voir avec la théorie platonicienne des Formes ou Idées et, par conséquent, aussi avec la théo¬rie hégélienne de l'Esprit Objectif ; mais ma théorie diffère radicalement, sur certains points décisifs, de celles de Platon et de Hegel. Elle a plus à voir encore avec la théorie d'un univers des propositions en soi et des vérités en soi de Bolzano, bien qu'elle en diffère également. Ce qui ressemble de plus près à mon troi¬sième monde, c'est l'univers des contenus de pensée objectifs de Frege.
Il n'entre ni dans ma conception ni dans mon argu¬mentation d'interdire de classer nos mondes différem¬ment ou de ne pas les classer du tout. Nous serions en droit, en particulier, de distinguer plus de trois mondes. Mon expression « le troisième monde « n'est qu'une simple affaire de commodité.
En soutenant cette idée d'un troisième monde objec¬tif, mon espoir est de défier ceux que j'appelle les « phi
losophes de la croyance « : ceux qui, comme Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant ou Russell, s'intéressent à nos croyances subjectives, et à leur fondement ou à leur origine. À l'encontre de ces philosophes de la croyance, je fais valoir que notre problème est de trou¬ver des théories meilleures et plus audacieuses ; et que ce qui compte, c'est la préférence critique et non pas la croyance. [...]
Je voudrais défendre [...] trois thèses principales, qui toutes concernent l'épistémologie. Je prends « épisté¬mologie « au sens de théorie de la connaissance scientifique.
Ma première thèse est la suivante. L'épistémologie traditionnelle a étudié la connaissance ou la pensée en un sens subjectif — au sens où nous employons ordinai¬rement les expressions « je connais « ou « je pense «. Ce qui, de mon point de vue, a conduit les épistémologues hors de leur sujet : alors qu'ils voulaient étudier la connaissance scientifique, ils ont étudié en fait quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la connaissance scienti¬fique. Car la connaissance scientifique n'est tout simple¬ment pas une connaissance au sens où nous employons ordinairement l'expression « je connais «. Alors que la connaissance au sens de « je connais « appartient à ce que j'appelle le « deuxième monde «, le monde des sujets, la connaissance scientifique appartient au troi¬sième monde, au monde des théories objectives, des problèmes objectifs et des arguments objectifs.
Ainsi ma première thèse est-elle que l'épistémologie traditionnelle, celle de Locke, Berkeley, Hume et même de Russell, est hors sujet, en un sens assez strict de cette expression. Le corollaire de cette thèse, c'est qu'une grande partie de l'épistémologie contemporaine est éga¬lement hors sujet. Ce qui inclut la logique épistémique moderne, si nous supposons qu'elle se propose de
contribuer à une théorie de la connaissance scientifique. Néanmoins, tout logicien épistémique peut aisément s'immuniser complètement contre ma critique, à la simple condition de bien préciser que son propos n'est pas de contribuer à la théorie de la connaissance scientifique.
Ma première thèse implique que la connaissance et la pensée ont chacune deux sens : (1) la connaissance ou la pensée au sens subjectif, qui consiste en un état d'esprit ou de conscience, ou en une disposition à un comportement ou à une réaction, et (2) la connaissance ou la pensée au sens objectif qui consiste en des pro¬blèmes, des théories, et des arguments en tant que tels. La connaissance en ce sens objectif est totalement indé-pendante de la prétention de quiconque à la connais-sance ; elle est aussi indépendante de la croyance ou de la disposition à l'assentiment (ou à l'affirmation, ou à l'action) de qui que ce soit. La connaissance au sens objectif est une connaissance sans connaisseur : c'est une connaissance sans sujet connaissant.
De la pensée au sens objectif, Frege écrivait : « J'entends par pensée non pas l'acte subjectif de penser, mais son contenu objectif [...] «
On peut illustrer ces deux sens de la pensée et leurs intéressantes relations mutuelles à l'aide de cette cita-tion extrêmement convaincante de Heyting, qui dit, à propos de l'acte par lequel Brouwer a inventé sa théorie du continu :
« Si les fonctions récursives avaient été inventées auparavant, il [Brouwer] n'aurait peut-être pas formé la notion de suite de choix, ce qui, je pense, eût été dommage. «
Cette citation fait référence, d'une part, à certains processus de la pensée subjective de Brouwer ; elle dit qu'ils auraient pu ne pas se produire (ce qui eût été
malheureux) si la situation de problème objective avait été différente. Heyting fait donc état de certaines influences possibles sur les processus de la pensée sub¬jective de Brouwer, et il exprime également son opinion concernant la valeur de ces processus de pensée subjec-tive. Or ce qui est important, c'est que des influences, en tant qu'influences, doivent être subjectives : seule une connaissance familière subjective des fonctions récursives aurait pu avoir sur Brouwer l'effet malheu-reux de l'empêcher d'inventer les suites de libre choix.
D'autre part, la citation de Heyting met en lumière une certaine relation objective entre les contenus objectifs de deux pensées ou théories : Heyting ne fait pas réfé-rence aux conditions subjectives ou aux processus élec-trochimiques dans le cerveau de Brouwer, mais à une situation de problème objective dans les mathématiques et à ses possibles influences sur les actes subjectifs de la pensée de Brouwer qui étaient orientés vers la résolu¬tion de ces problèmes objectifs. Je décrirais ceci en disant que la remarque de Heyting porte sur la logique situationnelle objective ou de troisième monde de l'invention de Brouwer ; la remarque de Heyting implique que la situation de troisième monde peut affecter le deuxième monde. De manière analogue, quand Heyting suggère qu'il eût été malheureux que Brouwer n'inventât pas les suites de choix, c'est une manière de dire que le contenu objectif de la pensée de Brouwer avait de la valeur et de l'intérêt ; de la valeur et de l'intérêt, dans la mesure où il modifiait la situa¬tion de problème objective dans le troisième monde.
Pour formuler les choses simplement, si je dis : « la pensée de Brouwer fut influencée par celle de Kant « ou même « Brouwer rejeta la théorie kantienne de l'espace «, je parle alors, en partie au moins, d'actes de pensée au sens subjectif — le mot « influence « indique
un contexte de processus de pensée ou d'actes de pensée. Mais, si je dis : « la pensée de Brouwer diffère considérablement de celle de Kant «, il est assez clair alors que je parle essentiellement de contenus. Et, enfin, si je dis : « les pensées de Brouwer sont incompa¬tibles avec celles de Russell «, alors, en me servant d'un terme logique comme « incompatible «, je montre sans aucune ambiguïté que je n'emploie le mot « pensée « qu'au sens objectif frégéen, et que je ne parle que du contenu objectif, ou du contenu logique, des théories.
Tout comme le langage ordinaire ne dispose malheu-reusement pas de termes distincts pour « pensée « au sens du deuxième monde et « pensée « au sens du troi¬sième monde, il ne dispose pas non plus de termes distincts pour les deux sens correspondants de « je connais « et de « connaissance «.
Afin de montrer que les deux sens existent, j'indi¬querai en premier lieu trois exemples du sens subjectif ou relevant du deuxième monde :
(1) « Je sais (I know) que vous essayez de me provo-quer, mais je ne tomberai pas dans la provocation. «
(2) « Je sais (I know) que l'on n'a jamais démontré le dernier théorème de Fermat, mais je crois qu'on le démontrera un jour. «
(3) D'après l'article « Connaissance (Knowledge)« dans The Oxford English Dictionary : la connaissance est l'« état d'être au courant ou informé «.
J'indiquerai maintenant trois exemples du sens objectif ou relevant du troisième monde :
(1) D'après l'article « Connaissance (Knowledge) « dans The Oxford English Dictionary : la connaissance est une « branche du savoir ; une science ; un art «.
(2) « Étant donné le présent état de la connaissance métamathématique, il semble possible que le dernier théorème de Fermat soit indécidable. «
(3) « Je certifie que cette thèse est une contribution originale et importante à la connaissance. «
Ces exemples très banals ont pour unique rôle de m'aider à bien faire comprendre ce que j'entends quand je parle de « connaissance au sens objectif «. Si je cite The Oxford English Dictionary, on ne devrait interpréter cela ni comme une concession à l'analyse du langage ni comme une tentative pour me concilier ses partisans. Je ne le cite pas pour tenter de prouver que « l'usage ordinaire « recouvre la « connaissance « au sens objectif de mon troisième monde. En fait, j'ai été surpris de trouver dans The Oxford English Dictionary des exemples d'usages objectifs de « connaissance «. (J'ai été encore plus surpris de trouver certains usages au moins partiellement objectifs de connaître [to know] : « distin-guer [.. .] disposer d'un savoir sur (une chose, un lieu, une personne) ; [...] comprendre «. Que ces usages puissent être partiellement objectifs, cela ressortira de ce qui suit.) En tout cas, mes exemples n'ont pas fonc-tion d'arguments, mais seulement d'illustrations.
Ma première thèse, que jusqu'à présent je n'ai pas démontrée mais seulement illustrée, était que l'épisté-mologie traditionnelle, en se concentrant sur le deuxième monde, ou sur la connaissance au sens sub-jectif, est hors sujet quand elle étudie la connaissance scientifique.
Ma seconde thèse, c'est que l'étude propre à l'épisté-mologie est celle des problèmes et des situations de problèmes scientifiques, des conjectures scientifiques (je ne prends ici cette expression que comme un syno-nyme d'hypothèse scientifique ou de théorie scienti-fique), des discussions scientifiques, des arguments critiques, et du rôle joué par les preuves dans l'argu-mentation, par conséquent, des revues et livres scienti-fiques, ainsi que des expérimentations et de leur
évaluation dans les débats scientifiques ; en bref, ma seconde thèse est que l'étude du troisième monde large¬ment autonome de la connaissance objective est d'une importance décisive pour l'épistémologie.
Une étude épistémologique, telle que ma seconde thèse la définit, montre que le plus souvent les scienti¬fiques ne prétendent ni que leurs conjectures sont vraies, ni qu'ils les « connaissent « au sens subjectif de « connaître «, ni qu'ils y croient. En général, ils ne prétendent pas à la connaissance mais, quand ils déve¬loppent leurs programmes de recherche, ils agissent en s'appuyant sur des suppositions concernant ce qui est et ce qui n'est pas fécond, pour savoir quelle ligne de recherche promet de nouveaux résultats dans ce troi¬sième monde de la connaissance objective. Autrement dit, les scientifiques agissent sur la base d'une supposi¬tion ou, si vous préférez, d'une croyance subjective (car nous pouvons appeler ainsi la base subjective d'une action), qui porte sur ce que promet le prochain déve¬loppement dans le troisième monde de la connaissance objective.
Ce qui, à mon avis, fournit un argument en faveur à la fois de ma première thèse (celle de la non-pertinence d'une épistémologie subjectiviste) et de ma seconde thèse (celle de la pertinence d'une épistémologie objectiviste).
Mais j'ai une troisième thèse. La voici : une épistémo-logie objectiviste qui étudie le troisième monde peut nous aider à faire la lumière sur de larges pans du deuxième monde, celui de la conscience subjective, en particulier sur les processus de pensée subjective des scientifiques ; mais la réciproque n'est pas vraie.
Telles sont mes trois thèses principales.

«
76 1 ROUSSEAU ET TOCQUEVILLE
évident, par la lecture des Livres Sacrés, que le premier
homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières
et des préceptes, n'était
point lui-même dans cet état, et
qu'en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit
tout philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le
déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur
état de nature, à moins qu'ils n'y soient retombés par
quelque événement extraordinaire.
Paradoxe fort embar
rassant à défendre, et
tout à fait impossible à prouver.
Commençons donc par écarter tous
les faits, car ils ne
touchent
point à la question.
Il ne faut pas prendre les
recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet,
pour des vérités historiques, mais seulement pour des rai
sonnements hypothétiques et conditionnels ; plus
propres à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer
la véritable origine, et semblables à ceux que font tous
les jours nos physiciens sur la formation du monde.
La
religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même
ayant tiré
les hommes de l'état de nature, immédiatement
après la création,
ils sont inégaux parce qu'il a voulu
qu'ils
le fussent ; mais elle ne nous défend pas de former
des conjectures tirées de la seule nature de
l'homme et
des êtres qui l'environnent, sur
ce qu'aurait pu devenir le
genre humain, s'il fût resté abandonné à lui-même.
Voilà
ce qu'on me demande, et ce que je me propose d' exami
ner dans
ce Discours.
Mon sujet intéressant l'homme en
général, je tâcherai de prendre
un langage qui convienne
à toutes
les nations, ou plutôt, oubliant les temps et les
lieux, pour ne songer qu'aux hommes à qui je parle, je
me supposerai dans
le lycée d'Athènes, répétant les leçons
de mes maîtres, ayant
les Platon et les Xénocrate pour
juges, et le genre humain pour auditeur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La philosophie de Karl Popper: la science et la falsification en épistémologie
- Popper, sir Karl Raimund - philosophie.
- Explication de texte de Karl Jaspers: introduction à la philosophie(14/20)
- PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE, la Science moderne en révolution, Werner Karl Heisenberg - résumé de l'oeuvre
- MISÈRE DE L’HISTORICISME, Karl Raimund Popper - résumé de l'oeuvre