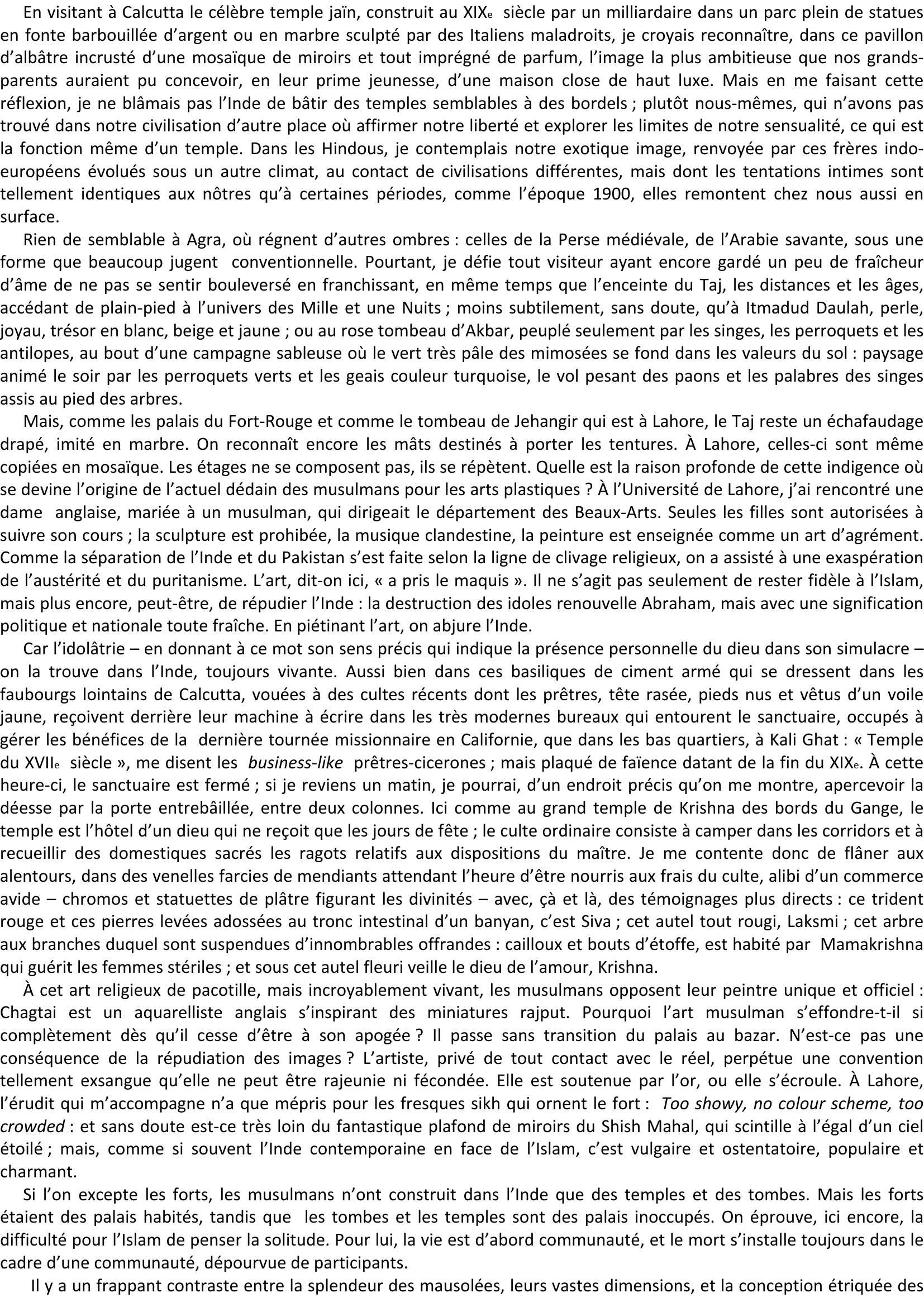J'errais un soir dans l'enceinte de Bhir Mound, délimitée par un talus de déblais. Ce modeste village, dont les soubassements seuls ont subsisté, ne dépasse plus le niveau des ruelles géométriques où je marchais. Il me semble considérer son plan de très haut ou de très loin, et cette illusion, favorisée par l'absence de végétation, ajoutait une profondeur à celle de l'histoire. Dans ces maisons vécurent peut-être les sculpteurs grecs qui suivaient Alexandre, créateurs de l'art du Gandhara et qui inspirèrent aux anciens bouddhistes l'audace de figurer leur dieu. Un reflet brillant à es pieds m'arrêta : c'était, dégagée par les pluies récentes, une piécette d'argent portant l'inscription grecque : MENANDRU BASILEUS SÔTEROS. Que serait aujourd'hui l'Occident si la tentative d'union entre le monde méditerranéen et l'Inde avait réussi de façon durable ? Le christianisme, l'Islam, auraient-ils existé ? C'était surtout l'Islam dont la présence e tourmentait ; non parce que j'avais passé les mois précédents en milieu musulman : ici confronté aux grands onuments de l'art gréco-bouddhique, mes yeux et mon esprit restaient encombrés par le souvenir des palais mogols auxquels j'avais consacré les dernières semaines à Delhi, Agra et Lahore. Mal informé de l'histoire et de la littérature de l'Orient, les oeuvres s'imposaient à moi (comme chez ces peuples primitifs où j'étais arrivé sans connaître leur langue) et 'offraient le seul trait saillant où je puisse accrocher ma réflexion. Après Calcutta, sa grouillante misère et ses faubourgs sordides qui paraissent seulement transposer sur le plan humain a profusion moisissante des tropiques, je comptais trouver à Delhi la sérénité de l'histoire. D'avance, je me voyais nstallé, comme à Carcassonne ou à Semur, dans un hôtel désuet, niché dans les remparts, pour y songer au clair de une ; quand on m'avait dit qu'il me faudrait choisir entre la nouvelle et l'ancienne ville, je n'avais pas hésité, désignant au asard un hôtel situé dans la seconde. Quelle ne fut pas ma surprise d'être emmené par un taxi pour une randonnée de rente kilomètres à travers un paysage informe, dont je me demandais s'il était un antique champ de bataille, où la égétation laissait percer les ruines à de rares intervalles, ou un chantier délaissé. Quand, enfin, nous arrivâmes à la ville rétendue ancienne, la désillusion s'accrut : comme partout ailleurs, c'était un cantonnement anglais. Les jours suivants 'apprirent qu'au lieu d'y trouver le passé concentré sur un petit espace, à la façon des villes européennes, Delhi 'apparaîtrait comme une brousse ouverte à tous les vents où les monuments étaient éparpillés, pareils aux dés sur le apis. Chaque souverain avait voulu construire sa propre ville, abandonnant et démolissant la précédente pour en rélever les matériaux. Il n'y avait pas une, mais douze ou treize Delhi, perdues à des dizaines de kilomètres les unes des utres à travers une plaine où l'on devinait çà et là des tumuli, des monuments et des tombes. Déjà, l'Islam me éconcertait par une attitude envers l'histoire contradictoire à la nôtre et contradictoire en elle-même : le souci de onder une tradition s'accompagnait d'un appétit destructeur de toutes les traditions antérieures. Chaque monarque vait voulu créer l'impérissable en abolissant la durée. Je m'appliquais donc, en sage touriste, à parcourir des distances énormes pour visiter des monuments dont chacun emblait bâti dans le désert. Le Fort-Rouge est plutôt un palais qui combine des vestiges de la Renaissance (ainsi les mosaïques de pietra dura) avec un embryon de style Louis XV dont on se sent persuadé ici qu'il est né d'influences mongoles. Malgré la somptuosité es matériaux, le raffinement du décor, je restais insatisfait. Rien d'architectural dans tout cela, qui dément l'impression 'un palais : plutôt un assemblage de tentes montées « en dur », dans un jardin qui serait lui-même un campement déalisé. Toutes les imaginations paraissent dérivées des arts textiles : baldaquins de marbre évoquant les plis d'un rideau, jali qui sont vraiment (et non point par métaphore) des « dentelles de pierre ». Le dais impérial en marbre est la copie 'un dais démontable, en bois recouvert de draperies ; pas plus que son modèle, il ne fait corps avec la salle d'audiences. ême le tombeau d'Houmayoun, pourtant archaïque, donne au visiteur ce sentiment de malaise qui résulte du manque 'un élément essentiel. L'ensemble fait une belle masse, chaque détail est exquis, mais il est impossible de saisir un lien organique entre les parties et le tout. La Grande Mosquée - Jamma Masjid - qui est du VIIe siècle, contente davantage le visiteur occidental sous le double rapport de la structure et de la couleur. On se sent près d'admettre qu'elle ait été conçue et voulue comme un tout. Pour quatre cents francs, on m'y a montré les plus anciens exemplaires du Coran, un poil de la barbe du Prophète fixé par une astille de cire au fond d'une boîte vitrée remplie de pétales de roses, et ses sandales. Un pauvre fidèle s'approche pour rofiter du spectacle, mais le préposé l'écarte avec horreur. Est-ce qu'il n'a pas payé quatre cents francs, ou que la vue de es reliques est trop chargée de puissance magique pour un croyant ? Pour céder à cette civilisation, il faut aller à Agra. Car on peut tout dire sur le Taj Mahal, et son charme facile de carte postale en couleurs. On peut ironiser sur la procession de jeunes mariés britanniques à qui le privilège fut accordé de passer leur lune de miel dans le temple de droite en grès rose, et sur les vieilles demoiselles célibataires, mais non moins nglo-saxonnes, qui chériront jusqu'à la mort le souvenir du Taj scintillant sous les étoiles et reflétant son ombre blanche ans la Jumna. C'est le côté 1900 de l'Inde ; mais, quand on y pense, on s'aperçoit qu'il repose sur des affinités profondes plus que sur le hasard historique et la conquête. Sans doute l'Inde s'est-elle européanisée aux environs de 1900, et elle en a gardé la marque dans son vocabulaire et ses usages victoriens : lozenge pour bonbon, commode pour chaise percée. ais, inversement, on comprend ici que les années 1900 furent la « période hindoue » de l'Occident : luxe des riches, ndifférence à la misère, goût des formes alanguies et tarabiscotées, sensualité, amour des fleurs et des parfums, et jusqu'aux moustaches effilées, aux boucles et aux fanfreluches. En visitant à Calcutta le célèbre temple jaïn, construit au XIXe siècle par un milliardaire dans un parc plein de statues en fonte barbouillée d'argent ou en marbre sculpté par des Italiens maladroits, je croyais reconnaître, dans ce pavillon d'albâtre incrusté d'une mosaïque de miroirs et tout imprégné de parfum, l'image la plus ambitieuse que nos grandsarents auraient pu concevoir, en leur prime jeunesse, d'une maison close de haut luxe. Mais en me faisant cette réflexion, je ne blâmais pas l'Inde de bâtir des temples semblables à des bordels ; plutôt nous-mêmes, qui n'avons pas trouvé dans notre civilisation d'autre place où affirmer notre liberté et explorer les limites de notre sensualité, ce qui est la fonction même d'un temple. Dans les Hindous, je contemplais notre exotique image, renvoyée par ces frères indoeuropéens évolués sous un autre climat, au contact de civilisations différentes, mais dont les tentations intimes sont tellement identiques aux nôtres qu'à certaines périodes, comme l'époque 1900, elles remontent chez nous aussi en surface. Rien de semblable à Agra, où régnent d'autres ombres : celles de la Perse médiévale, de l'Arabie savante, sous une forme que beaucoup jugent conventionnelle. Pourtant, je défie tout visiteur ayant encore gardé un peu de fraîcheur d'âme de ne pas se sentir bouleversé en franchissant, en même temps que l'enceinte du Taj, les distances et les âges, ccédant de plain-pied à l'univers des Mille et une Nuits ; moins subtilement, sans doute, qu'à Itmadud Daulah, perle, oyau, trésor en blanc, beige et jaune ; ou au rose tombeau d'Akbar, peuplé seulement par les singes, les perroquets et les ntilopes, au bout d'une campagne sableuse où le vert très pâle des mimosées se fond dans les valeurs du sol : paysage nimé le soir par les perroquets verts et les geais couleur turquoise, le vol pesant des paons et les palabres des singes ssis au pied des arbres. Mais, comme les palais du Fort-Rouge et comme le tombeau de Jehangir qui est à Lahore, le Taj reste un échafaudage rapé, imité en marbre. On reconnaît encore les mâts destinés à porter les tentures. À Lahore, celles-ci sont même opiées en mosaïque. Les étages ne se composent pas, ils se répètent. Quelle est la raison profonde de cette indigence où e devine l'origine de l'actuel dédain des musulmans pour les arts plastiques ? À l'Université de Lahore, j'ai rencontré une ame anglaise, mariée à un musulman, qui dirigeait le département des Beaux-Arts. Seules les filles sont autorisées à uivre son cours ; la sculpture est prohibée, la musique clandestine, la peinture est enseignée comme un art d'agrément. omme la séparation de l'Inde et du Pakistan s'est faite selon la ligne de clivage religieux, on a assisté à une exaspération e l'austérité et du puritanisme. L'art, dit-on ici, « a pris le maquis ». Il ne s'agit pas seulement de rester fidèle à l'Islam, ais plus encore, peut-être, de répudier l'Inde : la destruction des idoles renouvelle Abraham, mais avec une signification olitique et nationale toute fraîche. En piétinant l'art, on abjure l'Inde. Car l'idolâtrie - en donnant à ce mot son sens précis qui indique la présence personnelle du dieu dans son simulacre - n la trouve dans l'Inde, toujours vivante. Aussi bien dans ces basiliques de ciment armé qui se dressent dans les aubourgs lointains de Calcutta, vouées à des cultes récents dont les prêtres, tête rasée, pieds nus et vêtus d'un voile aune, reçoivent derrière leur machine à écrire dans les très modernes bureaux qui entourent le sanctuaire, occupés à érer les bénéfices de la dernière tournée missionnaire en Californie, que dans les bas quartiers, à Kali Ghat : « Temple u XVIIe siècle », me disent les business-like prêtres-cicerones ; mais plaqué de faïence datant de la fin du XIXe. À cette heure-ci, le sanctuaire est fermé ; si je reviens un matin, je pourrai, d'un endroit précis qu'on me montre, apercevoir la éesse par la porte entrebâillée, entre deux colonnes. Ici comme au grand temple de Krishna des bords du Gange, le emple est l'hôtel d'un dieu qui ne reçoit que les jours de fête ; le culte ordinaire consiste à camper dans les corridors et à ecueillir des domestiques sacrés les ragots relatifs aux dispositions du maître. Je me contente donc de flâner aux lentours, dans des venelles farcies de mendiants attendant l'heure d'être nourris aux frais du culte, alibi d'un commerce vide - chromos et statuettes de plâtre figurant les divinités - avec, çà et là, des témoignages plus directs : ce trident ouge et ces pierres levées adossées au tronc intestinal d'un banyan, c'est Siva ; cet autel tout rougi, Laksmi ; cet arbre ux branches duquel sont suspendues d'innombrables offrandes : cailloux et bouts d'étoffe, est habité par Mamakrishna ui guérit les femmes stériles ; et sous cet autel fleuri veille le dieu de l'amour, Krishna. À cet art religieux de pacotille, mais incroyablement vivant, les musulmans opposent leur peintre unique et officiel : hagtai est un aquarelliste anglais s'inspirant des miniatures rajput. Pourquoi l'art musulman s'effondre-t-il si complètement dès qu'il cesse d'être à son apogée ? Il passe sans transition du palais au bazar. N'est-ce pas une onséquence de la répudiation des images ? L'artiste, privé de tout contact avec le réel, perpétue une convention ellement exsangue qu'elle ne peut être rajeunie ni fécondée. Elle est soutenue par l'or, ou elle s'écroule. À Lahore, 'érudit qui m'accompagne n'a que mépris pour les fresques sikh qui ornent le fort : Too showy, no colour scheme, too crowded : et sans doute est-ce très loin du fantastique plafond de miroirs du Shish Mahal, qui scintille à l'égal d'un ciel étoilé ; mais, comme si souvent l'Inde contemporaine en face de l'Islam, c'est vulgaire et ostentatoire, populaire et charmant. Si l'on excepte les forts, les musulmans n'ont construit dans l'Inde que des temples et des tombes. Mais les forts étaient des palais habités, tandis que les tombes et les temples sont des palais inoccupés. On éprouve, ici encore, la difficulté pour l'Islam de penser la solitude. Pour lui, la vie est d'abord communauté, et le mort s'installe toujours dans le cadre d'une communauté, dépourvue de participants. Il y a un frappant contraste entre la splendeur des mausolées, leurs vastes dimensions, et la conception étriquée des pierres tombales qu'ils abritent. Ce sont de tout petits tombeaux où l'on doit se sentir à l'étroit. À quoi donc servent ces alles, ces galeries qui les entourent et dont seuls jouiront les passants ? Le tombeau européen est à la mesure de son abitant : le mausolée est rare et c'est sur la tombe même que s'exercent l'art et l'ingéniosité, pour la rendre somptueuse t confortable au gisant. Dans l'Islam, le tombeau se divise en monument splendide, dont le mort ne profite pas, et une demeure mesquine elle-même dédoublée d'ailleurs entre un cénotaphe visible et une sépulture cachée) où le mort paraît prisonnier. Le roblème du repos de l'au-delà trouve une solution deux fois contradictoire : d'une part, confort extravagant et nefficace, de l'autre inconfort réel, le premier apportant une compensation au second. N'est-ce pas l'image de la civilisation musulmane qui associe les raffinements les plus rares : palais de pierres précieuses, fontaines d'eau de rose, mets recouverts de feuilles d'or, tabac à fumer mêlé de perles pilées, servant de couverture à la rusticité des moeurs et à la bigoterie qui imprègne la pensée morale et religieuse ? Sur le plan esthétique, le puritanisme islamique, renonçant à abolir la sensualité, s'est contenté de la réduire à ses formes mineures : parfums, dentelles, broderies et jardins. Sur le plan moral, on se heurte à la même équivoque d'une olérance affichée en dépit d'un prosélytisme dont le caractère compulsif est évident. En fait, le contact des nonusulmans les angoisse. Leur genre de vie provincial se perpétue sous la menace d'autres genres de vie, plus libres et lus souples que le leur, et qui risquent de l'altérer par la seule contiguïté. Plutôt que parler de tolérance, il vaudrait mieux dire que cette tolérance, dans la mesure où elle existe, est une erpétuelle victoire sur eux-mêmes. En la préconisant, le Prophète les a placés dans une situation de crise permanente, ui résulte de la contradiction entre la portée universelle de la révélation et l'admission de la pluralité des fois eligieuses. Il y a là une situation « paradoxale » au sens pavlovien, génératrice d'anxiété d'une part et de complaisance n soi-même de l'autre, puisqu'on se croit capable, grâce à l'Islam, de surmonter un pareil conflit. En vain, d'ailleurs : omme le remarquait un jour devant moi un philosophe indien, les musulmans tirent vanité de ce qu'ils professent la valeur universelle de grands principes : liberté, égalité, tolérance ; et ils révoquent le crédit à quoi ils prétendent en ffirmant du même jet qu'ils sont les seuls à les pratiquer. Un jour, à Karachi, je me trouvais en compagnie de Sages musulmans, universitaires ou religieux. À les entendre vanter a supériorité de leur système, j'étais frappé de constater avec quelle insistance ils revenaient à un seul argument : sa simplicité. La législation islamique en matière d'héritage est meilleure que l'hindoue, parce qu'elle est plus simple. Veutn tourner l'interdiction traditionnelle du prêt à intérêt : il suffit d'établir un contrat d'association entre le dépositaire et e banquier, et l'intérêt se résoudra en une participation du premier dans les entreprises du second. Quant à la réforme graire, on appliquera la loi musulmane à la succession des terres arables jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment ivisées, ensuite on cessera de l'appliquer - puisqu'elle n'est pas article de dogme - pour éviter un morcellement xcessif : There are so many ways and means... Tout l'Islam semble être, en effet, une méthode pour développer dans l'esprit des croyants des conflits insurmontables, quitte à les sauver par la suite en leur proposant des solutions d'une très grande (mais trop grande) simplicité. D'une main on les précipite, de l'autre on les retient au bord de l'abîme. Vous inquiétez-vous de la vertu de vos épouses ou de vos filles pendant que vous êtes en campagne ? Rien de plus simple, voilez-les et cloîtrez-les. C'est ainsi qu'on en arrive au burkah moderne, semblable à un appareil orthopédique avec sa coupe compliquée, ses guichets en passementerie pour la vision, ses boutons-pression et ses cordonnets, le lourd tissu dont il est fait pour s'adapter exactement aux contours du corps humain tout en le dissimulant aussi complètement que possible. Mais, de ce fait, la arrière du souci s'est seulement déplacée, puisque maintenant il suffira qu'on frôle votre femme pour vous déshonorer, t vous vous tourmenterez plus encore. Une franche conversation avec de jeunes musulmans enseigne deux choses : 'abord, qu'ils sont obsédés par le problème de la virginité prénuptiale et de la fidélité ultérieure ; ensuite que le purdah, c'est-à-dire la ségrégation des femmes, fait en un sens obstacle aux intrigues amoureuses, mais les favorise sur un autre lan : par l'attribution aux femmes d'un monde propre, dont elles sont seules à connaître les détours. Cambrioleurs de harems quand ils sont jeunes, ils ont de bonnes raisons pour s'en faire les gardiens une fois mariés. Hindous et musulmans de l'Inde mangent avec leurs doigts. Les premiers, délicatement, légèrement, en saisissant la nourriture dans un fragment de chapati ; on appelle ainsi ces larges crêpes, vite cuites en les plaquant au flanc intérieur d'une jarre enfouie dans le sol et remplie de braises jusqu'au tiers. Chez les Musulmans, manger avec ses doigts devient n système : nul ne saisit l'os de la viande pour ronger la chair. De la seule main utilisable (la gauche étant impure, parce ue réservée aux ablutions intimes) on pétrit, on arrache les lambeaux ; et quand on a soif, la main graisseuse empoigne le verre. En observant ces manières de table qui valent bien les autres, mais qui, du point de vue occidental, semblent faire ostentation de sans-gêne, on se demande jusqu'à quel point la coutume, plutôt que vestige archaïque, ne résulte pas d'une réforme voulue par le Prophète : « Ne faites pas comme les autres peuples, qui mangent avec un couteau », nspiré par le même souci, inconscient sans doute, d'infantilisation systématique, d'imposition homosexuelle de la ommunauté par la promiscuité qui ressort des rituels de propreté après le repas, quand tout le monde se lave les mains, e gargarise, éructe et crache dans la même cuvette, mettant en commun, dans une indifférence terriblement autiste, la même peur de l'impureté associée au même exhibitionnisme. La volonté de se confondre est d'ailleurs accompagnée par