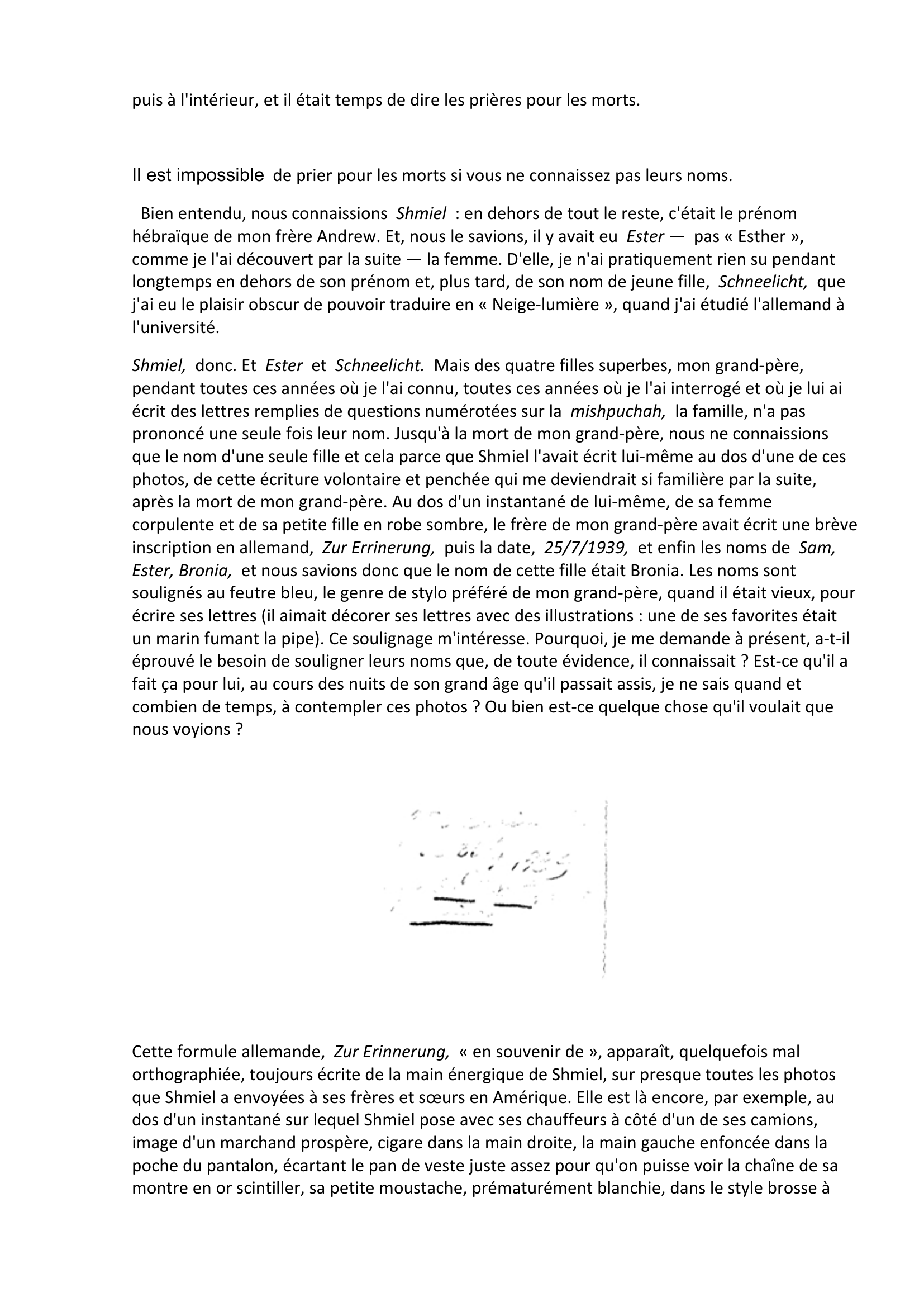laquelle nous appartenions. C'était l'automne, les Jours Austères : nous nous rendions à l'Yizkor, le service de commémoration. Cette fois-là, ma mère avait dû lire le Kaddish, la prière des morts, uniquement pour sa mère, qui était morte de manière si inattendue après lui avoir confié un billet de vingt dollars (et elle l'a encore : le billet est soigneusement rangé dans le sac en cuir rouge au fond d'un tiroir dans sa maison de Long Island, et elle le sort de temps en temps pour me le montrer, en même temps que les lunettes et la prothèse auditive de mon grand-père, comme si c'étaient des reliques) - « uniquement pour sa mère », puisque tous les autres étaient encore en vie : son père, ses soeurs et ses frères, tous ceux qui étaient venus d'Europe, cinquante ans plus tôt, tous à l'exception de Shmiel. Nous montions lentement les marches basses, ce soir-là, afin que ma mère pût pleurer sa mère. Peut-être que c'était parce que j'avais les yeux bleus, comme elle et sa mère, qu'elle m'avait emmené, ce soir-là. Le soleil se couchait et l'atmosphère s'était soudain rafraîchie, et c'était pour cette raison que ma mère avait décidé de retourner dans le parking pour prendre un pull dans la voiture, et pendant ce bref délai supplémentaire avant que commence l'effrayante (pensais-je) prière, elle s'était mise à parler de sa famille, de ses parents décédés, et j'avais mentionné ceux qui avaient été tués. Oui, oui, avait dit ma mère. A l'époque, elle était à l'apogée de sa beauté : les pommettes saillantes, la mâchoire carrée, le grand sourire photogénique de star du cinéma, avec les incisives un peu en avant très sexy. Ses cheveux, qui s'étaient assombris avec le temps pour prendre une riche couleur auburn avec quelques mèches blondes, seul signe à présent qu'elle avait été une blonde filasse, comme l'avaient été sa mère et sa grand-mère, comme l'était autrefois mon frère Matt (Matthew, Matt, qui avait le visage fin, quelque peu allongé, les pommettes saillantes, d'une icône de l'Eglise orthodoxe, des yeux couleur ambre, bizarrement félins, et une crinière de cheveux blond platine dont j'étais, avec ma masse de cheveux noirs, bouclés et incontrôlables, secrètement jaloux) - les cheveux de ma mère s'étaient soulevés dans le vent d'automne qui s'était levé. Elle avait soupiré et dit, Oncle Shmiel et sa femme, ils avaient quatre filles superbes. Au moment où elle avait dit ça, un petit avion était passé au-dessus de nos têtes en faisant beaucoup de bruit et, pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait dit fauves et non filles, ce qui m'avait un peu troublé, puisque j'avais toujours su, même si nous savions si peu, que nous savions au moins ceci : ils avaient quatre filles. Ma confusion n'avait duré qu'un instant, puisque ma mère avait ajouté quelques secondes plus tard, d'une voix légèrement altérée, comme si elle se parlait à elle-même, Ils les ont toutes violées et ils les ont tuées. J'étais resté pétrifié. J'avais douze ans et j'étais un peu en retard pour mon âge, sexuellement. Ce que j'avais ressenti, quand j'ai entendu cette histoire choquante - d'autant plus choquante, semblait-il, en raison du ton très détaché sur lequel ma mère avait laissé passer cette information, comme si elle s'était adressée non pas à moi, son enfant, mais à un adulte qui avait une parfaite connaissance du monde et de ses cruautés -, ce que j'avais ressenti, plus que tout, c'était de la gêne. Non pas de la gêne vis-à-vis de l'aspect sexuel de l'information dont on venait de me faire part, mais plutôt une gêne du fait que toute envie de la questionner plus avant sur ce détail rare et surprenant pourrait être mal interprétée par ma mère comme l'expression de ma lubricité. Et donc, étranglé par ma propre honte, j'avais laissé passer ce commentaire. Ce qui, bien entendu, avait dû frapper ma mère comme étant plus étrange que si je lui avais demandé de m'en dire plus. Ces choses tournaient à toute vitesse dans ma tête alors que nous gravissions de nouveau les marches de l'escalier de la synagogue et, au moment où j'ai été capable de formuler, laborieusement, une question sur ce qu'elle venait de dire, formulée d'une manière qui ne paraissait pas déplacée, nous étions arrivés devant la porte et puis à l'intérieur, et il était temps de dire les prières pour les morts. Il est impossible de prier pour les morts si vous ne connaissez pas leurs noms. Bien entendu, nous connaissions Shmiel : en dehors de tout le reste, c'était le prénom hébraïque de mon frère Andrew. Et, nous le savions, il y avait eu Ester -- pas « Esther », comme je l'ai découvert par la suite -- la femme. D'elle, je n'ai pratiquement rien su pendant longtemps en dehors de son prénom et, plus tard, de son nom de jeune fille, Schneelicht, que j'ai eu le plaisir obscur de pouvoir traduire en « Neige-lumière », quand j'ai étudié l'allemand à l'université. Shmiel, donc. Et Ester et Schneelicht. Mais des quatre filles superbes, mon grand-père, pendant toutes ces années où je l'ai connu, toutes ces années où je l'ai interrogé et où je lui ai écrit des lettres remplies de questions numérotées sur la mishpuchah, la famille, n'a pas prononcé une seule fois leur nom. Jusqu'à la mort de mon grand-père, nous ne connaissions que le nom d'une seule fille et cela parce que Shmiel l'avait écrit lui-même au dos d'une de ces photos, de cette écriture volontaire et penchée qui me deviendrait si familière par la suite, après la mort de mon grand-père. Au dos d'un instantané de lui-même, de sa femme corpulente et de sa petite fille en robe sombre, le frère de mon grand-père avait écrit une brève inscription en allemand, Zur Errinerung, puis la date, 25/7/1939, et enfin les noms de Sam, Ester, Bronia, et nous savions donc que le nom de cette fille était Bronia. Les noms sont soulignés au feutre bleu, le genre de stylo préféré de mon grand-père, quand il était vieux, pour écrire ses lettres (il aimait décorer ses lettres avec des illustrations : une de ses favorites était un marin fumant la pipe). Ce soulignage m'intéresse. Pourquoi, je me demande à présent, a-t-il éprouvé le besoin de souligner leurs noms que, de toute évidence, il connaissait ? Est-ce qu'il a fait ça pour lui, au cours des nuits de son grand âge qu'il passait assis, je ne sais quand et combien de temps, à contempler ces photos ? Ou bien est-ce quelque chose qu'il voulait que nous voyions ? Cette formule allemande, Zur Erinnerung, « en souvenir de », apparaît, quelquefois mal orthographiée, toujours écrite de la main énergique de Shmiel, sur presque toutes les photos que Shmiel a envoyées à ses frères et soeurs en Amérique. Elle est là encore, par exemple, au dos d'un instantané sur lequel Shmiel pose avec ses chauffeurs à côté d'un de ses camions, image d'un marchand prospère, cigare dans la main droite, la main gauche enfoncée dans la poche du pantalon, écartant le pan de veste juste assez pour qu'on puisse voir la chaîne de sa montre en or scintiller, sa petite moustache, prématurément blanchie, dans le style brosse à dents rendu célèbre par quelqu'un d'autre, parfaitement taillée. Au dos de la photo, Shmiel a écrit Zur Errinerung an dein Bruder, « pour te souvenir de ton frère », et puis une inscription un peu plus longue qui mentionne la date : le 19 avril 1939. A ses frères et soeurs, Shmiel n'écrivait qu'en allemand, alors que ce n'était pas la langue dans laquelle ils se parlaient autrefois, qui était le yiddish, ni l'une de celles qu'ils employaient pour parler aux Gentils dans leur ville ou dans d'autres villes, qui était soit le polonais, soit l'ukrainien. Pour eux, l'allemand restait la langue supérieure, officielle, la langue du gouvernement et de l'école primaire, une langue qu'ils avaient apprise dans une grande et unique salle de classe où était accroché (je l'ai appris) un grand portrait de l'empereur austro-hongrois, François-Joseph Ier, qui serait ensuite remplacé par celui d'Adam Mickiewicz, le grand poète polonais, puis par celui de Staline, puis par celui de Hitler et puis par celui de Staline, et enfin - bon, arrivé à ce point, il n'y avait plus de Jäger pour aller à l'école et voir quel portrait s'y trouvait accroché. Mais c'était l'allemand qu'ils avaient appris, Shmiel, ses frères et ses soeurs, à l'école Baron Hirsch, et c'était l'allemand qu'ils avaient encore en tête quand ils s'écrivaient des choses sérieuses. Par exemple (quatre décennies après que ces frères et soeurs ont appris leurs Du et Sie, et der et dem, et einzwei-drei), Ce que tu lis dans les journaux représente à peine dix pour cent de ce qui se passe ici. Ou encore, plus tard, Je vais, pour ma part, écrire une lettre adressée au Président Roosevelt et je vais lui expliquer que tous mes frères et soeurs sont déjà aux Etats-Unis et que mes parents y sont même enterrés, et peut-être que ça marchera. L'allemand, la langue des choses graves, était celle qu'ils lisaient et écrivaient avec quelques rares fautes d'orthographe ou de grammaire, avec peut-être quelques écarts en yiddish parfois, encore plus rarement en hébreu, qu'ils avaient aussi appris par coeur à l'époque où ils étaient encore des petits garçons et des petites filles, pendant le règne de l'empereur dont l'empire allait très bientôt disparaître. Des écarts comme celui qui figure dans une lettre où Shmiel écrit, Fais tout ce que tu peux pour me sortir de ce Gehenim. Gehenim en hébreu signifie « enfer », et quand j'ai lu cette lettre pour la première fois, au cours d'une année qui était aussi éloignée de celle où Shmiel l'avait écrite que l'était l'année où il l'avait écrite de celle de sa naissance, j'ai été saisi par une soudaine bouffée de quelque chose de si ténu que j'aurais presque pu le perdre complètement : une perception fugace mais intense de ce qu'avaient été, peut-être, son enfance et celle de mon grand-père, de la façon, peut-être, dont leur père, mi-furieux, miamusé, avait sans doute employé l'hébreu pour réprimander ses enfants ou se plaindre du Gehenim qu'était devenue sa vie à cause d'eux, ne se doutant pas en 1911 quel genre d'enfer allait devenir sa petite ville. Donc, l'allemand est la langue qu'ils s'écrivaient. Mais l'unique fois où j'ai entendu mon grandpère parler l'allemand, c'était bien après que Shmiel n'était plus rien d'autre que la terre et l'atmosphère d'une prairie en Ukraine, lorsque mon grand-père, se préparant à contrecoeur au départ annuel pour le spa, Bad Gastein, où sa quatrième épouse le forçait à se rendre, avait dit à cette femme (qui avait un numéro tatoué sur l'avant-bras et qui, ayant été une Russe bien élevée, sous d'autres régimes des décennies plus tôt, dédaignait de parler le yiddish), alors qu'ils finissaient de faire leurs nombreux bagages et de préparer les provisions spéciales pour Schloimele : Also, fertig? -- Alors, prête? -- ce qui explique peut-être pourquoi j'associerais toujours par la suite l'allemand, même après avoir appris à le lire et à le parler, à ces vieux Juifs qu'on forçait à aller dans des endroits où ils ne voulaient pas aller. Zur Erinnerung, pour te souvenir de moi. Cette photo, avec son inscription, est la raison pour laquelle, jusqu'à une époque bien plus tardive, Shmiel était le seul des six dont nous