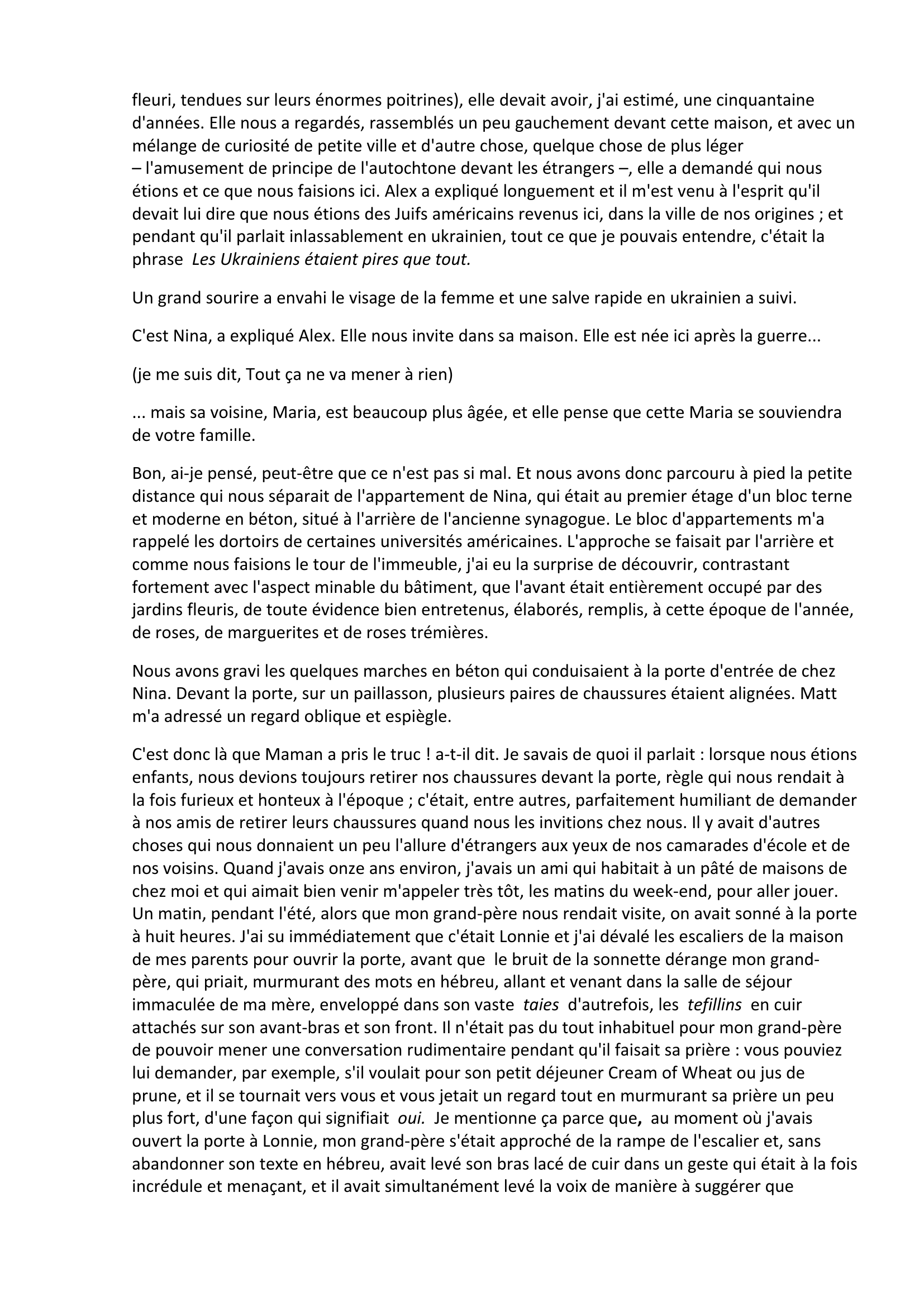et, parfois même, comme Lemberg, mais jamais comme L'viv, les pâtés de maison massifs de l'ère Habsbourg, composés d'immeubles d'habitation impossibles à distinguer de ceux de Vienne, de Budapest ou de Prague, avec leurs fenêtres néo-classiques, certaines surmontées de frontons, d'autres par de minces arches, donnant sur leurs voisins, avec leurs blocs de pierres rugueuses au rez-de-chaussée qui, si mes souvenirs d'un cours d'histoire de l'architecture sont bons, avaient pour but de donner aux occupants une impression de sécurité - nous savions, en regardant toutes ces choses, toute cette histoire de la communauté juive d'Europe compressée en deux jours et demi, le ghetto grouillant, l'assimilation manquée, l'annihilation réussie, nous savions que, aussi intéressant, poignant ou ennuyeux que cela ait pu être, nous ne faisions qu'attendre le bon moment. Le point essentiel de notre voyage de six jours, nous le savions, c'était Bolechow : tout - l'organisation, la dépense, l'effort, les querelles, l'article -, tout dépendait - et trouverait sa justification - du fait de pouvoir découvrir quelque chose, quelqu'un qui les aurait connus et pourrait nous raconter ce qui s'était passé, ou nous raconter au moins une histoire assez bonne pour être vraie, pour être répétée. C'était tout l'intérêt du voyage, ce dimanche, quand nous irions enfin à Bolechow. Et c'est donc le quatrième jour que nous sommes finalement partis pour Bolechow. Quand notre voiture s'est arrêtée sur la place minuscule et mal entretenue, il n'y avait absolument personne. Depuis la petite crête sur la route qu'il faut franchir juste avant d'entrer dans la petite ville, Bolechow ne ressemble pas à grand-chose : un ensemble de maisons massives aux toits pointus, regroupées autour d'un labyrinthe de rues si serrées que la petite place ouverte fait l'effet d'un soupir de soulagement, la ville entière étant nichée dans une dépression au milieu des collines. Pendant que je regardais en contrebas de l'endroit où nous nous étions arrêtés pour prendre des photos - Matt, qui n'avait cessé d'échanger des méchancetés avec Andrew dans la voiture, voulait sortir et photographier un cheval qui se trouvait près du panneau, très laid, qui annonçait le nom de la ville en ukrainien, Bolekhiv - j'ai pensé à quel point elle paraissait vulnérable : combien il était facile d'y entrer, combien elle était isolée. Nous sommes remontés dans la voiture et nous avons continué. Là, dans la ville minuscule, nous avons trouvé trois personnes, chacune nous faisant approcher un peu plus près d'eux, de Shmiel et de sa ramille, même si chacune nous rappelait à quel point ils étaient éloignés dans le temps. Nous avons d'abord trouvé Nina. Alex avait garé la Passat sur la place non pavée, irrégulière, de la ville, pas très loin de l'église ukrainienne au dôme en forme d'oignon et peint de couleur vive où un service était en cours, et juste en face de la maison qui se trouvait là où se dressait autrefois la maison de ma famille (quelques mois plus tôt, Alex avait trouvé une carte d'ingénieur topographique du XIXesiècle de la ville et avait repéré « notre » maison, la maison n° 141). Du même côté de la place que l'église se trouvait l'ancienne mairie, à côté de laquelle se trouvait autrefois le commerce de la famille. En face de la mairie, il y avait la grande synagogue où mon grand-père avait fait sa bar-mitsva ; après la fin de la guerre, quand il n'y avait plus eu de Juifs pour faire leur bar-mitsva ou quoi que ce fût d'autre, elle avait été transformée en salle de réunion des tanneurs. Tout le monde étant à l'église, pour autant que nous pouvions en juger, l'endroit avait l'air plutôt désolé, même s'il paraissait paisible. Alors que nous faisions quelques pas, dans l'herbe haute et le gravier mouillés, nous avons entendu les chants liturgiques en provenance de l'église. Une chèvre, qui n'était pas entravée, errait là. Soudain, une femme à l'allure joviale est passée rapidement. Trapue, comme c'est assez courant chez les femmes d'une certaine origine slave (comme le sont aussi les robes à motif fleuri, tendues sur leurs énormes poitrines), elle devait avoir, j'ai estimé, une cinquantaine d'années. Elle nous a regardés, rassemblés un peu gauchement devant cette maison, et avec un mélange de curiosité de petite ville et d'autre chose, quelque chose de plus léger - l'amusement de principe de l'autochtone devant les étrangers -, elle a demandé qui nous étions et ce que nous faisions ici. Alex a expliqué longuement et il m'est venu à l'esprit qu'il devait lui dire que nous étions des Juifs américains revenus ici, dans la ville de nos origines ; et pendant qu'il parlait inlassablement en ukrainien, tout ce que je pouvais entendre, c'était la phrase Les Ukrainiens étaient pires que tout. Un grand sourire a envahi le visage de la femme et une salve rapide en ukrainien a suivi. C'est Nina, a expliqué Alex. Elle nous invite dans sa maison. Elle est née ici après la guerre... (je me suis dit, Tout ça ne va mener à rien) ... mais sa voisine, Maria, est beaucoup plus âgée, et elle pense que cette Maria se souviendra de votre famille. Bon, ai-je pensé, peut-être que ce n'est pas si mal. Et nous avons donc parcouru à pied la petite distance qui nous séparait de l'appartement de Nina, qui était au premier étage d'un bloc terne et moderne en béton, situé à l'arrière de l'ancienne synagogue. Le bloc d'appartements m'a rappelé les dortoirs de certaines universités américaines. L'approche se faisait par l'arrière et comme nous faisions le tour de l'immeuble, j'ai eu la surprise de découvrir, contrastant fortement avec l'aspect minable du bâtiment, que l'avant était entièrement occupé par des jardins fleuris, de toute évidence bien entretenus, élaborés, remplis, à cette époque de l'année, de roses, de marguerites et de roses trémières. Nous avons gravi les quelques marches en béton qui conduisaient à la porte d'entrée de chez Nina. Devant la porte, sur un paillasson, plusieurs paires de chaussures étaient alignées. Matt m'a adressé un regard oblique et espiègle. C'est donc là que Maman a pris le truc ! a-t-il dit. Je savais de quoi il parlait : lorsque nous étions enfants, nous devions toujours retirer nos chaussures devant la porte, règle qui nous rendait à la fois furieux et honteux à l'époque ; c'était, entre autres, parfaitement humiliant de demander à nos amis de retirer leurs chaussures quand nous les invitions chez nous. Il y avait d'autres choses qui nous donnaient un peu l'allure d'étrangers aux yeux de nos camarades d'école et de nos voisins. Quand j'avais onze ans environ, j'avais un ami qui habitait à un pâté de maisons de chez moi et qui aimait bien venir m'appeler très tôt, les matins du week-end, pour aller jouer. Un matin, pendant l'été, alors que mon grand-père nous rendait visite, on avait sonné à la porte à huit heures. J'ai su immédiatement que c'était Lonnie et j'ai dévalé les escaliers de la maison de mes parents pour ouvrir la porte, avant que le bruit de la sonnette dérange mon grandpère, qui priait, murmurant des mots en hébreu, allant et venant dans la salle de séjour immaculée de ma mère, enveloppé dans son vaste taies d'autrefois, les tefillins en cuir attachés sur son avant-bras et son front. Il n'était pas du tout inhabituel pour mon grand-père de pouvoir mener une conversation rudimentaire pendant qu'il faisait sa prière : vous pouviez lui demander, par exemple, s'il voulait pour son petit déjeuner Cream of Wheat ou jus de prune, et il se tournait vers vous et vous jetait un regard tout en murmurant sa prière un peu plus fort, d'une façon qui signifiait oui. Je mentionne ça parce que, au moment où j'avais ouvert la porte à Lonnie, mon grand-père s'était approché de la rampe de l'escalier et, sans abandonner son texte en hébreu, avait levé son bras lacé de cuir dans un geste qui était à la fois incrédule et menaçant, et il avait simultanément levé la voix de manière à suggérer que personne, sain d'esprit, ne pouvait venir sonner à huit heures du matin. Puis, il avait tourné les talons et il était reparti dans la salle de séjour, mes yeux ravis ne le quittant pas une seconde : mon grand-père tellement drôle et exotique. Lorsque je m'étais retourné pour murmurer quelque chose à Lonnie, il avait redescendu les escaliers du perron et disparu. Et c'est la dernière fois, disait mon grand-père en racontant cette histoire, que nous l'avons vu, celui-là ! Nous avions donc ces moeurs étranges dans la famille, les prières de mon grand-père, l'insistance de ma mère pour que les chaussures soient alignées sur le paillasson juste derrière la porte d'entrée. J'ai pensé à ça, tout comme Matt venait de le faire, quand nous avons franchi le seuil de l'appartement de Nina, et il m'est venu à l'esprit que ma mère, sans doute lorsqu'elle était petite fille, avait intégré cette règle imposée par son père, qui avait dû lui-même s'y plier, un demi-siècle plus tôt, parce qu'il avait vécu, tout comme Nina un siècle plus tard, dans une petite ville de campagne où en faisant cent mètres dans la rue vous aviez de fortes chances de couvrir vos chaussures de cochonneries - de la poussière, de la boue, ou pire encore. L'appartement était minuscule. Une grande partie de la petite salle de séjour était occupée par un grand canapé, sur lequel nous avons presque tous - les quatre Mendelsohn et Alex - réussi à nous caler, les jambes repliées devant la petite table basse. La salle de séjour donnait sur une petite cuisine et une sorte de chambre, où trônait, pour autant que je pouvais voir, un piano. Pendant que nous prenions place sur le canapé, Nina, qui faisait des bruits divers dans la cuisine, continuait à bavarder d'une voix forte et en ukrainien avec Alex, qui avait l'air amusé et aussi content que nous ayons peut-être trouvé ce que nous cherchions. Nina a fini pat revenir de la cuisine, une petite assiette à la main. Elle contenait des tranches du saucisson local. Puis, elle est allée prendre sur la crédence une bouteille poussiéreuse de ce qu'elle a décrit comme un Champagne de l'ère soviétique - c'était bizarre de penser que les Soviétiques faisaient du Champagne, avons-nous dit, mais elle a répliqué que c'était autrefois une grosse affaire à l'Est, dans un des indéchiffrables « quelque chose - stan » - et, après l'avoir débouché, elle en a versé dans chacun de nos verres de fête. Ensuite, elle a préparé une tasse de Nescafé pour chacun de nous, ce qu'elle avait l'air de considérer comme une faveur. C'est un grand honneur, nous a dit Alex, avec un regard destiné à nous avertir. Matt, assis à côté de moi, a marmonné qu'il n'aimait pas le Nescafé. Andrew et moi avons grincé des dents et dit simultanément, Bois ce putain de Nescafé, Matt. Je me suis demandé ce que pouvait bien penser Alex. Alex est un type costaud, blond, sociable, de trente-cinq ans environ, avec un grand sourire permanent entre des fossettes roses. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, il avait fait profession d'emmener les Juifs américains dans les shtetls de l'Europe de l'Est, autour de sa ville natale de L'viv, qu'il nous a fièrement fait visiter (pendant le tour de la ville, il m'avait assuré qu'il n'y avait aucun château dans les environs de Bolechow qui ait autrefois appartenu à un aristocrate polonais). Au cours des dix dernières années, il en était venu à connaître plus de choses sur l'histoire des Juifs de Galicie que les Juifs eux-mêmes. Il était le premier Ukrainien à qui j'aie jamais eu vraiment affaire et lorsque nous nous étions finalement rencontres à l'aéroport de Cracovie, le jour de notre arrivée, nous avions tous été séduits par sa chaleur et sa spontanéité naturelles, qui nous avaient permis de dépasser rapidement la maladresse inévitable du premier contact. C'était pendant le long trajet de Cracovie à L'viv, le lendemain de notre visite d'Auschwitz, que nous lui avons demandé comment un jeune Ukrainien, ancien soldat dans l'armée soviétique, en était