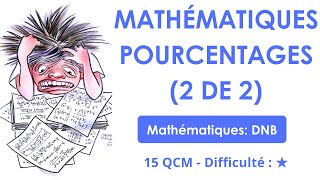La croissance est-elle sans fin ?
Publié le 17/01/2011
Extrait du document
Introduction : Au milieu du XXème siècle, les pays développés se sont donnés une représentation économique simple en projetant aussi bien l’infinie diversité des biens et de services que la plupart des rapports sociaux dans le miroir de la production. Ayant bâti des systèmes de comptabilité nationale, ils ont pu résumer leur performance économique globale en un seul chiffre, le PIB, et mesurer sa croissance annuelle. Celle-ci est devenue l’indicateur fétiche d’une finalité suprême, d’un état du monde, selon la vision des pays les plus riches qui ne doutaient d’ailleurs pas que cette vision devait être partagée par tous.
Si le miroir n’a pas disparu, il semble s’être brouillé depuis quelques décennies. Quelques années avant le déclenchement de la crise des années 1970, la croissance a été contestée comme finalité en soi par une fraction des jeunes générations des pays les plus favorisés («on ne tombe pas amoureux d’un taux de croissance«) et sa possibilité même mise en cause dans le rapport fameux issu des travaux du Club de Rome, intitulé The limits to growth « (Halte à la croissance ? dans sa traduction française). Dans quelle mesure peut-on encore évoquer aujourd’hui la fin de la croissance économique ? Les moteurs de la croissance sont-ils aussi pérennes que le laissent entendre les «nouvelles théories de la croissance« ?La notion de «croissance soutenable« n’est-elle pas l’ultime avatar des thèmes défendus dans le «Livre des limites« de 1972?La croissance infinie est-elle toujours relié au progrès du bien-être?
Il apparaît qu’au moment même où l’analyse économique semble pouvoir remettre en cause l’épuisement du processus de croissance tant craint par les classiques (I), les contraintes naturelles rendent insoutenables les rythmes de croissance observés et leur généralisation à l’échelle planétaire (II). Le divorce entre croissance et progression du bien être dans les pays développés montre justement à propos qu’elle ne peut plus être une fin en soi (III)
I) La croissance économique semble avoir levé l’obstacle des rendements décroissants qui pesait sur sa perennité
A) Le processus de croissance a longtemps semblé contraint par la présence de rendements décroissants
1) Les économistes classiques anticipaient la survenue d’un état stationnaire, du fait de la rareté du facteur fixe qu’est la terre. Marx et Schumpeter doutaient eux de la poursuite de la croissance dans un cadre capitaliste.
2) Le modèle de Solow (1956) laisse un pronostic ambigu sur le phénomène. Sans moteur externe, l’épuisement de la composante endogène de la croissance, l’accumulation du capital, conduit à un état semi-stationnaire (toutes les variables croissent au même rythme, celui du facteur rare, le travail alors que les variables par tête –capital et produit par tête- s’arrêtent de croître. L’état est donc bien stationnaire pour le capital par tête et donc le produit par tête). Seul, le progrès technique, agissant comme un multiplicateur de travail, permet la prolongation de la hausse du produit par tête, en repoussant la survenue des rendements décroissants du capital. Cependant, rien ne permet de garantir la pérennité de cette croissance puisque le progrès technique «tombe du ciel« et qu’il n’est pas possible d’agir sur le taux de croissance de long terme (impact transitoire de la hausse du taux d’épargne ou de les variations de la croissance démographique)
B) La croissance semble cependant pouvoir nourrir la croissance de manière pérenne
1) L’endogénéisation du progrès technique semble faire reculer le spectre des rendements décroissants ( reprendre ici les principaux arguments des «nouvelles théories de la croissance « : auto-entretien de la croissance par des feedbacks reposant sur des externalités positives liées à l’accumulation de différentes formes de capitaux (plus de rendements décroissants), non rareté des nouveaux facteurs les plus importants de la croissance (économie des idées avec Romer, capital humain avec Lucas), incitation à engager des activités d’innovation.
2) La croissance économique apparaît avant tout comme une construction sociale dans la mesure où la croissance reste bornée par la qualité des arrangements institutionnels (approche régulationniste). Ces analyses hétérodoxes peuvent à la fois être utilisées pour montrer qu’il n’y a pas de lois naturelles qui conduisent à l’épuisement de la croissance mais aussi pour montrer que les facteurs ne suffisent pas et que la qualité du cadre institutionnel peut être un obstacle à la croissance ce qui amène alors le C)
C) Mais ce processus paraît difficile à stimuler par des politiques de croissance
1) Les analyses précédentes mettent en évidence trois phénomènes centraux, à l’origine du progrès technique au sens large : la recherche-développement et l’innovation, la division du travail et le capital humain. Rien ne démontre cependant que ces sources de la productivité ne peuvent se tarir: les rendements décroissants de la recherche sont aujourd’hui de plus en plus souvent avancés (Charles Jones montre ainsi que le modèle de Romer est en réalité semi-endogène car seul un accroissement du nombre des chercheurs, dépendant de celui –exogène- de la population peut maintenir le taux de croissance de la PGF constant), la division du travail atteint ses limites lorsque la parcellisation des tâches devient contre-productive ou élève les coûts de coordination et l’élévation du capital humain peut avoir un impact décroissant sur la croissance. Les externalités restent d’autre part subordonnées au caractère explicite et codifié de la connaissance or il apparaît que l’efficacité des entreprises relève largement d’un savoir tacite, difficilement transférable
2) Le taux de croissance de la PGF semble historiquement être borné sur le long terme. Si la croissance des Trente Glorieuses tout comme celle de la Nouvelle Economie ont pu laisser croire que les économistes avaient trouvé le secret de la croissance éternelle et les moyens de la stimuler, cette certitude résiste en effet mal à l’analyse historique du phénomène. Non seulement, le taux de croissance de long terme fonctionne comme une frontière indépassable, mais les théories de la croissance endogène ont beaucoup de mal à indiquer concrètement quel est le facteur dont l’impact sur la croissance peut être le plus fort. Aussi, l’hypothèse d’un progrès technique exogène, donc incertain, peut apparaître la plus raisonnable et laisse planer le doute sur la prolongation infinie du processus.
Transition : Les nouvelles théories de la croissance, tant orthodoxes qu’hétérodoxes semblent avoir levé, à la fin du vingtième siècle, les incertitudes sur la prolongation du processus de croissance même si elles donnent peu de recettes concrètes pour l’entretenir. Pourtant, les craintes malthusiennes ont ressurgi sous le concept fourre tout de «développement durable«. C’est désormais l’équilibre de la biosphère qui imposerait de fortes contraintes au processus de croissance à venir, au point d’inciter à une décroissance sélective.
II) Mais c’est désormais la soutenabilité du processus de croissance capitaliste qui paraît remise en question
A) La croissance dans un cadre capitaliste est porteuse de coûts environnementaux croissants et d’inégalités intra et inter-générationnelles
1) Le concept de «développement durable ou soutenable« apparu dans les années 1980 avec le Rapport Brundtland (1987) et lancé médiatiquement par le Sommet de la Terre de Rio en 1992 montre que la croissance ne peut durer sans prendre en compte les contraintes environnementales et la nécessaire répartition du bien être au sein des générations vivantes et entre celles-ci et les générations futures. Il est relayé par le nouveau rapport des époux Meadows de 1992, vingt ans après le «livre des limites«, au titre aussi alarmant, Beyond the limits.
2) Ces travaux retrouvent les constats empiriques : la croissance ne réduit pas les inégalités au sein des pays, contrairement aux prévisions symbolisées par la courbe de Kuznets, et entre les pays, puisque s’affirme l’hypothèse de «clubs de convergence« relativement fermés.
B) La soutenabilité de ce processus repose sur la croyance forte dans les possibilités techniques
1) Comme il l’avait fait dans son modèle de 1956, pour montrer alors que la croissance équilibrée était possible (fonction de production à facteurs substituables), Solow suggère en 1974 et en 1992 que la soutenabilité est possible si le capital naturel utilisé par les générations présentes est compensé par une accumulation de capital produit (physique, humain, technologique), laissé en compensation aux générations futures.
2) Outre le caractère déséquilibré de l’échange (celui-ci suppose que les générations futures n’ont pas leur mot à dire et qu’elles en acceptent donc les termes), ce raisonnement, qui justifie de continuer sur la même voie, fait la part belle aux possibilités de substitution et repose sur une confiance infinie dans les possibilités du progrès technique. La partie précédente a cependant montré que des incertitudes croissantes pesaient sur le rendement de la recherche et on peut aussi s’interroger sur l’hypothèse de substituabilité.
C) La soutenabilité forte montre cependant que la croissance est contrainte par un capital naturel critique
1) Le rapport du Club de Rome avait déjà fait sensation en montrant au début des années 1970 les conséquences prévisibles de la croissance énergophage des Trente Glorieuses. Le récent choc pétrolier de 2004/2007 montre que les ressources non renouvelables sont désormais une contrainte forte sur la croissance. D’autre part, les analyses en terme d’empreinte écologique soulignent combien les pays développés ont déjà largement abusé du capital naturel théoriquement à leur disposition. Les économies contemporaines redécouvrent ainsi, au prix de crises écologiques, qu’elles sont soumises à certaines lois tenant à la finitude des ressources naturelles et aux limites de leur régénération (l’humanité emprunterait à la nature chaque année 20 % de ressources renouvelables de plus que les flux annuels de régénération naturelle de ces ressources, selon un calcul du WWF de 1999. Suivant la même source, un américain utiliserait 9,6 hectares soit 5 fois la surface bio-productive disponible par habitant, estimée à 1,9 hectare)
2) Il existe donc un capital naturel critique, qui échappe aux possibilités de substitution et qui doit être préservé pour assurer la pérennité de la croissance. C’est la soutenabilité forte qui semble aujourd’hui s’imposer. Si certains pensent pouvoir garantir une croissance durable en protégeant une partie du capital naturel (bio-diversité, qualité de l’atmosphère), d’autres pensent que seule une décroissance est soutenable. Même si cette durabilité fait l’objet d’appréciations différentes, elle signifie qu’ une contrainte forte s’exercera désormais sur la croissance économique à venir si elle veut préserver le bien être des générations futures.
Transition: Le processus de croissance connaît donc, en plus de la borne que constitue le trend de croissance de long terme («état régulier«), une contrainte beaucoup plus forte exercée par la biosphère. C’est le retour de la limite imposée par le facteur terre, sous une forme renouvelée, dont les classiques avaient déjà souligné l’importance dans la survenue de l’état stationnaire. Pour autant ce processus ne pourrait-il pas être encouragé face au divorce manifeste entre croissance économique, bien-être et progrès social.
III) La croissance économique, en devenant une fin en soi, s’est éloignée du progrès social
Après l’âge d’or des Trente glorieuses où, très clairement, le «plus a été synonyme du mieux« dans les pays développés (A), la divergence entre progrès social et croissance économique est devenue manifeste dans les économies développées et fragilise la religion dont elle fait l’objet (B). La phase de «rendements décroissants« du concept lui-même dans sa capacité à synthétiser le progrès du bien-être humain oblige à chercher ailleurs les nouvelles finalités du développement économique (C) .
A) La croissance économique est, depuis Adam Smith, associée au progrès du bien-être dans une logique du «plus synonyme du mieux«[1]
1) Si l’analyse de Smith semble parfois contradictoire (dans la Théorie des sentiments moraux, il écrit «quant au bien être du corps et à la paix de l’esprit , le mendiant qui se chauffe au soleil au bord de la route possède la sécurité pour laquelle les rois se battent«, 1759), on reconnaît qu’il est à l’origine de ce qui deviendra la «religion de la croissance« par la suite dans une logique où le «plus est synonyme du mieux«. Une large partie de la littérature économique laisse entendre que le bien-être croît avec le revenu réel, tant pour les individus que pour les nations. En micro-économie, la théorie des choix du consommateur postule que la satisfaction de celui-ci est une fonction croissante des quantités consommées. En macro-économie, on admet en général que la consommation, tant privée que publique, détermine le niveau de satisfaction ou de bien-être dont peut jouir la population d’un pays et que l’objectif de croissance économique concerne le bien-être futur des nations. La croissance économique permet de créer des emplois, de dégager les prélèvements nécessaires au financement des biens publics nécessaires à l’amélioration du bien être collectif. Comme le consommateur est réputé insatiable, comme la satisfaction de la populations augmente quand son revenu s’accroît, les gouvernements et les institutions internationales (UE, OCDE) semblent autorisés à placer de manière récurrente la croissance économique au rang de leurs objectifs prioritaires.
2) Les défenseurs de la croissance montrent d’ailleurs qu’elle est facteur développement économique puisque celle-ci tend à réduire les inégalités (au travers d’un processus décrit par la courbe de Kuznets) et que le développement durable serait une «sixième étape de la croissance« dans la logique d’une «Courbe de Kuznets environnementale«. La croissance économique permettrait ainsi à la fois de résoudre les problèmes de répartition («faire croître le gâteau avant de le partager«, «travailler plus pour gagner plus«) et les problèmes environnementaux en donnant aux pays les moyens de mettre en œuvre les activités de dépollution et les recherches nécessaires pour substituer le capital technologique, physique et humain au capital naturel.
3) Il est aussi évident que la situation des pays en développement, pour lesquels le «plus sera encore longtemps synonyme du mieux« (routes, adduction d’eau potable, écoles, hôpitaux) sert de caution à la défense de la croissance des pays développés d’autant plus que la croissance des PED dépend de celle des pays du Nord. C’est oublier que la «satisfaction de vie« dans les pays occidentaux n’augmente plus
B) Tant bien même elle serait infinie, la croissance doit être freinée car le plus a cessé d’être synonyme du mieux dans les pays développés[2]
1) La richesse reste largement relative et, au fil de la croissance économique, les aspirations personnelles sont constamment relevées à la hausse. Ainsi l’allocataire du RMI gagne 10 fois plus que les 2$ par jour qui constituent un des seuils de pauvreté absolue retenus aujourd’hui. Il est pourtant souvent plus «malheureux« que les pauvres des pays en développement. L’effet d’habitude conduit à une élévation permanente du revenu minimum nécessaire pour vivre au fur et à mesure de l’enrichissement si bien que le bien être ne puisse jamais croître avec celui-ci. Ce phénomène est renforcé par les phénomènes d’interdépendance du bien-être et l’analyse des biens positionnels (c-a-d des biens dont la valeur dépend justement du fait que tout le monde ne les a pas et dont le nombre augmente avec l’élévation des niveaux de vie)
2) La richesse n’est pas tout dans le sens où l’individu n’attribue pas uniquement de la valeur à la quantité des biens qu’il consomme. On sait que le PIB ne prend pas en compte de nombreux éléments qui font la qualité de vie (( on peut montrer ici les services domestiques ou bénévoles qui augmentent la satisfaction ainsi que les facteurs liés à la croissance qui dégradent le bien être –inégalités, chômage et dégradation des conditions de travail, dégradation de la santé comme l’hypertension, l’anxiété, le stress, la dépression, le déclin du lien social, l’insécurité, la dégradation de l’environnement bien sûr)
3) On remarquera que, dans la construction de l’IDH, ce rendement décroissant de la croissance du PIB/tête en matière de production du bien-être est déjà intégré puisque, non seulement il ne compte que pour 1/3 dans l’indice global, mais que c’est son logarithme qui est pris en compte dans le calcul de l’indice de PIB/tête (plus il est élevé et moins une même augmentation jour sur l’indice)
C) Le concept de «croissance« est donc aujourd’hui en crise
Il y a très longtemps que les concepts de croissance et de productivité ont fait l’objet de travaux visant à en montrer les limites ou les effets pervers. En 1972, James Tobin et William Nordhaus ( “Is Growth Obsolete ”, in : Economic Growth, NBER-Columbia University Press, 1972) avaient ébauché une critique du concept de croissance sous l’angle de son incapacité à refléter le progrès du bien-être. Ce genre de contestation avait été balayé d’un revers de la main par les économistes et statisticiens, estimant qu’il ne fallait pas confondre un indicateur agrégé de production et un indicateur synthétique de bien-être, ce dernier étant jugé impraticable et sans fondement scientifique. Il est vrai que le bien-être d’une société et son évolution ont peu de chances de pouvoir se résumer à l’usage d’un indicateur unique de «bonheur national brut«. De là à affirmer qu’une évaluation multicritère et pluraliste (incluant certains indicateurs économiques traditionnels) de la qualité du développement social est hors de portée, il n’y a qu’un pas, difficile à franchir. Or ce pas a été allègrement franchi dans le débat public, et de fait les concepts de croissance et de productivité ont contribué à symboliser le progrès de la richesse des nations, bien au-delà de leur contenu scientifique réel ou supposé, en dominant de façon écrasante tous les autres.
Il y a pourtant quelques raisons de penser que les principaux outils de statistique économique constamment mis en avant dans le débat public pour signifier le progrès, «l’expansion«, ou la progression de la «richesse« sont en crise larvée.
1) La critique interne est dans la majorité des cas technique et «réformiste«, en ce sens qu'elle ne remet nullement en question la validité de ces concepts. Bien au contraire, elle vise à mieux les cerner statistiquement. C'est une critique de méthodes qui sont jugées trop frustes pour atteindre les «véritables« valeurs à mesurer, et qui provoqueraient de ce fait des «biais« (surestimation ou sous-estimation de ces vraies valeurs, selon les cas). Mais il n'y aurait aucun doute : ces «véritables« valeurs existent quelque part. Il n'empêche que, en analysant cette quête de rectifications méthodologiques visant notamment à mieux capturer cette bête rétive et fuyante qu'est «l'effet qualité«, en consultant les débats menés au sein de ce courant critique (des débats relancés par l'épineuse question de la mesure de la «nouvelle économie«) et les résultats contradictoires auxquels il parvient, on peut dévoiler des incertitudes plus redoutables que celles qu'il prétend traiter, masquées sous un discours et un appareillage technique toujours plus sophistiqué. Ces incertitudes majeures portent en fait sur les concepts eux-mêmes et sur leur capacité à traduire les nouvelles formes de production de richesses et de performance productive dans le cadre du «post-fordisme« ( cours (rapport Boskin, méthode hédonique)
2) A côté de cette critique interne «modérée« et « réformiste«, on trouve une minorité de critiques internes plus radicales, considérant d'emblée que les incertitudes majeures de ces mesures ne sont pas techniques mais conceptuelles, et qu'elles reflètent le «rendement décroissant« de ces concepts, élaborés pour interpréter la croissance «fordiste« de la production de masse de biens et de services standardisés, mais de plus en plus inadaptés à l'évaluation du développement d'économies de la qualité et de l'innovation, du service, de l'information et de la connaissance, autant de notions qui résistent vigoureusement à leur intégration dans des concepts qui n'ont pas été construits pour les refléter. La fiabilité des données relatives au PIB en termes réels a tendance à diminuer avec l'émergence d'économies de services, et certains doutent même de la possibilité de maintenir à terme « pour une partie de plus en plus importante du PIB, la fiction des calculs en volume ou à prix constants«.
Au total, l'examen de ces deux degrés de critique "interne" méthodologique ou théorique, l'une faible, l'autre forte, conduit à défendre l'hypothèse que le «paradigme« de la croissance et de la productivité est en crise larvée, et que l'examen de ses propres contradictions révèle un besoin : celui d'un paradigme alternatif de l'évaluation socioéconomique et pluraliste des modes de développement, englobant le premier en le relativisant
3) Son dépassement pourrait alors accompagner les mutations d’une économie économe ( montrer ici le rôle des services dans l’amélioration des états –«outcomes«-, dans la réduction de l’empreinte écologique de la croissance et dans la possibilité de maintenir une augmentation de l’activité et de l’emploi puis la limitation de la croissance dans son objet, dans l’espace et dans le temps éventuellement.
Conclusion: La croissance dans les pays développés semble en partie assurée même si le retour aux 30 Glorieuses paraît compromis. Cet âge d’or ne doit pas être d’ailleurs hypostasié puisque ses contemporains ne l’ont jamais vécu ainsi et qu’il suivait une phase longue de perturbations exceptionnelle des économies et des sociétés. Il faut aussi se souvenir que cette croissance fût énergophage, gaspilleuse, source de traumatismes sociaux (aliénation du travail), d’inégalités internationales et destructrice de l’environnement.
L’enjeu est donc ailleurs: dans une croissance plus qualitative que nos indicateurs traditionnels paraissent de plus en plus incapables d’appréhender et dans une croissance soutenable, préservant les capacités des générations futures à satisfaire leurs besoins dans les meilleures conditions et luttant contre les phénomènes d’exclusion sociale. L’état stationnaire pourrait être la marque de la sagesse des hommes, rompant définitivement l’assimilation du progrès social et du bonheur à la croissance économique, le fruit d’une décision politique et non d’un quelconque déterminisme naturel. Sagesse qu’avait déjà John Stuart Mill lorsqu’il écrivait en 1848: «il n’est pas nécessaire de faire observer que l’état stationnaire de la population et de la richesse n’implique pas l’immobilité du progrès humain. Il resterait autant d’espace que jamais pour toute sorte de culture morale et de progrès moraux ou sociaux; autant de place pour améliorer l’art de vivre et plus de probabilité de le voir amélioré lorsque les âmes cesseraient d’être remplies du soin d’acquérir des richesses«.
-----------------------
[1] Cette partie doit beaucoup à l’article d’Isabelle Cassiers et Catherine Delain, «La croissance économique ne fait pas le bonheur : les économistes le savent-ils ?«, Regards économiques, n°38, 2006
[2] idem
Liens utiles
- L'homme est un pont, non une fin. Nietzsche.
- Le théâtre a-t-il pour fonction de tout dire, de tout expliquer au spectateur de la crise que vivent les personnages? - Par quels moyens et quelles fonctions Juste la Fin du monde est une pièce qui nous retrace la crise de cette famille?
- la fin justifie les moyens
- L'EUROPE DE L'OUEST EN CONSTRUCTION JUSQU'A LA FIN DES ANNÉES 1980
- Effets de la migration internationale sur la croissance économique