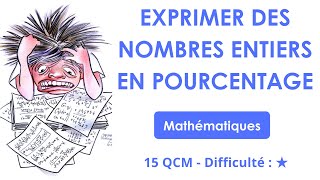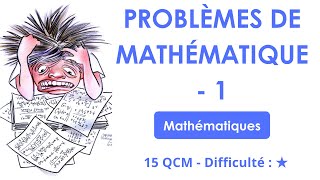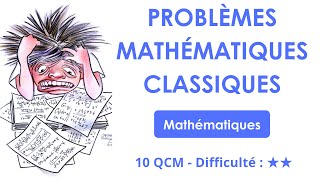L'Essence Du Théâtre
Publié le 16/10/2010
Extrait du document
Tandis que Louis JOUVET écrit : « L’essentiel d’une ' uvre dramatique, c’est le texte. Tout l’art du comédien est un art de dire », Antonin ARTAUD définit ainsi les remèdes à apporter à la crise du théâtre : « Le théâtre, art indépendant et autonome, se doit pour ressusciter ou simplement pour vivre, de bien marquer ce qui le différencie d’avec le texte, d’avec la parole pure, d’avec la littérature et tous les autres moyens écrits et fixés. »
En confrontant ces deux opinions, vous tenterez, à l’aide d’exemples précis, de définir ce qui constitue à vos yeux l’essence du théâtre.
Bousculant la normalité d’un petit village, un spectre étrange vient, dans Intermezzo, la pièce de Giraudoux, mettre « toute la morale bourgeoise cul par-dessus tête. » Il constitue peut-être une métaphore du théâtre, dans la mesure où, comme un intermède, un accident au c' ur du quotidien, le théâtre nous offre un divertissement voulu. L’acte de lire une pièce ou de se rendre à une représentation théâtrale est toujours volontaire, voire prémédité ' comme un assassinat du réel. Nous soulignons déjà l’apparente dichotomie entre le texte et la représentation du théâtre, à laquelle chaque représentation et chaque auteur cherchent à répondre. Différentes conceptions du théâtre peuvent alors entrer en opposition. Ainsi, tandis que Louis Jouvet écrit : « L’essentiel d’une ' uvre dramatique, c’est le texte. Tout l’art du comédien est un art de dire », Antonin Artaud définit ainsi les remèdes à apporter à la crise du théâtre : « Le théâtre, art indépendant et autonome, se doit pour ressusciter ou simplement pour vivre, de bien marquer ce qui le différencie d’avec le texte, d’avec la parole pure, d’avec la littérature et tous les autres moyens écrits et fixés. » Mais alors, l’essence du théâtre se trouve-t-elle dans l’art de dire un texte que met en ' uvre le comédien, ou dans une prise de distance avec le texte et la littérature? D’abord, considérons, avec Jouvet, que le texte constitue le plus important dans l’' uvre dramatique, d’une part, et que le comédien ne met en ' uvre qu’un art de dire, d’autre part. Ensuite, nous soulignerons les limites d’une telle perception, et tâcherons avec Artaud d’« en finir avec le théâtre de texte ». Enfin, nous rechercherons le par-delà de ces opinions, en nous demandant si l’essence du théâtre ne se trouverait pas plutôt dans une liturgie poétique.
D'abord, le théâtre serait essentiellement constitué par le dire d’un texte, fondement du théâtre, par un comédien, qui mettrait en ' uvre un art de dire ce texte.
D’une part, le théâtre serait avant tout une ' uvre dramatique, dans le sens d’une création littéraire appartenant à un genre, le genre dramatique. L’on peut dans cette mesure lire un texte de théâtre, pour soi, en tant que lecteur, comme on le pourrait faire d’un roman. En tant que tout, le texte dramatique prend sens par la simple lecture, mettant en ' uvre le même pouvoir du lecteur, à savoir donner une existence éphémère aux personnages et évènements constitutifs d’un texte romanesque. Se pose alors la question d’une ' uvre dénommée pièce, c’est-à-dire revêtue de certaines caractéristiques propres au genre théâtral et la différenciant d’un texte romanesque. C’est dans cette mesure qu’intervient le problème de l’écriture théâtrale elle-même, et de ses particularités. En effet, cette écriture est double : d’une part, elle est la transcription de dialogues entre les personnages, d’autre part, elle comporte un certain nombre de didascalies. Ces dernières sont, certes, des indications scéniques, concernant un jeu éventuel, elles marquent la présence d’un auteur omnipotent qui règle tout. Elles donnent aussi sens et précision à des situations qui, uniquement couchées sur le papier, prennent ainsi chez le lecteur un certain relief. Par ailleurs, le langage dramatique se caractérise par l’absence de récit, autrement dit par une négation relative du diégétique comme paratexte, et l’inscription dans un autre mode d’écriture. L’action se met en place sans qu’il soit besoin d’indications supplémentaires, le personnage se présente lui-même dans l’élan même de son action. C’est l’événement et le texte dialogué qui donnent forme aux personnages de théâtre ; la force et l’identité sont crées par la parole, allégées par l’écriture dramatique, plus souples et vivantes, bien qu’elles fassent partie d’un texte. Et même, si un personnage fait un récit ou une description dans sa réplique, nous avons là à faire à une mise en abyme plutôt qu’à un extrait de récit. Se pose alors, dans la mesure où le texte semble disposer d’une certaine indépendance et d’une existence en soi comme théâtre, d’une pièce qui ne serait absolument pas jouée et uniquement destinée à la lecture. C’est l’idée d’une pièce injouable, que l’on ne pourrait que lire, comme une vaste aventure dialoguée. Prenons par exemple le cas de Lorenzaccio, de Musset. La complexité de la structure, la multiplicité des personnages ont fait que cette pièce est réputée injouable, avec ses trente-huit scènes et d’incessants changements de décor : elle est, paradoxalement, un « spectacle dans un fauteuil » qui ne se destine pas à la représentation, mais prend le statut d’une pièce à lire, où le texte est l’essentiel. C’est-à-dire qu’un manuscrit revêt un caractère quasi sacré dans le sens où la parole de l’auteur est fixée, imprimée, élevée à un statut de Tout cohérent, voulu, maîtrisé, abouti, presque immuable. En outre, nous devons souligner que le texte de théâtre est soumis à la lecture, mais également à la critique et à l’analyse, ce qui en fait bien un objet littéraire. Cet objet a une certaine indépendance, celle qui laisse le choix de l’imaginaire, parfois même à travers l’imprécision de l’auteur, et c’est ce flou que la représentation vient dissiper, ôtant peut-être une part de sens à l’' uvre. D’ailleurs, cette représentation impose une certaine vision du texte, elle tente de transcrire ce qui est écrit en une pièce que l’on représente, au risque de la trahir, ou de la figer dans une certaine interprétation. Le texte apparaît en lui-même, nous l’avons dit, et il est donc un objet parfaitement intelligible, qui peut faire appel au raisonnement et à l’intellect, sans qu’il faille se sentir obligé de lui donner une dimension sensible, qu’il ne contient et n’appelle pas obligatoirement. Ainsi, il semble bien que le texte soit, dans une certaine mesure, l’essentiel de l’' uvre dramatique.
D’autre part, si la pièce devait sortir de son simple statut de texte, et être montée sur scène, l’art du comédien ne serait, pour Jouvet, qu’un art de dire. En effet, l’on pourrait concevoir, à l’instar de d’Aubignac, qu’ « au théâtre, parler, c’est agir » Nous retrouvons ici une conception occidentale fortement ancrée de la Parole et du pouvoir de création de cette dernière. C’est le Verbe qui s’incarne et donne naissance à la civilisation chrétienne, héritière des valeurs grecques antiques (aux temps du développement des premières formes de théâtre) Le théâtre est une occasion, à travers les Mystères médiévaux, de faire accéder intensément un public populaire à la découverte des Ecritures. C’est donc que la valeur de la parole prononcée n’est plus à prouver, et que le dire joue un rôle primordial au théâtre. Ainsi, l’action se fait au théâtre par la parole, puisque le texte lui-même donne naissance à l’événement, il l’accompagne ou le commente. Il y là comme une hypertrophie de la parole, puisque le discours est équivalent à l’action et presque la constitue : le comédien doit donc mettre en ' uvre un véritable « art de dire » C’est ce dernier qui incarne paradoxalement les mots qu’il prononce, qui leur donne une résonance nouvelle face au spectateur, qui est également auditeur. Par ailleurs, le théâtre, qui garda longtemps sa forme versifiée, est un genre de littérature orale, qui doit, aux origines, être véhiculée par la mémoire pour se diffuser. Il est un genre déclamatoire, et c’est peut-être là que se trouve pour le comédien l’ « art de dire le texte » Un rythme imposé comme celui de l’alexandrin ôte, évidemment, tout naturel à la parole. En ce sens, le théâtre se trouve à mi-chemin entre le dit et l’écrit, puisqu’il doit avoir la perfection de la langue écrite, dans sa beauté, son travail, son élégance, son aboutissement non-spontané, et, en même temps, donner vie, une vie crédible et vraisemblable face au spectateur. La recherche formelle risque dans ce cas d’imposer sa primauté sur le sentiment que l’on veut exprimer. Pourtant, une ' uvre comme Phèdre, de Racine, est véritablement chargée en tension dramatique, elle constitue l’essence de la tragédie, la haute expression du théâtre, celle qui inspire terreur et pitié. C’est donc que la qualité formelle, ce que l’on pourrait prendre pour un enfermement, est en vérité une libération du sens, une apothéose de l’expression sincère et poétique, au plus près des passions humaines sublimées. La maîtrise des mots que met en ' uvre l’auteur doit être reprise par le comédien, qui doit montrer la même maîtrise des mots, de son propre corps, pour mettre en relief non lui-même, mais le texte, dans un souci constant d’éviter toute exhibition. Bien déclamer un alexandrin, avec ce que cela suppose comme virtuosité pour les diérèses et les exigences formelles, c’est en fait libérer la parole théâtrale. Le naturel est perdu au profit d’une sorte de chant, qui triche presque avec le langage quotidien par les exigences nouvelles du rythme de l’alexandrin, forcément artificiel. La fascination du spectateur est également considérable : l’alexandrin exerce, par sa perfection, son ampleur majestueuse, un pouvoir essentiel, presque celui de la musique. Ce qui semble indicible, c’est-à-dire tout l’effroi et la fascination que nous inspirent des passions humaines pleinement déversées sur le monde, est contenu, tendu dans douze syllabes incomparables. L’on s’efforce de faire tenir dans ce carcan une puissance infinie, plus qu’humaine, parfaitement indécente et impossible à montrer sur scène.
Mais toutes ces passions sont l’objet d’une condamnation, ce qui explique que l’on exige de l’acteur d’exercer un art de dire là où le jeu n’est pas envisageable pour des questions de bienséance et de maîtrise du monde, exigences tout à fait classiques. Platon, déjà, au livre III de La République, demande que l’on chasse poètes et acteurs de la cité, parce qu’ils proposent des modèles immoraux, que le peuple imiterait naturellement. C’est donc ici la séduction qu’exerce le jeu de théâtre qui est condamnée, et cette condamnation prend un caractère plus fort encore lorsqu’elle est le fait des jansénistes. Ces derniers considèrent que l’acteur doit ressentir certaines des passions qu’exprime le texte pour les bien représenter. Cette violence des passions ne peut évidemment trouver sa place dans une société qui recherche la dévotion à une divinité transcendante, puisque le théâtre est avant tout le lieu des passions humaines, dans leur dimension certes élevée, surhumaine, mais pas forcément divine, uniquement égoïste, déversant son flot d’amour et de haine, de désespoir et de vertu. Ainsi, l’on peut se demander qu’elle doit être l’attitude du comédien lors de la représentation. Doit-il mettre en ' uvre un « art de dire » ou ressentir le texte, être imprégné des passions et des conflits mis en scène au point de les assimiler et d’en restituer presque sincèrement, par imitation, authentiquement, leur force et leur puissance ? L’acteur applique un art de bien dire, l’art d’être un bon comédien, c’est-à-dire non pas d’imiter la nature, puisque nous avons dit que le texte dramatique revêt un caractère artificiel, mais de se conformer au modèle idéal que l’auteur veut voir représenté. C’est dans ce sens que Diderot, dans Le Paradoxe sur le Comédien, expose le travail que le comédien doit faire sur les propres effets de son jeu : il doit l’analyser, donc lui ôter tout caractère authentiquement passionné pour parvenir un jeu qui transmettra l’impression de sincérité. Il s’agirait de se dépouiller de soi pour entrer avec maîtrise dans le jeu d’un personnage contrôlé. L’acteur est donc pleinement conscient à la fois de son identité et de celle du rôle qu’il doit jouer : l’on ne lui demande pas de sensibilité, mais un art de dire. Si nous revenons à notre idée d’un jeu qui corrompt, et qui pour cette raison est condamné, nous pouvons cependant soutenir que l’art de dire reste un art, et le comédien un artiste, c’est-à-dire qu’il fait appel à un sens esthétique qui tient du génie. Aussi, cet art de dire pourrait dans ce sens se rapprocher d’un art du chant, celui de l’aria, de la complainte, de la tirade chantée, d’un psaume que l’on déclame, d’un art de la voix, d’une qualité mystérieuse mais travaillée. La beauté de la voix, le sublime du dire, viennent encore renforcer le sublime du texte, et le tout devient authentiquement création, grâce à l’acteur dont les accents magnifient encore un texte en l’offrant à entendre, et non plus seulement à lire. Cet art de dire est une vraie puissance, puisqu’il donne naissance non seulement aux sentiments et réactions du lecteur et du spectateur-auditeur, mais encore et surtout au drame lui-même. Nous pourrions aussi évoquer, pour aller plus loin dans l’idée d’un texte comme fondement du théâtre, avec le cas du théâtre dit engagé, c’est-à-dire par exemple une pièce comme Nekrassov, de Sartre. Tout le développement dramatique n’est pas articulé autour d’un intérêt premier pour le théâtre comme l’entend Artaud, mais comme une pièce éminemment didactique, presque politique, dans le sens où elle interroge l’homme dans ses valeurs. Ici, la signification de la pièce n’est pas à trouver dans la représentation d’un drame, mais bien dans un drame comme prétexte littéraire pour développer certaines thèses, celles de la philosophie existentialiste. L’on pourra cependant objecter à cela qu’un théâtre ainsi politique, qui se veut donc ouvertement subversif et dérangeant l’ordre établi, fait plutôt ' uvre de pamphlet ou d’essai déguisé, sous le masque du théâtre. Le texte jouera ici le rôle fondamental, car porter l’' uvre au théâtre c’est en fait exposer des idées sous une certaine forme, sans forcément de soucier du théâtre pour lui-même, en le considérant donc comme un moyen plutôt qu’en tant que fin en soi.
Donc, nous pouvons aller dans le sens de Louis Jouvet dans la mesure où le texte est important pour l’' uvre dramatique — mais en constitue-t-il l’essentiel ? — et où l’art du comédien a à voir avec un art de dire — mais ne s’arrête peut-être pas là.
Ensuite, nous pouvons nous demander si le théâtre dans sa plénitude ne serait pas composé plutôt non seulement du caractère dual que nous avons évoqué, mais encore s’il ne faudrait pas, avec Artaud, en finir avec le théâtre de littérature.
Voyons quelle pourrait être cette définition du théâtre dans sa dualité. Si l’' uvre dramatique ne devait exister qu’en tant que genre littéraire, elle n’aurait pas, pour prendre pleinement sens, à être représentée, c’est-à-dire à être jouée, devant un public, par des acteurs, sur un lieu particulier : la scène. Artaud fustige justement la tendance, néfaste, qu’a le théâtre à rester enclos dans le champ du texte, éventuellement dans celui du dire. Quelle peut être cette crise du théâtre qu’il souhaite circonscrire ? Nous avons vu que l’art du comédien pouvait être un art de dire. Mais il se trouve un moment, justement, où le comédien est dans l’impossibilité stricte de dire : il n’en a plus la capacité, car la parole ne prend plus sens, les mots ne portent plus rien, ils sont parfaitement déconstruits parce que leurs valeurs sont des valeurs mortes avec la première moitié du xxème siècle. C’est ainsi que Samuel Beckett, dans En attendant Godot, met dans la bouche de Vladimir et d’Estragon des expressions toutes faites, qui ne veulent rien dire, accompagnent une pensée insignifiante : « C’est fatal », « C’est forcé », « C’est normal » Revenons donc à une vision plus pragmatique du théâtre, qui tienne compte de son histoire, et nous verrons alors que le théâtre, dans une dimension considérable, est lié à la représentation, autrement dit au fait d’établir sur un lieu théâtral une relation de nature multiple (entre les comédiens entre eux, les spectateurs avec les comédiens) au c' ur d’un double conflit : celui du n' ud de l’action dramatique, et celui se jouant des deux côtés de l’écran que compose la scène entre acteurs et public. Le théâtre est un lieu d’architecture et un lieu de l’action dramatique, où se joue, dans une exposition unique, une vision vivante d’un texte. L’étymologie même nous ramène à cette source d’un théâtre fait pour jouer. En effet, théâtre vient du grec theatron, du verbe theomai, voir. L’aspect visuel est encore souligné dans spectacle, issu du latin species : apparence extérieure. C’est dire si le théâtre se rapporte essentiellement au visuel, plutôt qu’au texte, et fait appel à un spectacle. C’est d’ailleurs ce goût que le public a pour le spectacle qui permet des mises en scène justement spectaculaires, miroirs fantasmés d’une réalité transcendée. Ainsi, le théâtre est une affaire de gens sensibles, impressionnables, dans le sens d’humains, c’est-à-dire jamais libérés des passions, ayant besoin d’une violence épidémique, qui se répand comme dans un rêve sur la scène. Le théâtre de la cruauté qu’Antonin Artaud appelle de ses v' ux dans Le théâtre et son double, c’est justement cela. Le théâtre, dit-il, est comme la peste, puisqu’il bouleverse les collectivités : il est comme un incendie, un exorcisme général qui vient briser tous les carcans. Il pousse à une révolte virtuelle, il incite au crime, à l’héroïsme et à l’exaltation. La scène, en tant que lieu physique, ne peut être remplie seulement de mots, il lui faut de la puissance, de la poésie, de la mise en scène. La parole théâtrale ne saurait donc être seulement la parole prononcée par l’acteur qui récite son texte et qui donne la réplique d’un dramaturge conscient de sa création, elle est plutôt l’expression, par toutes les formes autres que la littérature, qui fige et finalement fait mourir, mais elle demande un spectacle total (avec des machines et des lumières, des sons) où les mots sont des incantations, pour un théâtre où « la sauvagerie, les chimères, le cannibalisme se débondent » Et de voir tout cela procure au spectateur un intense frisson d’effroi, une crainte chargée d’espérances inavouables, une élévation qui le conduit en un soi qu’il ne peut voir avec ses yeux de personnage social. C’est seulement en s’éloignant de la littérature que le théâtre pourra ainsi recouvrer son essence et survivre, lui qui est miné par les tentatives de théâtre psychologique, qui brisent l’élan vital d’un art autonome et absolu. La musique spectrale, les techniques d’élécro-acoustiques qu’utilise la création contemporaine, comme Xu Yi avec son « Plein du Vide », rejoignent un peu cet univers onirique et déroutant, où le son recouvre l’ensemble de l’espace, où les couches tonales enveloppent l’auditeur de toutes parts, les sons d’origine électronique se mêlant à ceux des instruments ont une fonction de spatialisation. Le théâtre vient, plus qu’à travers la parole, envahir l’espace scénique, envahir le spectateur, prendre d’assaut l’univers entier dans la profondeur de ses mystères.
Pour que s’exprime cette sauvagerie, cette totalité du théâtre tel que le conçoit Artaud, il faut que le théâtre « marque ce qui le distingue du texte », c’est-à-dire les éléments de la représentation, tout ce qui apparaît sur scène et dont le surgissement est inexprimable dans la littérature. Ce terme de littérature contient d’ailleurs comme une tonalité de mépris, pour ce qui serait écrit, donc fixé, figé, poussiéreux presque car jamais remis en mouvement, tout élan, tout dynamisme étant mort une fois l’ouvrage imprimé. La mise en scène au théâtre doit alors être particulièrement impressionnante, magnifique et sublime, parce qu’elle est le reflet face au public de ses attentes les plus humaines, les plus viscérales, les plus inavouables, bestiales et inexprimables : celles qui concernent la force des sens et les pulsions spontanées. Dans cette mesure, retrouver l’habitude des masques antiques permet de s’approcher au plus près de l’espace du théâtre. L’acteur, chaussé de cothurnes, le visage couvert d’un masque surdimensionné, monté sur des échasses, portant des bras articulés, est une bête, un monstre, une machine, un être enfin qui cristallise en lui tous les désirs du spectateur, tous les désirs de l’homme. Il devient créature, fantasme vivant, étrangeté exposée et finalement médium entre les dieux et le spectateur, entre Dionysos et les participants d’un banquet pleinement abouti. La représentation prend alors son caractère foncièrement théâtral, sa puissance de dire par elle-même, comme un tout. Il s’en dégage une solennité qui marque que le théâtre est un hors-du-monde, un autre lieu, un ailleurs dans la ville, une fresque baroque au sein d’une cité trop policée, dont les citoyens muets étouffent et meurent. L’essence du théâtre ne saurait alors se trouver dans le seul texte, qui n’est que littérature, mais elle est dans la représentation, dans ce qu’Artaud appelle « une expression dynamique de l’espace », dans une « agitation poétique des forces vives » Le goût du spectateur est ici comblé dans un frisson imperceptible : tous ses désirs et ses angoisses, présentés sur scène, dans une transmutation glorieuse, pour quelques heures d’une représentation unique, avec des acteurs qui réinventent le théâtre sous nos yeux, dans la maîtrise de leurs corps démesurément agrandis, dans la démesure même, enfin, dans la bestialité d’une représentation, dans le cannibalisme en public, dans une dévoration éphémère, une libération des démons de nos âmes et des attentes de notre humanité déchaînée. Ce goût du sang, cette excitation morbide face au drame, tout cela ne peut être comblé par un simple art de dire, il faut au moins un spectacle total pour le satisfaire. Il faut créer pour cela un langage unique et total, « à mi-chemin entre le texte et la pensée » L’espace théâtral jouera ici tout son rôle : la parole, l’acte et le décor sont intimement liés pour participer et procéder de l’essence du théâtre. En effet, ils sont en interaction constante, dans un univers proprement théâtral. Que l’on pense, par exemple, à la pièce de Ionesco, Le Roi se meurt. Alors que le roi Béranger croyait avoir le temps de vivre encore des siècles avant de mourir, tout son royaume (la scène se passe dans la salle du trône), devient cancer, désagrégation, agonie : il est parfaitement impuissant face à un ordre du monde monstrueux, gangrené, en pleine déliquescence, dans un envahissement de l’absurde qui l’empêche de commander aux étoiles. Tandis que le roi perd sa puissance, tout l’univers s’écroule autour de lui, tout s’éteint, tout se consume, rien ne vaut plus. La parole en est réduite à l’impuissance, au bégaiement, à l’onomatopée. La sénilité guette un monde en ruine qui s’écroule sous nos yeux, tandis que le roi prend conscience de sa déchéance, de son impossibilité d’agir encore sur quoi que ce soit, alors qu’il le voudrait tant.
Les accessoires jouent eux-mêmes, bien qu’immobiles, un rôle dans cette mise en scène. Les objets, là où la parole de l’acteur est caduque, envahissent l’espace et partent à l’assaut de la scène. Dans Les Chaises, de Ionesco, les petits vieux apportent avec une frénésie croissante des dizaines de chaises sur la scène, et l’on a presque l’impression, comme le souligne une didascalie, que « les chaises jouent toutes seules. » C’est-à-dire que la matière exerce sa supériorité sur la simple parole qui ne peut plus tenir son rôle. Par ailleurs, là où la parole pure, ce théâtre de littérature que dénonce Artaud, ne peut plus avoir cours, c’est le corps qui peut exercer un rôle prépondérant. Comme nous l’avons vu, les masques grimaçants, les coiffures gigantesques, tout ce qui transforme l’homme-comédien pour en faire le comédien total, sont une métamorphose du corps. Et plus encore, cette métamorphose peut être l’objet du théâtre, parce que l’art (par exemple à travers le développement du « body art ») a ôté tous les mystères du corps, il est exhibition dans nos sociétés post-modernes. Aussi, ce corps de l’acteur est en soi un moyen d’expression, à théâtre de muscles, d’os, de chair et de sang. Plus que la voix, tout est mouvement, tout est dynamisme vivant, tout est expression forte de l’être. Cette métamorphose du corps est particulièrement criante dans Rhinocéros, de Ionesco : à la fin de la pièce, alors que tous les habitants ont subi la métamorphose, Béranger en vient à trouver son corps d’homme lourd, laid, hideux en comparaison de « la peau lisse et sans poils » des animaux. C’est que, puisque le monde change, le corps et les références humaines normées n’ont plus cours. Le corps lui-même est mise en scène, et l’on se rapprocherait presque d’un spectacle muet effrayant, une pantomime monstrueuse, où des machines à formes humaines apparaissent sur scène, comme le surgissement d’un ailleurs absurde qui pourtant prend sens dans la déréliction d’un acteur, d’un metteur en scène qui ne savent plus quoi dire. D’ailleurs, nous avons réfuté que l’art du comédien soit uniquement un art de dire, puisqu’il est plutôt un art de jouer, mais ce jeu ne peut se faire seul, c’est-à-dire sans direction. C’est là qu’intervient le metteur en scène : il donne, comme acteur de la représentation, acteur extérieur au sens d’agissant pour qu’ait lieu la représentation, le sens à suivre pour donner une interprétation du texte, une vision de l’' uvre. Mais cela ne signifie pas que le comédien ne puisse plus être également acteur de son propre jeu : la part d’improvisation, et même la création totale en cours de jeu se développent dans l’art contemporain, dans un art où l’apparence de spontanéité couvre cependant parfois la préparation minutieuse d’un mouvement du dire par le corps. Ici, le théâtre se rapproche presque de la danse, du ballet. Le genre n’est pas forcément éminemment solennel ou sérieux, chargé d’une tension dramatique mystique et insoutenable, puisque le premier acte du Tartuffe de Molière s’ouvre sur ce genre de chorégraphie. En outre, nous devons définir au-delà de cela, ce qui constitue la contradiction principale entre le texte dramatique en tant que tel et la représentation, qui à eux deux nous permettront peut-être d’approcher une définition de l’essence du théâtre. C’est-à-dire que le texte en soi n’est rien, parce qu’il ne dispose pas des éléments que nous avons évoqués, et qui constituent véritablement, comme un tout, la théâtralité, que Barthes défini dans ses Essais critiques comme « le théâtre moins le texte » C’est à partir de cela que doit s’articuler la réflexion sur un théâtre authentique, qui s’éloigne de plus en plus de tout autre genre littéraire. Barthes souligne ainsi, dans « Le théâtre de Baudelaire », que les schémas que le poète nous a laissé de ces tentatives de création dramatique ne satisfont pas au genre théâtral, puisqu’ils essaient toujours se justifier eux-mêmes, de se donner sens par les artifices de lumière et de ce qui pourrait passer pour des détails scéniques, alors qu’il s’agit d’Idées tout à fait dans le ton de l’' uvre baudelairienne, qui est essentiellement poétique et ne peut se vouloir avec succès théâtrale. C’est donc que le genre théâtre ne saurait se limiter à un genre littéraire, qui serait celui du drame. Il existe bien en tant qu’art autonome, c’est-à-dire qui obéit à ses propres lois, qui n’ont rien à voir avec la littérature, mais également indépendant, en ce sens qu’il est total pour lui-même et se recouvre entièrement de sa valeur intrinsèque.
Ainsi, il semble que la proposition d’Artaud ait un caractère plus pertinent, plus humain aussi, quant à la vision du théâtre qu’elle présente, comme un art en soi qui est tout autre que le texte.
Enfin, demandons-nous dans quelle mesure une définition de l’essence du théâtre serait possible dans un par-delà de ces définitions antagonistes, en considérant que le théâtre serait un art certes en danger, mais capable de se renouveler en tant que liturgie poétique.
D’une part, nous devons nous interroger sur cette crise même qui touche, selon Artaud, le théâtre. Nous avons ébauché une explication en nous interrogeant sur l’incapacité que l’acteur éprouve à parler, son impuissance à dire le texte. Cette impuissance est l’écho du mal qui frappe toute la littérature et la pensée qui croyait faire partie de la « civilisation », depuis les massacres et les guerres qui frappent le xxème siècle. Il se développe alors un anti-théâtre, qui prend le contre-pied des valeurs que l’on accordait communément à cet art auparavant. Ainsi, l’absurde même permet au théâtre de survivre et de se recréer. Il s’agit de procéder à un aggiornamento du genre dramatique, en reprenant son nom, théâtre, et en insufflant à l’intérieur même de l’' uvre la contestation du genre théâtral. Une pièce comme La Leçon, de Ionesco, avec le meurtre absurde de l’élève compulsivement répété par le professeur, ne fait pas appel à des choses compréhensibles, mais bien à un symbole ou même plutôt à un silence face à l’absurde qui nous déroute. La pièce se déroule dans un environnement connu, codifié, une sorte de cadre bourgeois, parfaitement banal et ordinaire. Et c’est pourtant dans ce cadre que surgit l’impossible et l’irréel pourtant représenté en chair et en os, par des comédiens qui nous déroutent d’autant plus qu’ils semblent sérieux dans le non-sens de leur propos. Aussi, le théâtre s’éloigne ici vraiment de « tous les moyens écrits et fixés » habituellement dans la mesure où il devient insulte à la rationalité et provocation face à l’ordre tranquille. La puissance du théâtre ne se trouve alors pas forcément dans l’établissement d’un cadre étrange, sombre et angoissant par lui-même, volontairement affecté, mais par une infection de l’absurde, celle qui effraie et finalement fascine au plus haut point, c’est-à-dire celle qui montre le surgissement dans notre quotidien de l’expression d’un absurde que nous ressentons, comme si tout se valait et donc ne valait rien. Les comédiens vont donc littéralement « meubler la conversation » comme on meuble la scène, parce qu’ils ne sont que des machines reproduisant à l’infini leur cycle improbable. Cette dimension cyclique est peut-être essentielle au théâtre. En effet, les siècles précédents nous ont habitué à un dénouement, c’est-à-dire à une résolution du n' ud, du conflit dramatique qui motive la pièce. Pourtant, l’impossibilité de dire trouve comme écho l’impossibilité de conclure, l’incapacité à résoudre, et donc la répétition perpétuelle d’une même scène. C’est ce qui se produit dans La Cantatrice chauve, de Ionesco, lorsque, à la fin de la pièce, les Smith échangent leur place avec les Martin, et que l’ensemble recommence, avec les mêmes propos d’une effrayante banalité. Pourtant, ces phrases toutes faites que l’on « sert » à ses invités comme on leur sert le thé, machinalement, nous font rire : c’est que nous n’en sentons pas peut-être toute la compulsion morbide qui s’en dégage. Alors, puisqu’il ne peut plus aller de l’avant, qu’il est paralysé dans les mots et dans la vacuité du dire, le théâtre parvient encore à nous faire rire. Mais il ne s’agit plus là, sans doute, du rire comique de la satire légère, mais d’un rire désespéré, profondément tragique. Ce rire de fou, réponse au monde, écho d’un rien qui ne veut même plus se laisser nommer, est peut-être ce qui tend l’acteur, comme un arc, de tout son corps ployé vers le propre vide de son âme, de celle des spectateurs. C’est donc ce rire qui est créateur, qui devient théâtre, instrument et fin de la représentation. C’est donc le réel demande à être réinventé et imaginé de nouveau dans le théâtre, sur la scène même, au-delà du simple texte. Ce texte, pourtant, peut contenir en lui toute la poésie d’une sorte de méta-langage, la beauté touchante et naïve d’un mot qui n’est pas suivi d’un effet. Chez Ionesco, de même que Béranger dans Le Roi se meurt a beau donner des ordres aux étoiles, elles ne bougent, le petit vieux des Chaises dit à sa femme : « Bois ton thé, Sémiramis » ; et Ionesco d’ajouter en didascalie : « il n’y a pas de thé, évidemment » Un mot sans effet, c’est une parole sans monde, un Verbe sans Création, un échec plein de néant, le soubresaut d’un mort.
D’autre part, l’essence du théâtre, en équilibre précaire entre dire et faire, entre texte et scène, trouve peut-être une synthèse de sa définition dans la liturgie théâtrale. Littéralement, la liturgie est le culte rendu devant le peuple : le théâtre se joue souvent dans une salle, dans un lieu d’architecture qui porte le même nom qu’un genre. Une chapelle, une salle de spectacle, deux lieux de silence, de recueillement, d’hors-le-monde. Des gestes, accomplis mille fois, avec toujours la même force et la même fraîcheur, la même intensité. Les mêmes mots, sacrés, répétés par des milliers de prêtres ; le même texte dramatique, modulé mille fois par des milliers de comédiens. Les origines du théâtre mêmes sont d’ordre religieux, elles ont à voir avec le culte de Dionysos, le dieu de l’ivresse, avec les fêtes sacrées. Le fait de porter un costume fait également parti d’un cérémonial théâtral. Ainsi, l’on peut parler chez Jean Genet, du travestissement en tant que cérémonial de théâtre : les deux s' urs, dans Les Bonnes, portent les vêtements de leur maîtresse, pour occuper un temps un autre rôle que le leur, pour se perdre dans ce qu’elles ne peuvent pas être. La chose est plus frappante encore dans Le Balcon. Celui qui était déguisé en évêque pour sa « séance » dans la « maison des rêves » (c’est-à-dire un « bordel de l’imaginaire », exutoire des fantasmes et vaste salle de théâtre), veut se rhabiller tout seul, pour garder encore quelques instants la torpeur de son rêve, le plaisir qu’il a tiré à être physiquement l’Evêque, à porter, comme un paradigme, la mitre et l’habit, à devenir Figure, Idée, reflet d’un type. Le lieu, le costume, sont autant de parallèles à la liturgie. La comparaison que nous établissons entre théâtre et liturgie est à prendre avec les précautions et réserves qui s’imposent, elle est une piste de réflexion. Mais plus encore, le schéma de déroulement que suit une pièce classique : les trois coups frappés réclamant le silence, le lever de rideau, l’entrée en scène (la procession d’entrée), le n' ud dramatique, les péripéties, le point de tension suprême (l’Elévation), le dénouement, le rideau qui tombe, les gens qui sortent et commentent (l’Envoi) Aller voir une pièce de théâtre, c’est participer charnellement à une Eucharistie esthétique, c’est communier au corps et au sang du comédien, c’est s’abreuver à la source du texte dit et vécu, tant l’âme est assoiffée. C’est prendre sens dans le noir, au milieu de la foule, dans un lieu sacré, un lieu que l’on visite, que l’on attend de ressentir et d’annoncer. Le théâtre, avec ses rites et la variété de ses formes d’Adoration de l’art, est une Messe, un banquet de puissance, un moment de sacré, un gouffre lumineux dans lequel l’âme, fascinée, épuisée, joyeuse, s’abandonne. L’acteur est le servant d’autel, le metteur en scène un célébrant invisible et dont la trace pourtant se sent partout, pour une même foule, prête à entendre, psalmodiée sur tous les tons, l’antique liturgie des hommes, l’histoire immuable des passions, des surgissements, des apaisements de l’âme. Une même Ecriture, un texte figé en apparence, qui pourtant dans la bouche du comédien et dans son corps tout entier, mais aussi dans chaque c' ur et dans chaque instrument, prend des accents sans cesse nouveaux et toujours chargés de la même force. Le spectateur ressort, épuisé d’avoir participé au Sacrifice, chantant de toute son âme, retrouvant peu à peu le monde au milieu duquel il sera témoin. Soulignons, enfin, que le spectateur commente la représentation qu’il vient de voir, à l’instar du critique analysant la pièce qu’il vient de lire, pour la faire partager aux autres. C’est-à-dire que, le rideau tombé, l’on essaie de faire vivre encore un peu la magie des quelques heures qui ont su réunir la foule pour partager un dire et un agir, l’art d’un comédien transcendé par la théâtralité, la force d’un parler autre et d’un se mouvoir librement dans la maîtrise totale de soi pour l’acteur (celui qui fait, en latin) ou dans l’abandon au monde du spectateur (celui qui voit), dans une relation intense et complexe. Ainsi, le théâtre trouve peut-être, dans une métaphore de la liturgie, une définition de son essence en tant qu’à la fois issu du texte et projeté sur scène.
En conclusion, nous avons vu que que les opinions de Jouvet et d’Artaud, bien qu’au premier abord strictement antagonistes, se rejoignent dans une conception du théâtre qui pourrait lier à la fois le texte comme point de départ et la représentation comme fin. Le texte, même s’il est constitutif de l’' uvre dramatique, n’en compose peut-être pas l’essentiel. Tout se fait dans la distinction nette qui sépare le théâtre des autres genres littéraires pour en faire un art, comme l’écrit Artaud, « autonome et indépendant », où le comédien non seulement ne met pas en oeuvre un seul art de dire, mais tout un agir, voire un tout agir. Cela ne suffit pas, puisque le théâtre peut aujourd’hui se rapprocher de la danse, mais aussi des autres formes de l’ « expression scénique », comme un « art » des rues, de l’improvisation, de la folie au c' ur d’un monde ordonné à l’excès. Le comédien est aussi acteur amateur, celui qui se fait un instant comédien. Il n’en reste pas moins que la dimension sacrée de l’acte théâtral ne doit sans doute pas disparaître au profit d’un non-art, médiocre partout, sur des scènes qui n’en sont plus, au milieu de spectateurs qui n’en sont plus vraiment, comme la modernité l’exige. Le théâtre reste un acte presque charnel, une relation physique avec le texte et la scène, l’aboutissement d’un long travail et l’explosion d’une ' uvre.
Liens utiles
- ESSENCE DU THÉÂTRE (L’), Henri Gouhier
- Le conflit essence du théâtre ?
- En vous appuyant sur votre expérience de lecteur et de spectateur, vous expliquerez et discuterez cette réflexion de H. Gouhier : « La représentation n'est pas une sorte d'épisode qui s'ajoute à l'oeuvre; la représentation tient à l'essence même du théâtre ; l'oeuvre dramatique est faite pour être représentée: cette intention la définit.
- Le Conflit, Essence Du Théâtre ?
- Henri Gouhier, L'essence du théâtre