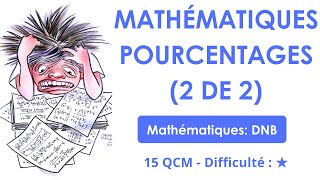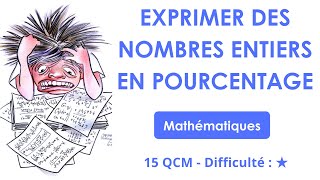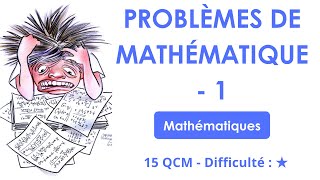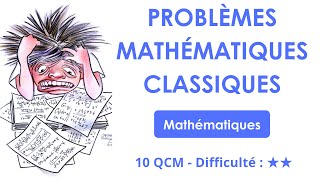En consignant le témoignage d'un paysan français, Ephraïm Grenadou, Alain Prévost a construit un document d'histoire en même temps qu'il a fait œuvre de mémoire. Dans la première moitié du XXe siècle, la population française reste majoritairement rurale ; les effets de la révolution industrielle du XIXe siècle sont souvent encore ténus et les sociétés rurales présentent un visage très traditionnel : des champs très morcelés, le cheval comme force motrice, le fumier comme seul engrais malgré les progrès de la chimie. Les activités ne sont pas spécialisées, on cultive avant tout pour assurer sa subsistance (céréales, quelques bêtes) et on vend peu.
Grenadou paysan français d’Ephraïm Grenadou et Alain Prévost
Me voici donc charretier chez mon père. Quand il s’était mis à son compte, ma grand-mère lui avait donné cette maison que nous habitions, trop petite pour une ferme. Mon père a d’abord ajouté une étable, puis une écurie à deux chevaux qui s’est trouvée trop étroite quand on a eu le troisième cheval qu’il a fallu loger dans l’étable. À ce moment-là, on commençait déjà à commander la maçonnerie à des gens de métier. Mon père a fait construire un petit hangar, puis une grange pour l’avoine. Le blé restait en meule jusqu’à ce que l’entrepreneur vienne pour les battages. Tous ces bâtiments étaient couverts en paille. En 1913, mon père a fait recouvrir la maison, l’étable et l’écurie de tuiles. Ca commençait à se voir dans le pays : la peur des incendies et des orages. Je connais bien vingt endroits à Saint Loup où le tonnerre est tombé. On craignait la foudre bien plus que maintenant. En mai 1910, elle nous a tué Colibri notre cheval. Pauvre Colibri, de l’oreille au pied droit ça l’avait brûlé, mais son frère Papillon à côté de lui n’avait rien eu. Le même jour, l’orage a découvert tout le clocher de l’église. En 1917 la foudre est encore tombée chez nous, sur la cheminée de la maison ; elle a brisé des pavés et cassé des assiettes dans le placard. Mon père cultivait vingt-cinq hectares, une cinquantaine de champs, certains inaccessibles dans le milieu des autres, en long, en large ; les plus petits faisaient six ares. Avant le remembrement un champ de trois hectares était un miracle. Naturellement la plaine était couverte de monde. Pour faire du blé on labourait trois fois : le premier coup à quatre, cinq centimètres, le deuxième plus creux ; le troisième coup, il fallait que la charrue trace une raille dans laquelle la herse enterrerait le blé semé à la main. Dans la ferme de mon père, à quelque chose près, on récoltait huit hectare en blé, huit en avoine, huit en fourrage et en betteraves. Il fallait un petit champ d’orge pour les deux ou trois cochons qu’on élevait par an. On avait donc le blé à vendre. L’avoine, on la battait soi-même au fléau, pour les chevaux. Le fourrage et les betteraves nourrissaient les vaches. On vendait le lait, le fumier retournait aux champs. Quand mon père s’agrandissait, il gardait une vache de plus pour le fumier. J’occupais deux chevaux à labourer. Avec le troisième, mon père allait à l’herbe ; il binait les betteraves, curait l’étable. Ma mère trayait les six ou sept vaches, s’occupait de la cuisine et de la lingerie. Nous n’étions plus que trois. Ma sœur s’était mariée en 1911 avec Clément, son vieux copain d’école. Mon père leur avait donné une petite maison héritée de la vieille tante paralytique morte chez nous. Clément montait une briqueterie au bout du pays. Ça marchait pas mal. En hiver, mon père me réveillait à quatre heures et demie. Je couchais toujours dans l’étable. Il m’apportait la lanterne tempête qu’il pendait à un clou. À chaque cheval, je donnais sa botte de fourrage et quatre litres d’avoine que je puisais dans un coffre qui s’appelait le provendier. Et puis je me recouchais un peu. À cinq heures je me relevais pour panser mes chevaux pendant une demi-heure. J’allais chercher de l’eau dans la mare avec deux seaux, je leur donnais à boire. Ensuite, je déjeunais : du pain, un bout de cochon, du fromage et un coup de cidre coupé d’eau. Mon père m’envoyait dans les champs dix minutes avant le petit jour, pour qu’aussitôt arrivé je puisse travailler. Toute ma matinée… Je dételais pour arriver à la soupe de onze heures. Certains chevaux connaissaient l’heure ; arrêtés dans le bout du champ, ils ne voulaient plus remonter, ils sentaient la soupe. Si j’étais loin, je dételais, cinq, dix minutes, un quart d’heure d’avance, le temps de m’en venir, monté sur un cheval. Je soignais mes chevaux, à boire, quatre litres d’avoine et le fourrage, un peu avant, un peu après ma soupe pour qu’ils ne mangent pas trop vite. Au moment de partir, je les habillais ; un petit coup sur la crinière, que ce soit propre. J’enlevais la crinière de dessous le collier, ça pouvait les blesser et les rendre malheureux. À une heure je repartais. Certains jours, le midi ou bien le soir me prenait que je n’y avais pas songé. En allant doucement les chevaux ne souffraient pas, ils étaient habitués. Le temps semblait court.
Source : Grenadou (Ephraïm), Grenadou paysan français, éd. établie par Alain Prévost, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points histoire «, 1966.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.