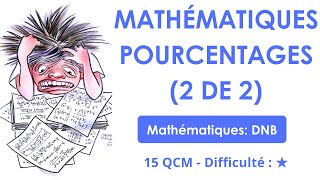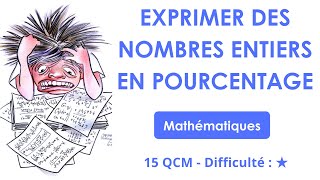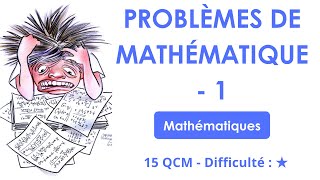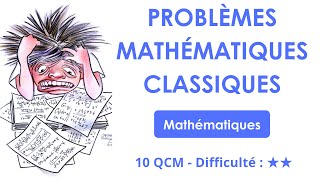Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors : voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d’audace, fils de l’empire et petits-fils de la révolution.
Or, du passé, ils n’en voulaient plus, car la foi en rien ne se donne ; l’avenir, ils l’aimaient, mais quoi ? comme Pygmalion Galathée ; c’était pour eux comme une amante de marbre, et ils attendaient qu’elle s’animât, que le sang colorât ses veines.
Il leur restait donc le présent, l’esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n’est ni la nuit ni le jour ; ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux plein d’ossements, serré dans le manteau des égoïstes et grelottant d’un froid terrible. L’angoisse de la mort leur entra dans l’âme à la vue de ce spectre moitié momie et moitié foetus ; ils s’en approchèrent comme le voyageur à qui l’on montre à Strasbourg la fille d’un vieux comte de Saverdern embaumée dans sa parure de fiancée. Ce squelette enfantin fait frémir, car ses mains, fluettes et livides, portent l’anneau des épousées, et sa tête tombe en poussière au milieu des fleurs d’oranger. [...]
Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l’oisiveté et à l’ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d’eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leur bras.
[...]
En même temps que la vie du dehors était si pâle et si mesquine, la vie intérieure de la société prenait un aspect sombre et silencieux ; l’hypocrisie la plus sévère régnait dans les mœurs ; les idées anglaises se joignant à la dévotion, la gaîté même avait disparu. Peut-être était-ce la Providence qui préparait déjà ses voies nouvelles ; peut-être était-ce l’ange avant-coureur des sociétés futures qui semait déjà dans le cœur des femmes les germes de l’indépendance humaine, que, quelque jour, elles réclameront. Mais il est certain que tout d’un coup, chose inouïe, dans tous les salons de Paris, les hommes passèrent d’un côté et les femmes de l’autre ; et ainsi, les uns vêtus de blanc comme des fiancées, les autres vêtus de noir comme des orphelins, ils commencèrent à se mesurer des yeux.
Qu’on ne s’y trompe pas : ce vêtement noir que portent les hommes de notre temps est un symbole terrible ; pour en venir là, il a fallu que les armures tombassent pièce à pièce et les broderies, fleur à fleur. C’est la raison humaine qui a renversé toutes les illusions ; mais elle en porte elle-même le deuil, afin qu’on la console.
Les mœurs des étudiants et des artistes, ces mœurs si libres, si belles, si pleines de jeunesse, se ressentirent du changement universel. [...] l’amour était traité comme la gloire et la religion ; c’était une illusion ancienne. [...]
Or, vers ce temps-là, deux poètes [...]venaient de consacrer leur vie à rassembler tous les éléments d’angoisse et de douleur, épars dans l’univers. Goethe, le patriarche d’une littérature nouvelle, après avoir peint dans Werther la passion qui mène au suicide avait tracé dans son Faust la plus sombre figure humaine qui eût jamais représenté le mal et le malheur. Ses écrits commencèrent alors à passer d’Allemagne en France.
Du fond de son cabinet d’étude, entouré de tableaux et de statues, riche, heureux et tranquille, il regardait venir à nous son œuvre de ténèbres avec un sourire paternel. Byron lui répondit par un cri de douleur qui fit tressaillir la Grèce, et suspendit Manfred sur les abîmes, comme si le néant eût été le mot de l’énigme hideuse dont il s’enveloppait.[...]
Quand les idées anglaises et allemandes passèrent ainsi sur nos têtes, ce fut comme un dégoût morne et silencieux, suivi d’une convulsion terrible. [...]
Ce fut comme une dénégation de toutes choses du ciel et de la terre, qu’on peut nommer désenchantement ou, si l’on veut, désespérance, comme si l’humanité en léthargie avait été crue morte par ceux qui lui tâtaient le pouls. De même que ce soldat à qui l’on demanda jadis : A quoi crois-tu ? et qui le premier répondit : A moi ; ainsi la jeunesse de France, entendant cette question, répondit la première : A rien.
Dès alors il se forma comme deux camps : d’une part, les esprits exaltés, souffrants, toutes les âmes expansives qui ont besoin de l’infini plièrent la tête en pleurant ; ils s’enveloppèrent de rêves maladifs, et l’on ne vit plus que de frêles roseaux sur un océan d’amertume. D’une autre part, les hommes de chair restèrent debout, inflexibles, au milieu des jouissances positives, et il ne leur prit d’autre souci que de compter l’argent qu’ils avaient. Ce ne fut qu’un sanglot et un éclat de rire, l’un venant de l’âme, et l’autre du corps.