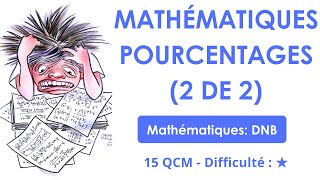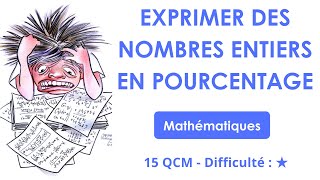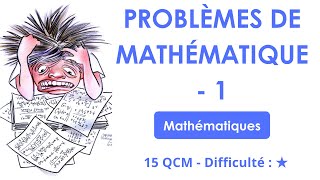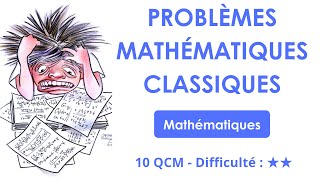Prince des poètes et poète maudit: VERLAINE
Publié le 16/09/2006
Extrait du document
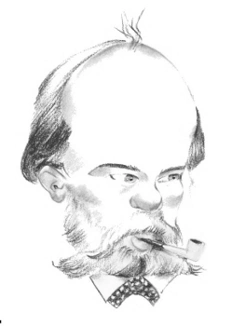
Prince des poètes et poète maudit, prisonnier et professeur, père de famille et homosexuel, débauché et catholique – si c’est effectivement de la voyance que naît l’inspiration poétique, Paul Verlaine incarne la poésie même, car il a tout vu, tout vécu. L’histoire de sa vie nous a procuré des millers et millers de pages biographiques ; celle de son âme – cinq tomes volumineux : prose, poésie, théâtre, même pornographie. Aura tort pourtant celui qui voudra – par paresse ou lassitude – séparer ces deux domaines, puisque l’oeuvre verlainienne ne peut être perçue qu’à travers ses expériences et que c’est seulement en combinant les deux qu’on arrive à déchiffrer – autant qu’il est possible de déchiffrer un génie – le message de Pauvre Lelian.
Né à Metz en 1844, choyé, voire gâté par sa mère, petit Paul-Marie avait, comme lui-même le confesse dans son autoportrait railleur, une enfance hereuse. Depuis ses quatorze ans, il avait rimé à mort, faisant des choses vraiement drôles dans le genre obscéno-macabre . Déjà pendant ses études à Paris, il manifestait une attitude fortement nonchalante – inscrit en droit, il a très vite compris que la vraie vie se déroulait ailleurs ; à force de fréquenter les cafés du cercle poétique, il a commencé à sécher les cours et, par la suite, rompu avec l’éducation traditionnelle. Et paradoxalement, c’est justement à cause de quitter Alma Mater qu’il a obtenu sa licence – licence poétique : en 1866, le Parnasse Contemporain publie ses poèmes ; quelques mois plus tard, apparaît (à compte d’auteur) son premier recueil, accueilli par Anatole France et Mallarmé : Poèmes saturniens. Le grand voyage est désormais entrepris.
La parution des Fêtes galantes en 1869 coïncide avec la rencontre de Mathilde Mauté. Verlaine – déjà abusant de l’absinthe, ce nectar du XIXe siècle – lui fait la cour toute l’année, pour la conduire finalement à l’autel le 11 août 1870. Le bonheur conjugal ne durera point, malgré le témoignage de l’amour rendu dans la Bonne Chanson. Alcoolique, neurasthénique, le poète tente deux fois de tuer sa mère et ne sait pas pourvoir à l’entretien de la famille. Durant la Commune, les Verlaine se réfugient en province (juin-août 1871) pour ensuite revenir à Paris, où ils s’installent chez la famille de Mathilde. Un mois plus tard, le mari, le futur père, mais surtout l’artiste, s’engage dans l’aventure qui va anéantir son mariage ; ayant reçu quelques poèmes d’un certain Arthur Rimbaud, jeune et insolent, un enfant de seize à dix-sept ans, déjà nanti de tout le bagage poétique qu’il faudrait que le vrai public connût , il l’invite à la capitale. L’hôte, venu de Charleville, sera hébergé – au plus grand surpris de Mathilde et ses parents – dans le foyer des Mauté.
Bien que la femme réussisse enfin à se débarasser de l’intrus, elle en fait en même temps – quoiqu’inconsciemment – une croix sur l’avenir du couple ; Paul, qui déjà antérieurement était loin de l’idéal, subit une transformation terrifiante : non seulement qu’il traîne, s’enivrant – avec Rimbaud, bien entendu – dans les milieux poétiques suspects (tel le cercle Zutique), mais surtout il commence à battre Mathilde et la menace de mort. Celle-ci accouche en octobre d’un enfant, Georges, et quelques mois après, s’enfuit avec lui, laissant Paris en proie aux deux tapageurs.
Dès là, l’histoire accélère, tout en tournant en tragique : l’année 1872 apporte une suite de départs et de retours, un véritable ping-pong dont Verlaine devient la balle et Rimbaud et Mathilde – joueurs. Sauf que, évidemment, c’est à la balle de décider qui gagnera. Tandis que les deux poètes partent pour Belgique (vagabondage dont l’écho se fera entendre dans les Romances sans paroles), Mathilde entreprend des procédures de séparation. Quelques sets après, en juillet 1873, lors d’une dispute, envenimée par l’alcool, Verlaine tire sur son ami deux coups d’un revolver : Rimbaud n’est blessé que légèrement, et pourtant porte une plainte. L’assasin manqué, arrêté par la police, outre l’interrogatoire traditionnel, doit subir un examen médical, révélant des pratiques homosexuelles ; pour ce double crime, il est condamné à deux ans de prison (d’où il sortira cependant plus tôt que prevu, grâce à sa bonne conduite).
Mais, paradoxalement, ce paysage on ne peut plus morose a suscité chez Verlaine une subtilité jusqu’alors inégalable, et qu’il n’allait d’ailleurs égaler jamais plus. De cette inspiration va naître une oevure suprême, l’expression la plus parfaite du talent poétique: la Sagesse. Le poète illuminé est bien conscient de cette perfection au moment même de la création : dans une lettre envoyé à son ami Edmond Lepelletier, il décrit qu’il éprouve en grand, en immense, ce qu’on ressent quand, les premières difficultés surmontées, on perçoit une science, un art, une langue nouvelle . La nouveauté de cet art consiste surtout dans son caractère religieux – ce libertin acharné, cet enfant terrible de la décadence, retrouve enfin sa paix : Dieu lui a fait la grâce de comprendre l’avertissement. Il s’est prosterné devant l’Autel longtemps méconnu .
A la sortie du prison en janvier 1875, Verlaine, réconcilié avec Dieu, essaie de se réconcilier aussi avec Rimbaud : leur dernière rencontre a lieu à Stuttgart. Mais l’attitude du jeune rebelle est impitoyable : non seulement il bafoue la métamorphose spirituelle de son vieil ami, mais aussi en quelques heures il lui fait renier sa foi. Ainsi se termine pour Pauvre Lelian l’aventure qui l’a coûté son mariage, sa dignité et sa liberté. Pour ce qui concerne Rimbaud, il va bientôt renoncer à la poésie pour mourir, à l’âge de trente-sept ans, d’une tumeur cancréuse de genou, aggravée par une ancienne siphylis.
Commence alors pour Verlaine une période des voyages. Il part pour Angleterre, où il devient professeur : à Londres, puis à Stickney, à Boston, à Bournemouth. On peut trouver quelques impressions de ce voyage dans la troisième partie de la Sagesse, qu’il a achevé vers 1877. Le recueil, publié en 1881, passe innaperçu.
Citons grosso modo les autres évènements de la vie de Verlaine – sans entrer dans les détails, car pour les fins de cette analyse, il n’a fallu que suivre son histoire jusqu`au moment de la composition de la Sagesse. En 1884, il publie les Poètes maudits, l’hommage en prose rendu à ses contemporains, dont – bien évidemment – Rimbaud. Chose singulière : il s’y décrit lui-même aussi, sous le pseudonyme de Pauvre Lelian (anagramme de son propre nom), en altérant les titres de ses ouvrages (p.ex. Sapientia pour Sagesse). L’année suivante, il fait paraître Jadis et Naguère, contentant le célèbre poème l’Art poétique. Depuis, sa vie se dégrade de plus en plus : l’alcoolisme, un autre emprisonnement pour un attentat à la vie de sa mère, les rélations avec deux prostituées parisiennes, la maladie (hydarthrose du genou) et hospitalisations, vie de clochard... Malgré le titre du Prince des Poètes, que lui accordent en 1894 les lecteurs du Journal, l’on voit très bien que son duché est sur le point de s’écrouler.
Paul Verlaine décède le 8 janvier 1896, à cinquante-deux ans, d’une congestion pulmonaire. Quelques mois plus tard, Emile Verhaeren écrira : Depuis la mort de Victor Hugo, ce fut celle de Paul Verlaine qui frappa le plus profondément les Lettres françaises. (...) [Q]u’il agrée cet hommage posthume que vous, ses lecteurs et admirateurs et nous, ses amis et ses fervents, ensemble, nous lui rendons avec une égale piété tendre et exaltée .
La Sagesse, composée entre 1874 et 1877, est un livre de pénitence d’un homme mûr, lassé de son existence amertume. Parnassien par son culte de la forme, par son style extrêmement soigné, Verlaine rompt pourtant avec le précepte de l’art pour art ; son spiritualisme sensuel renvoie plutôt aux grands romantiques, tel Lamartine, qu’aux fascinations antiques de Lisle.
Le livre comprend trois parties distinctes : la premiere relate l’expérience amère d’un pécheur, sa conversion et l’espoir du salut ; le caractère de la deuxième est plus théologique, epuré de l’aspect personnel ; la troisième partie enfin exprime une tendre mélancolie, les souvenirs du passé païen y sont mêlés avec les réflexions d’une âme attristé, mais quiète. Et c’est justement de cette dernière partie que provient le poème L’échelonnement des haies.
Créé vers 1876, pendant le séjour du poète à Bournemouth, cette image en vers avait originellement été intitulée « Paysage en Lincolnshire « . Verlaine y exprime son ravissement pour les magnifiques meadows (prairies) pleins de moutons , pour la tranquilité et la douceur de la campagne (ou plutôt champagne) anglaise. Ce thème, quoiqu’incontestablement banal, est pourtant réalisé avec une virtuosité supérieure.
Les 16 vers de ce poème (repartis en 4 quatrains dans certaines éditions) sont particulièrement marqués de la musicalité ; chose très caractèristique pour Verlaine, ce vieux jongleur des sons. Il obtient cet effet grâce au jeu constant des assonances, auxquelles il s’attaque dès le premier vers : les trois nasales au milieu (-on-, -ne-, -ment-) sont embrassées des paires respectives de [e]. (éch-, -el- ; -des-, -haies). Une pareille situation s’observe dans le sixième vers : cette fois, les nasales (sont- ; -tend-) sont aux bords et les [e] (-lé-, -gers-, -vert-) au milieu. A ces chiasmes sonores correspond la rime, naturellement aussi embrassée.
Pourtant, ces régularités prosodiques ne contribuent pas à l’uniformité rythmique : ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’on arrive à définir la métrique : chaque vers se compose de 7 syllabes, mais les enjambements (vers 2/3, vers 11/12, vers 13/14) brouillent la lecture harmonieuse. De telles ruptures renvoient, peut-être, aux ondulations du terrain, signalées par le champ lexical de la mer (mer, v.2 ; vague, v.9 ; déferler, v.13 ; onde, v.14).
Le poète nous présente un paysage paisible, dont d’ailleurs il est totalement absent. Point de « je «, point d’empreintes émotionnelles – on pourrait dire qu’il ne s’agit plus d’un poème, mais d’un tableau ; surtout que, dès les premiers lignes, se dresse une perspective formidable (moutonne à l’infini, v.2). Cependant, les sensations qu’on est incité à éprouver, dépassent les limites de la peinture, car tous les sens du lecteur sont engagés dans l’affaire : l’odorat (qui sent bon, v.4), le goût (les jeunes baies, v.4), le toucher (le vent tendre, v.6) et l’ouïe (déferlait, v.13 et cloches, v.15). Il ne suffit donc pas parler du pittoresque, il faut trouver une expression nouvelle pour ce sentiment de téléportation brusque vers une réalité parallèle !
Verlaine-le magicien sait bien comment susciter de tels sentiments. Premièrement, son poème semble n’avoir ni le début ni la fin. Ainsi, le tempo des premiers vers est très rapide, tandis que le lecteur s’attenderait plutôt à une montée progressive de vitesse : personne n’est apprivoisé à un mot de 5 syllabes ouvrant le tout premier vers – surtout si ce vers n’a que 7 syllabes ! La fin, elle non plus, n’est pas conforme aux règles classiques de la poésie : on apprend que tout à l’heure déferlait / l’onde (...) / de cloches (v.13,14,15), il est donc naturel d’escompter une suite : l’imparfait utilisé dans cette phrase l’annonce ! Si au moins l’auteur avait chosi le passé composé, ou le passe simple, la situation aurait été plus claire : une ombre déferla – point final. L’impression de l’improvisation qui s’empare du lecteur, et qui fait penser aux haikus japonais, rend possible la téléportation mentionnée ci-dessus, puisque le début et la fin sont des artifices artistiques, et la réalité est aussi illimitée que ce poème.
L’autre procédé accréditant le réalisme est le mouvement : sur le plan sémantique aussi bien que sur le plan syntaxique. Tel le verbe moutonner (v.2), joint aux haies (v.1), évoque une image de l’agitation des feuilles ; une image renforcée en plus par la métaphore de la mer (v.2/3). De même, les arbres (...) / (...) légers, v.5/6) font penser à une certaine dynamique, une dynamique qui atteint son point de culmination avec l’apparition des poulains (v.8), de leur agilité (v.8) et leurs ébats (s’ébattre et s’étendre, v.7). Les autres éléments ranimant cette scène appartiennent au registre stylistique : l’auteur exploite des figures rares, surprenantes, pour échapper à la monotonie des métaphores du type « belle comme une rose «. Ainsi, il se sert de l’alliance des mots moulin (v.5) et léger (v.6), de la métonymie (vert tendre, v.6 pour la prairie) et de l’hypallage (ce sont les poulains qui s’ébattent, et non l’agilité).
Une façon de plus pour vivifier le poème : la provocation ! L’utilisation du même mot dans les vers qui se suivent est une chose condamnable. Verlaine, non seulement qu’il ose répéter le mot aussi (v.10 et 11), mais – comble de malheur – montre assez d’audace pour le situer à la fin de la ligne, de manière à ce que aussi rime à... aussi ! Que cette rime, à force de l’enjambent, ne s’aperçoit pas, c’est une autre paire de manches...
Une approche semblable se manifeste dans les vers 6 et 7. Si la rime idéntique (aussi-aussi) peut être, à la limite, acceptée comme l’exemple de l’excentricité de l’auteur, il n’en est pas le cas avec la rime défectueuse, portant sur un mot et son composé. Et, même si tendre (adjectif) n’est pas un composé du verbe étendre, il suffit d’oublier pour un instant la signification afin de voir et d’entendre qu’en effet, il s’agit de la même chose... Quel outrage !
Dans son impertinence, Verlaine ne manque pas à manquer aussi une comparaison, la plus facile figure stylistique du monde. Dans les vers 11 et 12, il rapproche l’idée de la douceur des brébis à la douceur de la laine des brébis : le comparant appartient (littéralement !) au comparé. Il commet presque le même péché en parlant des cloches (v.15) qu’il compare aux flûtes : à quoi bon illustrer un instrument par un autre ? Et pourtant – cela se voit dans le vers suivant – il est capable de suivre la recette canonique : le ciel comme du lait. Dans quel but a-t-il donc gâté un si bel exemle du parallélisme de construction ? Evidemment, pour que les critiques bavent de rage...
Alors, comme l’on vient de prouver, le poème est provocant et mouvementé. Mais paradoxalement, ce qui constitue son trait principal, c’est la douceur. On a beau se courroucer contre l’usage aberrant de la comparaison : la brebis restera le symbole de tout ce qui est pur et innocent, et cette pureté et innocence elle va léguer à l’oeuvre. Et puis, il y a la clarté, la fraîcheur des baies, la légerté, la sensualité sublime des volutes, le tintement des cloches... Seul le véritable poète sait combiner l’irreguralité des formes d’expression avec l’harmonie absolue du fond thématique en obtenant un résultat aussi homogène, aussi séduisant... le poète absolu, le Prince des Poètes.
BIBLIOGRAPHIE:
1. Paul VERLAINE, Sagesse, 1881, in Oeuvres poétiques, texte établi par J. Robichez, CLASSIQUES GARNIER, Paris 1995
2. Paul VERLAINE, Les poètes maudits, 1884, in Les poètes maudits, LEON VANIER EDITEUR, Paris, 1888
3. Charles MORICE, Paul Verlaine, LEON VANIER EDITEUR, Paris 1888
4. Paul ESCOUBE, Préférences: Charles Guérin, Remy de Gourmont, Stéphane Mallarmé, Jules Laforgue, Paul Verlain, MERCURE DE FRANCE, Paris 1913
5. Edmond LEPELLETIER, Paul Verlaine – sa vie, son oeuvre, MERCURE DE FRANCE, Paris 1923
____________________________________________________________
______________________________
6. Emile VERHAEREN, Paul Verlaine, in La Revue Blanche, tome XII, premier semestre 1897, in La Revue Blanche, SLATKINE REPRINTS, Genève 1968
Liens utiles
- Paul Verlaine: Poète maudit ou pécheur repenti?
- POÈTES MAUDITS (Les) de Paul-Marie Verlaine (résumé et analyse de l’oeuvre)
- POÈTES MAUDITS (les), de Verlaine
- Verlaine Paul Marie, 1844-1896, né à Metz (Moselle), poète français.
- Lucrèce par Pierre Guéguen Le grand Lucrèce, esprit sain, raison offensive, intelligence cosmique, n'en incarne pas moins ce monstre romantique moderne que l'on appelle un Poète Maudit, comme le fut Rimbaud, ou, dernier en date, Artaud.