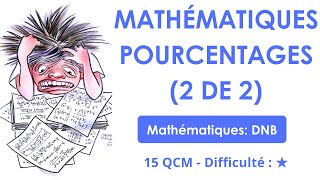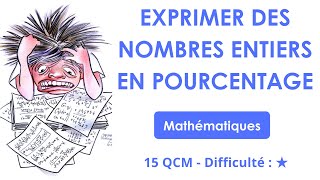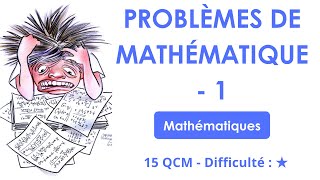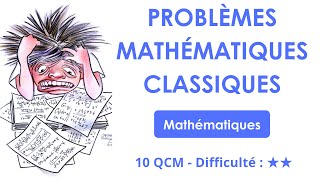COMMENTAIRE DE TEXTE, Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, chapitre 26
Publié le 19/01/2011
Extrait du document
COMMENTAIRE DE TEXTE
Voyage au bout de la nuit ; Louis Ferdinand Céline
Le vingtième siècle est une improbable expérience humaine. Il faut dire que la révolution industrielle avait abondamment achalandé le laboratoire. Du coup les scientifiques se sont mis à cœur joie, ils ont commencé en quatorze par toute sorte de déformations sur le cobaye, ils ont coupé quelques membres à l’aide de shrapnels, percé les cartilages, les côtes, l’humérus, le radius à l’aide de billes de plombs, ils ont aspergé le corps de sulfure de dichlorodiéthyle, regardant sans compassion le coulis de framboise se rependant sur l’inox de la table d’autopsie. L’expérience a néanmoins marché, le patient était toujours vivant. D’autres scientifiques se sont dits : « les hommes sont si nécessairement fou qu’il faudrait être fou par un autre tour de folie de n’être pas fou ». Ils ont donc accouru à ce laboratoire et une recrudescence de manipulations est apparue : certains ont découpé l’encéphale à l’aide d’un marteau, d’autres le centre nerveux avec une faucille et des petits malins ont dessiné un svastika sur le crâne du patient. Ils se sont étonnés que l’organisme fonctionne toujours. Alors ils ont recommencé les déformations sur le cobaye en expérimentant la consomption, la radiation et j’en passe. Le vingtième siècle a libéré un cristal d’irisation aux rayons guerriers, totalitaires, décolonisateurs, mais des rayons souvent pourpres. Les hommes ne se battaient pas pour des terres, des biens, ni pour des religions mais pour des convictions. Ce siècle d’expérience a troublé les hommes, décrit des entailles profondes dans leur cœur. Beaucoup d’écrivains se sont alors interrogé sur la condition humaine et ont montré leur engagement sur ce bouillon d’idéologie telle que Malraux, Eluard, Aragon, Saint-Exupéry. Chez d’autres, le sentiment que l’homme est une bête qui erre sempiternellement dans l’absurdité s’est développée, chez Sartre, Camus et notamment Céline. Dans Voyage au bout de la nuit, récit désenchanté des tribulations de Ferdinand Bardamu dans les débuts d’un vingtième siècle obscure et asphyxiant, le héros face à l’absurdité du monde qui voudrait l’entraîner ne peut qu’offrir de la lâcheté, de la distance par rapport à celui-ci. Que ce soit sur les champs de bataille de la première guerre mondiale, en Afrique en compagnie de colons fondant sous un soleil brûlant, en Amérique dans la tourmente taylorienne, ou dans les faubourgs miséreux de Paris comme ici, Céline véhicule une vue particulière du monde. Si le cru, la vérité et la justesse de cette vue ressortent de façon pertinente c’est parce que Céline à l’instar de Bel-Ami est Maupassant et Figaro, Beaumarchais, est Bardamu. Sa propre expérience nourrit ce livre presque autobiographique. Le chapitre vingt-six dans lequel Bardamu devenue médecin tâte le pouls de l’indigence dans un immeuble de banlieue parisienne aux moribonds à chaque étage, illustre parfaitement cette vue. Par quels moyens Céline montre une vision de l’homme et du monde pessimiste et désabusée ? Trois axes, le personnage antihéroïque de Bardamu dans un premier temps, une situation de dénuement moral et physique dans un deuxième temps et un style au service de la vision en terminaison.
Ferdinand Bardamu est l’antihéros. Son comportement, son regard, ses intentions s’inscrivent dans l’homme. Il ne donne pas d’impulsion à l’action mais transporte seulement le miroir qui permet au monde de Céline de se refléter dedans. C’est un médecin spectateur et un médecin pusillanime.
C’est un grand observateur, passe presque plus de temps à observer le peuple qu’à soigner ses malades. Sa vision permet de décortiquer la scène et de quadriller cette misère. Son rôle permet de cerner le personnage. La focalisation est interne et permet de révéler le caractère du personnage. La vue se jette sur tout ce qui bouge : « son public d’agonie remonte par ici », « la famille d’en bas vient voir », « des gens venu de loin entre en surnombre ». Il observe les flux de badauds monter tout en associant leurs intentions : « si par ici ça allait se terminer aussi mal que chez eux ». Il observe cette misère avec distance, s’attache à des petits détails : « un cousin est tout saisi » ; « il voudrait voir leurs jambes pendant qu’il y est ». Lui aussi Bardamu voudrait voir leurs jambes, sa personnalité légèrement vicieuse et libidineuse impose l’axe du regard. Néanmoins, sa vision clinique est rapide : « cette expulsion de fœtus n’avance pas » presque lapidaire, comme s’il profitait de cette visite médicale pour mieux observer le peuple qui grouille autour de lui. Ce n’est pas soigner les gens qui l’intéresse, mais prendre des prises de vue sur cette pauvreté. Il montre une certaine passivité devant la situation de plus en plus compliqué : « Les uns en voulaient de l’hôpital, les autres y montraient absolument hostile » ; « la sage-femme méprisait tout le monde. » Sans les sentiments que lui inspire cette scène qui sont décrits, ce serait une focalisation externe. L’image de la parturiente agonisante ne lui soulève aucune émotion : « Je lui découvre le trou de sa femme, […], qu’il regarde ». Tout son comportement donne l’impression que c’est un réalisateur, met en place les éléments de l’action, soulève le tissu qui cache l’horreur et dit à l’homme : « vas-y regarde, je tourne. » Il analyse ses acteurs : « il est fameux. Son pantalon est vaste et vague et sa veste aussi. » ; « il pleure une espèce de larme Pierre, et puis il se remet debout. » Reste atone, sans émotion particulière devant cette misère. Son odorat n’est pas développé mais son ouï si : « les coups de grelots qui sautent et cabriolent à travers les manches » ; « elle qui gémit comme un chien », ne retient que les sons forts et terribles qui imposent l’atmosphère, qui sortent de l’ordinaire. Non seulement Bardamu voit bien les choses, mais il saisit immédiatement la nature de chacun, les badauds qui « apprennent l’existence », Pierre et « son hésitation de mari ». Il a une vision du monde qui le porte à observer des détails anodins, l’habillement de Pierre, les sons particuliers. Il est aux antipodes des héros, il est passif, sans contact direct avec les personnages, doué d’une cynique solitude observatrice, plongé dans un univers qu’il connait que trop bien.
C’est un grand couard. Il cherche à échapper à cette misère, saillante, turgescente, qui se présente devant lui. Pour s’échapper, il transforme les sentiments, les émotions de tristesse, de pitié qui devrait l’envahir par quelque choses d’amusent. Il ne veut pas faire face à cette pauvreté : « faut prendre tout ce qu’il y a à regarder en distractions dans les environs » Bardamu détourne à sa façon ses yeux. Médecin est une corvée, une corvée qu’il s’afflige pour dieu sait qu’elle raison : « tant qu’on est en train de passer la nuit blanche, qu’on a fait le sacrifice ». Bardamu se cherche, peut-être est-il entré dans la médecine pour trouver un sens à sa vie, soigner les gens. Mais lorsqu’il est face à ces gens, il ne veut pas regarder avec de vrais yeux, comme Pierre : « il ne sait pas en somme ce qu’il veut ». C’est une sorte de peur face à la vie qui caractérise Bardamu, cette peur se manifeste par l’absence de compassion pour ces gens et l’empêche de se risquer dans une quelconque réussite, il abandonne : « Pourquoi l’attendre encore ? Ça aurait pu durer le reste de la nuit son hésitation de mari. […]. Autant s’en aller ailleurs. ». Sa vie est un ratage complet, il réussit à se convaincre de la futilité de ses échecs, comme un homme qui ne veut pas voir la vérité en face : « c’était cent francs de perdus pour moi, voilà tout ! Mais n’importe comment avec cette sage-femme j’aurais eu des ennuis… c’était couru. ». Il se procure des excuses, il fuit la difficulté : « je n’allais tout de même pas me lancer dans des manœuvres opératoires devant tout le monde, fatigué comme j’étais ! » Le « tant pis » accentue bien les choses, symbolise en deux mots sa lâcheté. Bardamu renonce à soigner les plaies béantes du peuple comme il renonce à se donner une raison de vivre, une identité, il se fuit lui-même : « Allons-nous-en ! ». Il doit payer ses dettes à lui-même, prouver qu’il est quelqu’un, quelque chose mais repousse l’échéance de son atermoiement : « Ça sera pour une autre fois… ». Pour le coup, toute sa vie est résumée en deux mots : « Résignons-nous ! » Finalement, il se convainc lui-même qu’il ne peut rien pour modifier ce monde et lui-même, montre sa pusillanimité : « Laissons la nature tranquille ». La nature avec un grand N mais aussi sa nature à lui.
Il se meut avec son barda, d’où Bardamu, il traîne son équipement de soldat, son barda vers le front du malheur. Il transporte en plus de son barda un esprit bizarre, appart. Il ne met pas en adéquation son rôle de médecin et ses actions. Un esprit contradictoire, donc, profondément humain et antihéroïque. La focalisation interne permet au personnage de se livrer aux lecteurs qui cerne le personnage, et qui par miséricorde, excuse son comportement. Faute avoué à demi pardonner. Le personnage est la passerelle qui permet de faire le lien du lecteur au monde tel que Céline veut nous le montrer.
Après la passerelle, il faut le décor. L’extrait recrée un dénuement physique et moral. Les mourants et les expirants abondent, les spectateurs sont présents, la parturiente, la sage-femme, le mari sont les acteurs d’une scène dramatique et sinistre. L’aspect humain et l’action humaine sont écœurants et amorales, au milieu de tout cela, le personnage de Pierre symbolise cette classe sociale.
Cette situation est décrite crûment sans ménagement. Si cet extrait n’appuie pas sur notre glotte, il reste qu’un léger malaise peut envahir les âmes sensibles. Nous avons un champ lexical repoussant : des « cancéreux », la « mort », l’ « agonie » qui emplissent l’atmosphère. La mort côtoie les animaux : « Les chiens de tout le monde on les entend par coups de grelots qui sautent et cabriolent à travers les marches. » la solennité du passage de vie à trépas est détruite. Les vivants, les animaux, les morts se mélangent dans un bouillon nauséabond. On entre dans cette misère physique, sans pudeur, écorché vif. « Tout le monde est débraillé », sans concession, sans euphémisme, l’atmosphère de la pauvreté est récré, presque palpable. La nécrose, les masses d’hommes presque assimilés à des bêtes tellement les chiens sont proches, l’impudeur ne suffisent pas, il faut rajouter de l’hémoglobine. « Cette expulsion de fœtus n’avance pas, (…), ça saigne encore seulement. » D’ailleurs, ce n’est pas un bébé, un bambin, un nourrisson, tous ces noms mignons mais bien un fœtus. Ce n’est pas le signe d’une nouvelle génération, un moment heureux mais un homme de plus dans un monde dégénéré. Céline arrive à nous dégoûter au moment où le mari regarde : « le trou de sa femme d’où suintent des caillots et puis des glouglous », c’est presque insoutenable, Céline enfonce de manière très incisive une vision de l’homme dégoutant, pauvre et pourri dans notre esprit par l’intermédiaire des sensations. Puis il continue par l’assimilation complète de ces hommes, ces formes agonisantes dans la pénombre miséreuse à des animaux : « Elle gémit comme un gros chien qu’aurait passé sous une auto ». C’est immonde, Bardamu évolue au milieu de bêtes. La déchéance humaine de la condition pauvre de la société urbaine et industrielle du début du XXe doublé à une insalubrité, une absence d’hygiène nous apparait alors au nos yeux ébaubis. Céline réussit à nous plonger dans la vie difficile des villes par l’intermédiaire de mots qui déclenchent des sensations et dessinent des hommes dénués de dignité physique, décomposés, de la pourriture en suspens.
Les comportements de cette pourriture humaine n’arrangent rien. Les hommes se précipitent telle une presse grouillante devant la mort, seule distraction de leur vie misérable. Cette presse a un nom, « public d’agonie », comme nous l’avons vu, leurs physique, leur cries sont ceux de bêtes, leurs mœurs également. « La famille d’en bas vient voir si par ici ça allait se terminer aussi mal que chez eux. » ; « Les chiens, […], Ils montent aussi ». Le rapprochement de ces deux entités fait office de comparaison. Cette foule veulent échapper un tant soit peu à leur torpeur indigente. Pour se faire ils ont le sommeil : « le seul plaisir du pauvre » dixit Zola, ils ont également le coït mais aussi l’émotion de la mort. Rappelez-vous les attroupements devant la guillotine pendant la terreur pour admirer ces têtes, sièges de l’âme et de la pensé se détacher du corps. Pour montrer l’indigence morale des pauvres, Céline ne fait pas dans la dentelle, montre leur comportement bestial qui recherche l’émotion plutô
Liens utiles
- Commentaire de Texte de Louis Ferdinand Céline Extrait de Voyage au bout de la nuit : Bardamu à l'hôpital psychiatrique
- Louis-Ferdinand CÉLINE Voyage au bout de la nuit - Texte seul
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline
- commentaire de Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline