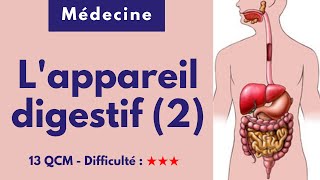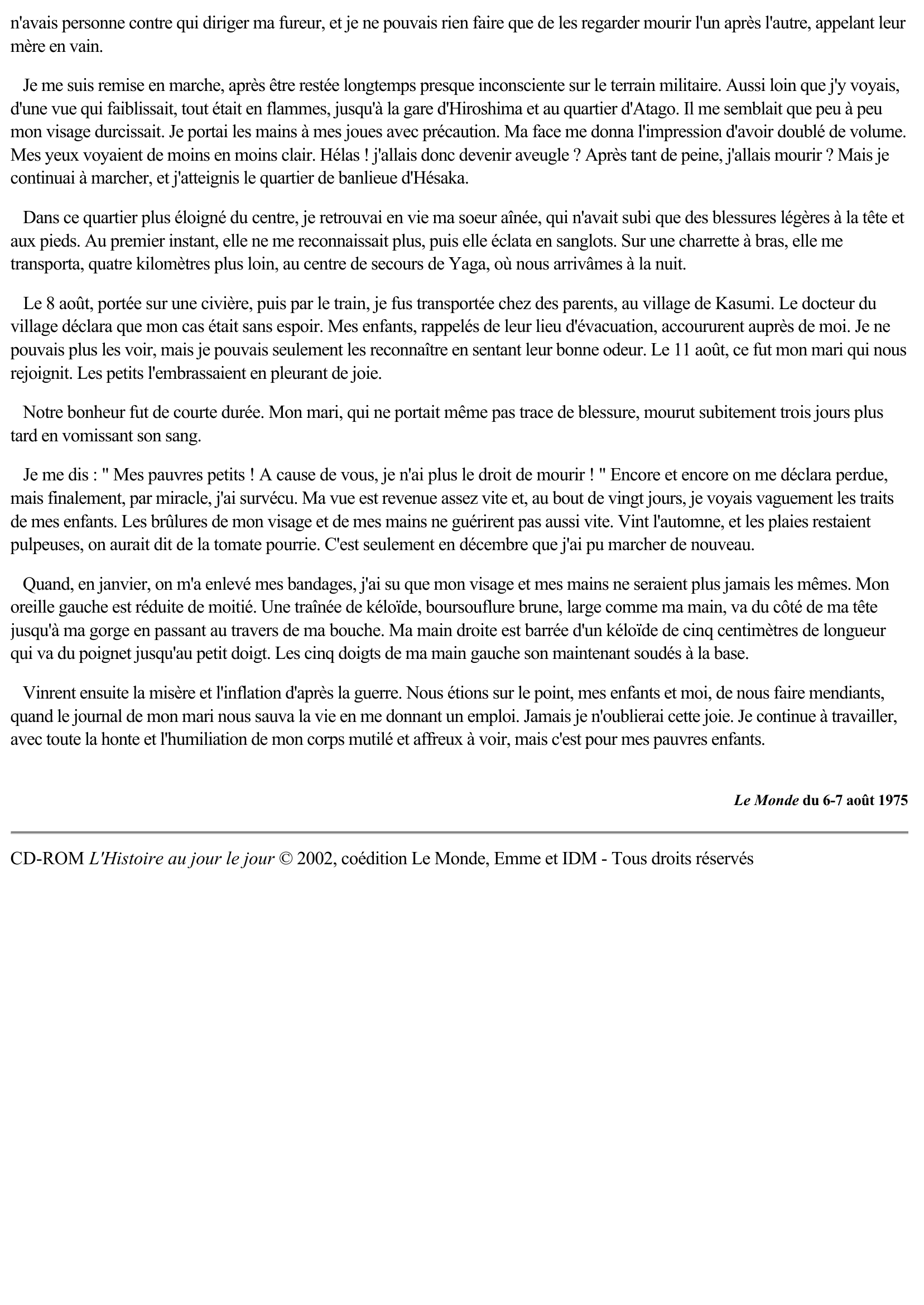Soudain le ciel devint tout noir
Publié le 02/08/2006
Extrait du document
6 août 1945 - Ce récit est extrait d'une brochure publiée par des citoyens d'Hiroshima et de Nagasaki. Intitulée Give me water, elle contient une demi-douzaine de témoignages de rescapés des deux villes " atomisées ".
C'était à Hiroshima, ce matin du 6 août 1945. J'avais rejoint une équipe de femmes qui, comme moi, travaillaient comme volontaires à faire des coupe-feu de protection contre les raids incendiaires, en démolissant pour cela des rangs entiers de maisons. Mon mari, à cause d'une alerte aérienne la nuit d'avant, était resté au journal Chugoku ( " Journal du Japon central " ), où il était employé.
Notre groupe, en file indienne, avait passé le pont de Tsurumi quand, sans qu'il y eût alerte aérienne, un avion ennemi apparut tout seul, très haut au-dessus de nos têtes. Ses ailes d'argent brillaient au soleil d'un éclat étincelant. Une femme cria : " Oh! regardez, un parachute! " Je me tournai dans la direction qu'elle désignait, et juste à ce moment-là un éclair fulgurant occupa tout le ciel.
Est-ce l'éclair qui vint le premier, ou le bruit de l'explosion, déchirant mes entrailles? Je ne me rappelle plus. J'avais été jetée par terre, aplatie sur le sol, et, immédiatement, le monde commença à s'écrouler autour de moi, sur ma tête, sur mes épaules. Je ne voyais plus rien. Il faisait complètement noir. Je crus que ma dernière heure était venue. Je pensai à mes trois enfants, qui avaient été évacués à la campagne de peur des raids. J'essayai de me relever. Je ne pouvais plus bouger : les débris continuaient à tomber, poutres et tuiles, s'entassant au-dessus de moi.
Je finis tout de même par arriver à me dégager en rampant. Il y avait une odeur terrible dans l'air. Pensant que la bombe qui nous avait frappés pouvait être une bombe incendiaire au phosphore jaune-comme il en tombait sur tant d'autres villes,-je me frottai le nez et la bouche assez fort avec mon tenugul, une sorte de serviette japonaise que j'avais à la ceinture. A mon horreur je découvris que la peau de mon visage était restée dans la serviette. Ah! celle de mes mains, celle de mes bras se détachait aussi !
Je me retrouvai assise par terre, anéantie. Peu à peu je réalisai que toutes mes compagnes avaient disparu. Qu'est-ce qui leur était arrivé ? Une panique frénétique me saisit, je voulais fuir, mais où ? Où trouver seulement une rue ?
Je finis par apercevoir le pont de Tsurumi et me précipitai jusque-là en courant, enjambant les entassements de décombres.
Ce que j'aperçus alors sous le pont me bouleversa.
Par centaines, des gens gigotaient dans la rivière. Etaient-ce des hommes ou des femmes, je ne pouvais pas le dire, ils étaient tous dans le même état : leurs visages étaient bouffis et de couleur grise, leurs cheveux hirsutes, ils tenaient les mains levées, et avec des grognements de douleur ils se jetaient dans l'eau. Moi-même j'avais une violente envie d'en faire autant, à cause de la souffrance qui me brûlait tout le corps. Les rayons ardents auxquels j'avais été exposée avaient été assez forts pour réduire en lambeaux brûlés mon pantalon de travail. Mais je me retins de me jeter à l'eau, car je ne sais pas nager.
En fuyant, je criais tout haut les noms de mes trois petits. Où est-ce que j'allais? Je n'en sais plus rien, mais j'ai gardé gravées dans les yeux les images d'horreur entrevues çà et là sur ma route.
Une mère, la figure et les épaules couvertes de sang, essayait frénétiquement de se jeter à l'intérieur d'une maison en feu. Un homme la retenait, et elle hurlait : " Lâchez-moi ! lâchez-moi ! mon fils est là-dedans en train de brûler! " On aurait dit un démon en furie. Sous le pont de Kojin, qui était à moitié écroulé et avait perdu ses fortes rambardes de béton armé, je vis flotter dans l'eau, comme des chiens crevés, un grand nombre de cadavres, à peu près nus, leurs vêtements étant en lambeaux. Au bord de l'eau, près de la rive, il y avait une femme étendue sur le dos, les seins arrachés, baignant dans le sang.
Comment cette horrible chose avait-elle pu arriver ? Je pensai aux scènes de l'enfer bouddhiste, telles que me les décrivait ma grand-mère quand j'étais petite.
J'ai dû errer ainsi au moins deux heures avant de me retrouver sur le terrain militaire de l'est. Mes brûlures me faisaient souffrir, mais c'était une souffrance différente de celle des brûlures ordinaires.
C'était une douleur sombre qui me semblait venue en quelque sorte d'en dehors de mon propre corps. Une espèce de pus jaune suppurait de mes mains, et je pensai que mon visage devait être aussi horrible à voir.
Autour de moi, sur le terrain, il y avait une quantité d'écoliers et de lycéens, garçons et filles, qui se débattaient dans les affres de l'agonie. C'étaient comme moi des membres du corps des volontaires de la défense antiaérienne. Je les entendais qui criaient, comme à moitié fous : " Maman, maman ! " Ils étaient tellement brûlés et saignants que les regarder était un spectacle insupportable. Comme tout de même je m'y forçai, une rage me saisit, je criai : " Pourquoi ? Pourquoi ces enfants ? " Mais je n'avais personne contre qui diriger ma fureur, et je ne pouvais rien faire que de les regarder mourir l'un après l'autre, appelant leur mère en vain.
Je me suis remise en marche, après être restée longtemps presque inconsciente sur le terrain militaire. Aussi loin que j'y voyais, d'une vue qui faiblissait, tout était en flammes, jusqu'à la gare d'Hiroshima et au quartier d'Atago. Il me semblait que peu à peu mon visage durcissait. Je portai les mains à mes joues avec précaution. Ma face me donna l'impression d'avoir doublé de volume. Mes yeux voyaient de moins en moins clair. Hélas ! j'allais donc devenir aveugle ? Après tant de peine, j'allais mourir ? Mais je continuai à marcher, et j'atteignis le quartier de banlieue d'Hésaka.
Dans ce quartier plus éloigné du centre, je retrouvai en vie ma soeur aînée, qui n'avait subi que des blessures légères à la tête et aux pieds. Au premier instant, elle ne me reconnaissait plus, puis elle éclata en sanglots. Sur une charrette à bras, elle me transporta, quatre kilomètres plus loin, au centre de secours de Yaga, où nous arrivâmes à la nuit.
Le 8 août, portée sur une civière, puis par le train, je fus transportée chez des parents, au village de Kasumi. Le docteur du village déclara que mon cas était sans espoir. Mes enfants, rappelés de leur lieu d'évacuation, accoururent auprès de moi. Je ne pouvais plus les voir, mais je pouvais seulement les reconnaître en sentant leur bonne odeur. Le 11 août, ce fut mon mari qui nous rejoignit. Les petits l'embrassaient en pleurant de joie.
Notre bonheur fut de courte durée. Mon mari, qui ne portait même pas trace de blessure, mourut subitement trois jours plus tard en vomissant son sang.
Je me dis : " Mes pauvres petits ! A cause de vous, je n'ai plus le droit de mourir ! " Encore et encore on me déclara perdue, mais finalement, par miracle, j'ai survécu. Ma vue est revenue assez vite et, au bout de vingt jours, je voyais vaguement les traits de mes enfants. Les brûlures de mon visage et de mes mains ne guérirent pas aussi vite. Vint l'automne, et les plaies restaient pulpeuses, on aurait dit de la tomate pourrie. C'est seulement en décembre que j'ai pu marcher de nouveau.
Quand, en janvier, on m'a enlevé mes bandages, j'ai su que mon visage et mes mains ne seraient plus jamais les mêmes. Mon oreille gauche est réduite de moitié. Une traînée de kéloïde, boursouflure brune, large comme ma main, va du côté de ma tête jusqu'à ma gorge en passant au travers de ma bouche. Ma main droite est barrée d'un kéloïde de cinq centimètres de longueur qui va du poignet jusqu'au petit doigt. Les cinq doigts de ma main gauche son maintenant soudés à la base.
Vinrent ensuite la misère et l'inflation d'après la guerre. Nous étions sur le point, mes enfants et moi, de nous faire mendiants, quand le journal de mon mari nous sauva la vie en me donnant un emploi. Jamais je n'oublierai cette joie. Je continue à travailler, avec toute la honte et l'humiliation de mon corps mutilé et affreux à voir, mais c'est pour mes pauvres enfants.
Le Monde du 6-7 août 1975
«
n'avais personne contre qui diriger ma fureur, et je ne pouvais rien faire que de les regarder mourir l'un après l'autre, appelant leurmère en vain.
Je me suis remise en marche, après être restée longtemps presque inconsciente sur le terrain militaire.
Aussi loin que j'y voyais,d'une vue qui faiblissait, tout était en flammes, jusqu'à la gare d'Hiroshima et au quartier d'Atago.
Il me semblait que peu à peumon visage durcissait.
Je portai les mains à mes joues avec précaution.
Ma face me donna l'impression d'avoir doublé de volume.Mes yeux voyaient de moins en moins clair.
Hélas ! j'allais donc devenir aveugle ? Après tant de peine, j'allais mourir ? Mais jecontinuai à marcher, et j'atteignis le quartier de banlieue d'Hésaka.
Dans ce quartier plus éloigné du centre, je retrouvai en vie ma soeur aînée, qui n'avait subi que des blessures légères à la tête etaux pieds.
Au premier instant, elle ne me reconnaissait plus, puis elle éclata en sanglots.
Sur une charrette à bras, elle metransporta, quatre kilomètres plus loin, au centre de secours de Yaga, où nous arrivâmes à la nuit.
Le 8 août, portée sur une civière, puis par le train, je fus transportée chez des parents, au village de Kasumi.
Le docteur duvillage déclara que mon cas était sans espoir.
Mes enfants, rappelés de leur lieu d'évacuation, accoururent auprès de moi.
Je nepouvais plus les voir, mais je pouvais seulement les reconnaître en sentant leur bonne odeur.
Le 11 août, ce fut mon mari qui nousrejoignit.
Les petits l'embrassaient en pleurant de joie.
Notre bonheur fut de courte durée.
Mon mari, qui ne portait même pas trace de blessure, mourut subitement trois jours plustard en vomissant son sang.
Je me dis : " Mes pauvres petits ! A cause de vous, je n'ai plus le droit de mourir ! " Encore et encore on me déclara perdue,mais finalement, par miracle, j'ai survécu.
Ma vue est revenue assez vite et, au bout de vingt jours, je voyais vaguement les traitsde mes enfants.
Les brûlures de mon visage et de mes mains ne guérirent pas aussi vite.
Vint l'automne, et les plaies restaientpulpeuses, on aurait dit de la tomate pourrie.
C'est seulement en décembre que j'ai pu marcher de nouveau.
Quand, en janvier, on m'a enlevé mes bandages, j'ai su que mon visage et mes mains ne seraient plus jamais les mêmes.
Monoreille gauche est réduite de moitié.
Une traînée de kéloïde, boursouflure brune, large comme ma main, va du côté de ma têtejusqu'à ma gorge en passant au travers de ma bouche.
Ma main droite est barrée d'un kéloïde de cinq centimètres de longueurqui va du poignet jusqu'au petit doigt.
Les cinq doigts de ma main gauche son maintenant soudés à la base.
Vinrent ensuite la misère et l'inflation d'après la guerre.
Nous étions sur le point, mes enfants et moi, de nous faire mendiants,quand le journal de mon mari nous sauva la vie en me donnant un emploi.
Jamais je n'oublierai cette joie.
Je continue à travailler,avec toute la honte et l'humiliation de mon corps mutilé et affreux à voir, mais c'est pour mes pauvres enfants.
Le Monde du 6-7 août 1975
CD-ROM L'Histoire au jour le jour © 2002, coédition Le Monde, Emme et IDM - Tous droits réservés.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Stendhal, LE ROUGE ET LE NOIR
- Les racines du Ciel de Romain Gary analyse écocritique
- Oral Stendhal Le Rouge et le noir
- les personnages féminins dans le rouge et le noir
- Analyse lineaire le rouge et le noir exipit