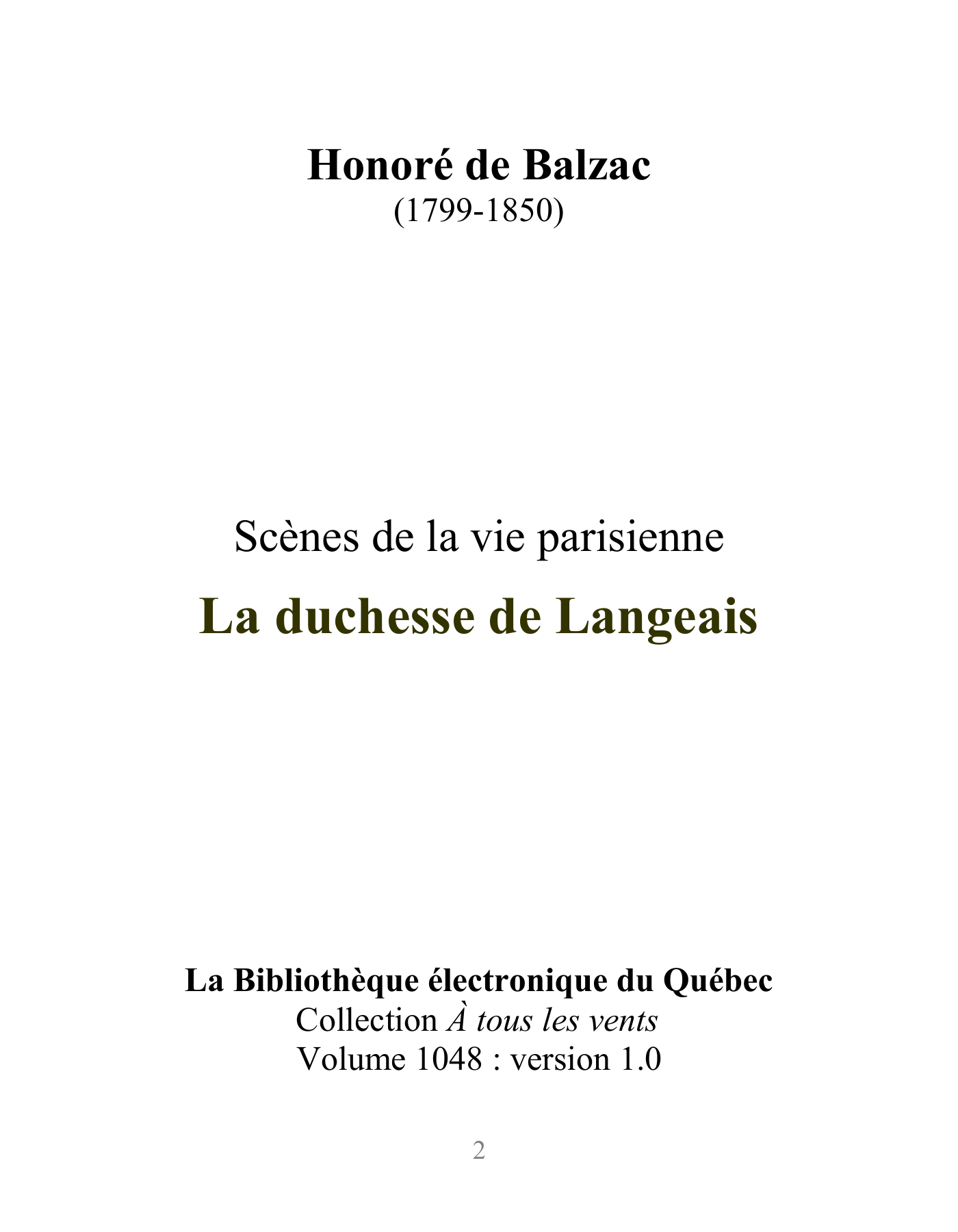duchesse
Publié le 10/06/2016
Extrait du document
Honoré de Balzac La duchesse de Langeais BeQ Honoré de Balzac (1799-1850) Scènes de la vie parisienne La duchesse de Langeais La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 1048 : version 1.0 2 La Duchesse de Langeais, deuxième épisode de l’Histoire des Treize, fait partie des Scènes de la vie parisienne. 3 La duchesse de Langeais Édition de référence : Éditions Rencontre, Lausanne, 1968. 4 À Franz Liszt. 5 Il existe dans une ville espagnole située sur une île de la Méditerranée, un couvent de Carmélites Déchaussées où la règle de l’Ordre institué par sainte Thérèse s’est conservée dans la rigueur primitive de la réformation due à cette illustre femme. Ce fait est vrai, quelque extraordinaire qu’il puisse paraître. Quoique les maisons religieuses de la Péninsule et celles du Continent aient été presque toutes détruites ou bouleversées par les éclats de la révolution française et des guerres napoléoniennes, cette île ayant été constamment protégée par la marine anglaise, son riche couvent et ses paisibles habitants se trouvèrent à l’abri des troubles et des spoliations générales. Les tempêtes de tout genre qui agitèrent les quinze premières années du dixneuvième siècle se brisèrent donc devant ce rocher, peu distant des côtes de l’Andalousie. Si le nom de l’Empereur vint bruire jusque sur cette plage, il est douteux que son fantastique cortège de gloire et les flamboyantes majestés de sa vie 6 météorique aient été comprises par les saintes filles agenouillées dans ce cloître. Une rigidité conventuelle que rien n’avait altérée recommandait cet asile dans toutes les mémoires du monde catholique. Aussi, la pureté de sa règle y attira-t-elle, des points les plus éloignés de l’Europe, de tristes femmes dont l’âme, dépouillée de tous liens humains, soupirait après ce long suicide accompli dans le sein de Dieu. Nul couvent n’était d’ailleurs plus favorable au détachement complet des choses d’ici-bas, exigé par la vie religieuse. Cependant, il se voit sur le Continent un grand nombre de ces maisons magnifiquement bâties au gré de leur destination. Quelques-unes sont ensevelies au fond des vallées les plus solitaires ; d’autres suspendues au-dessus des montagnes les plus escarpées, ou jetées au bord des précipices ; partout l’homme a cherché les poésies de l’infini, la solennelle horreur du silence ; partout il a voulu se mettre au plus près de Dieu : il l’a quêté sur les cimes, au fond des abîmes, au bord des falaises, et l’a trouvé partout. Mais nulle autre part que sur ce rocher à demi européen, africain à demi, ne 7 pouvaient se rencontrer autant d’harmonies différentes qui toutes concourussent à si bien élever l’âme, à en égaliser les impressions les plus douloureuses, à en attiédir les plus vives, à faire aux peines de la vie un lit profond. Ce monastère a été construit à l’extrémité de l’île, au point culminant du rocher, qui, par un effet de la grande révolution du globe, est cassé net du côté de la mer, où, sur tous les points, il présente les vives arêtes de ses tables légèrement rongées à la hauteur de l’eau, mais infranchissables. Ce roc est protégé de toute atteinte par des écueils dangereux qui se prolongent au loin, et dans lesquels se joue le flot brillant de la Méditerranée. Il faut donc être en mer pour apercevoir les quatre corps du bâtiment carré dont la forme, la hauteur, les ouvertures ont été minutieusement prescrites par les lois monastiques. Du côté de la ville, l’église masque entièrement les solides constructions du cloître, dont les toits sont couverts de larges dalles qui les rendent invulnérables aux coups de vent, aux orages et à l’action du soleil. L’église, due aux libéralités d’une famille espagnole, couronne la 8 ville. La façade hardie, élégante, donne une grande et belle physionomie à cette petite cité maritime. N’est-ce pas un spectacle empreint de toutes nos sublimités terrestres que l’aspect d’une ville dont les toits pressés, presque tous disposés en amphithéâtre devant un joli port, sont surmontés d’un magnifique portail à triglyphe gothique, à campaniles, à tours menues, à flèches découpées ? La religion dominant la vie, en en offrant sans cesse aux hommes la fin et les moyens, image tout espagnole d’ailleurs ! Jetez ce paysage au milieu de la Méditerranée, sous un ciel brûlant ; accompagnez-le de quelques palmiers, de plusieurs arbres rabougris, mais vivaces qui mêlaient leurs vertes frondaisons agitées aux feuillages sculptés de l’architecture immobile ! Voyez les franges de la mer blanchissant les récifs, et s’opposant au bleu saphir des eaux ; admirez les galeries, les terrasses bâties en haut de chaque maison et où les habitants viennent respirer l’air du soir parmi les fleurs, entre la cime des arbres de leurs petits jardins. Puis, dans le port, quelques voiles. Enfin, par la sérénité d’une nuit qui commence, écoutez 9 la musique des orgues, le chant des offices, et les sons admirables des cloches en pleine mer. Partout du bruit et du calme ; mais plus souvent le calme partout. Intérieurement, l’église se partageait en trois nefs sombres et mystérieuses. La furie des vents ayant sans doute interdit à l’architecte de construire latéralement ces arcsboutants qui ornent presque partout les cathédrales, et entre lesquels sont pratiquées des chapelles, les murs qui flanquaient les deux petites nefs et soutenaient ce vaisseau, n’y répandaient aucune lumière. Ces fortes murailles présentaient à l’extérieur l’aspect de leurs masses grisâtres, appuyées, de distance en distance, sur d’énormes contreforts. La grande nef et ses deux petites galeries latérales étaient donc uniquement éclairées par la rose à vitraux coloriés, attachée avec un art miraculeux au-dessus du portail, dont l’exposition favorable avait permis le luxe des dentelles de pierre et des beautés particulières à l’ordre improprement nommé gothique. La plus grande portion de ces trois nefs était livrée aux habitants de la ville, qui venaient y entendre la messe et les offices. Devant le chœur, se trouvait 10 une grille derrière laquelle pendait un rideau brun à plis nombreux, légèrement entrouvert au milieu, de manière à ne laisser voir que l’officiant et l’autel. La grille était séparée, à intervalles égaux, par des piliers qui soutenaient une tribune intérieure et les orgues. Cette construction, en harmonie avec les ornements de l’église, figurait extérieurement, en bois sculpté, les colonnettes des galeries supportées par les piliers de la grande nef. Il eût donc été impossible à un curieux assez hardi pour monter sur l’étroite balustrade de ces galeries de voir dans le chœur autre chose que les longues fenêtres octogones et coloriées qui s’élevaient par pans égaux, autour du maîtreautel. Lors de l’expédition française faite en Espagne pour rétablir l’autorité du roi Ferdinand VII, et après la prise de Cadix, un général français, venu dans cette île pour y faire reconnaître le gouvernement royal, y prolongea son séjour, dans le but de voir ce couvent, et trouva moyen de s’y introduire. L’entreprise était certes délicate. Mais un homme de passion, un homme dont la vie n’avait été, pour ainsi dire, 11 qu’une suite de poésies en action, et qui avait toujours fait des romans au lieu d’en écrire, un homme d’exécution surtout, devait être tenté par une chose en apparence impossible. S’ouvrir légalement les portes d’un couvent de femmes ? À peine le pape ou l’archevêque métropolitain l’eussent-ils permis. Employer la ruse ou la force ? en cas d’indiscrétion, n’était-ce pas perdre son état, toute sa fortune militaire, et manquer le but ? Le duc d’Angoulême était encore en Espagne, et de toutes les fautes que pouvait impunément commettre un homme aimé par le généralissime, celle-là seule l’eût trouvé sans pitié. Ce général avait sollicité sa mission afin de satisfaire une secrète curiosité, quoique jamais curiosité n’ait été plus désespérée. Mais cette dernière tentative était une affaire de conscience. La maison de ces Carmélites était le seul couvent espagnol qui eût échappé à ses recherches. Pendant la traversée, qui ne dura pas une heure, il s’éleva dans son âme un pressentiment favorable à ses espérances. Puis, quoique du couvent il n’eût vu que les murailles, que de ces religieuses il n’eût pas même aperçu les robes, et qu’il n’eût 12 écouté que les chants de la Liturgie, il rencontra sous ces murailles et dans ces chants de légers indices qui justifièrent son frêle espoir. Enfin, quelque légers que fussent des soupçons si bizarrement réveillés, jamais passion humaine ne fut plus violemment intéressée que ne l’était alors la curiosité du général. Mais il n’y a point de petits événements pour le cœur ; il grandit tout ; il met dans les mêmes balances la chute d’un empire de quatorze ans et la chute d’un gant de femme, et presque toujours le gant y pèse plus que l’empire. Or, voici les faits dans toute leur simplicité positive. Après les faits viendront les émotions. Une heure après que le général eut abordé cet îlot, l’autorité royale y fut rétablie. Quelques Espagnols constitutionnels, qui s’y étaient nuitamment réfugiés après la prise de Cadix, s’embarquèrent sur un bâtiment que le général leur permit de fréter pour s’en aller à Londres. Il n’y eut donc là ni résistance ni réaction. Cette petite Restauration insulaire n’allait pas sans une messe, à laquelle durent assister les deux compagnies commandées pour l’expédition. Or, 13 ne connaissant pas la rigueur de la clôture chez les Carmélites Déchaussées, le général avait espéré pouvoir obtenir, dans l’église, quelques renseignements sur les religieuses enfermées dans le couvent, dont une d’elles peut-être lui était plus chère que la vie et plus précieuse que l’honneur. Ses espérances furent d’abord cruellement déçues. La messe fut, à la vérité, célébrée avec pompe. En faveur de la solennité, les rideaux qui cachaient habituellement le chœur furent ouverts, et en laissèrent voir les richesses, les précieux tableaux et les chasses ornées de pierreries dont l’éclat effaçait celui des nombreux ex-voto d’or et d’argent attachés par les marins de ce port aux piliers de la grande nef. Les religieuses s’étaient toutes réfugiées dans la tribune de l’orgue. Cependant, malgré ce premier échec, durant la messe d’actions de grâces, se développa largement le drame le plus secrètement intéressant qui jamais ait fait battre un cœur d’homme. La sœur qui touchait l’orgue excita un si vif enthousiasme qu’aucun des militaires ne regretta d’être venu à l’office. Les soldats même y trouvèrent du plaisir, et tous les officiers furent 14 dans le ravissement. Quant au général, il resta calme et froid en apparence. Les sensations que lui causèrent les différents morceaux exécutés par la religieuse sont du petit nombre de choses dont l’expression est interdite à la parole, et la rend impuissante, mais qui, semblables à la mort, à Dieu, à l’Éternité, ne peuvent s’apprécier que dans le léger point de contact qu’elles ont avec les hommes. Par un singulier hasard, la musique des orgues paraissait appartenir à l’école de Rossini, le compositeur qui a transporté le plus de passion humaine dans l’art musical, et dont les œuvres inspireront quelque jour, par leur nombre et leur étendue, un respect homérique. Parmi les partitions dues à ce beau génie, la religieuse semblait avoir plus particulièrement étudié celle du Mose, sans doute parce que le sentiment de la musique sacrée s’y trouve exprimé au plus haut degré. Peut-être ces deux esprits, l’un si glorieusement européen, l’autre inconnu, s’étaient-ils rencontrés dans l’intuition d’une même poésie. Cette opinion était celle de deux officiers, vrais dilettanti, qui regrettaient sans doute en Espagne le théâtre Favart. Enfin, au Te 15 Deum, il fut impossible de ne pas reconnaître une âme française dans le caractère que prit soudain la musique. Le triomphe du Roi Très-Chrétien excitait évidemment la joie la plus vive au fond du cœur de cette religieuse. Certes elle était Française. Bientôt le sentiment de la patrie éclata, jaillit comme une gerbe de lumière dans une réplique des orgues où la sœur introduisit des motifs qui respirèrent toute la délicatesse du goût parisien, et auxquels se mêlèrent vaguement les pensées de nos plus beaux airs nationaux. Des mains espagnoles n’eussent pas mis, à ce gracieux hommage fait aux armes victorieuses, la chaleur qui acheva de déceler l’origine de la musicienne. – Il y a donc de la France partout ? dit un soldat. Le général était sorti pendant le Te Deum, il lui avait été impossible de l’écouter. Le jeu de la musicienne lui dénonçait une femme aimée avec ivresse, et qui s’était si profondément ensevelie au cœur de la religion et si soigneusement dérobée aux regards du monde, qu’elle avait 16 échappé jusqu’alors à des recherches obstinées adroitement faites par des hommes qui disposaient et d’un grand pouvoir et d’une intelligence supérieure. Le soupçon réveillé dans le cœur du général fut presque justifié par le vague rappel d’un air délicieux de mélancolie, l’air de Fleuve du Tage, romance française dont souvent il avait entendu jouer le prélude dans un boudoir de Paris à la personne qu’il aimait, et dont cette religieuse venait alors de se servir pour exprimer, au milieu de la joie des triomphateurs, les regrets d’une exilée. Terrible sensation ! Espérer la résurrection d’un amour perdu, le retrouver encore perdu, l’entrevoir mystérieusement, après cinq années pendant lesquelles la passion s’était irritée dans le vide, et agrandie par l’inutilité des tentatives faites pour la satisfaire ! Qui, dans sa vie, n’a pas, une fois au moins, bouleversé son chez-soi, ses papiers, sa maison, fouillé sa mémoire avec impatience en cherchant un objet précieux, et ressenti l’ineffable plaisir de le trouver, après un jour ou deux consumés en recherches vaines ; après avoir espéré, désespéré 17 de le rencontrer ; après avoir dépensé les irritations les plus vives de l’âme pour ce rien important qui causait presque une passion ? Eh ! bien, étendez cette espèce de rage sur cinq années ; mettez une femme, un cœur, un amour à la place de ce rien ; transportez la passion dans les plus hautes régions du sentiment ; puis supposez un homme ardent, un homme à cœur et face de lion, un de ces hommes à crinière qui imposent et communiquent à ceux qui les envisagent une respectueuse terreur ! Peut-être comprendrez-vous alors la brusque sortie du général pendant le Te Deum, au moment où le prélude d’une romance jadis écoutée avec délices par lui, sous des lambris dorés, vibra sous la nef de cette église marine. Il descendit la rue montueuse qui conduisait à cette église, et ne s’arrêta qu’au moment où les sons graves de l’orgue ne parvinrent plus à son oreille. Incapable de songer à autre chose qu’à son amour, dont la volcanique éruption lui brûlait le cœur, le général français ne s’aperçut de la fin du Te Deum qu’au moment où l’assistance espagnole descendit par flots. Il sentit que sa 18 conduite ou son attitude pouvaient paraître ridicules, et revint prendre sa place à la tête du cortège, en disant à l’alcade et au gouverneur de la ville qu’une subite indisposition l’avait obligé d’aller prendre l’air. Puis, afin de pouvoir rester dans l’île, il songea soudain à tirer parti de ce prétexte d’abord insouciamment donné. Objectant l’aggravation de son malaise, il refusa de présider le repas offert par les autorités insulaires aux officiers français ; il se mit au lit, et fit écrire au major général pour lui annoncer la passagère maladie qui le forçait de remettre à un colonel le commandement des troupes. Cette ruse si vulgaire, mais si naturelle, le rendit libre de tout soin pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de ses projets. En homme essentiellement catholique et monarchique, il s’informa de l’heure des offices et affecta le plus grand attachement aux pratiques religieuses, piété qui, en Espagne, ne devait surprendre personne. Le lendemain même, pendant le départ de ses soldats, le général se rendit au couvent pour assister aux vêpres. Il trouva l’église désertée par les habitants qui, malgré leur dévotion, étaient 19 allés voir sur le port l’embarcation des troupes. Le Français, heureux de se trouver seul dans l’église, eut soin d’en faire retentir les voûtes sonores du bruit de ses éperons ; il y marcha bruyamment, il toussa, il se parla tout haut à luimême pour apprendre aux religieuses, et surtout à la musicienne, que, si les Français partaient, il en restait un. Ce singulier avis fut-il entendu, compris ?... le général le crut. Au Magnificat, les orgues semblèrent lui faire une réponse qui lui fut apportée par les vibrations de l’air. L’âme de la religieuse vola vers lui sur les ailes de ses notes, et s’émut dans le mouvement des sons. La musique éclata dans toute sa puissance ; elle échauffa l’église. Ce chant de joie, consacré par la sublime liturgie de la Chrétienté Romaine pour exprimer l’exaltation de l’âme en présence des splendeurs du Dieu toujours vivant, devint l’expression d’un cœur presque effrayé de son bonheur, en présence des splendeurs d’un périssable amour qui durait encore et venait l’agiter au-delà de la tombe religieuse où s’ensevelissent les femmes pour renaître épouses du Christ. 20 L’orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout demander, il peut tout exprimer. N’est-ce pas, en quelque sorte, un piédestal sur lequel l’âme se pose pour s’élancer dans les espaces lorsque, dans son vol, elle essaie de tracer mille tableaux, de peindre la vie, de parcourir l’infini qui sépare le ciel de la terre ? Plus un poète en écoute les gigantesques harmonies, mieux il conçoit qu’entre les hommes agenouillés et le Dieu caché par les éblouissants rayons du Sanctuaire les cent voix de ce chœur terrestre peuvent seules combler les distances, et sont le seul truchement assez fort pour transmettre au ciel les prières humaines dans l’omnipotence de leurs modes, dans la diversité de leurs mélancolies, avec les teintes de leurs méditatives extases, avec les jets impétueux de leurs repentirs et les mille fantaisies de toutes les croyances. Oui, sous ces longues voûtes, les mélodies enfantées par le génie des choses saintes trouvent des grandeurs inouïes dont elles se parent et se fortifient. Là, le 21 jour affaibli, le silence profond, les chants qui alternent avec le tonnerre des orgues, font à Dieu comme un voile à travers lequel rayonnent ses lumineux attributs. Toutes ces richesses sacrées semblèrent être jetées comme un grain d’encens sur le frêle autel de l’Amour à la face du trône éternel d’un Dieu jaloux et vengeur. En effet, la joie de la religieuse n’eut pas ce caractère de grandeur et de gravité qui doit s’harmonier avec les solennités du Magnificat ; elle lui donna de riches, de gracieux développements, dont les différents rythmes accusaient une gaieté humaine. Ses motifs eurent le brillant des roulades d’une cantatrice qui tâche d’exprimer l’amour, et ses chants sautillèrent comme l’oiseau près de sa compagne. Puis, par moments, elle s’élançait par bonds dans le passé pour y folâtrer, pour y pleurer tour à tour. Son mode changeant avait quelque chose de désordonné comme l’agitation de la femme heureuse du retour de son amant. Puis, après les fugues flexibles du délire et les effets merveilleux de cette reconnaissance fantastique, l’âme qui parlait ainsi fit un retour sur elle-même. La musicienne, passant du majeur 22 au mineur, sut instruire son auditeur de sa situation présente. Soudain elle lui raconta ses longues mélancolies et lui dépeignit sa lente maladie morale. Elle avait aboli chaque jour un sens, retranché chaque nuit quelque pensée, réduit graduellement son cœur en cendres. Après quelques molles ondulations, sa musique prit, de teinte en teinte, une couleur de tristesse profonde. Bientôt les échos versèrent les chagrins à torrents. Enfin tout à coup les hautes notes firent détonner un concert de voix angéliques, comme pour annoncer à l’amant perdu, mais non pas oublié, que la réunion des deux âmes ne se ferait plus que dans les cieux : touchante espérance ! Vint l’Amen. Là, plus de joie ni de larmes dans les airs ; ni mélancolie, ni regrets. L’Amen fut un retour à Dieu ; ce dernier accord fut grave, solennel, terrible. La musicienne déploya tous les crêpes de la religieuse, et, après les derniers grondements des basses, qui firent frémir les auditeurs jusque dans leurs cheveux, elle sembla s’être replongée dans la tombe d’où elle était pour un moment sortie. Quand les airs eurent, par degrés, cessé leurs vibrations oscillatoires, vous 23 eussiez dit que l’église, jusque là lumineuse, rentrait dans une profonde obscurité. Le général avait été rapidement emporté par la course de ce vigoureux génie, et l’avait suivi dans les régions qu’il venait de parcourir. Il comprenait, dans toute leur étendue, les images dont abonda cette brûlante symphonie, et pour lui ces accords allaient bien loin. Pour lui, comme pour la sœur, ce poème était l’avenir, le présent et le passé. La musique, même celle du théâtre, n’est-elle pas, pour les âmes tendres et poétiques, pour les cœurs souffrants et blessés, un texte qu’ils développent au gré de leurs souvenirs ? S’il faut un cœur de poète pour faire un musicien, ne faut-il pas de la poésie et de l’amour pour écouter, pour comprendre les grandes œuvres musicales ? La Religion, l’Amour et la Musique ne sont-ils pas la triple expression d’un même fait, le besoin d’expansion dont est travaillée toute âme noble ? Ces trois poésies vont toutes à Dieu, qui dénoue toutes les émotions terrestres. Aussi cette sainte Trinité humaine participe-t-elle des grandeurs infinies de Dieu, que nous ne configurons jamais sans l’entourer des feux de 24 l’amour, des sistres d’or de la musique, de lumière et d’harmonie. N’est-il pas le principe et la fin de nos œuvres ? Le Français devina que, dans ce désert, sur ce rocher entouré par la mer, la religieuse s’était emparée de la musique pour y jeter le surplus de passion qui la dévorait. Était-ce un hommage fait à Dieu de son amour, était-ce le triomphe de l’amour sur Dieu ? questions difficiles à décider. Mais, certes, le général ne put douter qu’il ne retrouvât en ce cœur mort au monde une passion tout aussi brûlante que l’était la sienne. Les vêpres finies, il revint chez l’alcade, où il était logé. Restant d’abord en proie aux mille jouissances que prodigue une satisfaction longtemps attendue, péniblement cherchée, il ne vit rien au-delà. Il était toujours aimé. La solitude avait grandi l’amour dans ce cœur, autant que l’amour avait été grandi dans le sien par les barrières successivement franchies et mises par cette femme entre elle et lui ! Cet épanouissement de l’âme eut sa durée naturelle. Puis vint le désir de revoir cette femme, de la disputer à Dieu, de la lui ravir, projet téméraire qui plut à cet homme 25 audacieux. Après le repas, il se coucha pour éviter les questions, pour être seul, pour pouvoir penser sans trouble, et resta plongé dans les méditations les plus profondes, jusqu’au lendemain matin. Il ne se leva que pour aller à la messe. Il vint à l’église, il se plaça près de la grille ; son front touchait le rideau ; il aurait voulu le déchirer, mais il n’était pas seul : son hôte l’avait accompagné par politesse, et la moindre imprudence pouvait compromettre l’avenir de sa passion, en ruiner les nouvelles espérances. Les orgues se firent entendre, mais elles n’étaient plus touchées par les mêmes mains. La musicienne des deux jours précédents ne tenait plus le clavier. Tout fut pâle et froid pour le général. Sa maîtresse était-elle accablée par les mêmes émotions sous lesquelles succombait presque un vigoureux cœur d’homme ? Avait-elle si bien partagé, compris un amour fidèle et désiré, qu’elle en fût mourante sur son lit dans sa cellule ? Au moment où mille réflexions de ce genre s’élevaient dans l’esprit du Français, il entendit résonner près de lui la voix de la personne qu’il adorait, il en reconnut le 26 timbre clair. Cette voix, légèrement altérée par un tremblement qui lui donnait toutes les grâces que prête aux jeunes filles leur timidité pudique, tranchait sur la masse du chant, comme celle d’une prima donna sur l’harmonie d’un finale. Elle faisait à l’âme l’effet que produit aux yeux un filet d’argent ou d’or dans une frise obscure. C’était donc bien elle ! Toujours Parisienne, elle n’avait pas dépouillé sa coquetterie, quoiqu’elle eût quitté les parures du monde pour le bandeau, pour la dure étamine des Carmélites. Après avoir signé son amour la veille, au milieu des louanges adressées au Seigneur, elle semblait dire à son amant : – Oui, c’est moi, je suis là, j’aime toujours : mais je suis à l’abri de l’amour. Tu m’entendras, mon âme t’enveloppera, et je resterai sous le linceul brun de ce chœur d’où nul pouvoir ne saurait m’arracher. Tu ne me verras pas. – C’est bien elle ! se dit le général en relevant son front, en le dégageant de ses mains, sur lesquelles il l’avait appuyé ; car il n’avait pu d’abord soutenir l’écrasante émotion qui s’éleva comme un tourbillon dans son cœur quand cette 27 voix connue vibra sous les arceaux, accompagnée par le murmure des vagues. L’orage était au dehors, et le calme dans le sanctuaire. Cette voix si riche continuait à déployer toutes ses câlineries, elle arrivait comme un baume sur le cœur embrasé de cet amant, elle fleurissait dans l’air, qu’on désirait mieux aspirer pour y reprendre les émanations d’une âme exhalée avec amour dans les paroles de la prière. L’alcade vint rejoindre son hôte, il le trouva fondant en larmes à l’Élévation, qui fut chantée par la religieuse, et l’emmena chez lui. Surpris de rencontrer tant de dévotion dans un militaire français, l’alcade avait invité à souper le confesseur du couvent, et il en prévint le général, auquel jamais nouvelle n’avait fait autant de plaisir. Pendant le souper, le confesseur fut l’objet des attentions du Français, dont le respect intéressé confirma les Espagnols dans la haute opinion qu’ils avaient prise de sa piété. Il demanda gravement le nombre des religieuses, des détails sur les revenus du couvent et sur ses richesses, en homme qui paraissait vouloir entretenir poliment le bon vieux prêtre des choses dont il devait être le plus occupé. Puis 28 il s’informa de la vie que menaient ces saintes filles. Pouvaient-elles sortir ? les voyait-on ? – Seigneur, dit le vénérable ecclésiastique, la règle est sévère. S’il faut une permission de Notre Saint-Père pour qu’une femme vienne dans une maison de Saint-Bruno, ici même rigueur. Il est impossible à un homme d’entrer dans un couvent de Carmélites Déchaussées, à moins qu’il ne soit prêtre et attaché par l’archevêque au service de la Maison. Aucune religieuse ne sort. Cependant la grande sainte (la mère Thérèse) a souvent quitté sa cellule. Le Visiteur ou les Mères Supérieures peuvent seules permettre à une religieuse, avec l’autorisation de l’archevêque, de voir des étrangers, surtout en cas de maladie. Or nous sommes un Chef d’Ordre, et nous avons conséquemment une Mère Supérieure au Couvent. Nous avons, entre autres étrangères, une Française, la sœur Thérèse, celle qui dirige la musique de la Chapelle. – Ah ! répondit le général en feignant la surprise. Elle a dû être satisfaite du triomphe des armes de la maison de Bourbon ? 29 – Je leur ai dit l’objet de la messe, elles sont toujours un peu curieuses. – Mais la sœur Thérèse peut avoir des intérêts en France, elle voudrait peut-être y faire savoir quelque chose, en demander des nouvelles ? – Je ne le crois pas, elle se serait adressée à moi pour en savoir. – En qualité de compatriote, dit le général, je serais bien curieux de la voir... Si cela est possible, si la Supérieure y consent, si... – À la grille, et même en présence de la Révérende Mère, une entrevue serait impossible pour qui que ce soit ; mais en faveur d’un libérateur du trône catholique et de la sainte religion, malgré la rigidité de la Mère, la règle peut dormir un moment, dit le confesseur en clignant les yeux. J’en parlerai. – Quel âge a la sœur Thérèse ? demanda l’amant qui n’osa pas questionner le prêtre sur la beauté de la religieuse. – Elle n’a plus d’âge, répondit le bonhomme avec une simplicité qui fit frémir le général. 30 Le lendemain matin, avant la sieste, le confesseur vint annoncer au Français que la sœur Thérèse et la Mère consentaient à le recevoir à la grille du parloir, avant l’heure des vêpres. Après la sieste, pendant laquelle le général dévora le temps en allant se promener sur le port, par la chaleur du midi, le prêtre revint le chercher, et l’introduisit dans le couvent ; il le guida sous une galerie qui longeait le cimetière, et dans laquelle quelques fontaines, plusieurs arbres verts et des arceaux multipliés entretenaient une fraîcheur en harmonie avec le silence du lieu. Parvenus au fond de cette longue galerie, le prêtre fit entrer son compagnon dans une salle partagée en deux parties par une grille couverte d’un rideau brun. Dans la partie en quelque sorte publique, où le confesseur laissa le général, régnait, le long du mur, un banc de bois ; quelques chaises également en bois se trouvaient près de la grille. Le plafond était composé de solives saillantes, en chêne vert, et sans nul ornement. Le jour ne venait dans cette salle que par deux fenêtres situées dans la partie affectée aux religieuses, en sorte que cette faible lumière, mal reflétée par un 31 bois à teintes brunes, suffisait à peine pour éclairer le grand Christ noir, le portrait de sainte Thérèse et un tableau de la Vierge qui décoraient les parois grises du parloir. Les sentiments du général prirent donc, malgré leur violence, une couleur mélancolique. Il devint calme dans ce calme domestique. Quelque chose de grand comme la tombe le saisit sous ces frais planchers. N’était-ce pas son silence éternel, sa paix profonde, ses idées d’infini ? Puis, la quiétude et la pensée fixe du cloître, cette pensée qui se glisse dans l’air, dans le clair-obscur, dans tout, et qui, n’étant tracée nulle part, est encore agrandie par l’imagination, ce grand mot : la paix dans le Seigneur, entre là, de vive force, dans l’âme la moins religieuse. Les couvents d’hommes se conçoivent peu ; l’homme y semble faible : il est né pour agir, pour accomplir une vie de travail à laquelle il se soustrait dans sa cellule. Mais dans un monastère de femmes, combien de vigueur virile et de touchante faiblesse ! Un homme peut être poussé par mille sentiments au fond d’une abbaye, il s’y jette comme dans un précipice ; mais la femme n’y vient jamais qu’entraînée par 32 un seul sentiment : elle ne s’y dénature pas, elle épouse Dieu. Vous pouvez dire aux religieux : Pourquoi n’avez-vous pas lutté ? Mais la réclusion d’une femme n’est-elle pas toujours une lutte sublime ? Enfin, le général trouva ce parloir muet et ce couvent perdu dans la mer tout pleins de lui. L’amour arrive rarement à la solennité ; mais l’amour encore fidèle au sein de Dieu, n’était-ce pas quelque chose de solennel, et plus qu’un homme n’avait le droit d’espérer au dixneuvième siècle, par les mœurs qui courent ? Les grandeurs infinies de cette situation pouvaient agir sur l’âme du général, il était précisément assez élevé pour oublier la politique, les honneurs, l’Espagne, le monde de Paris, et monter jusqu’à la hauteur de ce dénouement grandiose. D’ailleurs, quoi de plus véritablement tragique ? Combien de sentiments dans la situation des deux amants seuls réunis au milieu de la mer sur un banc de granit, mais séparés par une idée, par une barrière infranchissable ! Voyez l’homme se disant : – Triompherai-je de Dieu dans ce cœur ? Un léger bruit fit tressaillir cet homme, le rideau brun se tira ; puis il vit dans la 33 lumière une femme debout, mais dont la figure lui était cachée par le prolongement du voile plié sur la tête : suivant la règle de la maison, elle était vêtue de cette robe dont la couleur est devenue proverbiale. Le général ne put apercevoir les pieds nus de la religieuse, qui lui en auraient attesté l’effrayante maigreur ; cependant, malgré les plis nombreux de la robe grossière qui couvrait et ne parait plus cette femme, il devina que les larmes, la prière, la passion, la vie solitaire l’avaient déjà desséchée. La main glacée d’une femme, celle de la Supérieure sans doute, tenait encore le rideau ; et le général, ayant examiné le témoin nécessaire de cet entretien, rencontra le regard noir et profond d’une vieille religieuse, presque centenaire, regard clair et jeune, qui démentait les rides nombreuses par lesquelles le pâle visage de cette femme était sillonné. – Madame la duchesse, demanda-t-il d’une voix fortement émue à la religieuse qui baissait la tête, votre compagne entend-elle le français ? – Il n’y a pas de duchesse ici, répondit la 34 religieuse. Vous êtes devant la sœur Thérèse. La femme, celle que vous nommez ma compagne, est ma Mère en Dieu, ma Supérieure ici-bas. Ces paroles, si humblement prononcées par la voix qui jadis s’harmoniait avec le luxe et l’élégance au milieu desquels avait vécu cette femme, reine de la mode à Paris, par une bouche dont le langage était jadis si léger, si moqueur, frappèrent le général comme l’eût fait un coup de foudre. – Ma sainte mère ne parle que le latin et l’espagnol, ajouta-t-elle. – Je ne sais ni l’un ni l’autre. Ma chère Antoinette, excusez-moi près d’elle. En entendant son nom doucement prononcé par un homme naguère si dur pour elle, la religieuse éprouva une vive émotion intérieure que trahirent les légers tremblements de son voile, sur lequel la lumière tombait en plein. – Mon frère, dit-elle en portant sa manche sous son voile pour s’essuyer les yeux peut-être, je me nomme la sœur Thérèse... 35 Puis elle se tourna vers la mère, et lui dit, en espagnol, ces paroles que le général entendait parfaitement ; il en savait assez pour le comprendre, et peut-être aussi pour le parler : – Ma chère mère, ce cavalier vous présente ses respects, et vous prie de l’excuser de ne pouvoir les mettre lui-même à vos pieds ; mais il ne sait aucune des deux langues que vous parlez... La vieille inclina la tête lentement, sa physionomie prit une expression de douceur angélique, rehaussée néanmoins par le sentiment de sa puissance et de sa dignité. – Tu connais ce cavalier ? lui demanda la Mère en lui jetant un regard pénétrant. – Oui, ma mère. – Rentre dans ta cellule, ma fille ! dit la Supérieure d’un ton impérieux. Le général s’effaça vivement derrière le rideau, pour ne pas laisser deviner sur son visage les émotions terribles qui l’agitaient ; et, dans l’ombre, il croyait voir encore les yeux perçants de la Supérieure. Cette femme, maîtresse de la 36 fragile et passagère félicité dont la conquête coûtait tant de soins, lui avait fait peur, et il tremblait, lui qu’une triple rangée de canons n’avait jamais effrayé. La duchesse marchait vers la porte, mais elle se retourna : – Ma Mère, ditelle d’un ton de voix horriblement calme, ce Français est un de mes frères. – Reste donc, ma fille ! répondit la vieille femme après une pause. Cet admirable jésuitisme accusait tant d’amour et de regrets, qu’un homme moins fortement organisé que ne l’était le général se serait senti défaillir en éprouvant de si vifs plaisirs au milieu d’un immense péril, pour lui tout nouveau. De quelle valeur étaient donc les mots, les regards, les gestes dans une scène où l’amour devait échapper à des yeux de lynx, à des griffes de tigre ! La sœur Thérèse revint. – Vous voyez, mon frère, ce que j’ose faire pour vous entretenir un moment de votre salut, et des vœux que mon âme adresse pour vous chaque jour au ciel. Je commets un péché mortel. J’ai menti. Combien de jours de pénitence pour 37 effacer ce mensonge ! mais ce sera souffrir pour vous. Vous ne savez pas, mon frère, quel bonheur est d’aimer dans le ciel, de pouvoir s’avouer ses sentiments alors que la religion les a purifiés, les a transportés dans les régions les plus hautes, et qu’il nous est permis de ne plus regarder qu’à l’âme. Si les doctrines, si l’esprit de la sainte à laquelle nous devons cet asile ne m’avaient pas enlevée loin des misères terrestres, et ravie bien loin de la sphère où elle est, mais certes au-dessus du monde, je ne vous eusse pas revu. Mais je puis vous voir, vous entendre et demeurer calme.... – Hé ! bien, Antoinette, s’écria le général en l’interrompant à ces mots, faites que je vous voie, vous que j’aime maintenant avec ivresse, éperdument, comme vous avez voulu être aimée par moi. – Ne m’appelez pas Antoinette, je vous en supplie. Les souvenirs du passé me font mal. Ne voyez ici que la sœur Thérèse, une créature confiante en la miséricorde divine. Et, ajouta-telle après une pause, modérerez-vous, mon frère. Notre Mère nous séparerait impitoyablement, si 38 votre visage trahissait des passions mondaines, ou si vos yeux laissaient tomber des pleurs. Le général inclina la tête comme pour se recueillir. Quand il leva les yeux sur la grille, il aperçut, entre deux barreaux, la figure amaigrie, pâle, mais ardente encore de la religieuse. Son teint, où jadis fleurissaient tous les enchantements de la jeunesse, où l’heureuse opposition d’un blanc mat contrastait avec les couleurs de la rose du Bengale, avait pris le ton chaud d’une coupe de porcelaine sous laquelle est enfermée une faible lumière. La belle chevelure dont cette femme était si fière avait été rasée. Un bandeau ceignait son front et enveloppait son visage. Ses yeux, entourés d’une meurtrissure due aux austérités de cette vie, lançaient, par moments, des rayons fiévreux, et leur calme habituel n’était qu’un voile. Enfin, de cette femme il ne restait que l’âme. – Ah ! vous quitterez ce tombeau, vous qui êtes devenue ma vie ! Vous m’apparteniez, et n’étiez pas libre de vous donner, même à Dieu. Ne m’avez-vous pas promis de sacrifier tout au 39 moindre de mes commandements ? Maintenant vous me trouverez peut-être digne de cette promesse, quand vous saurez ce que j’ai fait pour vous. Je vous ai cherchée dans le monde entier. Depuis cinq ans, vous êtes ma pensée de tous les instants, l’occupation de ma vie. Mes amis, des amis bien puissants, vous le savez, m’ont aidé de toute leur force à fouiller les couvents de France, d’Italie, d’Espagne, de Sicile, de l’Amérique. Mon amour s’allumait plus vif à chaque recherche vaine ; j’ai souvent fait de longs voyages sur un faux espoir, j’ai dépensé ma vie et les plus larges battements de mon cœur autour des murailles de plusieurs cloîtres. Je ne vous parle pas d’une fidélité sans bornes, qu’est-ce ? un rien en comparaison des vœux infinis de mon amour. Si vous avez été vraie jadis dans vos remords, vous ne devez pas hésiter à me suivre aujourd’hui. – Vous oubliez que je ne suis pas libre. – Le duc est mort, répondit-il vivement. La sœur Thérèse rougit. – Que le ciel lui soit ouvert, dit-elle avec une 40 vive émotion, il a été généreux pour moi. Mais je ne parlais pas de ces liens, une de mes fautes a été de vouloir les briser tous sans scrupule pour vous. – Vous parlez de vos vœux, s’écria le général en fronçant les sourcils. Je ne croyais pas que quelque chose vous pesât au cœur plus que votre amour. Mais n’en doutez pas, Antoinette, j’obtiendrai du Saint-Père un bref qui déliera vos serments. J’irai certes à Rome, j’implorerai toutes les puissances de la terre ; et si Dieu pouvait descendre, je le... – Ne blasphémez pas. – Ne vous inquiétez donc pas de Dieu ! Ah ! j’aimerais bien mieux savoir que vous franchiriez pour moi ces murs ; que, ce soir même, vous vous jetteriez dans une barque au bas des rochers. Nous irions être heureux je ne sais où, au bout du monde ! Et, près de moi, vous reviendriez à la vie, à la santé, sous les ailes de l’Amour. – Ne parlez pas ainsi, reprit la sœur Thérèse, vous ignorez ce que vous êtes devenu pour moi. Je vous aime bien mieux que je ne vous ai jamais 41 aimé. Je prie Dieu tous les jours pour vous et je ne vous vois plus avec les yeux du corps. Si vous connaissiez, Armand, le bonheur de pouvoir se livrer sans honte à une amitié pure que Dieu protège ! Vous ignorez combien je suis heureuse d’appeler les bénédictions du ciel sur vous. Je ne prie jamais pour moi : Dieu fera de moi suivant ses volontés. Mais vous, je voudrais, au prix de mon éternité, avoir quelque certitude que vous êtes heureux en ce monde, et que vous serez heureux en l’autre, pendant tous les siècles. Ma vie éternelle est tout ce que le malheur m’a laissé à vous offrir. Maintenant, je suis vieillie dans les larmes, je ne suis plus ni jeune ni belle ; d’ailleurs vous mépriseriez une religieuse devenue femme, qu’aucun sentiment, même l’amour maternel, n’absoudrait pas.... Que me direz-vous qui puisse balancer les innombrables réflexions accumulées dans mon cœur depuis cinq années, et qui l’ont changé, creusé, flétri ? J’aurais dû le donner moins triste à Dieu ! – Ce que je dirai, ma chère Antoinette ! je dirai que je t’aime ; que l’affection, l’amour, l’amour vrai, le bonheur de vivre dans un cœur 42 tout à nous, entièrement à nous, sans réserve, est si rare et si difficile à rencontrer, que j’ai douté de toi, que je t’ai soumise à de rudes épreuves ; mais aujourd’hui je t’aime de toute les puissances de mon âme : si tu me suis dans la retraite, je n’entendrai plus d’autre voix que la tienne, je ne verrai plus d’autre visage que le tien... – Silence, Armand ! Vous abrégez le seul instant pendant lequel il nous sera permis de nous voir ici-bas. – Antoinette, veux-tu me suivre ? – Mais je ne vous quitte pas. Je vis dans votre cœur, mais autrement que par un intérêt de plaisir mondain, de vanité, de jouissance égoïste ; je vis ici pour vous, pâle et flétrie, dans le sein de Dieu ! S’il est juste, vous serez heureux... – Phrases que tout cela ! Et si je te veux pâle et flétrie ? Et si je ne puis être heureux qu’en te possédant ? Tu connaîtras donc toujours des devoirs en présence de ton amant ? Il n’est donc jamais au-dessus de tout dans ton cœur ? Naguère, tu lui préférais la société, toi, je ne sais quoi ; maintenant, c’est Dieu, c’est mon salut. 43 Dans la sœur Thérèse, je reconnais toujours la duchesse ignorante des plaisirs de l’amour, et toujours insensible sous les apparences de la sensibilité. Tu ne m’aimes pas, tu n’as jamais aimé... – Ha, mon frère... – Tu ne veux pas quitter cette tombe, tu aimes mon âme, dis-tu ? Eh ! bien, tu la perdras à jamais, cette âme, je me tuerai... – Ma mère, cria la sœur Thérèse en espagnol, je vous ai menti, cet homme est mon amant ! Aussitôt le rideau tomba. Le général, demeuré stupide, entendit à peine les portes intérieures se fermant avec violence. – Ah ! elle m’aime encore ! s’écria-t-il en comprenant tout ce qu’il y avait de sublime dans le cri de la religieuse. Il faut l’enlever d’ici... Le général quitta l’île, revint au quartiergénéral, il allégua des raison de santé, demanda un congé et retourna promptement en France. Voici maintenant l’aventure qui avait déterminé la situation respective où se trouvaient 44 alors les deux personnages de cette scène. Ce que l’on nomme en France le faubourg Saint-Germain n’est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place Royale, le faubourg SaintHonoré, la Chaussée-d’Antin possèdent également des hôtels où se respire l’air du faubourg Saint-Germain. Ainsi, déjà tout le faubourg n’est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s’agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies. Les manières, le parler, en un mot la tradition faubourg Saint-Germain est à Paris, depuis environ quarante ans, ce que la Cour y était jadis, ce qu’était l’hôtel Saint-Paul dans le quatorzième siècle, le Louvre au quinzième, le Palais, l’hôtel Rambouillet, la place Royale au seizième, puis Versailles au dix-septième et au dix-huitième siècle. À toutes les phases de l’histoire, le Paris de la haute classe et de la noblesse a eu son centre, comme le Paris vulgaire aura toujours le sien. Cette singularité périodique offre une ample matière aux réflexions de ceux 45 qui veulent observer ou peindre les différentes zones sociales ; et peut-être ne doit-on pas en rechercher les causes seulement pour justifier le caractère de cette aventure, mais aussi pour servir à de graves intérêts, plus vivaces dans l’avenir que dans le présent, si toutefois l’expérience n’est pas un non-sens pour les partis comme pour la jeunesse. Les grands seigneurs et les gens riches, qui singeront toujours les grands seigneurs, ont, à toutes les époques, éloigné leurs maisons des endroits très habités. Si le duc d’Uzès se bâtit, sous le règne de Louis XIV, le bel hôtel à la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre, acte de bienfaisance qui le rendit, outre ses vertus, l’objet d’une vénération si populaire que le quartier suivit en masse son convoi, ce coin de Paris était alors désert. Mais aussitôt que les fortifications s’abattirent, que les marais situés au-delà des boulevards s’emplirent de maisons, la famille d’Uzès quitta ce bel hôtel, habité de nos jours par un banquier. Puis la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place Royale, les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son 46 aise dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s’étaient élevés autour de l’hôtel bâti par Louis XIV au duc du Maine, le Benjamin de ses légitimés. Pour les gens accoutumés aux splendeurs de la vie, est-il en effet rien de plus ignoble que le tumulte, la boue, les cris, la mauvaise odeur, l’étroitesse des rues populeuses ? Les habitudes d’un quartier marchand ou manufacturier ne sont-elles pas constamment en désaccord avec les habitudes des Grands ? Le Commerce et le Travail se couchent au moment où l’aristocratie songe à dîner, les uns s’agitent bruyamment quand l’autre se repose ; leurs calculs ne se rencontrent jamais, les uns sont la recette, et l’autre est la dépense. De là des mœurs diamétralement opposées. Cette observation n’a rien de dédaigneux. Une aristocratie est en quelque sorte la pensée d’une société, comme la bourgeoisie et les prolétaires en sont l’organisme et l’action. De là des sièges différents pour ces forces ; et, de leur antagonisme, vient une antipathie apparente que produit la diversité de mouvements faits néanmoins dans un but commun. Ces 47 discordances sociales résultent si logiquement de toute charte constitutionnelle, que le libéral le plus disposé à s’en plaindre, comme d’un attentat envers les sublimes idées sous lesquelles les ambitieux des classes inférieures cachent leurs desseins, trouverait prodigieusement ridicule à monsieur le prince de Montmorency de demeurer rue Saint-Martin, au coin de la rue qui porte son nom, ou à monsieur le duc de Fitz-James, le descendant de la race royale écossaise, d’avoir son hôtel rue Marie-Stuart, au coin de la rue Montorgueil. Sint ut sunt, aut non sint, ces belles paroles pontificales peuvent servir de devise aux Grands de tous les pays. Ce fait, patent à chaque époque, et toujours accepté par le peuple, porte en lui des raisons d’état : il est à la fois un effet et une cause, un principe et une loi. Les masses ont un bon sens qu’elles ne désertent qu’au moment où les gens de mauvaise foi les passionnent. Ce bon sens repose sur des vérités d’un ordre général, vraies à Moscou comme à Londres, vraies à Genève comme à Calcutta. Partout, lorsque vous rassemblerez des familles d’inégale fortune sur un espace donné, vous verrez se 48 former des cercles supérieurs, des patriciens, des première, seconde et troisième sociétés. L’égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saura le convertir en fait. Il serait bien utile pour le bonheur de la France d’y populariser cette pensée. Aux masses les moins intelligentes se révèlent encore les bienfaits de l’harmonie politique. L’harmonie est la poésie de l’ordre, et les peuples ont un vif besoin d’ordre. La concordance des choses entre elles, l’unité, pour tout dire en un mot, n’est-elle pas la plus simple expression de l’ordre ? L’Architecture, la musique, la poésie, tout dans la France s’appuie, plus qu’en aucun autre pays, sur ce principe, qui d’ailleurs est écrit au fond de son clair et pur langage, et la langue sera toujours la plus infaillible formule d’une nation. Aussi, voyezvous le peuple y adoptant les airs les plus poétiques, les mieux modulés ; s’attachant aux idées les plus simples ; aimant les motifs incisifs qui contiennent le plus de pensées. La France est le seul pays où quelque petite phrase puisse faire une grande révolution. Les masses ne s’y sont jamais révoltées que pour essayer de mettre 49 d’accord les hommes, les choses et les principes. Or, nulle autre nation ne sent mieux la pensée d’unité qui doit exister dans la vie aristocratique, peut-être parce que nulle autre n’a mieux compris les nécessités politiques : l’histoire ne la trouvera jamais en arrière. La France est souvent trompée, mais comme une femme l’est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d’abord au calcul. Ainsi déjà, pour premier trait caractéristique, le faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses hôtels, ses grands jardins, leur silence, jadis en harmonie avec la magnificence de ses fortunes territoriales. Cet espace mis entre une classe et toute une capitale n’est-il pas une consécration matérielle des distances morales qui doivent les séparer ? Dans toutes les créations, la tête a sa place marquée. Si par hasard une nation fait tomber son chef à ses pieds, elle s’aperçoit tôt ou tard qu’elle s’est suicidée. Comme les nations ne veulent pas mourir, elles travaillent alors à se refaire une tête. Quand la nation n’en a plus la force, elle périt, comme ont péri Rome, Venise et tant d’autres. La distinction introduite par la 50 différence des mœurs entre les autres sphères d’activité sociale et la sphère supérieure implique nécessairement une valeur réelle, capitale, chez les sommités aristocratiques. Dès qu’en tout l’État, sous quelque forme qu’affecte le Gouvernement, les patriciens manquent à leurs conditions de supériorité complète, ils deviennent sans force, et le peuple les renverse aussitôt. Le peuple veut toujours leur voir aux mains, au cœur et à la tête, la fortune, le pouvoir et l’action ; la parole, l’intelligence et la gloire. Sans cette triple puissance, tout privilège s’évanouit. Les peuples, comme les femmes, aiment la force en quiconque les gouverne, et leur amour ne va pas sans le respect ; ils n’accordent point leur obéissance à qui ne l’impose pas. Une aristocratie mésestimée est comme un roi fainéant, un mari en jupon ; elle est nulle avant de n’être rien. Ainsi, la séparation des Grands, leurs mœurs tranchées ; en un mot, le costume général des castes patriciennes est tout à la fois le symbole d’une puissance réelle, et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Le faubourg Saint-Germain s’est laissé momentanément abattre pour n’avoir pas voulu 51 reconnaître les obligations de son existence qu’il lui était encore facile de perpétuer. Il devait avoir la bonne foi de voir à temps, comme le vit l’aristocratie anglaise, que les institutions ont leurs années climatériques où les mêmes mots n’ont plus les mêmes significations, où les idées prennent d’autres vêtements, et où les conditions de la vie politique changent totalement de forme, sans que le fond soit essentiellement altéré. Ces idées veulent des développements qui appartiennent essentiellement à cette aventure, dans laquelle ils entrent, et comme définition des causes, et comme explication des faits. Le grandiose des châteaux et des palais aristocratiques, le luxe de leurs détails, la somptuosité constante des ameublements, l’aire dans laquelle s’y meut sans gêne, et sans éprouver de froissement, l’heureux propriétaire, riche avant de naître ; puis l’habitude de ne jamais descendre au calcul des intérêts journaliers et mesquins de l’existence, le temps dont il dispose, l’instruction supérieure peut prématurément acquérir ; enfin les traditions patriciennes qui lui donnent des forces sociales 52 que ses adversaires compensent à peine par des études, par une volonté, par une vocation tenaces ; tout devrait élever l’âme de l’homme qui, dès le jeune âge, possède de tels privilèges, lui imprimer ce haut respect de lui-même dont la moindre conséquence est une noblesse de cœur en harmonie avec la noblesse du nom. Cela est vrai pour quelques familles. Çà et là, dans le faubourg Saint-Germain, se rencontrent de beaux caractères, exceptions qui prouvent contre l’égoïsme général qui a causé la perte de ce monde à part. Ces avantages sont acquis à l’aristocratie française, comme à toutes les efflorescences patriciennes qui se produiront à la surface des nations aussi longtemps qu’elles assiéront leur existence sur le domaine, le domaine-sol comme le domaine-argent, seule base solide d’une société régulière ; mais ces avantages ne demeurent aux patriciens de toute sorte qu’autant qu’ils maintiennent les conditions auxquelles le peuple les leur laisse. C’est des espèces de fiefs moraux dont la tenure oblige envers le souverain, et ici le souverain est certes aujourd’hui le peuple. Les temps sont changés, et 53 aussi les armes. Le Banneret à qui suffisait jadis de porter la cotte de maille, le haubert, de bien manier la lance et de montrer son pennon, doit aujourd’hui faire preuve d’intelligence ; et là où il n’était besoin que d’un grand cœur, il faut, de nos jours, un large crâne. L’art, la science et l’argent forment le triangle social où s’inscrit l’écu du pouvoir, et d’où doit procéder la moderne aristocratie. Un beau théorème vaut un grand nom. Les Fugger modernes sont princes de fait. Un grand artiste est réellement un oligarque, il représente tout un siècle, et devient presque toujours une loi. Ainsi, le talent de la parole, les machines à haute pression de l’écrivain, le génie du poète, la constance du commerçant, la volonté de l’homme d’État qui concentre en lui mille qualités éblouissantes, le glaive du général, ces conquêtes personnelles faites par un seul sur toute la société pour lui imposer, la classe aristocratique doit s’efforcer d’en avoir aujourd’hui le monopole, comme jadis elle avait celui de la force matérielle. Pour rester à la tête d’un pays, ne faut-il pas être toujours digne de le conduire ; en être l’âme et l’esprit, pour en faire 54 agir les mains ? Comment mener un peuple sans avoir les puissances qui font le commandement ? Que serait le bâton des maréchaux sans la force intrinsèque du capitaine qui le tient à la main ? Le faubourg Saint-Germain a joué avec des bâtons, en croyant qu’ils étaient tout le pouvoir. Il avait renversé les termes de la proposition qui commande son existence. Au lieu de jeter les insignes qui choquaient le peuple et de garder secrètement la force, il a laissé saisir la force à la bourgeoisie, s’est cramponné fatalement aux insignes, et a constamment oublié les lois que lui imposait sa faiblesse numérique. Une aristocratie, qui personnellement fait à peine le millième d’une société, doit aujourd’hui, comme jadis, y multiplier ses moyens d’action pour y opposer, dans les grandes crises, un poids égal à celui des masses populaires. De nos jours, les moyens d’action doivent être des forces réelles, et non des souvenirs historiques. Malheureusement, en France, la noblesse, encore grosse de son ancienne puissance évanouie, avait contre elle une sorte de présomption dont il était difficile qu’elle se défendît. Peut-être est-ce un défaut 55 national. Le Français, plus que tout autre homme, ne conclut jamais en dessous de lui, il va du degré sur lequel il se trouve au degré supérieur : il plaint rarement les malheureux au-dessus desquels il s’élève, il gémit toujours de voir tant d’heureux au-dessus de lui. Quoiqu’il ait beaucoup de cœur, il préfère trop souvent écouter son esprit. Cet instinct national qui fait toujours aller les Français en avant, cette vanité qui ronge leurs fortunes et les régit aussi absolument que le principe d’économie régit les Hollandais, a dominé depuis trois siècles la noblesse, qui, sous ce rapport, fut éminemment française. L’homme du faubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa supériorité matérielle en faveur de sa supériorité intellectuelle. Tout, en France, l’en a convaincu, parce que depuis l’établissement du faubourg Saint-Germain, révolution aristocratique commencée le jour où la monarchie quitta Versailles, le faubourg Saint-Germain s’est, sauf quelques lacunes, toujours appuyé sur le pouvoir, qui sera toujours en France plus ou moins faubourg Saint-Germain : de là sa défaite en 1830. À cette époque, il était comme une 56 armée opérant sans avoir de base. Il n’avait point profité de la paix pour s’implanter dans le cœur de la nation. Il péchait par un défaut d’instruction et par un manque total de vue sur l’ensemble de ses intérêts. Il tuait un avenir certain, au profit d’un présent douteux. Voici peut-être la raison de cette fausse politique. La distance physique et morale que ces supériorités s’efforçaient de maintenir entre elles et le reste de la nation, a fatalement eu pour tout résultat, depuis quarante ans, d’entretenir dans la haute classe le sentiment personnel en tuant le patriotisme de caste. Jadis, alors que la noblesse française était grande, riche et puissante, les gentilshommes savaient, dans le danger, se choisir des chefs et leur obéir. Devenus moindres, ils se sont montrés indisciplinables ; et, comme dans le Bas-Empire, chacun d’eux voulait être empereur ; en se voyant tous égaux par leur faiblesse, ils se crurent tous supérieurs. Chaque famille ruinée par la révolution, ruinée par le partage égal des biens, ne pensa qu’à elle, au lieu de penser à la grande famille aristocratique, et il leur semblait que si toutes s’enrichissaient, le parti serait fort. Erreur. 57 L’argent aussi n’est qu’un signe de la puissance. Composées de personnes qui conservaient les hautes traditions de bonne politesse, d’élégance vraie, de beau langage, de pruderie et d’orgueil nobiliaires, en harmonie avec leurs existences, occupations mesquines quand elles sont devenues le principal d’une vie de laquelle elles ne doivent être que l’accessoire, toutes ces familles avaient une certaine valeur intrinsèque, qui, mise en superficie, ne leur laisse qu’une valeur nominale. Aucune de ces familles n’a eu le courage de se dire : Sommes-nous assez fortes pour porter le pouvoir ? Elle se sont jetées dessus comme firent les avocats en 1830. Au lieu de se montrer protecteur comme un Grand, le faubourg SaintGermain fut avide comme un parvenu. Du jour où il fut prouvé à la nation la plus intelligente du monde, que la noblesse restaurée organisait le pouvoir et le budget à son profit, ce jour, elle fut mortellement malade. Elle voulait être une aristocratie quand elle ne pouvait plus être qu’une oligarchie, deux systèmes bien différents, et que comprendra tout homme assez habile pour lire attentivement les noms patronymiques des lords 58 de la chambre haute. Certes, le gouvernement royal eut de bonnes intentions ; mais il oubliait constamment qu’il faut tout faire vouloir au peuple, même son bonheur, et que la France, femme capricieuse, veut être heureuse ou battue à son gré. S’il y avait eu beaucoup de ducs de Laval, que sa mo...
« Honoré de Balzac (1799-1850) Scènes de la vie parisienne La duchesse de Langeais La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 1048 : version 1.0 2. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- GUERMANTES Oriane, duchesse de. Personnage de A la Recherche dU temps perdu de Marcel Proust
- LANGEAIS (la duchesse de). Personnage du roman de même nom (1834) d’Honoré de Balzac
- DUCHESSE D’AMALiFI (La) de John Webster
- GRANDE DUCHESSE DE GÉROLSTEIN (La). (résumé)
- DÉESSES (Les) ou Les trois romans de la duchesse d'Assy (résumé & analyse)