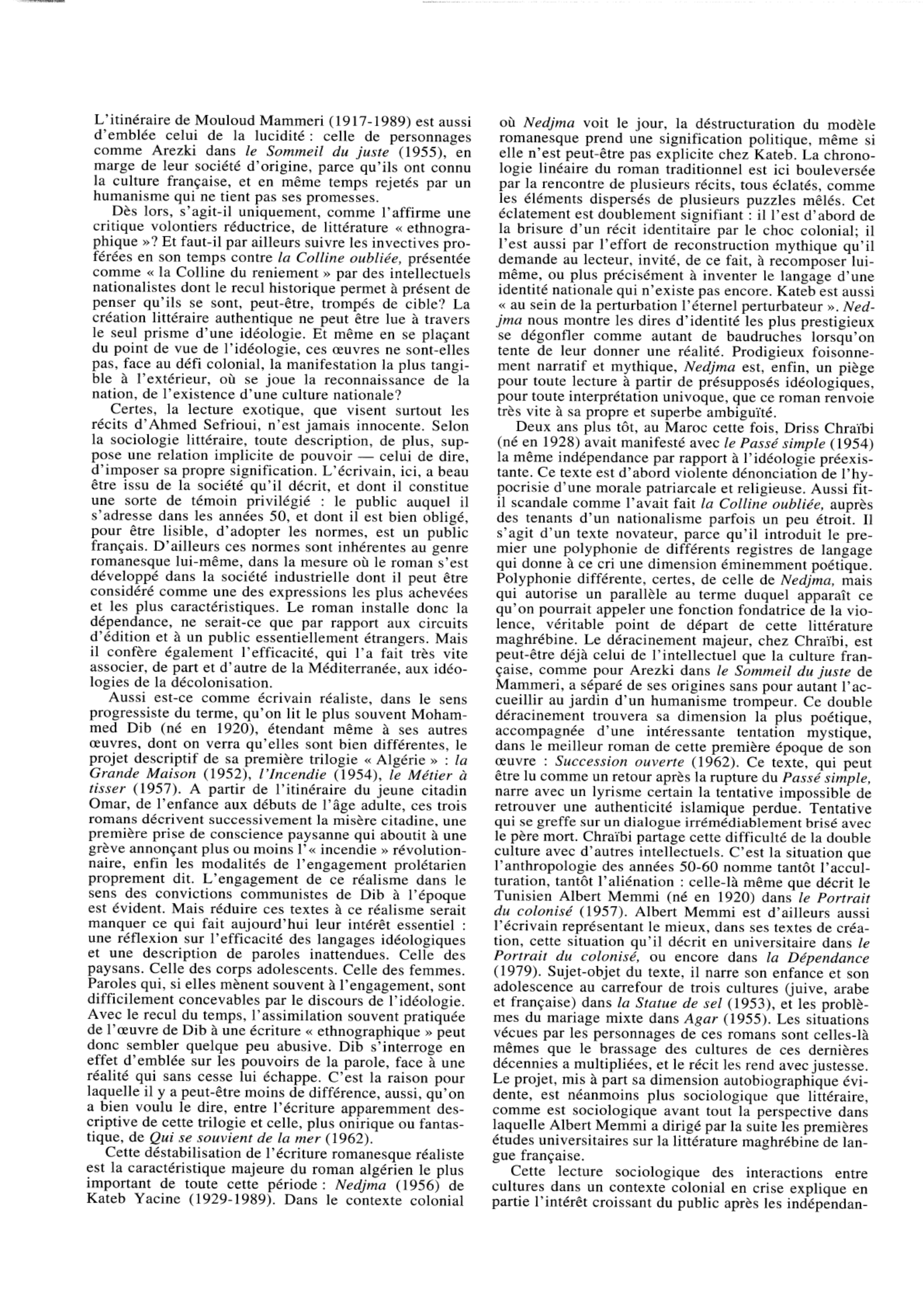MAGHREB. Littérature d'expression française
Publié le 26/11/2018
Extrait du document
L’itinéraire de Mouloud Mammeri (1917-1989) est aussi d’emblée celui de la lucidité : celle de personnages comme Arezki dans le Sommeil du juste (1955), en marge de leur société d’origine, parce qu’ils ont connu la culture française, et en même temps rejetés par un humanisme qui ne tient pas ses promesses.
Dès lors, s’agit-il uniquement, comme l’affirme une critique volontiers réductrice, de littérature « ethnographique »? Et faut-il par ailleurs suivre les invectives proférées en son temps contre la Colline oubliée, présentée comme « la Colline du reniement » par des intellectuels nationalistes dont le recul historique permet à présent de penser qu’ils se sont, peut-être, trompés de cible? La création littéraire authentique ne peut être lue à travers le seul prisme d’une idéologie. Et même en se plaçant du point de vue de l’idéologie, ces œuvres ne sont-elles pas, face au défi colonial, la manifestation la plus tangible à l’extérieur, où se joue la reconnaissance de la nation, de l’existence d’une culture nationale?
Certes, la lecture exotique, que visent surtout les récits d’Ahmed Sefrioui, n’est jamais innocente. Selon la sociologie littéraire, toute description, de plus, suppose une relation implicite de pouvoir — celui de dire, d’imposer sa propre signification. L'écrivain, ici, a beau être issu de la société qu’il décrit, et dont il constitue une sorte de témoin privilégié : le public auquel il s’adresse dans les années 50, et dont il est bien obligé, pour être lisible, d’adopter les normes, est un public français. D’ailleurs ces normes sont inhérentes au genre romanesque lui-même, dans la mesure où le roman s’est développé dans la société industrielle dont il peut être considéré comme une des expressions les plus achevées et les plus caractéristiques. Le roman installe donc la dépendance, ne serait-ce que par rapport aux circuits d’édition et à un public essentiellement étrangers. Mais il confère également l'efficacité, qui l’a fait très vite associer, de part et d’autre de la Méditerranée, aux idéologies de la décolonisation.
Aussi est-ce comme écrivain réaliste, dans le sens progressiste du terme, qu’on lit le plus souvent Mohammed Dib (né en 1920), étendant même à ses autres œuvres, dont on verra qu’elles sont bien différentes, le projet descriptif de sa première trilogie « Algérie » : la Grande Maison (1952), l'incendie (1954), le Métier à tisser (1957). A partir de l’itinéraire du jeune citadin Omar, de l’enfance aux débuts de l’âge adulte, ces trois romans décrivent successivement la misère citadine, une première prise de conscience paysanne qui aboutit à une grève annonçant plus ou moins l’« incendie » révolutionnaire, enfin les modalités de l’engagement prolétarien proprement dit. L’engagement de ce réalisme dans le sens des convictions communistes de Dib à l’époque est évident. Mais réduire ces textes à ce réalisme serait manquer ce qui fait aujourd'hui leur intérêt essentiel : une réflexion sur l’efficacité des langages idéologiques et une description de paroles inattendues. Celle des paysans. Celle des corps adolescents. Celle des femmes. Paroles qui, si elles mènent souvent à l’engagement, sont difficilement concevables par le discours de l’idéologie. Avec le recul du temps, l’assimilation souvent pratiquée de l’œuvre de Dib à une écriture « ethnographique » peut donc sembler quelque peu abusive. Dib s’interroge en effet d’emblée sur les pouvoirs de la parole, face à une réalité qui sans cesse lui échappe. C’est la raison pour laquelle il y a peut-être moins de différence, aussi, qu’on a bien voulu le dire, entre l’écriture apparemment descriptive de cette trilogie et celle, plus onirique ou fantastique, de Qui se souvient de la mer (1962).
Cette déstabilisation de l’écriture romanesque réaliste est la caractéristique majeure du roman algérien le plus important de toute cette période : Nedjma (1956) de Kateb Yacinc (1929-1989). Dans le contexte colonial
où Nedjma voit le jour, la déstructuration du modèle romanesque prend une signification politique, même si elle n’est peut-être pas explicite chez Kateb. La chronologie linéaire du roman traditionnel est ici bouleversée par la rencontre de plusieurs récits, tous éclatés, comme les éléments dispersés de plusieurs puzzles mêlés. Cet éclatement est doublement signifiant : il l’est d’abord de la brisure d’un récit identitaire par le choc colonial; il l’est aussi par l’effort de reconstruction mythique qu’il demande au lecteur, invité, de ce fait, à recomposer lui-même, ou plus précisément à inventer le langage d’une identité nationale qui n’existe pas encore. Kateb est aussi « au sein de la perturbation l’éternel perturbateur ». Nedjma nous montre les dires d’identité les plus prestigieux se dégonfler comme autant de baudruches lorsqu’on tente de leur donner une réalité. Prodigieux foisonnement narratif et mythique, Nedjma est, enfin, un piège pour toute lecture à partir de présupposés idéologiques, pour toute interprétation univoque, que ce roman renvoie très vite à sa propre et superbe ambiguïté.
Deux ans plus tôt, au Maroc cette fois, Driss Chraïbi (né en 1928) avait manifesté avec le Passé simple (1954) la même indépendance par rapport à l’idéologie préexistante. Ce texte est d’abord violente dénonciation de l’hypocrisie d’une morale patriarcale et religieuse. Aussi fit-il scandale comme l’avait fait la Colline oubliée, auprès des tenants d’un nationalisme parfois un peu étroit. Il s’agit d’un texte novateur, parce qu’il introduit le premier une polyphonie de différents registres de langage qui donne à ce cri une dimension éminemment poétique. Polyphonie différente, certes, de celle de Nedjma, mais qui autorise un parallèle au terme duquel apparaît ce qu’on pourrait appeler une fonction fondatrice de la violence, véritable point de départ de cette littérature maghrébine. Le déracinement majeur, chez Chraïbi, est peut-être déjà celui de l’intellectuel que la culture française, comme pour Arezki dans le Sommeil du juste de Mammeri, a séparé de ses origines sans pour autant l’accueillir au jardin d’un humanisme trompeur. Ce double déracinement trouvera sa dimension la plus poétique, accompagnée d’une intéressante tentation mystique, dans le meilleur roman de cette première époque de son œuvre : Succession ouverte (1962). Ce texte, qui peut être lu comme un retour après la rupture du Passé simple, narre avec un lyrisme certain la tentative impossible de retrouver une authenticité islamique perdue. Tentative qui se greffe sur un dialogue irrémédiablement brisé avec le père mort. Chraïbi partage cette difficulté de la double culture avec d’autres intellectuels. C’est la situation que l’anthropologie des années 50-60 nomme tantôt l’acculturation, tantôt l’aliénation : celle-là même que décrit le Tunisien Albert Memmi (né en 1920) dans le Portrait du colonisé (1957). Albert Memmi est d’ailleurs aussi l’écrivain représentant le mieux, dans ses textes de création, cette situation qu’il décrit en universitaire dans le Portrait du colonisé, ou encore dans la Dépendance (1979). Sujet-objet du texte, il narre son enfance et son adolescence au carrefour de trois cultures (juive, arabe et française) dans la Statue de sel (1953), et les problèmes du mariage mixte dans Agar (1955). Les situations vécues par les personnages de ces romans sont celles-là mêmes que le brassage des cultures de ces dernières décennies a multipliées, et le récit les rend avec justesse. Le projet, mis à part sa dimension autobiographique évidente, est néanmoins plus sociologique que littéraire, comme est sociologique avant tout la perspective dans laquelle Albert Memmi a dirigé par la suite les premières études universitaires sur la littérature maghrébine de langue française.
Cette lecture sociologique des interactions entre cultures dans un contexte colonial en crise explique en partie l'intérêt croissant du public après les indépendances du Maroc et de la Tunisie (1956) et alors que la guerre s’intensifie en Algérie jusqu’à l’indépendance en 1962. L’édition va se diversifier et de nouveaux écrivains algériens seront en quelque sorte portés par l’actualité. C’est le cas de Malek Haddad (1927-1979), qui s’était fait connaître en France, dans un contexte militant, par des poèmes et des essais centrés sur la guerre et la quête d'une culture algérienne {le Malheur en danger, 1956, et Les zéros tournent en rond, 1961). Ses romans montreront surtout le déchirement entre ses attaches avec la culture française, et l’amour de la patrie-épouse meurtrie {Je t'offrirai une gazelle, 1959; l'Élève et la leçon, 1960; Le quai aux fleurs ne répond plus, 1961). D’écriture assez limpide, ils dégagent de cette irrémédiable opposition un lyrisme incontestable, quoique parfois un peu facile.
En Algérie toujours, Assia Djebar (née en 1936) n'abordera le thème de la guerre que dans son troisième roman, les Enfants du nouveau monde (1962). Auparavant, elle sera entrée en littérature à partir d'une autre rupture : celle d’une parole de femme, dans la Soif (1957) ou encore les Impatients (1958), parole qui ne l’empêchera pas dans les Enfants du nouveau monde de développer une peinture très didactique de la société algérienne en guerre. Pourtant il ne s'agit pas d'une épopée des combattants : l’action ne se déroule pas au maquis, mais en ville, et permet de décrire surtout comment la guerre est vécue au jour le jour dans différents milieux de la société citadine, et principalement par les femmes. Ce développement d'un vécu féminin, puis d’une parole féminine de la guerre, sera l’originalité majeure des Alouettes naïves (1967), qui dépassera sans l’abandonner complètement le didactisme des Enfants du nouveau monde, et se terminera sur la constatation désabusée qu'une fois la guerre d’indépendance terminée, le vrai combat, celui qui mènera vers une société où la parole féminine, entre autres, pourra s'exprimer, reste peut-être encore à faire. Ce scepticisme quant aux lendemains est également ce que l’on retient à la fin du gros roman, où l'épique est bien présent, que Mouloud Mam-meri a consacré lui aussi à la guerre : l’Opium et le Bâton (1965). Poussé par l'actualité de la guerre, le roman algérien de cette période, même s’il a été tenté par l’épique, a donc toujours gardé la distance d’un humanisme cohérent avec la formation de ses auteurs. Ce thème de la guerre se trouve surtout, à cette époque, dans la poésie. Dans une tradition qui rappelle celle des poètes de la Résistance française quelque quinze ans plus tôt, les textes des poètes algériens de la guerre sont davantage liés à l’événement qui les a produits, qu’à une dimension littéraire d’écrivains que le développement ultérieur d’une œuvre aurait consacrés comme tels. On est presque étonné de trouver les noms de Kateb Yacine ou Mohammed Dib dans des anthologies de cette poésie. Inversement, les noms moins connus d’Henri Kréa, Anna Gréki, Leila Djabali ou Zhor Zerari sont indissociables de cette guerre à laquelle ils n’ont pourtant consacré au total que peu de textes. Seuls Malek Haddad et Bachir Hadj-Ali (né en 1920) échappent à cette inscription problématique de la guerre dans l’histoire de la littérature algérienne. Mais leur œuvre confirme ce qui vient d’être dit du primat de la poésie en ce qui concerne ce thème.
Commémoration ou rupture?
MAGHREB. Littérature d'expression française. Dès son intitulé, la littérature maghrébine de langue française indique une localisation spatiale double et ambiguë, qui restera durant toute son histoire sa dynamique majeure. Si cette littérature dit le Maghreb dans la plupart de ses œuvres, et si ses écrivains sont issus du Maghreb, sa langue n’est pas celle du Maghreb. Et de même le genre dominant de cette littérature, à savoir le roman, ne correspond pas à une tradition littéraire locale. Pourtant la littérature de langue française reste encore, du moins pour l’Algérie et le Maroc, l’expression maghrébine la plus reconnue à l’extérieur, tant dans les pays européens que dans les pays arabes.
Définie par un espace de référence double, la littérature maghrébine de langue française est également liée, dans l’image qu’en véhicule le public, au contexte historique de la décolonisation. Sa double étiquette spatiale s’explique en partie par la colonisation française du Maghreb. Aussi, le français reste une référence importante et se pratique encore beaucoup. Mais cette langue n'en a pas moins été celle du colon, et son utilisation par des écrivains ne laissera pas de poser des problèmes. Dans ce contexte complexe, cette littérature nous interrogera donc aussi sur la manière dont nous la lisons. Faut-il la considérer comme un simple document sur une société exotique, s’adressant de ce fait prioritairement à des lecteurs européens auxquels sembleraient la destiner sa langue et son genre littéraire privilégié? Faut-il y voir un témoignage de quelques consciences éclairées sur les injustices dont leur société a été ou est encore victime, témoignage qui s’adresserait alors aussi bien à l’extérieur qu’à l'intérieur de cette société? A qui cette littérature, véritablement, s’adresse-t-elle? Par-delà toutes ses déterminations sociologiques, historiques ou politiques, reconnaissons-nous à cette littérature le droit d’être, d’abord, littérature? Autant dire qu’il ne saurait y avoir de description de la littérature maghrébine qui ne soit d’abord une problématique.
Littérature et décolonisation
Jusqu’à une date récente, la littérature maghrébine de langue française est restée inséparable du contexte de la décolonisation dans lequel elle a vu le jour. Si l’on trouve des textes épars d’écrivains maghrébins dès avant la guerre de 1939-1945, et particulièrement les poèmes de Jean Amrouche (1906-1962), ou le premier roman de sa sœur, Marguerite Taos Amrouche, on ne commence à parler de littérature maghrébine en tant que telle qu’à partir de 1949-1950.
Premiers écrivains maghrébins véritablement perçus comme tels, Ahmed Sefrioui (né en 1915) au Maroc et Mouloud Feraoun (1913-1962) en Algérie sont pourtant loin d’être des révolutionnaires. Les récits du premier (le Chapelet d'ambre, 1949, ou la Boîte à merveilles, 1954) décrivent une société traditionnelle à l’exotisme charmant. Le Fils du pauvre (1950) de Feraoun nous décrit sans complaisance une Kabylie bien réelle, où la faim et la misère sont quotidiennes. Si le but avoué de Feraoun est d'abord d’écrire aussi bien que les modèles proposés par l’écriture française, pour « montrer que les Kabyles étaient précisément des hommes », et si l’humanisme reste pour lui une valeur fondamentale (ce qui lui vaudra peut-être d’être assassiné par 1’0.A.S. en 1962), ses romans suivants, la Terre et le Sang (1954) et Les chemins qui montent (1957) développent déjà la résonance plus tragique d’une société traditionnelle dans laquelle des personnages ayant connu d’autres valeurs n’ont plus leur place.
Ce tragique d’une société traditionnelle condamnée par l’irruption de la modernité nourrira le chant poignant de la Colline oubliée de Mouloud Mammeri en 1952.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉGYPTE. Littérature égyptienne d'expression française
- NÉGRO-AFRICAINE (littérature d'expression française)
- CARAÏBES et GUYANE. Littérature d’expression française.
- BELGIQUE. Littérature d'expression française. L'influence de la Belgique sur la littérature française
- VAL D'AOSTE (littérature d'expression française)