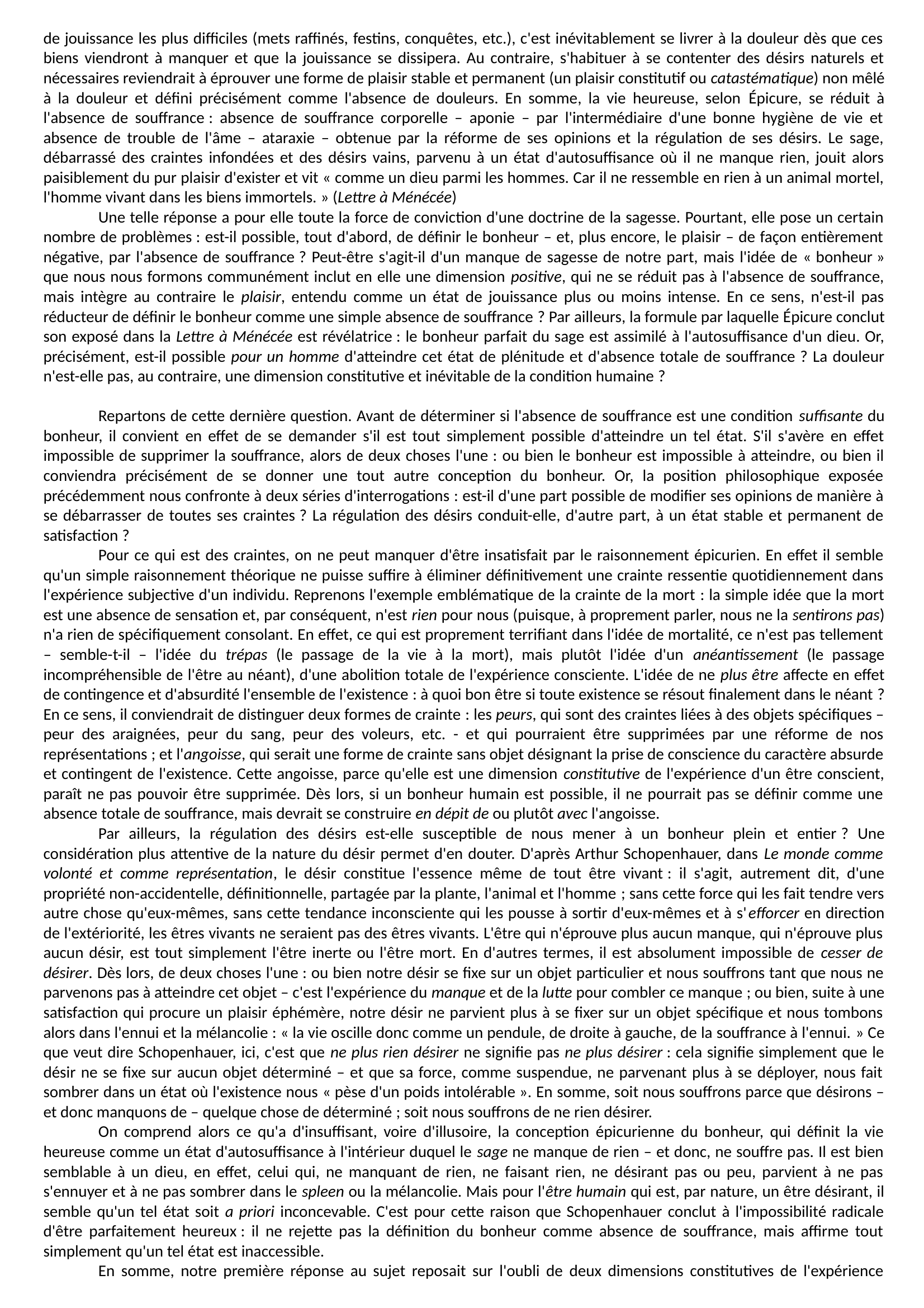Le bonheur se réduit-il à l'absence de souffrance ?
Publié le 31/10/2020
Extrait du document
« Vivre sans souci », « ne pas avoir de problème », « être tranquille » : ces conceptions communes du bonheur mettent toutes le bonheur en relation avec l'idée de souffrance, et le définissent précisément comme une absence de souffrance. Le bonheur, entendu de façon générale, paraît en effet désigner un état stable et durable de satisfaction ; la souffrance, quant à elle, désigne l'expérience d'une douleur, qu'elle soit physique ou morale ; elle signale par conséquent un état d'insatisfaction qui semble incompatible avec l'idée même de bonheur. En ce sens, la définition du bonheur comme absence de souffrance paraît presque tautologique. Néanmoins, une telle définition pose un double problème. D'une part, il n'est pas certain que l'élimination de toute forme de souffrance suffise à garantir l'accès au bonheur ; en ce sens, l'absence de souffrance serait une condition nécessaire mais non suffisante de la vie heureuse et il conviendrait alors de déterminer ce qui manque dans cette définition simplement négative du bonheur. D'autre part, il n'est pas certain que cette éviction de la souffrance soit tout simplement possible ; après tout, elle paraît être une dimension constitutive de l'existence humaine et chercher à l'éliminer définitivement participerait d'une illusion peu propice à nous conduire à une vie heureuse : en ce sens, l'absence de souffrance ne serait ni nécessaire, ni suffisante ; elle serait tout simplement impropre à saisir ce que pourrait être un bonheur humain défini positivement. En somme, le sujet nous invite à réinterroger la notion même de bonheur et les conceptions communes que nous pouvons nous en faire : existe-t-il une équivalence stricte entre l'absence de souffrance et l'idée de bonheur ou bien s'agit-il en réalité d'une conception incomplète, voire illusoire, qui risque de faire obstacle à la vie heureuse ? Au premier abord, bonheur et souffrance s'excluent mutuellement : la vie heureuse résiderait alors dans une absence totale de troubles de l'âme et du corps, un état de quiétude absolue. Toutefois, une telle définition du bonheur propose un idéal de vie qui, en tant que tel, semble hors de portée de l'être humain : il paraît impossible d'éliminer toute forme de souffrance de l'existence humaine. Il conviendra dès lors de se demander si le bonheur est inaccessible ou si, plutôt, il est possible de concilier au sein d'une même expérience bonheur et souffrance.
«
de jouissance les plus difficiles (mets raffinés, festins, conquêtes, etc.), c'est inévitablement se livrer à la douleur dès que ces
biens viendront à manquer et que la jouissance se dissipera.
Au contraire, s'habituer à se contenter des désirs naturels et
nécessaires reviendrait à éprouver une forme de plaisir stable et permanent (un plaisir constitutif ou catastématique ) non mêlé
à la douleur et défini précisément comme l'absence de douleurs.
En somme, la vie heureuse, selon É picure, se réduit à
l'absence de souffrance : absence de souffrance corporelle – aponie – par l'intermédiaire d'une bonne hygiène de vie et
absence de trouble de l'âme – ataraxie – obtenue par la réforme de ses opinions et la régulation de ses désirs.
Le sage,
débarrassé des craintes infondées et des désirs vains, parvenu à un état d'autosuffisance où il ne manque rien, jouit alors
paisiblement du pur plaisir d'exister et vit « comme un dieu parmi les hommes.
Car il ne ressemble en rien à un animal mortel,
l'homme vivant dans les biens immortels.
» ( Lettre à Ménécée )
Une telle réponse a pour elle toute la force de conviction d'une doctrine de la sagesse.
Pourtant, elle pose un certain
nombre de problèmes : est-il possible, tout d'abord, de définir le bonheur – et, plus encore, le plaisir – de façon entièrement
négative, par l'absence de souffrance ? Peut-être s'agit-il d'un manque de sagesse de notre part, mais l'idée de « bonheur »
que nous nous formons communément inclut en elle une dimension positive , qui ne se réduit pas à l'absence de souffrance,
mais intègre au contraire le plaisir , entendu comme un état de jouissance plus ou moins intense.
En ce sens, n'est-il pas
réducteur de définir le bonheur comme une simple absence de souffrance ? Par ailleurs, la formule par laquelle É picure conclut
son exposé dans la Lettre à Ménécée est révélatrice : le bonheur parfait du sage est assimilé à l'autosuffisance d'un dieu.
Or,
précisément, est-il possible pour un homme d'atteindre cet état de plénitude et d'absence totale de souffrance ? La douleur
n'est-elle pas, au contraire, une dimension constitutive et inévitable de la condition humaine ?
Repartons de cette dernière question.
Avant de déterminer si l'absence de souffrance est une condition suffisante du
bonheur, il convient en effet de se demander s'il est tout simplement possible d'atteindre un tel état.
S'il s'avère en effet
impossible de supprimer la souffrance, alors de deux choses l'une : ou bien le bonheur est impossible à atteindre, ou bien il
conviendra précisément de se donner une tout autre conception du bonheur.
Or, la position philosophique exposée
précédemment nous confronte à deux séries d'interrogations : est-il d'une part possible de modifier ses opinions de manière à
se débarrasser de toutes ses craintes ? La régulation des désirs conduit-elle, d'autre part, à un état stable et permanent de
satisfaction ?
Pour ce qui est des craintes, on ne peut manquer d'être insatisfait par le raisonnement épicurien.
En effet il semble
qu'un simple raisonnement théorique ne puisse suffire à éliminer définitivement une crainte ressentie quotidiennement dans
l'expérience subjective d'un individu.
Reprenons l'exemple emblématique de la crainte de la mort : la simple idée que la mort
est une absence de sensation et, par conséquent, n'est rien pour nous (puisque, à proprement parler, nous ne la sentirons pas )
n'a rien de spécifiquement consolant.
En effet, ce qui est proprement terrifiant dans l'idée de mortalité, ce n'est pas tellement
– semble-t-il – l'idée du trépas (le passage de la vie à la mort), mais plutôt l'idée d'un anéantissement (le passage
incompréhensible de l'être au néant), d'une abolition totale de l'expérience consciente.
L'idée de ne plus être affecte en effet
de contingence et d'absurdité l'ensemble de l'existence : à quoi bon être si toute existence se résout finalement dans le néant ?
En ce sens, il conviendrait de distinguer deux formes de crainte : les peurs , qui sont des craintes liées à des objets spécifiques –
peur des araignées, peur du sang, peur des voleurs, etc.
- et qui pourraient être supprimées par une réforme de nos
représentations ; et l' angoisse , qui serait une forme de crainte sans objet désignant la prise de conscience du caractère absurde
et contingent de l'existence.
Cette angoisse, parce qu'elle est une dimension constitutive de l'expérience d'un être conscient,
paraît ne pas pouvoir être supprimée.
Dès lors, si un bonheur humain est possible, il ne pourrait pas se définir comme une
absence totale de souffrance, mais devrait se construire en dépit de ou plutôt avec l'angoisse.
Par ailleurs, la régulation des désirs est-elle susceptible de nous mener à un bonheur plein et entier ? Une
considération plus attentive de la nature du désir permet d'en douter.
D'après Arthur Schopenhauer, dans Le monde comme
volonté et comme représentation , le désir constitue l'essence même de tout être vivant : il s'agit, autrement dit, d'une
propriété non-accidentelle, définitionnelle, partagée par la plante, l'animal et l'homme ; sans cette force qui les fait tendre vers
autre chose qu'eux-mêmes, sans cette tendance inconsciente qui les pousse à sortir d'eux-mêmes et à s' efforcer en direction
de l'extériorité, les êtres vivants ne seraient pas des êtres vivants.
L'être qui n'éprouve plus aucun manque, qui n'éprouve plus
aucun désir, est tout simplement l'être inerte ou l'être mort.
En d'autres termes, il est absolument impossible de cesser de
désirer .
Dès lors, de deux choses l'une : ou bien notre désir se fixe sur un objet particulier et nous souffrons tant que nous ne
parvenons pas à atteindre cet objet – c'est l'expérience du manque et de la lutte pour combler ce manque ; ou bien, suite à une
satisfaction qui procure un plaisir éphémère, notre désir ne parvient plus à se fixer sur un objet spécifique et nous tombons
alors dans l'ennui et la mélancolie : « la vie oscille donc comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
» Ce
que veut dire Schopenhauer, ici, c'est que ne plus rien désirer ne signifie pas ne plus désirer : cela signifie simplement que le
désir ne se fixe sur aucun objet déterminé – et que sa force, comme suspendue, ne parvenant plus à se déployer, nous fait
sombrer dans un état où l'existence nous « pèse d'un poids intolérable ».
En somme, soit nous souffrons parce que désirons –
et donc manquons de – quelque chose de déterminé ; soit nous souffrons de ne rien désirer.
On comprend alors ce qu'a d'insuffisant, voire d'illusoire, la conception épicurienne du bonheur, qui définit la vie
heureuse comme un état d'autosuffisance à l'intérieur duquel le sage ne manque de rien – et donc, ne souffre pas.
Il est bien
semblable à un dieu, en effet, celui qui, ne manquant de rien, ne faisant rien, ne désirant pas ou peu, parvient à ne pas
s'ennuyer et à ne pas sombrer dans le spleen ou la mélancolie.
Mais pour l' être humain qui est, par nature, un être désirant, il
semble qu'un tel état soit a priori inconcevable.
C'est pour cette raison que Schopenhauer conclut à l'impossibilité radicale
d'être parfaitement heureux : il ne rejette pas la définition du bonheur comme absence de souffrance, mais affirme tout
simplement qu'un tel état est inaccessible.
En somme, notre première réponse au sujet reposait sur l'oubli de deux dimensions constitutives de l'expérience.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le bonheur est-il seulement l'absence de souffrance? ?
- la souffrance apporte-t-elle le bonheur?
- Les notions au programme : Le désir – Le bonheur La problématique : Paradoxe du désir : il semble aspirer à la satisfaction mais mène souvent à la souffrance.
- SOUFFRANCE ET BONHEUR DU CHRÉTIEN. François Mauriac (résumé)
- La liberté n'est-elle pas un fardeau qui est source d'angoisse ? Le bonheur ne se réduit-il pas à la joie éphémère ?