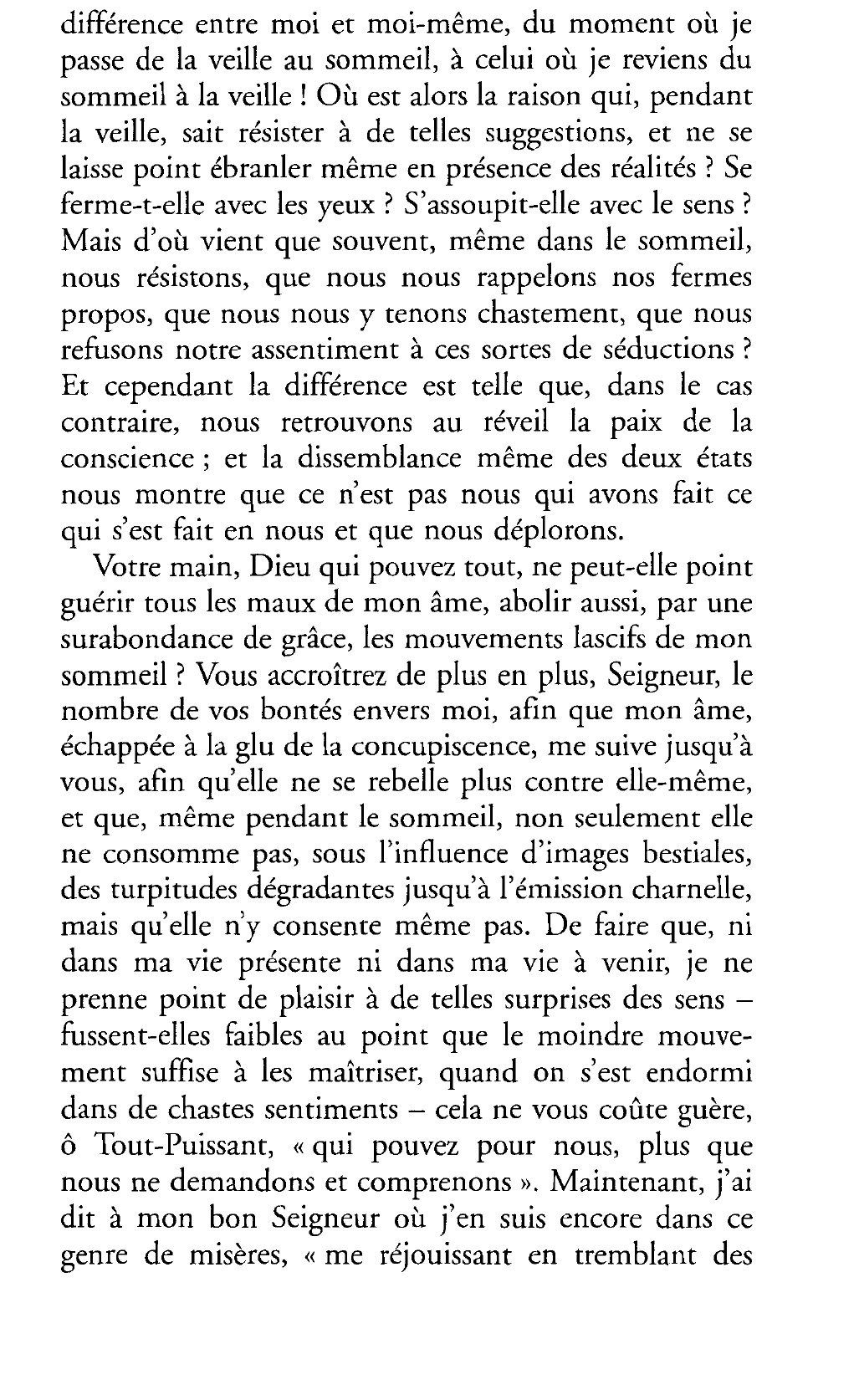Anthologie de textes: Christianisme et sexualité, chair, désir, pulsion
Publié le 25/03/2015
Extrait du document
EXTRAITS
1. La concupiscence de la chair
Saint Augustin, Les Confessions,
trad. Joseph Trabucco, Paris,
GF-Flammarion, 1964, X, xxx, p. 231-232.
Vous me commandez assurément de réprimer « la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'ambition du siècle «. Vous avez défendu les unions illégitimes, et quant au mariage, bien que vous l'ayez permis, vous avez enseigné qu'il existe un état qui lui est préférable. Et, avec votre grâce, j'ai opté pour cet état avant même de devenir le dispensateur de votre sacrement. Mais elles vivent encore dans ma mémoire, dont j'ai longuement traité, les images de ces voluptés : mes habitudes de jadis les y ont gravées. Elles s'offrent à moi, sans force à l'état de veille ; mais dans le som¬meil, elles m'imposent non seulement le plaisir, mais le consentement au plaisir et l'illusion de la chose même. Ces fictions ont un tel pouvoir sur mon âme, sur ma chair, que, toutes fausses qu'elles sont, elles suggèrent à mon sommeil ce que les réalités ne peuvent me suggé¬rer quand je suis éveillé. Ai-je donc alors cessé d'être moi-même, Seigneur mon Dieu ? Il y a une si grande
différence entre moi et moi-même, du moment où je passe de la veille au sommeil, à celui où je reviens du sommeil à la veille ! Où est alors la raison qui, pendant la veille, sait résister à de telles suggestions, et ne se laisse point ébranler même en présence des réalités ? Se ferme-t-elle avec les yeux ? S'assoupit-elle avec le sens ? Mais d'où vient que souvent, même dans le sommeil, nous résistons, que nous nous rappelons nos fermes propos, que nous nous y tenons chastement, que nous refusons notre assentiment à ces sortes de séductions ? Et cependant la différence est telle que, dans le cas contraire, nous retrouvons au réveil la paix de la conscience ; et la dissemblance même des deux états nous montre que ce n'est pas nous qui avons fait ce qui s'est fait en nous et que nous déplorons.
Votre main, Dieu qui pouvez tout, ne peut-elle point guérir tous les maux de mon âme, abolir aussi, par une surabondance de grâce, les mouvements lascifs de mon sommeil ? Vous accroîtrez de plus en plus, Seigneur, le nombre de vos bontés envers moi, afin que mon âme, échappée à la glu de la concupiscence, me suive jusqu'à vous, afin qu'elle ne se rebelle plus contre elle-même, et que, même pendant le sommeil, non seulement elle ne consomme pas, sous l'influence d'images bestiales, des turpitudes dégradantes jusqu'à l'émission charnelle, mais qu'elle n'y consente même pas. De faire que, ni dans ma vie présente ni dans ma vie à venir, je ne prenne point de plaisir à de telles surprises des sens —fussent-elles faibles au point que le moindre mouve¬ment suffise à les maîtriser, quand on s'est endormi dans de chastes sentiments — cela ne vous coûte guère, ô Tout-Puissant, « qui pouvez pour nous, plus que nous ne demandons et comprenons «. Maintenant, j'ai dit à mon bon Seigneur où j'en suis encore dans ce genre de misères, « me réjouissant en tremblant des
dons que vous m'avez déjà faits, et gémissant de ce qu'il y a encore chez moi d'inachevé. J'espère que vous parferez en moi vos miséricordes, jusqu'à la paix totale dont jouiront en vous mon être intérieur et extérieur, quand la mort aura été engloutie pour la victoire «.
2. L'éros possessif de la philosophie
platonicienne
Platon, Phèdre, trad. Luc Brisson, Paris,
GF-Flammarion, 2012, p. 93-100.
« Établissons [...] quelle sorte de choses est l'amour et quels sont ses effets, et proposons une définition. Ayons les yeux fixés là-dessus et reportons-nous-y, tandis que nous examinerons si c'est utilité ou dom-mage qu'apporte l'amour. [...]
Que l'amour soit une espèce de désir, c'est évident pour tout le monde. Que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même des gens qui n'aiment pas désirent ce qui est beau, nous le savons. Alors, à quoi distinguerons-nous celui qui aime de celui qui n'aime pas ? Il faut encore prendre en considération le fait que, en chacun de nous, il y a deux espèces de tendances qui nous gouvernent et nous dirigent, et que nous allons là où elles nous dirigent : l'une, qui est innée, c'est le désir des plaisirs ; l'autre, qui est une façon de voir acquise, c'est l'aspiration au meilleur. Or, ces deux ten¬dances qui sont en nous, tantôt s'accordent, tantôt se combattent ; et c'est parfois celle-ci qui domine, parfois l'autre. Cela posé, quand c'est une opinion rationnelle qui mène vers ce qu'il y a de meilleur et qui domine, cette domination s'appelle "tempérance". Mais, quand c'est un désir qui entraîne déraisonnablement vers le plaisir et qui gouverne en nous, ce gouvernement a pour nom "démesure". Or, on le sait, la démesure a beaucoup de noms, car elle présente une grande diver¬sité d'éléments et de formes, et celle de ces formes qui vient à prédominer sert à nommer l'homme qui la pos¬sède, dénomination qui n'est ni belle ni honorable. Si c'est le désir de la bonne chère qui l'emporte sur ce
que la raison présente comme le meilleur et sur le reste des désirs, voilà la gourmandise ; d'où le nom de "gour¬mand" qui désignera celui qui a ce vice. S'il s'agit par ailleurs du désir tyrannique de s'enivrer, on sait bien quel nom recevra l'homme entraîné sur cette pente. Et il en va de même pour le reste : les noms apparentés à ceux-là, et qui désignent des désirs apparentés, on voit bien comment, chaque fois que tel désir exerce son despotisme, il convient de les attribuer.
À quel désir je pensais, en disant tout ce que je viens de dire ? Cela maintenant est assez évident. Mais ce qui est dit est plus clair, de toute façon, que ce qui n'est pas dit. Je dirai donc que c'est ce désir dépourvu de raison, désir qui domine l'élan de l'opinion vers la rec¬titude, qui se porte vers le plaisir que donne la beauté, et qui, par l'effet des désirs qui sont de sa famille et qui ont pour objet la beauté des corps, se "renforce" à son tour très "fortement", je dirai donc que c'est ce désir-là qui, devenu penchant irrésistible et tirant son nom de sa "force" même, a été appelé Éros... [...]
Oui, celui qui est gouverné par le désir, celui qui est esclave du plaisir, cherche forcément, cela ne fait aucun doute, à obtenir de celui qu'il aime le plus de plaisir possible. Or, l'homme malade trouve agréable tout ce qui ne le contrarie pas, et hostile tout ce qui lui est supérieur ou égal. Dès lors, un amant ne supporte pas volontiers, chez le garçon qu'il aime, supériorité ou éga¬lité : il travaille au contraire à le rabaisser et à en faire son inférieur.
Or, l'ignorant est au-dessous du savant, le lâche au-dessous du brave, l'homme incapable de parler au-des¬sous de l'homme qui connaît la rhétorique, l'esprit lent au-dessous de l'esprit vif. Quand de tels défauts, et bien d'autres encore, se développent ou se trouvent naturel-lement dans l'esprit de l'aimé, l'amant, c'est forcé, se
réjouit des uns et fait naître les autres, sous peine d'être privé du plaisir du moment. Il est jaloux, cela va de soi, et il interdit à l'aimé de nouer beaucoup d'autres relations, même utiles, qui contribueraient à faire de lui un homme au sens plein du terme. Il lui cause ainsi un dommage considérable, le plus grand qui soit, en le privant du moyen d'acquérir la plus haute sagesse. Ce moyen, c'est la divine philosophie, dont l'amant détourne forcément le garçon qu'il aime, de peur d'en être dédaigné. N'importe quel stratagème lui est bon pour faire que le garçon reste ignorant de tout et qu'il n'ait d'yeux que pour son amant : il trouvera on ne peut plus agréable l'aimé qu'il aura réduit à cet état, mais il lui aura fait le plus grand tort. Ainsi, pour ce qui est de l'esprit, celui qui aime est-il un tuteur et un compagnon, dont on ne doit rien attendre d'utile. [...]
Voici, en vérité, une chose claire pour tout le monde, surtout pour l'amant : son voeu le plus ardent serait de voir le garçon qu'il aime perdre ce qu'il possède de plus cher, de plus doux à son coeur et de plus divin. Père, mère, parents et amis, il ne demanderait pas mieux, en effet, qu'il en fût privé, car il les tient pour des gêneurs et des censeurs de l'extrême agrément que lui procure son commerce avec lui. Ce n'est pas tout. Si le bien-aimé a de la fortune en or ou en propriété d'autres sortes, l'amant le jugera pareillement moins facile à séduire et, lorsqu'il l'aura séduit, moins facile à manier. Il s'ensuit forcément que l'amant est jaloux des garçons qu'il aime, parce qu'ils possèdent quelque chose, et qu'il se réjouit de la perte de ce qu'ils possèdent. [...]
Voilà [...] ce qu'il faut bien se mettre dans la tête : sache que l'amour que vous porte un amant ne s'accompagne pas de bonnes intentions, mais qu'il s'apparente à une sorte de faim qui cherche à s'assouvir. «
3. Les Dionysies grecques
Nietzsche, Crépuscule des idoles [1888], trad. Éric
Blondel et Patrick Wotling, Paris, GF-Flammarion,
2005, « Ce que je dois aux anciens «, § 4.
Je fus le premier qui, pour comprendre cet instinct hellénique plus ancien, encore riche et même débor-dant, ai pris au sérieux ce phénomène prodigieux qui porte le nom de Dionysos : il est explicable exclusive¬ment à partir d'un excès de force. Qui se consacre à l'étude des Grecs, comme le plus profond connaisseur de leur culture aujourd'hui vivant, comme Jakob Bur¬ckhardt de Bâle, aura saisi d'emblée que cela a joué un grand rôle : Burckhardt incorpora à sa Culture des Grecs une section spéciale sur le phénomène que j'ai nommé. Si l'on veut l'opposé, qu'on regarde la pauvreté d'instinct presque distrayante des philologues alle¬mands lorsqu'ils s'approchent du dionysiaque. Le célèbre Lobeck surtout, qui pénétra en rampant dans ce monde d'états mystérieux avec l'assurance vénérable d'un rat de bibliothèque desséché, et se persuada de faire oeuvre scientifique en étant d'une légèreté et d'une puérilité à écoeurer — Lobeck a donné à entendre, avec une véritable débauche d'érudition, que toutes ces curiosités ne rimaient absolument à rien. Les prêtres pouvaient bien, de fait, avoir communiqué à ceux qui participaient à ces orgies quelques éléments non dénués de valeur, par exemple que le vin incite à la joie, que, le cas échéant, l'homme vit de fruits, que les plantes fleurissent au printemps, se fanent en automne. Quant à cette profusion si déconcertante de rites, de symboles et de mythes d'origine orgiastique dont regorge littéra¬lement le monde antique, Lobeck y trouve une occa
sion de se faire un peu plus spirituel encore. « Les Grecs, dit-il (Aglaophamus, I, 672), s'ils n'avaient rien d'autre à faire, riaient, bondissaient, galopaient en tous sens, ou bien, l'homme en éprouvant parfois aussi l'envie, ils s'asseyaient, fondaient en larmes et gémis¬saient. D'autres arrivèrent ensuite et cherchèrent une raison à ce comportement étonnant ; et c'est ainsi que prirent naissance, pour expliquer ces usages, ces légendes liées aux fêtes et ces mythes innombrables. On crut en outre que cette agitation bouffonne qui, après tout se produisait les jours de fête, faisait aussi nécessai¬rement partie de la célébration des fêtes, et on le main¬tint comme une part indispensable du culte divin. « —C'est là un bavardage méprisable, on ne prendra pas un Lobeck au sérieux une seconde. Nous sommes affec¬tés d'une tout autre manière quand nous examinons le concept de « grec « que se sont formé Winckelmann et Goethe, et le trouvons incompatible avec l'élément à partir duquel se développe l'art dionysiaque — avec l'orgiasme. Je ne doute pas, de fait, que Goethe n'eût par principe exclu quelque chose de ce genre des possi¬bilités de l'âme grecque. Par conséquent, Goethe ne com¬prenait pas les Grecs. Car c'est uniquement dans les mystères dionysiaques, dans la psychologie de l'état dionysiaque que s'exprime le fait fondamental de l'instinct hellénique — sa « volonté de vie «. Que se garantissait l'Hellène au moyen de ces mystères ? La vie éternelle, l'éternel retour de la vie ; l'avenir promis et consacré dans le passé ; le oui triomphant à la vie dépassant la mort et le changement ; la vraie vie comme la poursuite de la vie dans son ensemble par la procréation, par les mystères de la sexualité. C'est pourquoi le symbole sexuel était pour les Grecs le sym¬bole vénérable en soi, la véritable pensée profonde de toute la piété antique. Tout détail de l'acte de procréa
tion, de grossesse, de naissance éveillait les sentiments les plus élevés et les plus solennels. Dans la doctrine des mystères, la douleur est déclarée sainte : les « dou¬leurs de la parturiente « sanctifient la douleur en géné¬ral — tout devenir et croissance, tout ce qui garantit l'avenir présuppose la douleur... Pour qu'existe le plai¬sir de créer, pour que la volonté de vie s'acquiesce éter¬nellement elle-même, il faut qu'existe éternellement aussi le « tourment de la parturiente «... C'est tout cela que signifie le mot Dionysos : je ne connais pas de symbolique plus élevée que cette symbolique grecque, celle des Dionysies. En elle, l'instinct le plus profond de la vie, celui de l'avenir de la vie, de l'éternité de la vie, donne lieu à un sentiment religieux — la voie même qui conduit à la vie, la procréation, est ressentie comme la voie sacrée... C'est seulement le christianisme, avec son ressentiment viscéral envers la vie, qui a fait de la sexualité quelque chose d'impur : il a recouvert d'ordure le commencement, le présupposé de notre vie...
4. Le mépris pour le corps ou le christianisme comme maladie
Nietzsche, L'Antéchrist [1895], trad. Éric Blondel,
Paris, GF-Flammarion, 1996, § 51.
Que, le cas échéant, la foi donne la béatitude, que la béatitude ne produise pas encore une idée vraie à partir d'une idée fixe, que la foi ne déplace pas les montagnes, mais qu'elle en mette là où il n'y en a pas : un passage rapide dans un asile de fous éclaire là-dessus suffisamment. Certes pas un prêtre : car celui-ci nie par instinct que la maladie soit maladie, que l'asile soit un asile. Le christianisme a besoin de la maladie, à peu près comme l'hellénisme a besoin d'un surplus de santé, —rendre malade est la véritable intention cachée de tout le système thérapeutique de salut de l'Église. Et l'Église elle-même — n'est-elle pas l'asile de fous catholique comme idéal ultime ? La terre tout entière comme asile de fous ? — L'homme religieux, tel que le veut l'Église, est un décadent typique ; l'époque où une crise reli¬gieuse s'empare d'un peuple est chaque fois caractérisée par des épidémies de maladies nerveuses ; le « monde intérieur « de l'homme religieux ressemble à s'y trom¬per au « monde intérieur « des surexcités et des asthé¬niques ; les états « sublimes « que le christianisme a suspendus comme valeur des valeurs au-dessus de l'humanité sont des formes épileptoïdes, — l'Église n'a canonisé ad majorem dei honorem que des toqués ou bien de grands imposteurs... Je me suis un jour permis de décrire tout le training chrétien de la pénitence et du salut (que l'on étudie aujourd'hui en Angleterre mieux que partout) comme une folie circulaire métho¬diquement provoquée, bien entendu sur un terrain déjà
prédisposé, c'est-à-dire foncièrement morbide. Nul n'est libre de devenir chrétien : on n'est pas « converti « au christianisme, il faut être assez malade pour cela... Nous autres, qui avons le courage de la santé, ainsi que du mépris, combien nous sommes en droit de mépriser une religion qui a enseigné à se méprendre sur le corps ! qui ne veut pas s'affranchir de la superstition de l'âme ! qui fait de l'alimentation insuffisante un « mérite « ! qui combat dans la santé une espèce d'ennemi, de diable, de tentation ! qui s'est fourré dans la tête qu'on pouvait promener une « âme parfaite « dans un corps cadavérique et qui à cette fin a eu besoin de s'arranger une nouvelle notion de la « perfection «, un être hâve, maladif, idiot jusqu'à l'exaltation, la prétendue « sain¬teté «, — la sainteté, elle-même rien qu'un syndrome du corps appauvri, épuisé, incurablement corrompu !... Le mouvement chrétien, en tant que mouvement euro-péen, est d'emblée un mouvement d'ensemble des élé-ments de rebut et de déchet de toute espèce (— ceux-là, avec le christianisme, veulent la puissance). Il n'exprime pas le déclin d'une race, il est un agrégat de formes de décadence venues de partout, qui se pressent les unes contre les autres et se cherchent. Ce n'est pas, comme on le croit, la corruption de l'Antiquité elle-même, de l'Antiquité aristocratique, qui a rendu pos¬sible le christianisme : on ne saurait trop rudement contredire l'idiotie des érudits qui soutient encore aujourd'hui ce genre d'opinion. À l'époque où les couches tchandalas malades, corrompues, se christiani-saient dans l'ensemble de l'imperium, le type justement contraire, l'aristocratie, existait sous sa forme la plus belle et la plus accomplie. C'est le grand nombre qui est devenu maître ; le démocratisme des instincts chré¬tiens fut victorieux... Le christianisme n'était pas « national «, n'était pas lié à une race, — il s'adressait à
toutes sortes de déshérités de la vie, il avait ses affidés partout. Le christianisme contient en son fond la ran¬cune des malades, leur instinct dirigés contre les bien-portants, contre la santé. Tout ce qui est bien réussi, fier, pétulant, la beauté surtout, lui blesse les oreilles et les yeux. Une fois de plus, je rappelle l'inappréciable parole de Paul : « Ce qui est faible aux yeux du monde, ce qui est folie aux yeux du monde, ce qui est vil et méprisé aux yeux du monde, Dieu l'a choisi « : c'était cela, la formule, in hoc signo a vaincu la décadence. — Dieu sur la Croix — ne comprend-on toujours pas l'effroyable arrière-pensée de ce symbole ? — Tout ce qui souffre, tout ce qui est suspendu à la Croix est divin... Nous sommes tous suspendus à la Croix, par conséquent nous sommes divins... Nous seuls sommes divins... Le christianisme fut une victoire, un mode de penser plus aristocratique en a péri, — le christianisme a été jusqu'ici le plus grand malheur de l'humanité.
5. Le Sermon sur la montagne
Matthieu, V-VII, trad. Louis Segond.
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ;
et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. [.. .]
Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom¬pense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ?
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. [...]
Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ;
car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.
6. Le Déluge chez Ovide
Ovide, Les Métamorphoses, I, 253-312,
trad. Joseph Chamonard, Paris, GF-Flammarion,
1966, p. 48-50.
Il [Jupiter] se disposait déjà à couvrir des traits de sa foudre toute la superficie de la terre, mais il craignit de voir l'éther sacré, au contact de tous ces feux, s'enflam¬mer, et le monde s'embraser d'un pôle à l'autre. Il se rappelle aussi que, suivant le destin, un jour doit venir où la mer, où la terre, où le ciel, demeure divine, à son tour envahi par les flammes, brûleront, où la masse du monde, édifiée avec tant d'art, s'écroulera. Il repose ses carreaux fabriqués par les mains des Cyclopes. Un châ¬timent tout différent lui sourit : il va consommer sous les eaux la perte du genre humain et, de tous les points du ciel, faire crever les nuages.
Aussitôt, il enferme l'Aquilon dans les antres d'Éole, et avec lui tous les vents qui mettent en déroute les nuages pris dans leurs tourbillons ; puis il lâche le Notus. Sur ses ailes humides, le Notus s'envole, son visage terrifiant couvert d'une obscurité de poix ; sa barbe est alourdie de pluie, l'eau coule de ses cheveux blancs, sur son front séjournent les brouillards, ses ailes, son sein ruissellent. Et quand, de sa main étendue, il pressa les nuages en suspens, avec fracas s'épanchent du haut de l'éther les cataractes qu'il enfermait. La messa¬gère de Junon, vêtue de couleurs chatoyantes, attire et recueille les eaux dont elle alimente les nuages. Les blés sont déversés ; sous les yeux du cultivateur éploré tous ses espoirs gisent à terre, et le labeur d'une longue année, devenu vain, est anéanti. Mais la colère de Jupi¬ter ne se borne pas aux limites du ciel, son domaine.
Son frère, roi des flots azurés, vient à son aide et lui apporte le secours de ses eaux. Il convoque les fleuves. Dès qu'ils eurent pénétré dans la demeure de leur maître : « De longues exhortations sont, dit-il, en ces circonstances, inutiles. Donnez libre cours à votre vio¬lence : c'est là ce qu'on vous demande. Ouvrez vos réservoirs et, renversant vos digues, lâchez sans contrainte les rênes à vos flots. « Ses ordres donnés, ils reviennent à leur demeure et ouvrent toutes grandes les bouches de leurs sources. Leur flot déchaîné prend sa course et roule vers les mers. Le dieu, de son côté, de son trident, a frappé la terre. Elle a tremblé, et la secousse a ouvert une large route aux eaux. Libres, les fleuves s'élancent hors de leur lit à travers les plaines ouvertes, entraînant tout ensemble avec les moissons, les arbres et les bêtes, les hommes et les maisons, les sanctuaires avec leur mobilier sacré. Si quelque demeure est restée debout et a pu résister, sans être renversée, à ce cataclysme, l'onde plus haute encore en recouvre cependant le toit, et les tours englouties dispa¬raissent dans le gouffre des eaux. Entre la mer et la terre, nulle différence n'apparaissait plus : tout n'était plus qu'une plaine liquide, et cette plaine n'avait même pas de rives. L'un se réfugie sur une colline, l'autre, installé dans une barque aux flancs incurvés, se guide à la rame là où il avait labouré naguère ; celui-là navigue au-dessus de son champ de blé ou du toit de sa ferme submergée ; celui-ci prend un poisson au sommet d'un orme ; c'est dans une verte prairie, si le hasard l'a voulu, que s'enfonce l'ancre, ou bien, de leur quille les barques courbes écrasent les vignes qu'elles surnagent. Et là où naguère les maigres chèvres brou¬tèrent le gazon, maintenant les phoques informes viennent se poser. Les Néréides sous l'eau contemplent avec étonnement des parcs, des villes, des maisons. Les
dauphins sont les hôtes des forêts, ils se jettent contre les branches et se heurtent aux chênes que le choc ébranle. Le loup nage au milieu des brebis. L'onde charrie des lions fauves, charrie des tigres. Sa force fou¬droyante n'est plus d'aucun secours pour le sanglier, non plus que la rapidité de sa course pour le cerf entraîné par le flot. Et, après avoir longtemps cherché une terre où pouvoir se poser, l'oiseau errant, les ailes fatiguées, tombe à la mer. Sous cet immense déborde¬ment de la plaine liquide, les hauteurs avaient disparu ; les flots insolites battaient les sommets des montagnes. Les êtres vivants, pour la plupart, sont emportés par l'onde ; ceux que l'onde a épargnés succombent à un long jeûne, faute de nourriture.
La Phocide sépare les Aoniens des champs où se dresse l'Œta ; terre féconde tant qu'elle fut une terre, mais, en ces conjonctures, simple partie de la mer, vaste pleine d'eaux soudainement assemblées. Un mont, en cet endroit, pointe ses deux sommets escarpés vers les astres ; il se nomme Parnasse, et son faîte dépasse les nuages. Lorsque Deucalion, en ce point — car l'eau avait recouvert le reste du monde —, monté sur une frêle barque, avec celle qui partageait sa couche 1, eut abordé, tous deux adressent leur hommage aux nymphes Coryciennes, aux divinités de la montagne, à Thémis, interprète du destin, qui était alors maîtresse de l'oracle. Jamais homme ne fut plus que lui vertueux, ni plus ami de la justice, jamais femme plus qu'elle pénétrée de la crainte des dieux.
Quand Jupiter vit que le monde n'était plus qu'une nappe liquide et stagnante, que, de tant de milliers d'hommes vivant naguère, il n'en restait qu'un, que de tant de milliers de femmes, il n'en restait qu'une, tous
1. Sa femme, Pyrrha, qui est aussi sa cousine germaine.
deux honnêtes, tous deux pleins de dévotion pour la divinité, il dispersa les nuages, et, le rideau de pluie écarté par l'aquilon, il rend au ciel la vue de la terre, à la terre, celle de l'éther.
«
70 1 PHILOSOPHIE DE LAMOUR
différence entre moi et moi-même, du moment où je
passe de la veille au sommeil, à celui
où je reviens du
sommeil à la veille ! Où est alors la raison qui, pendant
la veille, sait résister à de telles suggestions, et ne se
laisse point ébranler même en présence des réalités ? Se
ferme-t-elle avec les yeux ? S'assoupit-elle avec le sens ?
Mais d'où vient que souvent, même dans le sommeil,
nous résistons, que nous nous rappelons nos fermes
propos, que nous nous y tenons chastement, que nous
refusons notre assentiment à
ces sortes de séductions ?
Et cependant la différence est telle que, dans le cas
contraire, nous retrouvons au réveil la paix de la
conscience ; et la dissemblance même des deux états
nous montre que ce n'est pas nous qui avons fait
ce
qui s'est fait en nous et que nous déplorons.
Votre main,
Dieu qui pouvez tout, ne peut-elle point
guérir tous les maux de mon âme, abolir aussi, par une
surabondance de grâce,
les mouvements lascifs de mon
sommeil ? Vous accroîtrez de plus en plus, Seigneur, le
nombre de vos bontés envers moi,
afin que mon âme,
échappée à la glu de la concupiscence, me suive jusqu'à
vous,
afin qu'elle
ne
se rebelle plus contre elle-même,
et que, même
pendant le sommeil, non seulement elle
ne consomme pas, sous l'influence d'images bestiales,
des turpitudes dégradantes jusqu'à l'émission charnelle,
mais qu'elle n'y consente même pas.
De faire que, ni
dans
ma vie présente ni dans ma vie à venir, je ne
prenne
point de plaisir à de telles surprises des sens -
fussent-elles faibles au
point que le moindre mouve
ment suffise à les maîtriser, quand on s'est endormi
dans de chastes sentiments -cela ne vous coûte guère,
ô Tout-Puissant, «qui pouvez pour nous, plus que
nous ne demandons et comprenons».
Maintenant, j'ai
dit à
mon bon Seigneur où j'en suis encore dans ce
genre de misères,
«me réjouissant en tremblant des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mai 68, Sexualité, couple, famille - anthologie historique.
- Cicéron, Des lois (extrait) (anthologie de textes juridiques).
- Appel féministe à l'égalité (1898) (anthologie de textes juridiques).
- Accords Matignon (anthologie de textes juridiques).
- Ripert, la Règle morale dans les obligations civiles (extrait) (anthologie de textes juridiques).