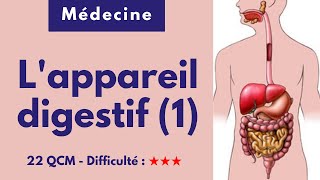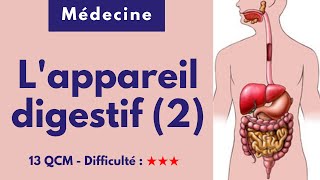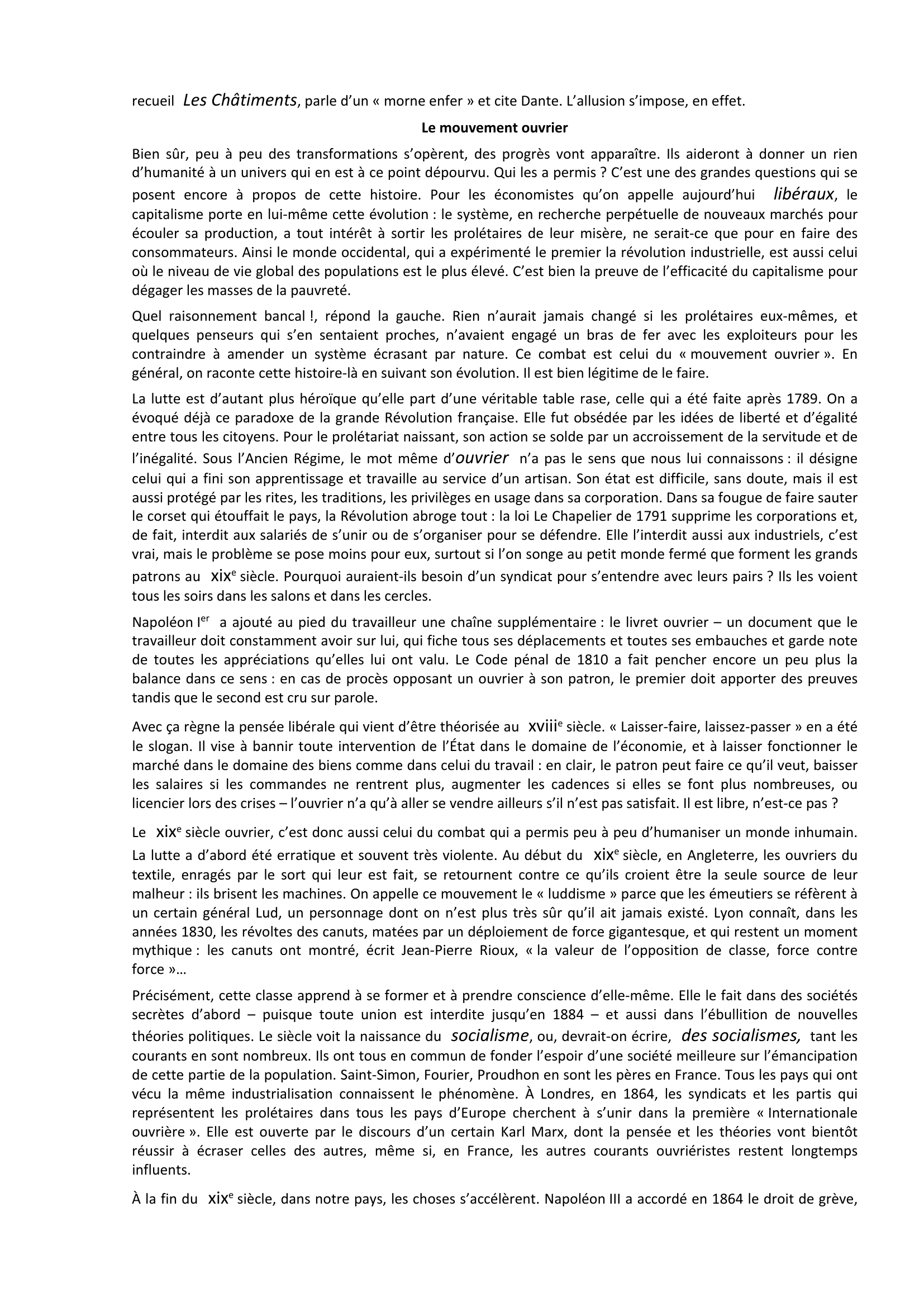35 Monde ouvrier Monde oublié ? Le xixe siècle, ses immenses usines, ses cheminées fumantes, ses mines, ses machines qui tournent dans un bruit d'enfer, ses villes tentaculaires et, partout, les travailleurs et leur misère, ces foules abruties par l'ouvrage, les prolétaires. On l'a vu plus haut, sur le plan de la politique, ce temps n'en finit plus de subir les répliques de la grande secousse de 1789. L'économie est sous le choc d'une autre révolution : la « révolution industrielle », c'est-à-dire le basculement de sociétés reposant sur l'agriculture et l'artisanat dans un monde dominé par les machines et la production à grande échelle. Pour l'historien Jean-Pierre Rioux, qui lui a consacré un livre indispensable et précis1, il s'agit de « la plus profonde mutation qui ait jamais affecté les hommes depuis le Néolithique ». Les causes en sont multiples. Les bouleversements techniques successifs qui se produisent au xviiie siècle en sont un puissant déclencheur et ils contribuent bientôt à alimenter eux-mêmes le système : la mise au point des métiers à tisser mécanisés bouleverse le secteur textile ; la machine à vapeur révolutionne la production, et, appliquée aux bateaux, ouvre la voie à la révolution des transports, bientôt amplifiée au centuple par l'invention du chemin de fer - qui, à son tour, crée de nouveaux besoins énormes en charbon pour alimenter les chaudières et en métal pour construire rails et locomotives. Repères - 1791 : loi Le Chapelier proscrivant toute organisation ouvrière - 1841 : loi interdisant le travail des enfants de moins de huit ans - 1864 : droit de grève accordé par Napoléon III - 1884 : loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats Commencé en Angleterre dans la deuxième moitié du xviiie siècle, le mouvement, sur un siècle, gagne une zone qui englobe le Nord et l'Est de la France, l'actuelle Belgique, la région de la Ruhr et se répand au fil des découvertes de nouveaux gisements de houille ou de minerai. Sur les plaines, dans les vallées, les puits de mine, les terrils, les hauts-fourneaux, les cheminées puantes forment l'horizon des temps nouveaux. Les modes de production antérieurs sont peu à peu balayés. Le petit artisanat disséminé, le travail de filage fait le soir à domicile perdent progressivement leur place dans le monde de la machine, du rendement, des unités de production de plus en plus énormes. Le phénomène est graduel : pendant un temps, nombre de travailleurs vont osciller entre les deux mondes, à l'usine à la morte saison, de retour aux champs l'été. Mais il semble irrésistible. En 1812, on compte, chez Schneider, au Creusot, 230 ouvriers. En 1870, ils sont 12 500. Au fil du temps, les usines, ces molochs du siècle, engloutissent ces masses humaines que les transformations de l'économie ont fini par jeter hors des campagnes et qui viennent, avec femmes et enfants, vendre aux patrons leur seul bien : leurs bras. On n'a pas idée, aujourd'hui, de ce que fut, au moment du choc de cette révolution industrielle, la condition de ces gens. La vie des paysans du temps était rude : nourriture monotone, travail physiquement éprouvant, logement réduit au minimum. Dans nombre de petites fermes, nous disent les enquêtes conduites au xixe, l'espace dévolu à toute la famille se résumait à une pièce unique séparée de l'étable par un muret ne montant pas jusqu'au plafond, ce qui permettait de bénéficier de la chaleur des bêtes. À côté de la vie d'un ouvrier, cela semble presque luxueux. À la campagne, au moins, le rythme des saisons, l'organisation de la journée en fonction de la lumière du jour permettent des plages de repos. À l'usine, les journées durent de douze à quinze heures, toujours les mêmes, sans congés, sans temps morts, dans la froideur de l'hiver ou la touffeur de l'été, dans le bruit des machines, la saleté de l'huile, la puanteur de la fumée, sous les ordres d'un contremaître ou d'un patron qui exige des cadences de plus en plus lourdes, et n'hésite pas, nous explique Rioux, à truquer la cloche pour retarder la sortie. Les adultes, hommes et femmes, y travaillent pour des salaires de misère - on aura compris que l'expression est à prendre dans son sens plein. Les enfants aussi, à partir de six ou sept ans : leur petite taille est souvent un avantage. Dans les mines, ils peuvent se faufiler dans les plus étroits boyaux ; à l'atelier, ils peuvent se glisser sous les machines, cela permet de les graisser ou de les réparer sans avoir à les arrêter... Pour les hommes, la seule distraction après l'ouvrage est d'aller se retourner la tête avec du mauvais alcool au cabaret. Les femmes ont droit à des heures supplémentaires d'un autre type : souvent des rabatteurs installés à la sortie même des ateliers les invitent à la prostitution. Dans l'argot du temps, on dit qu'elles font leur « cinquième quart ». Ensuite, il reste à s'effondrer d'abrutissement dans des soupentes puantes dont ne voudraient pas des bêtes. Victor Hugo est resté marqué à jamais par la visite qu'il a effectuée en 1851, à l'époque où il était député de la Seconde République, dans les caves de Lille, des trous à rats insalubres, sans lumière, sans feu, où des êtres de trente ans flétris comme des vieillards se mouraient de fatigue et de maladie sur des galetas. Le poème qu'il a tiré de cette enquête, publié dans le recueil Les Châtiments, parle d'un « morne enfer » et cite Dante. L'allusion s'impose, en effet. Le mouvement ouvrier Bien sûr, peu à peu des transformations s'opèrent, des progrès vont apparaître. Ils aideront à donner un rien d'humanité à un univers qui en est à ce point dépourvu. Qui les a permis ? C'est une des grandes questions qui se posent encore à propos de cette histoire. Pour les économistes qu'on appelle aujourd'hui libéraux, le capitalisme porte en lui-même cette évolution : le système, en recherche perpétuelle de nouveaux marchés pour écouler sa production, a tout intérêt à sortir les prolétaires de leur misère, ne serait-ce que pour en faire des consommateurs. Ainsi le monde occidental, qui a expérimenté le premier la révolution industrielle, est aussi celui où le niveau de vie global des populations est le plus élevé. C'est bien la preuve de l'efficacité du capitalisme pour dégager les masses de la pauvreté. Quel raisonnement bancal !, répond la gauche. Rien n'aurait jamais changé si les prolétaires eux-mêmes, et quelques penseurs qui s'en sentaient proches, n'avaient engagé un bras de fer avec les exploiteurs pour les contraindre à amender un système écrasant par nature. Ce combat est celui du « mouvement ouvrier ». En général, on raconte cette histoire-là en suivant son évolution. Il est bien légitime de le faire. La lutte est d'autant plus héroïque qu'elle part d'une véritable table rase, celle qui a été faite après 1789. On a évoqué déjà ce paradoxe de la grande Révolution française. Elle fut obsédée par les idées de liberté et d'égalité entre tous les citoyens. Pour le prolétariat naissant, son action se solde par un accroissement de la servitude et de l'inégalité. Sous l'Ancien Régime, le mot même d'ouvrier n'a pas le sens que nous lui connaissons : il désigne celui qui a fini son apprentissage et travaille au service d'un artisan. Son état est difficile, sans doute, mais il est aussi protégé par les rites, les traditions, les privilèges en usage dans sa corporation. Dans sa fougue de faire sauter le corset qui étouffait le pays, la Révolution abroge tout : la loi Le Chapelier de 1791 supprime les corporations et, de fait, interdit aux salariés de s'unir ou de s'organiser pour se défendre. Elle l'interdit aussi aux industriels, c'est vrai, mais le problème se pose moins pour eux, surtout si l'on songe au petit monde fermé que forment les grands patrons au xixe siècle. Pourquoi auraient-ils besoin d'un syndicat pour s'entendre avec leurs pairs ? Ils les voient tous les soirs dans les salons et dans les cercles. Napoléon Ier a ajouté au pied du travailleur une chaîne supplémentaire : le livret ouvrier - un document que le travailleur doit constamment avoir sur lui, qui fiche tous ses déplacements et toutes ses embauches et garde note de toutes les appréciations qu'elles lui ont valu. Le Code pénal de 1810 a fait pencher encore un peu plus la balance dans ce sens : en cas de procès opposant un ouvrier à son patron, le premier doit apporter des preuves tandis que le second est cru sur parole. Avec ça règne la pensée libérale qui vient d'être théorisée au xviiie siècle. « Laisser-faire, laissez-passer » en a été le slogan. Il vise à bannir toute intervention de l'État dans le domaine de l'économie, et à laisser fonctionner le marché dans le domaine des biens comme dans celui du travail : en clair, le patron peut faire ce qu'il veut, baisser les salaires si les commandes ne rentrent plus, augmenter les cadences si elles se font plus nombreuses, ou licencier lors des crises - l'ouvrier n'a qu'à aller se vendre ailleurs s'il n'est pas satisfait. Il est libre, n'est-ce pas ? Le xixe siècle ouvrier, c'est donc aussi celui du combat qui a permis peu à peu d'humaniser un monde inhumain. La lutte a d'abord été erratique et souvent très violente. Au début du xixe siècle, en Angleterre, les ouvriers du textile, enragés par le sort qui leur est fait, se retournent contre ce qu'ils croient être la seule source de leur malheur : ils brisent les machines. On appelle ce mouvement le « luddisme » parce que les émeutiers se réfèrent à un certain général Lud, un personnage dont on n'est plus très sûr qu'il ait jamais existé. Lyon connaît, dans les années 1830, les révoltes des canuts, matées par un déploiement de force gigantesque, et qui restent un moment mythique : les canuts ont montré, écrit Jean-Pierre Rioux, « la valeur de l'opposition de classe, force contre force »... Précisément, cette classe apprend à se former et à prendre conscience d'elle-même. Elle le fait dans des sociétés secrètes d'abord - puisque toute union est interdite jusqu'en 1884 - et aussi dans l'ébullition de nouvelles théories politiques. Le siècle voit la naissance du socialisme, ou, devrait-on écrire, des socialismes, tant les courants en sont nombreux. Ils ont tous en commun de fonder l'espoir d'une société meilleure sur l'émancipation de cette partie de la population. Saint-Simon, Fourier, Proudhon en sont les pères en France. Tous les pays qui ont vécu la même industrialisation connaissent le phénomène. À Londres, en 1864, les syndicats et les partis qui représentent les prolétaires dans tous les pays d'Europe cherchent à s'unir dans la première « Internationale ouvrière ». Elle est ouverte par le discours d'un certain Karl Marx, dont la pensée et les théories vont bientôt réussir à écraser celles des autres, même si, en France, les autres courants ouvriéristes restent longtemps influents. À la fin du xixe siècle, dans notre pays, les choses s'accélèrent. Napoléon III a accordé en 1864 le droit de grève, mais il est très restreint, très compliqué à exercer, et il n'a été accompagné d'aucun texte permettant aux travailleurs de s'unir. Il faut attendre la loi Waldeck-Rousseau, en 1884, pour qu'enfin les syndicats soient autorisés. Dès lors, le nombre de gens qui y adhèrent explose (190 000 en 1890, 400 000 quatre ans plus tard). La grève devient une scansion familière de la vie de l'usine. Les grandes revendications, comme la journée de huit heures - qui sera finalement adoptée après la Grande Guerre (loi de 1919) -, appuyées par les uns, récusées par les autres, sont des enjeux nationaux. Et, au tournant du siècle, si les socialistes peinent toujours à s'unir, ils ne sont plus ces extrémistes redoutés qui se regroupaient dans les arrière-salles fumeuses des faubourgs trente ou quarante ans auparavant. Ils ont leur groupe parlementaire, leurs leaders nationaux, Jaurès, plus républicain, ou Jules Guesde, plus marxiste. Ils auront même en 1899, pour la première fois de leur histoire et au grand dam d'une partie d'entre eux, un ministre faisant son entrée dans un « gouvernement bourgeois » (Millerand, dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau). Le geste déclenche des polémiques sans fin au sein de l'extrême gauche - doit-on collaborer avec le pouvoir ? -, il signe au moins ce fait indiscutable : les partis ouvriers représentent enfin un des grands courants de pensée parfaitement intégrés à la vie politique républicaine. Le monde oublié On le voit, il aura fallu bien du temps. C'est sur ce décalage que nous voudrions insister avant de clore ce chapitre. Le point paraîtra étonnant, car il est rare qu'on l'aborde en tant que tel, c'est dommage. En général, on se contente de suivre le déroulé des choses comme nous venons de le faire. Ainsi donc, constate-t-on, ce n'est que dans les années 1880-1890 que la « question ouvrière » et les partis qui s'en préoccupent entrent de plain-pied dans le débat national. Pourquoi oublier la remarque corollaire ? Cela signifierait-il donc qu'elle n'en a pas vraiment fait partie jusque-là, sinon à la marge ? Tentons donc de refaire la même histoire, mais avec un point de vue inverse. Il ne s'agit plus d'observer notre problématique sociale depuis le bas de l'échelle, là où elle est à vif, mais depuis son sommet, chez les dirigeants, les politiques, les penseurs. Les livres en parlent moins, ils ont tort. Étudier ce qui passionne une société à un moment donné est essentiel. Souligner l'art qu'elle peut mettre à ne pas traiter de sujets qui, rétrospectivement, nous semblent si importants ne l'est pas moins. On ne peut pas écrire, bien sûr, que cette omission est totale. Certains se penchent sur le sort du prolétariat pendant les six ou huit premières décennies de la révolution industrielle. L'Église, par tradition attentive aux pauvres, a vu naître dès les années 1830 ce courant que l'on appelle le catholicisme social, derrière de grandes personnalités comme Félicité de Lamennais (1782-1854), ou des oeuvres comme la société Saint-Vincent-de-Paul (organisation fondée en 1833), attentives à soulager les misères. Parfois, d'éminents philanthropes cherchent à alerter. On cite souvent, dans les livres d'aujourd'hui, l'enquête remarquable et terrible publiée en 1840 par Villermé, un médecin humaniste qui s'était plongé dans le quotidien des ouvriers des manufactures du textile. On la cite d'autant plus volontiers qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres pour cette période. La réalité qu'il décrit est effroyable. Le cri se fait entendre. Des parlementaires pensent qu'il faut faire quelque chose. Sur quoi cela débouche-t-il ? Sur une réforme de fond obligeant à donner à tous un salaire décent ? Ou au moins à un plan d'urgence visant à soulager au moins temporairement ces malheureux ? Pas du tout. Après des mois, on en arrive à un texte législatif, qui est lui aussi toujours cité, parce qu'il est considéré comme un des premiers du droit social français : la loi de 1841 qui décide avec bravoure qu'il est temps d'interdire le travail aux enfants de moins de huit ans, et exige qu'on ne permette pas à ceux de moins de douze ans de travailler plus de huit heures par jour. On a bien lu. Au début des années 1840, un demi-siècle après la Révolution française et ses rêves d'égalité et de bonheur pour tous, on en était encore à devoir produire une loi pour empêcher qu'on envoie des bambins se tuer sous les machines, dans les usines où mouraient leurs pères. Et encore, le texte a suscité de vives oppositions. L'État n'a pas à s'immiscer dans des contrats qui regardent des particuliers, ont dit les vrais libéraux. Les gens respectueux des hiérarchies ont ajouté : et puis les pères de famille dirigent l'éducation de leurs enfants comme ils l'entendent ! S'ils veulent que leur progéniture travaille, au nom de quoi, franchement, les en empêcherait-on ? Tous ceux-là seront rassurés par la suite des événements, d'ailleurs : la loi est adoptée mais rien n'est prévu pour qu'elle soit appliquée. Les enfants, même petits, continueront à travailler longtemps, la misère est telle qu'aucune famille ne peut se passer de l'appoint. En 1874 encore (chiffres cités là encore par Rioux), les usines de plus de 10 salariés en France emploient 670 000 hommes et 130 000 enfants. Il est donc inexact d'affirmer que la question sociale a été totalement absente du discours politique des deux premiers tiers du xixe siècle. Parfois, elle surgit même de façon brutale, extrême. Ainsi, au moment de la révolution de février 1848, avec Louis Blanc et ses amis, socialistes qui font une première entrée au gouvernement. C'est si bref. Ils ont le temps de pousser à la création des « ateliers nationaux », qui doivent donner du travail aux ouvriers qui n'en ont pas. En juin, les ateliers sont déjà fermés, les ouvriers sont réprimés à coups de fusil et Louis