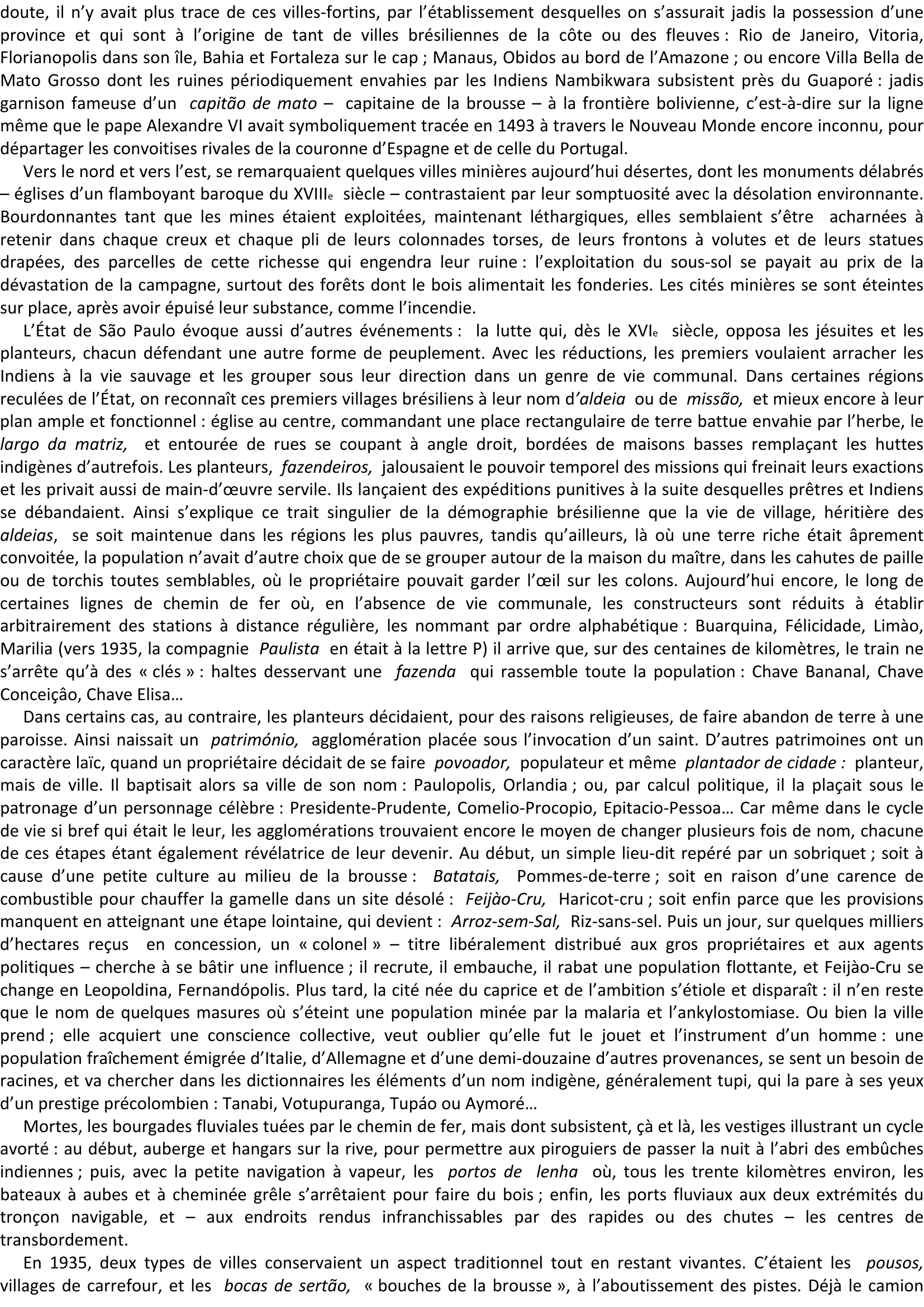s'ornaient de vertes palmes, luttes commémoratives fidèles à la tradition portugaise, entre mouros et cristãos ; procession de la nau catarineta, navire de carton gréé de voiles en papier ; pèlerinage à de lointaines paroisses protectrices des lépreux où, dans les effluves crapuleux de la pinga - alcool de canne à sucre très différent du rhum et qu'on absorbe pur ou en batida, c'est-à-dire mêlé au jus d'un citron galé - des bardes métis, bottés, costumés 'oripeaux et prodigieusement ivres, se provoquaient au son du tambour à des duels de chansons satiriques. Il y avait ussi les croyances et les superstitions dont il était intéressant de faire la carte : cure de l'orgelet par l'imposition d'un nneau d'or ; répartition de tous les aliments en deux groupes incompatibles : comida quente, comida fria, nourriture chaude et nourriture froide. Et d'autres associations maléfiques : poisson et viande, mangue avec boisson alcoolisée ou banane avec du lait. Pourtant, dans l'intérieur de l'État, il était plus passionnant encore de s'attacher, non pas aux vestiges des traditions méditerranéennes mais aux formes singulières que favorisait une société en gestation. Le sujet était le même, il s'agissait toujours du passé et du présent, mais à l'inverse de l'enquête ethnographique de type classique, qui cherche à expliquer celui-ci par celui-là, c'était ici le présent fluide qui paraissait reconstituer des étapes très anciennes de l'évolution européenne. Comme au temps de la France mérovingienne, on voyait naître la vie communale et urbaine dans une campagne de latifundia. Les agglomérations qui surgissaient n'étaient pas comme les villes d'aujourd'hui - si usées qu'il devient difficile d'y découvrir la marque de leur histoire particulière - confondues dans une forme de plus en plus homogène où s'affirment seulement les distinctions administratives. Au contraire, on pouvait scruter les villes comme un botaniste les plantes, reconnaissant au nom, à l'aspect et à la structure de chacune son appartenance à telle ou telle grande famille d'un règne ajouté par l'homme à la nature : le règne urbain. Au cours des XIXe et XXe siècles, l'anneau mouvant de la frange pionnière s'était lentement déplacé d'est en ouest et du sud vers le nord. En 1836, seule la Norte, c'est-à-dire la région entre Rio et São Paulo, était solidement occupée, et le mouvement gagnait la zone centrale de l'État. Vingt ans plus tard, la colonisation mordait au nord-est sur la Mogiana et la Paulista ; en 1886, elle entamait l'Araraquara, l'Alta Sorocabana et la Noroeste. Dans ces dernières zones, en 1935 encore, la courbe de croissance de la population épousait celle de la production du café tandis que, dans les vieilles terres du Nord, l'effondrement de l'une anticipait d'un demi-siècle le déclin de l'autre : la chute démographique commence à s'y faire sentir à partir de 1920, alors que, dès 1854, les terres épuisées tombent à l'abandon. Ce cycle d'utilisation de l'espace correspondait à une évolution historique dont la marque était également passagère. C'est seulement dans les grandes villes de la côte - Rio et São Paulo - que l'expansion urbaine semblait avoir une base assez solide pour paraître irréversible : São Paulo comptait 240 000 habitants en 1900, 580 000 en 1920, passait le million en 1928 et double ce cap aujourd'hui. Mais, à l'intérieur, les espèces urbaines naissaient et disparaissaient ; en même temps qu'elle se peuplait, la province se dépeuplait. En se déplaçant d'un point à un autre sans toujours s'accroître en nombre, les habitants changeaient de type social, et l'observation côte à côte de villes fossiles et de cités embryonnaires permettait, sur le plan humain et dans les limites temporelles extrêmement courtes, l'étude de transformations aussi saisissantes que celles du paléontologiste comparant au long des étages géologiques les phases, s'étendant sur des millions de siècles, de l'évolution des êtres organisés. Dès qu'on quittait la côte il ne fallait pas perdre de vue que, depuis un siècle, le Brésil s'était transformé plus qu'il ne s'était développé. À l'époque impériale, l'occupation humaine était faible, mais relativement bien répartie. Si les villes littorales ou voisines restaient petites, celles de l'intérieur avaient une vitalité plus grande qu'aujourd'hui. Par un paradoxe historique qu'on a trop souvent tendance à oublier, l'insuffisance générale des moyens de communication favorisait les plus mauvais ; quand on n'avait d'autre ressource que d'aller à cheval, on éprouvait moins de répugnance à prolonger de tels voyages pendant des mois plutôt que des jours ou des semaines, et à s'enfoncer là où le mulet seul pouvait se risquer. L'intérieur du Brésil vivait solidairement d'une vie lente sans doute, mais continue ; on naviguait à dates fixes sur les rivières, en petites étapes s'étendant sur plusieurs mois ; et des pistes complètement oubliées en 1935, comme celle de Cuiaba à Goyaz, servaient encore à un trafic intense de caravanes comptant chacune cinquante à deux cents mules, un siècle auparavant. Si l'on excepte les régions les plus reculées, l'abandon dans lequel était tombé le Brésil central au début du XXe siècle ne reflétait nullement une situation primitive : il était le prix payé pour l'intensification du peuplement et des échanges dans les régions côtières, en raison des conditions de vie moderne qui s'y instauraient ; tandis que l'intérieur, parce que le progrès y était trop difficile, régressait au lieu de suivre le mouvement au rythme ralenti qui lui appartient. Ainsi la navigation à vapeur qui raccourcit les trajets, a-t-elle tué à travers le monde des ports d'escale jadis célèbres ; on peut se demander si l'aviation, en nous invitant à jouer à saute-mouton par-dessus les étapes anciennes, n'est pas appelée à remplir le même rôle. Après tout, il est permis de rêver que le progrès mécanique s'arrache à lui-même cette rançon où se loge notre espoir : l'obligeant à rendre une menue monnaie de solitude et d'oubli, en échange de l'intimité dont il nous ravit massivement la jouissance. À une échelle réduite, l'intérieur de l'État de São Paulo et les régions voisines illustraient ces transformations. Sans doute, il n'y avait plus trace de ces villes-fortins, par l'établissement desquelles on s'assurait jadis la possession d'une province et qui sont à l'origine de tant de villes brésiliennes de la côte ou des fleuves : Rio de Janeiro, Vitoria, lorianopolis dans son île, Bahia et Fortaleza sur le cap ; Manaus, Obidos au bord de l'Amazone ; ou encore Villa Bella de Mato Grosso dont les ruines périodiquement envahies par les Indiens Nambikwara subsistent près du Guaporé : jadis garnison fameuse d'un capitão de mato - capitaine de la brousse - à la frontière bolivienne, c'est-à-dire sur la ligne même que le pape Alexandre VI avait symboliquement tracée en 1493 à travers le Nouveau Monde encore inconnu, pour départager les convoitises rivales de la couronne d'Espagne et de celle du Portugal. Vers le nord et vers l'est, se remarquaient quelques villes minières aujourd'hui désertes, dont les monuments délabrés - églises d'un flamboyant baroque du XVIIIe siècle - contrastaient par leur somptuosité avec la désolation environnante. Bourdonnantes tant que les mines étaient exploitées, maintenant léthargiques, elles semblaient s'être acharnées à retenir dans chaque creux et chaque pli de leurs colonnades torses, de leurs frontons à volutes et de leurs statues drapées, des parcelles de cette richesse qui engendra leur ruine : l'exploitation du sous-sol se payait au prix de la dévastation de la campagne, surtout des forêts dont le bois alimentait les fonderies. Les cités minières se sont éteintes sur place, après avoir épuisé leur substance, comme l'incendie. L'État de São Paulo évoque aussi d'autres événements : la lutte qui, dès le XVIe siècle, opposa les jésuites et les planteurs, chacun défendant une autre forme de peuplement. Avec les réductions, les premiers voulaient arracher les Indiens à la vie sauvage et les grouper sous leur direction dans un genre de vie communal. Dans certaines régions reculées de l'État, on reconnaît ces premiers villages brésiliens à leur nom d'aldeia ou de missão, et mieux encore à leur lan ample et fonctionnel : église au centre, commandant une place rectangulaire de terre battue envahie par l'herbe, le largo da matriz, et entourée de rues se coupant à angle droit, bordées de maisons basses remplaçant les huttes ndigènes d'autrefois. Les planteurs, fazendeiros, jalousaient le pouvoir temporel des missions qui freinait leurs exactions et les privait aussi de main-d'oeuvre servile. Ils lançaient des expéditions punitives à la suite desquelles prêtres et Indiens se débandaient. Ainsi s'explique ce trait singulier de la démographie brésilienne que la vie de village, héritière des aldeias, se soit maintenue dans les régions les plus pauvres, tandis qu'ailleurs, là où une terre riche était âprement onvoitée, la population n'avait d'autre choix que de se grouper autour de la maison du maître, dans les cahutes de paille ou de torchis toutes semblables, où le propriétaire pouvait garder l'oeil sur les colons. Aujourd'hui encore, le long de ertaines lignes de chemin de fer où, en l'absence de vie communale, les constructeurs sont réduits à établir arbitrairement des stations à distance régulière, les nommant par ordre alphabétique : Buarquina, Félicidade, Limào, Marilia (vers 1935, la compagnie Paulista en était à la lettre P) il arrive que, sur des centaines de kilomètres, le train ne s'arrête qu'à des « clés » : haltes desservant une fazenda qui rassemble toute la population : Chave Bananal, Chave Conceiçâo, Chave Elisa... Dans certains cas, au contraire, les planteurs décidaient, pour des raisons religieuses, de faire abandon de terre à une aroisse. Ainsi naissait un património, agglomération placée sous l'invocation d'un saint. D'autres patrimoines ont un caractère laïc, quand un propriétaire décidait de se faire povoador, populateur et même plantador de cidade : planteur, mais de ville. Il baptisait alors sa ville de son nom : Paulopolis, Orlandia ; ou, par calcul politique, il la plaçait sous le patronage d'un personnage célèbre : Presidente-Prudente, Comelio-Procopio, Epitacio-Pessoa... Car même dans le cycle de vie si bref qui était le leur, les agglomérations trouvaient encore le moyen de changer plusieurs fois de nom, chacune de ces étapes étant également révélatrice de leur devenir. Au début, un simple lieu-dit repéré par un sobriquet ; soit à cause d'une petite culture au milieu de la brousse : Batatais, Pommes-de-terre ; soit en raison d'une carence de combustible pour chauffer la gamelle dans un site désolé : Feijào-Cru, Haricot-cru ; soit enfin parce que les provisions anquent en atteignant une étape lointaine, qui devient : Arroz-sem-Sal, Riz-sans-sel. Puis un jour, sur quelques milliers 'hectares reçus en concession, un « colonel » - titre libéralement distribué aux gros propriétaires et aux agents politiques - cherche à se bâtir une influence ; il recrute, il embauche, il rabat une population flottante, et Feijào-Cru se change en Leopoldina, Fernandópolis. Plus tard, la cité née du caprice et de l'ambition s'étiole et disparaît : il n'en reste ue le nom de quelques masures où s'éteint une population minée par la malaria et l'ankylostomiase. Ou bien la ville rend ; elle acquiert une conscience collective, veut oublier qu'elle fut le jouet et l'instrument d'un homme : une opulation fraîchement émigrée d'Italie, d'Allemagne et d'une demi-douzaine d'autres provenances, se sent un besoin de acines, et va chercher dans les dictionnaires les éléments d'un nom indigène, généralement tupi, qui la pare à ses yeux 'un prestige précolombien : Tanabi, Votupuranga, Tupáo ou Aymoré... Mortes, les bourgades fluviales tuées par le chemin de fer, mais dont subsistent, çà et là, les vestiges illustrant un cycle vorté : au début, auberge et hangars sur la rive, pour permettre aux piroguiers de passer la nuit à l'abri des embûches ndiennes ; puis, avec la petite navigation à vapeur, les portos de lenha où, tous les trente kilomètres environ, les bateaux à aubes et à cheminée grêle s'arrêtaient pour faire du bois ; enfin, les ports fluviaux aux deux extrémités du tronçon navigable, et - aux endroits rendus infranchissables par des rapides ou des chutes - les centres de transbordement. En 1935, deux types de villes conservaient un aspect traditionnel tout en restant vivantes. C'étaient les pousos, villages de carrefour, et les bocas de sertão, « bouches de la brousse », à l'aboutissement des pistes. Déjà le camion commençait à se substituer aux anciens moyens de transport : caravanes de mules ou chars à boeufs ; empruntant les êmes pistes, contraint par leur état précaire à rouler en première ou en seconde sur des centaines de kilomètres, réduit u même rythme de marche que les bêtes de somme et astreint aux mêmes étapes où se coudoyaient les chauffeurs en alopettes huileuses et les tropeiros harnachés de cuir. Les pistes répondaient mal à l'espoir qu'on y plaçait. Diverses par leur origine : anciennes routes de caravanes ayant jadis servi, dans un sens, au transport du café, de l'alcool de canne et du sucre ; dans l'autre, du sel, des légumes secs et de la farine ; et coupées de temps à autre par un registro en pleine brousse : barrière de bois entourée de quelques huttes où une autorité problématique, incarnée par un paysan en loques, réclamait le prix du péage ; et, ceci expliquant cela, d'autres réseaux plus secrets : les estradas francas, destinées à éviter les droits ; enfin, les estradas muladas, c'està-dire les routes de mules, et les estradas boiadas, routes de chars à boeufs. Sur celles-là, on entendait fréquemment, endant deux ou trois heures d'affilée, le hurlement monotone et déchirant - au point d'en perdre la tête quand on 'avait pas l'habitude - produit par la friction de l'essieu d'un char se rapprochant lentement. Ces chars d'un modèle ntique, importés au XVIe siècle d'un monde méditerranéen où ils n'avaient guère changé depuis les temps protoistoriques, se composaient d'une lourde caisse à timon, à parois de vannerie, posant directement sur un essieu solidaire e roues pleines, sans moyeu. Les bêtes de trait s'épuisaient à vaincre la résistance stridente opposée par l'essieu à la aisse, bien plus qu'à faire avancer le tout. Aussi, les pistes étaient l'effet largement accidentel du nivelage résultant de l'action répétée d'animaux, de chars et e camions se dirigeant approximativement dans la même direction, mais chacun au hasard des pluies, des effondrements ou de la croissance de la végétation, cherchant à se frayer la voie la mieux adaptée aux circonstances : cheveau compliqué de ravines et de pentes dénudées, parfois réunies et larges alors d'une centaine de mètres, comme n boulevard en pleine brousse qui me rappelait les drailles cévenoles, ou bien se dissociant aux quatre coins de l'horizon ans qu'on sache jamais lequel de tous ces fils d'Ariane il fallait suivre pour ne pas, au bout d'une trentaine de kilomètres vaincus en plusieurs heures d'une progression périlleuse, se trouver perdu au milieu des sables ou des marais. À la saison des pluies, les pistes transformées en canaux de boue grasse étaient intransitables ; mais ensuite, le premier camion qui éussissait à passer creusait la glaise de sillons profonds auxquels la sécheresse donnait en trois jours la consistance et la olidité du ciment. Les véhicules qui suivaient n'avaient d'autre ressource que de placer leurs roues dans ces gorges et de aisser aller, ce qui était possible à condition d'avoir le même écartement des roues et la même hauteur de pont que le prédécesseur. Si l'écartement était le même et le châssis plus bas, le dôme de la piste vous élevait tout à coup, la voiture se trouvait perchée sur un socle compact qu'on était condamné à démanteler à la pioche. Si l'écartement était autre, il fallait rouler pendant des journées entières, les roues d'un côté en contre-bas dans une rainure, les autres surélevées, si bien que le véhicule risquait à chaque instant de verser. Il me souvient encore d'un voyage auquel René Courtin avait sacrifié sa Ford neuve. Jean Maugüé, lui et moi nous étions proposé d'aller aussi loin que la voiture s'y prêterait. Cela s'est terminé à mille cinq cents kilomètres de São Paulo, dans la hutte d'une famille d'indiens Karaja sur les bords de l'Araguaya ; au retour, les ressorts avant se brisèrent, nous roulâmes pendant cent kilomètres le bloc-moteur posant directement sur l'essieu, puis, pendant six cents autres, soutenu par une lame de fer qu'un artisan de village avait consenti à forger. Mais surtout, je me rappelle ces heures de conduite anxieuse, la nuit tombée - car les villages sont rares aux confins de São Paulo et de Goyaz - sans savoir à quel instant nous trahirait le sillon que nous avions choisi pour piste entre dix autres. Tout à coup, le pouso surgissait dans l'obscurité criblée d'étoiles tremblotantes : ampoules électriques alimentées par un petit moteur dont la pulsation était parfois perceptible depuis des heures, mais confondue par l'oreille avec les bruits nocturnes de la brousse. L'auberge offrait ses lits de fer ou ses hamacs, et dès l'aube on parcourait la rua direita de la cidade viajante, ville d'étape, avec ses maisons et ses bazars, et sa place occupée par les regatões et les mascates : commerçants, docteurs, dentistes et même notaires itinérants. Les jours de foire, l'animation est grande : des centaines de paysans isolés ont quitté leur cahute pour l'occasion avec toute leur famille, voyage de plusieurs jours qui permettra, une fois l'an, de vendre un veau, une mule, un cuir de tapir ou de puma, quelques sacs de maïs, de riz, ou de café, et de rapporter en échange une pièce de cotonnade, du sel, du pétrole pour la lampe et quelques balles de fusil. À l'arrière-plan le plateau s'étend, couvert de broussaille avec des arbustes épars. Une jeune érosion - le déboisement datant d'un demi-siècle - l'a légèrement décapé, comme à coups précautionneux d'herminette. Des différences de niveau de quelques mètres circonscrivent le début des terrasses et marquent des ravins naissants. on loin d'un cours d'eau large mais superficiel - inondation capricieuse plutôt que rivière déjà fixée dans un lit - deux ou rois avenues parallèles bordent les enclos luxuriants autour des ranchos en torchis, couverts de tuiles et faisant étinceler a blancheur crémeuse de leur enduit de chaux, rendue plus intense par l'encadrement marron des volets et le ayonnement du sol pourpre. Dès les premières habitations, qui ressemblent à des halles couvertes à cause de leurs açades percées de grandes fenêtres sans vitres et presque toujours béantes, commencent des prairies d'herbe dure ongée jusqu'à la racine par le bétail. En prévision de la foire, les organisateurs ont fait déposer des provisions de ourrage : fanes de canne à sucre ou jeunes palmes comprimées au moyen de branchages et de liens d'herbe. Les