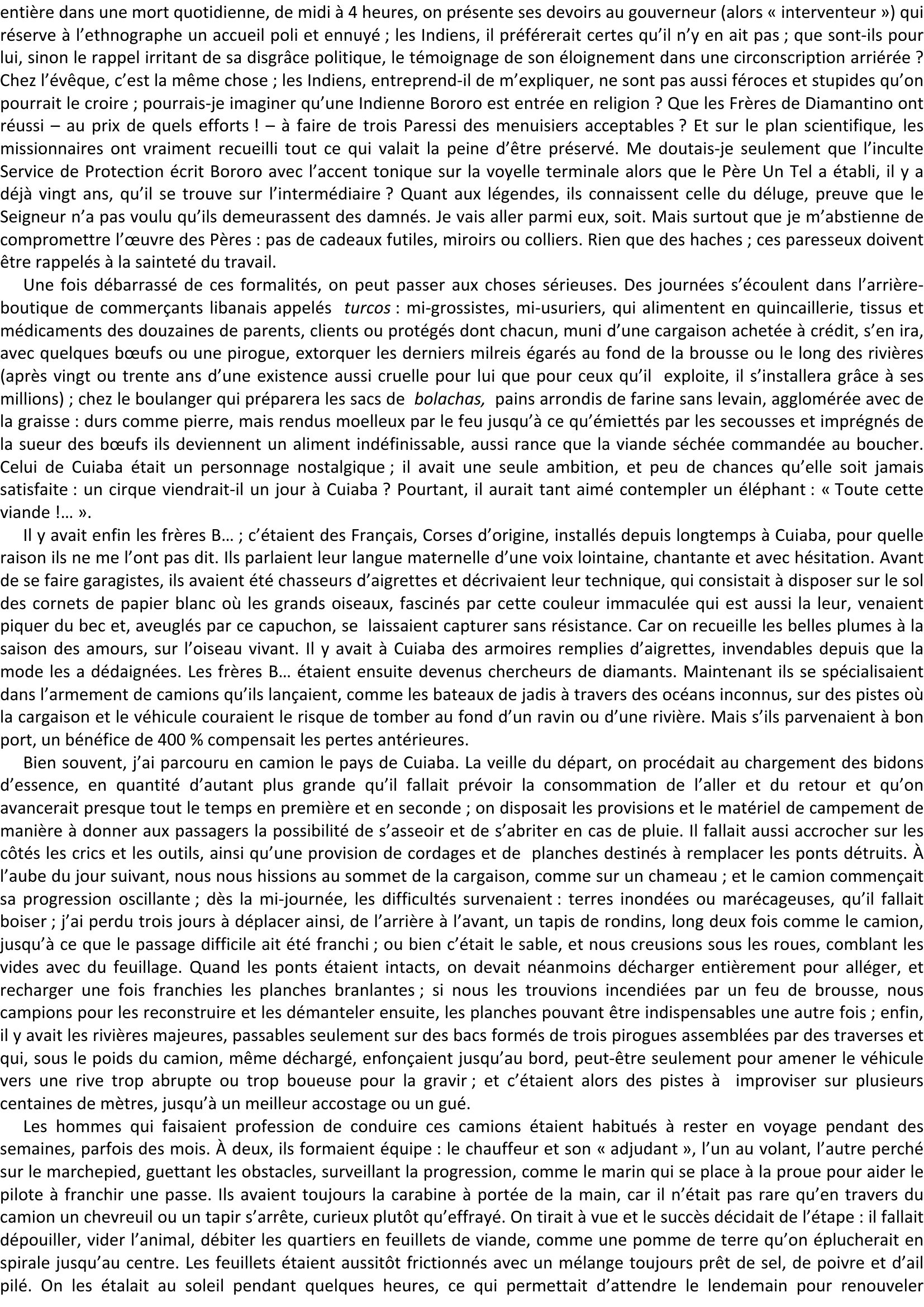Tous les trente kilomètres environ, le bateau s'arrêtait pour faire du bois à un dépôt ; et, quand c'était nécessaire, on attendait deux ou trois heures, le temps que le préposé soit allé dans la prairie capturer une vache au lasso, l'ait égorgée et dépouillée avec l'aide de l'équipage qui hissait ensuite la carcasse à bord, nous approvisionnant en viande fraîche pour quelques jours. Le reste du temps, le vapeur se glissait doucement le long des bras étroits ; cela s'appelle « négocier » les estimes, c'est-à-dire parcourir, les uns après les autres, ces unités de navigation que constituent les tronçons de fleuve compris entre deux courbes suffisamment marquées pour qu'on ne puisse voir au-delà. Ces estirões se rapprochent parfois à la aveur d'un méandre ; si bien que le soir on se trouve à quelques mètres à peine de l'endroit où l'on était le matin. Souvent, le bateau frôle les branches de la forêt inondée qui domine la berge ; le bruit du moteur éveille un monde innombrable d'oiseaux : araras au vol émaillé de bleu, de rouge et d'or ; cormorans plongeurs dont le cou sinueux évoque un serpent ailé ; perruches et perroquets qui remplissent l'air de cris suffisamment pareils à la voix pour qu'on puisse les ualifier d'inhumains. Par sa proximité et sa monotonie, le spectacle captive l'attention et provoque une sorte de torpeur. De temps à autre, une occasion plus rare émeut les passagers : couple de cervidés ou tapirs traversant à la nage ; cascavel - serpent à sonnette - ou giboya - python -- se tortillant à la surface de l'eau, léger comme un fétu ; ou troupe grouillante de jacarés, crocodiles inoffensifs qu'on se lasse vite d'abattre à la carabine d'une balle placée dans l'oeil. La pêche aux piranhas est plus mouvementée. Quelque part sur le fleuve se trouve un grand saladeiro, sècherie de viande allure de gibet ; parmi les ossements qui jonchent le sol, des barrières parallèles supportent des lambeaux violacés auessus desquels tournoie le vol obscur des charognards. Sur des centaines de mètres, le fleuve est rouge du sang de 'abattoir. Il suffit de jeter une ligne pour que, sans même attendre l'immersion de l'hameçon nu, plusieurs piranhas s'élancent ivres de sang et que l'une y suspende son losange d'or. Au pêcheur d'être prudent pour détacher sa proie ; un coup de dent lui emporterait le doigt. Après avoir passé le confluent du São Lourenço - sur le cours supérieur duquel nous irons, par terre, à la rencontre des Bororo - le pantanal disparaît ; de part et d'autre du fleuve domine un paysage de campo, savanes herbeuses où les habitations se font plus fréquentes et où errent les troupeaux. Bien peu de choses signalent Cuiaba au navigateur : une rampe pavée baignée par le fleuve et en haut de laquelle on devine la silhouette du vieil arsenal. De là, une rue longue de deux kilomètres et bordée de maisons rustiques conduit jusqu'à la place de la cathédrale, blanche et rose, qui se dresse entre deux allées de palmiers impériaux. À gauche, l'évêché ; à droite, le palais du gouverneur et, au coin de la rue principale, l'auberge - unique à l'époque - tenue par un gros Libanais. J'ai décrit Goyaz et je me répéterais si je m'appesantissais sur Cuiaba. Le site est moins beau, mais la ville possède le même charme, avec ses maisons austères, conçues à mi-chemin entre le palais et la chaumière. Comme le lieu est vallonné, de l'étage supérieur des habitations on découvre toujours une partie de la ville : maisons blanches à toits de tuiles orangées, couleur du sol enserrant les frondaisons des jardins, les quintaes. Autour de la place centrale en forme e L, un réseau de venelles rappelle la cité coloniale du XVIIIe siècle ; elles aboutissent à des terrains vagues servant de aravansérails, à des allées imprécises bordées de manguiers et de bananiers abritant des cabanes en torchis ; et puis, 'est très vite la campagne où paissent des troupes de boeufs en partance ou à peine arrivées du sertão. La fondation de Cuiaba remonte au milieu du XVIIIe siècle. Vers 1720, les explorateurs paulistes, appelés bandeirantes, parvenaient pour la première fois dans la région ; à quelques kilomètres du site actuel, ils établissaient un etit poste et des colons. Le pays était habité par les Indiens Cuxipo dont certains acceptèrent de servir dans les éfrichements. Un jour, un colon - Miguel Sutil le bien nommé - envoya quelques indigènes à la recherche de miel auvage. Ils revinrent le soir même, les mains remplies de pépites d'or ramassées en surface. Sans plus attendre, Sutil et un compagnon appelé Barbudo - le Barbu - suivirent les indigènes au lieu de leur collecte : l'or était là, partout. En un mois ils ramassèrent cinq tonnes de pépites. Il ne faut donc pas s'étonner que la campagne entourant Cuiaba ressemble par endroits à un champ de bataille ; des tertres couverts d'herbes et de broussailles attestent la fièvre ancienne. Aujourd'hui encore, il arrive qu'un Cuiabano trouve une pépite en cultivant ses légumes. Et sous forme de paillettes, l'or est toujours présent. À Cuiaba, les mendiants ont chercheurs d'or : on les voit à l'oeuvre dans le lit du ruisseau qui traverse la ville basse. Une journée d'efforts procure assez pour manger, et plusieurs commerçants emploient encore la petite balance qui permet l'échange d'une pincée de poudre contre la viande ou le riz. Immédiatement après une grande pluie, quand l'eau ruisselle dans les ravines, les enfants se précipitent, munis chacun d'une boule de cire vierge qu'ils plongent dans le courant, attendant que de menues parcelles brillantes viennent s'y coller. Les Cuiabanos prétendent d'ailleurs qu'un filon passe sous leur ville à plusieurs ètres de profondeur ; il gît, dit-on, sous le modeste bureau de la Banque du Brésil, plus riche de ce trésor que des ommes en réserve dans son coffre-fort démodé. De sa gloire ancienne, Cuiaba conserve un style de vie lent et cérémonieux. Pour l'étranger, la première journée se asse en allers et retours sur la place qui sépare l'auberge du palais du gouverneur : dépôt d'une carte de visite à 'arrivée ; une heure plus tard, l'aide de camp, gendarme moustachu, retourne la politesse ; après la sieste qui fige la ville entière dans une mort quotidienne, de midi à 4 heures, on présente ses devoirs au gouverneur (alors « interventeur ») qui réserve à l'ethnographe un accueil poli et ennuyé ; les Indiens, il préférerait certes qu'il n'y en ait pas ; que sont-ils pour ui, sinon le rappel irritant de sa disgrâce politique, le témoignage de son éloignement dans une circonscription arriérée ? hez l'évêque, c'est la même chose ; les Indiens, entreprend-il de m'expliquer, ne sont pas aussi féroces et stupides qu'on pourrait le croire ; pourrais-je imaginer qu'une Indienne Bororo est entrée en religion ? Que les Frères de Diamantino ont réussi - au prix de quels efforts ! - à faire de trois Paressi des menuisiers acceptables ? Et sur le plan scientifique, les missionnaires ont vraiment recueilli tout ce qui valait la peine d'être préservé. Me doutais-je seulement que l'inculte Service de Protection écrit Bororo avec l'accent tonique sur la voyelle terminale alors que le Père Un Tel a établi, il y a déjà vingt ans, qu'il se trouve sur l'intermédiaire ? Quant aux légendes, ils connaissent celle du déluge, preuve que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils demeurassent des damnés. Je vais aller parmi eux, soit. Mais surtout que je m'abstienne de compromettre l'oeuvre des Pères : pas de cadeaux futiles, miroirs ou colliers. Rien que des haches ; ces paresseux doivent être rappelés à la sainteté du travail. Une fois débarrassé de ces formalités, on peut passer aux choses sérieuses. Des journées s'écoulent dans l'arrièreboutique de commerçants libanais appelés turcos : mi-grossistes, mi-usuriers, qui alimentent en quincaillerie, tissus et médicaments des douzaines de parents, clients ou protégés dont chacun, muni d'une cargaison achetée à crédit, s'en ira, avec quelques boeufs ou une pirogue, extorquer les derniers milreis égarés au fond de la brousse ou le long des rivières (après vingt ou trente ans d'une existence aussi cruelle pour lui que pour ceux qu'il exploite, il s'installera grâce à ses millions) ; chez le boulanger qui préparera les sacs de bolachas, pains arrondis de farine sans levain, agglomérée avec de a graisse : durs comme pierre, mais rendus moelleux par le feu jusqu'à ce qu'émiettés par les secousses et imprégnés de a sueur des boeufs ils deviennent un aliment indéfinissable, aussi rance que la viande séchée commandée au boucher. elui de Cuiaba était un personnage nostalgique ; il avait une seule ambition, et peu de chances qu'elle soit jamais atisfaite : un cirque viendrait-il un jour à Cuiaba ? Pourtant, il aurait tant aimé contempler un éléphant : « Toute cette viande !... ». Il y avait enfin les frères B... ; c'étaient des Français, Corses d'origine, installés depuis longtemps à Cuiaba, pour quelle raison ils ne me l'ont pas dit. Ils parlaient leur langue maternelle d'une voix lointaine, chantante et avec hésitation. Avant de se faire garagistes, ils avaient été chasseurs d'aigrettes et décrivaient leur technique, qui consistait à disposer sur le sol des cornets de papier blanc où les grands oiseaux, fascinés par cette couleur immaculée qui est aussi la leur, venaient piquer du bec et, aveuglés par ce capuchon, se laissaient capturer sans résistance. Car on recueille les belles plumes à la saison des amours, sur l'oiseau vivant. Il y avait à Cuiaba des armoires remplies d'aigrettes, invendables depuis que la mode les a dédaignées. Les frères B... étaient ensuite devenus chercheurs de diamants. Maintenant ils se spécialisaient dans l'armement de camions qu'ils lançaient, comme les bateaux de jadis à travers des océans inconnus, sur des pistes où a cargaison et le véhicule couraient le risque de tomber au fond d'un ravin ou d'une rivière. Mais s'ils parvenaient à bon port, un bénéfice de 400 % compensait les pertes antérieures. Bien souvent, j'ai parcouru en camion le pays de Cuiaba. La veille du départ, on procédait au chargement des bidons d'essence, en quantité d'autant plus grande qu'il fallait prévoir la consommation de l'aller et du retour et qu'on avancerait presque tout le temps en première et en seconde ; on disposait les provisions et le matériel de campement de manière à donner aux passagers la possibilité de s'asseoir et de s'abriter en cas de pluie. Il fallait aussi accrocher sur les côtés les crics et les outils, ainsi qu'une provision de cordages et de planches destinés à remplacer les ponts détruits. À 'aube du jour suivant, nous nous hissions au sommet de la cargaison, comme sur un chameau ; et le camion commençait a progression oscillante ; dès la mi-journée, les difficultés survenaient : terres inondées ou marécageuses, qu'il fallait oiser ; j'ai perdu trois jours à déplacer ainsi, de l'arrière à l'avant, un tapis de rondins, long deux fois comme le camion, usqu'à ce que le passage difficile ait été franchi ; ou bien c'était le sable, et nous creusions sous les roues, comblant les ides avec du feuillage. Quand les ponts étaient intacts, on devait néanmoins décharger entièrement pour alléger, et echarger une fois franchies les planches branlantes ; si nous les trouvions incendiées par un feu de brousse, nous ampions pour les reconstruire et les démanteler ensuite, les planches pouvant être indispensables une autre fois ; enfin, l y avait les rivières majeures, passables seulement sur des bacs formés de trois pirogues assemblées par des traverses et ui, sous le poids du camion, même déchargé, enfonçaient jusqu'au bord, peut-être seulement pour amener le véhicule ers une rive trop abrupte ou trop boueuse pour la gravir ; et c'étaient alors des pistes à improviser sur plusieurs entaines de mètres, jusqu'à un meilleur accostage ou un gué. Les hommes qui faisaient profession de conduire ces camions étaient habitués à rester en voyage pendant des emaines, parfois des mois. À deux, ils formaient équipe : le chauffeur et son « adjudant », l'un au volant, l'autre perché ur le marchepied, guettant les obstacles, surveillant la progression, comme le marin qui se place à la proue pour aider le ilote à franchir une passe. Ils avaient toujours la carabine à portée de la main, car il n'était pas rare qu'en travers du amion un chevreuil ou un tapir s'arrête, curieux plutôt qu'effrayé. On tirait à vue et le succès décidait de l'étape : il fallait épouiller, vider l'animal, débiter les quartiers en feuillets de viande, comme une pomme de terre qu'on éplucherait en pirale jusqu'au centre. Les feuillets étaient aussitôt frictionnés avec un mélange toujours prêt de sel, de poivre et d'ail ilé. On les étalait au soleil pendant quelques heures, ce qui permettait d'attendre le lendemain pour renouveler l'opération qui devait être répétée aussi les jours suivants. On obtient ainsi la carne de sol, moins délectable que la carne de vento que l'on fait sécher en haut d'une perche, en plein vent à défaut de soleil, mais qui se garde aussi moins longtemps. Étrange existence que celle de ces conducteurs virtuoses, toujours prêts aux plus délicates réparations, improvisant et effaçant la voirie sur leur passage, exposés à rester plusieurs semaines en pleine brousse à l'endroit où le camion s'est brisé, jusqu'à ce qu'un camion concurrent passe pour donner l'alerte à Cuiaba, d'où l'on demandera à São Paulo ou Rio d'expédier la pièce cassée. Pendant ce temps on campe, on chasse, on fait la lessive, on dort et on patiente. Mon meilleur chauffeur avait fui la justice après un crime auquel il ne faisait jamais allusion ; on le savait à Cuiaba ; personne ne disait rien : pour accomplir un parcours impossible, nul n'aurait pu le remplacer. Aux yeux de tous, sa vie chaque jour risquée payait largement pour celle qu'il avait prise. Quand nous quittions Cuiaba vers 4 heures du matin, il faisait encore nuit. L'oeil devinait quelques églises décorées en stuc de la base au clocher ; les dernières rues bordées de manguiers taillés en boules et pavées de pierres de rivière faisaient tressauter le camion. L'aspect caractéristique de verger qu'offre la savane - en raison de l'espacement naturel des arbres - donne encore l'illusion d'un paysage aménagé alors qu'on est déjà dans la brousse ; la piste devient vite assez difficile pour en persuader : elle s'élève au-dessus du fleuve en courbes pierreuses interrompues par des ravines et des gués boueux, envahis par la capoeira. Dès qu'on a gagné un peu d'altitude, on découvre une ligne ténue et rosée, trop fixe pour qu'on la confonde avec les lueurs de l'aurore. Pendant longtemps, pourtant, on doute de sa nature et de sa réalité. Mais après trois ou quatre heures de route, en haut d'une pente rocailleuse, l'oeil embrasse un horizon plus vaste et qui contraint à l'évidence : du nord au sud, une paroi rouge se dresse à deux ou trois cents mètres au-dessus des collines verdoyantes. Vers le nord elle s'incline lentement jusqu'à se confondre avec le plateau. Mais du côté du sud, où se fait notre approche, on commence à distinguer des détails. Ce mur qui paraissait tout à l'heure sans défaut recèle des cheminées étroites, des pitons détachés en avant-garde, des balcons et des plates-formes. Dans cet ouvrage de pierre, il y a des redoutes et des défilés. Le camion mettra plusieurs heures à gravir la rampe, à peine corrigée par l'homme, qui ous conduira au rebord supérieur de la chapada du Mato Grosso, nous donnant accès à mille kilomètres de plateau s'inclinant doucement en direction du nord, jusqu'au bassin amazonien : le chapadão. C'est un autre monde qui s'ouvre. L'herbe rude, d'un vert laiteux, dissimule mal le sable, blanc, rose ou ocré, produit ar la décomposition superficielle du socle gréseux. La végétation se réduit à des arbres espacés, aux formes noueuses, rotégés contre la sécheresse qui règne pendant sept mois de l'année par une écorce épaisse, des feuilles vernissées et es épines. Il suffit pourtant que la pluie tombe pendant quelques jours pour que cette savane désertique se transforme n jardin : l'herbe verdoie, les arbres se couvrent de fleurs blanches et mauves. Mais toujours domine une impression 'immensité. Le sol est si uni, les pentes si faibles, que l'horizon s'étend sans obstacle jusqu'à des dizaines de kilomètres : ne demi-journée se passe à parcourir un paysage contemplé depuis le matin, répétant exactement celui traversé la eille, de sorte que perception et souvenir se confondent dans une obsession d'immobilité. Si lointaine que soit la terre, lle est tellement uniforme, à tel point dépourvue d'accidents que, très haut dans le ciel, on prend l'horizon éloigné pour es nuages. Le paysage est trop fantastique pour paraître monotone. De temps à autre, le camion passe à gué des cours d'eau sans berge qui inondent le plateau plutôt qu'ils ne le traversent, comme si ce terrain - un des plus anciens du monde et fragment encore intact du continent de Gondwana qui, au secondaire, unissait le Brésil et l'Afrique - était resté trop jeune pour que les rivières aient eu le temps de s'y creuser un lit. L'Europe offre des formes précises sous une lumière diffuse. Ici, le rôle, pour nous traditionnel, du ciel et de la terre s'inverse. Au-dessus de la traînée laiteuse du campo, les nuages bâtissent les plus extravagantes constructions. Le ciel est la région des formes et des volumes ; la terre garde la mollesse des premiers âges. Un soir, nous nous sommes arrêtés non loin d'un garimpo, colonie de chercheurs de diamants. Des ombres apparurent bientôt autour de notre feu : quelques garimpeiros qui tiraient de leur besace ou des poches de leurs vêtements en loques des petits tubes de bambou dont ils vidaient le contenu dans nos mains ; ce sont des diamants bruts, qu'ils espèrent nous vendre. Mais j'ai été suffisamment informé par les frères B... des moeurs du garimpo pour savoir que rien de tout cela ne peut être vraiment intéressant. Car le garimpo a ses lois non écrites, qui n'en sont pas moins strictement suivies. Ces hommes se divisent en deux catégories : aventuriers et fugitifs ; le dernier groupe est le plus nombreux, ce qui explique qu'une fois entré dans le garimpo on en sort difficilement. Le cours des petites rivières, dans le sable desquelles on ramasse le diamant, est contrôlé par les premiers occupants. Leurs ressources seraient insuffisantes pour leur permettre d'attendre la grande occasion, qui ne se produit pas si souvent. Ils sont donc organisés en bandes, chacune ommanditée par un chef se parant du titre de « capitaine » ou d'« ingénieur » ; celui-ci doit disposer de capitaux pour armer ses hommes, les équiper du matériel indispensable - seau en fer étamé pour remonter le gravier, tamis, bâtée, arfois aussi casque de scaphandre permettant de descendre dans les gouffres, et pompe à air - enfin et surtout, pour les ravitailler régulièrement. En échange, l'homme s'engage à ne vendre ses trouvailles qu'aux acheteurs accrédités (euxmêmes en liaison avec les grandes tailleries hollandaises ou anglaises) et à partager le bénéfice avec son chef. L'armement ne s'explique pas seulement par les rivalités fréquentes entre bandes. Jusqu'à une époque toute récente,