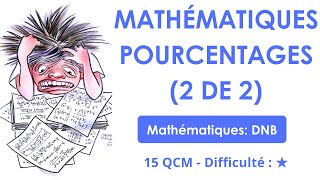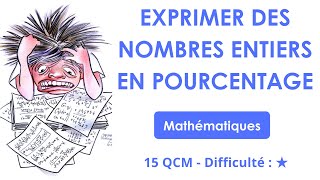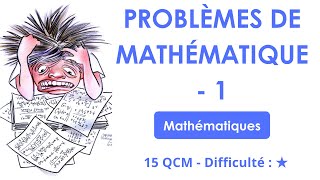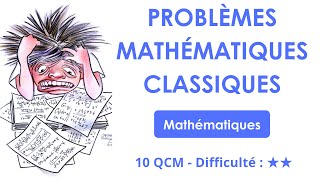Article de presse: Helmut Schmidt, un réalisme sans concessions
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
5 octobre 1980 - Qui eût pensé en mai 1974, après la démission à la fois digne et décevante de Willy Brandt, que celui qui lui succéderait allait devenir le chancelier le plus " durable " et aussi le plus populaire de l'Allemagne fédérale depuis Adenauer? L'arrivée de Helmut Schmidt à la chancellerie fut ressentie d'abord comme une rupture de ton. Les priorités politiques étaient déplacées, se portant sur les questions économiques, tandis que l'Ostpolitik était reléguée à l'arrière-plan.
Le style aussi changeait radicalement : loin du sentimentalisme, Helmut Schmidt n'était pas homme à s'agenouiller devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Willy Brandt avait levé les tabous de la guerre froide; lui se montrait d'emblée plus partisan du " donnant-donnant " que des beaux gestes symboliques. Foin du laisser-aller et des hésitations sur le plan intérieur, car le temps lui était compté. Il avait deux ans pour convaincre avant les élections de 1976. Le discours de la chancellerie changeait ainsi de registre : on passait de l'histoire au " management ".
Un langage technocratique
Le gouvernement de Willy Brandt avait été directement en prise sur les courants profonds qui travaillaient la société ouest-allemande. Après l'énorme poussée contestataire de la fin des années 60, un grand élan vers les réformes, secouant le conformisme de la vieille société démocrate chrétienne, avait marqué les trois premières années du gouvernement de coalition socialiste-libérale. Le mouvement, il est vrai, s'était arrêté en chemin vers 1972. L'arrivée au pouvoir de Helmut Schmidt marqua clairement le retour du pendule. Elle coïncidait en outre avec les premières répercussions en République fédérale de la crise économique mondiale. Le programme " réaliste et prudent " du nouveau chancelier désamorçait les critiques de l'opposition conservatrice, et son langage technocratique n'aurait été que celui de la désillusion pour la partie de l'opinion ouest-allemande tournée vers le changement s'il n'avait eu aussi un tour énergique et tranchant dont beaucoup lui savaient gré.
Six ans après, Helmut Schmidt reste cet homme direct et froid qui ne craint pas de recourir au sarcasme et s'emporte volontiers, mais sans passion, en mesurant toujours les effets de ses éclats. Sourd aux prophétismes en tout genre, s'irritant de toutes les contestations, il reste plus sensible au réalisme qu'aux grandes idées et préfère l'efficacité au prestige personnel. Rançon de cette attitude, il force parfois l'admiration, mais rarement la sympathie.
Il est aussi intransigeant, et son ascension au sein du parti social-démocrate, puis dans les instances gouvernementales de la République fédérale, s'est faite sans concessions. Il avait refusé, en décembre 1966, d'entrer dans le gouvernement de grande coalition, et il a fallu, en 1969, toute la persuasion de Willy Brandt pour qu'il accepte le portefeuille de la défense dans un gouvernement d'alliance avec les libéraux, auxquels il était peu favorable. Ministre des finances à partir de 1972, il s'était attaqué à l'inflation au moyen de mesures sévères. Malgré son impopularité, parmi les jeunes socialistes notamment, il avait acquis en 1974 une autorité telle qu'il apparut alors comme le successeur incontesté de Willy Brandt.
Tandis que le terrorisme défrayait la chronique, Helmut Schmidt chancelier gérait vigoureusement, et en bonne entente avec les milieux patronaux, la crise économique. Son succès sur ce plan fut le principal atout du SPD aux élections de 1976. Il lui permit aussi de parler haut et fort en Europe. La France et la République fédérale étaient, au moment de son arrivée à la chancellerie, au pis de leurs relations.
Helmut Schmidt, qui, quelques mois plus tôt, avait fustigé publiquement la politique française pour son " indépendantisme ", lors de la conférence de Washington sur l'énergie, était perçu de côté-ci du Rhin comme l'homme des Américains. En juillet 1976, il irritait à nouveau en déclarant que l'arrivée des communistes au gouvernement en Italie priverait ce pays des crédits occidentaux. On le savait coutumier de jugements brutaux sur les affaires intérieures de ses voisins. Mais, là encore, sa façon de " mettre les pieds dans le plat " était beaucoup moins dictée par le goût de l'éclat que par celui de l'efficacité : dans le climat pré-électoral morose de l'été 1976, c'était pour lui un moyen sûr de faire jouer en sa faveur l'anticommunisme ouest-allemand.
Face au terrorisme
Les événements ouest-allemands, puis internationaux, vont cependant lui fournir des occasions de s'illustrer d'une autre façon. A nul autre moment, sa fermeté ne semblera plus salutaire en RFA que face au terrorisme d'extrême gauche, qui culmine en septembre-octobre 1977 avec l'enlèvement de Hans Martin Schleyer et la prise d'otages de Mogadiscio. Il fait l'unanimité de la classe politique en refusant de céder au défi et sort de l'épreuve renforcé. Aux yeux de la grande majorité des Allemands de l'Ouest, de tous ceux que la mort des prisonniers de Stammheim n'a pas bouleversés, Helmut Schmidt, plus souple et moins arrogant, semble soudain avoir acquis ce " supplément d'humanité " dont même son entourage déplorait l'absence. Fort de ce succès, il aurait pu dissiper avec la même vigueur qu'il met à d'autres tâches le climat de " chasse aux sorcières " dénoncé par une large partie de l'opinion européenne. Il se contente de pourfendre l'antigermanisme de principe de ceux qui, à l'étranger, voudraient faire des citoyens de la République fédérale " les boucs émissaires de toute l'histoire allemande ".
Avec lui, en trois ans, la société ouest-allemande semble avoir parfaitement " digéré " le problème du terrorisme. Les seize morts de Munich n'ont pas suffi à lui faire redouter un autre danger extrémiste : celui des groupes néonazis qu'elle continue de considérer comme une poignée de nostalgiques farfelus auxquels on n'a même pas à infliger la clandestinité.
Avec lui également, l'Allemagne se penche sur son passé. Après la confusion ambiguë du " rétro ", elle décide de braquer les projecteurs sur les années noires. C'est, entre autres, la diffusion d'Holocauste sur les écrans de télévision et le vote par le Bundestag de l'imprescriptibilité des crimes nazis. Question de date sans doute : la majorité de la population ouest-allemande est née après la guerre.
Mais le fait qu'un homme aussi peu torturé, aussi résolument tourné vers le présent, que Helmut Schmidt ait incarné l'Etat à ce moment-là a sans doute facilité le passage.
Helmut Schmidt est-il l'homme des situations de crise? Il faut convenir que lorsqu'elles sont d'ordre international, il les traite avec une placidité qui confine au cynisme. Le chancelier fédéral est sans conteste la plus froide de ces " têtes froides " auxquelles Valéry Giscard d'Estaing faisait appel dans son message du Nouvel An, après le coup de Kaboul. Le rapprochement des diplomaties des deux pays, amorcé depuis 1978, s'est transformé au cours des derniers mois en une espèce de compétition entre les deux chefs d'Etat pour le titre de champion de la détente en Europe. Les événements plus récents n'ont pas servi sur ce plan le chancelier. Les troupes soviétiques entrent en Afghanistan : il pouvait d'autant mieux faire valoir le bien-fondé de sa politique à l'Est et d'autant mieux faire comprendre les nuances de son attitude à l'égard des Etats-Unis. Mais qu'une grève éclate à Gdansk et le voilà rappelé aux strictes réalités de l'Ostpolitik, et voilà que s'effondre toute la part du spectacle de sa diplomatie.
L'opposition cependant n'a guère pu jouer de l'argument. La construction des autoroutes vers Berlin-Ouest, l'évolution du commerce et de la circulation des personnes entre les deux Allemagnes, ont aujourd'hui plus de poids que l'annulation d'une rencontre entre chefs de gouvernement. Dans la République fédérale de Helmut Schmidt, c'est le tangible qui compte.
CLAIRE TREAN
Le Monde du 7 octobre 1980
Liens utiles
- Article de presse: Helmut Kohl, la force d'un père tranquille
- Comment rédiger un article de presse
- Schmidt Helmut, né en 1918 à Hambourg, homme politique allemand.
- Helmut Schmidt né en 1918 Né à Hambourg, il y fait ses études qu'il ne terminera qu'après la guerre avec un diplôme en économie.
- Article de presse en Anglais Film Pokemon 1