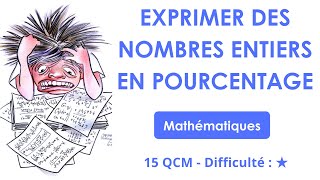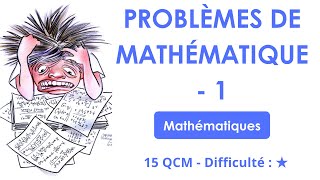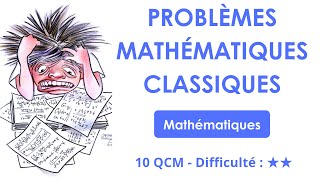Cours: L'HISTOIRE (2 de 2)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document

II. L’HISTOIRE COMME SCIENCE DE L’HOMME
On oppose traditionnellement des sciences dites "exactes" ou "dures", aux sciences humaines. Cette opposition est lourde de sous-entendus: ces dernières ne seraient ne seraient que des sciences "inexactes", "molles", des sciences au rabais qui ne doivent leur titre de science qu’à un abus de langage.
Mais qu’en est-il vraiment?
Parmi les sciences humaines, on compte particulièrement: la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, la psychanalyse, etc... Nous ne passerons pas en revue ces différentes sciences, mais nous nous intéresserons au cas particulier de l’histoire, en lui donnant une valeur générale. En effet, son cas est particulièrement intéressant.
1) la comparaison sciences humaines/sciences exactes
Sur quels critères se base-t-on pour dire que les mathématiques ou la physique sont des sciences alors que l’histoire n’en est pas une? Qu’est-ce qui pourrait entériner la supériorité épistémologique d’une science comme la physique sur une autre comme l’histoire?
Parmi ces critères, on cite souvent:
- la vérification: en physique, il est possible de vérifier une théorie. L’histoire, elle, s’intéresse à un objet absent, disparu, du passé; il est dès lors difficile de vérifier quoi que ce soit.
- le recours à un protocole expérimental: lors d’une expérience destinée à vérifier une théorie, le physicien suit un protocole qui garantit l’objectivité de ses résultats. L’historien, lui, ne dispose pas d’une telle méthodologie. Selon le sujet qu’il traite, il est souvent obligé de changer de manière de procéder, selon le sujet.
- la généralité: les énoncés de la science physique ont une valeur de généralité. On définit même la science comme un passage du singulier à l’universel. En histoire, par contre, les résultats auxquels on peut arriver sont par nature singuliers. Il s’agit toujours de connaître un événement précis, dans ce qu’il a d’unique. Aristote en tirait même la conclusion que l’histoire est moins philosophique que la poésie (Poétique). En effet, un poème comme l’Iliade peut avoir une valeur générale: il nous propose des types d’hommes (le valeureux Hector, le rusé Ulysse...) qui ont une valeur de modèle.
- l’utilisation des mathématiques: en physique, il est possible de réduire un phénomène compliqué en apparence à une formule mathématique simple. Le phénomène est donc quantifiable.
- l’établissement de lois: dès lors, la prévision est possible. Il suffit de distinguer quels sont les paramètres dont la variation va entraîner une modification du phénomène. C’est-à-dire que trouver quelles sont les lois universelles de la nature permet de prévoir ces phénomènes d’une part, et d’agir sur eux d’autre part. En histoire, il n’y a pas et il ne peut pas y avoir recherche de lois générales a priori. L’historien s’intéresse plutôt aux causes: il se contente d’expliquer comment un événement a pu se produire, ce qui ne veut pas dire qu’en réunissant les mêmes conditions, le même phénomène se répéterait. En effet, comme il s’intéresse à des sujets humains doués de liberté, rien n’est prévisible. La liberté est en ce sens un facteur de "désordre", rend caduque le projet d’une connaissance scientifique de l’homme.
- la neutralité du scientifique: en vertu de tous ces caractères de la science physique, on en déduit que le physicien est le modèle du scientifique rigoureux. Quand un physicien fait de la physique, il n’est jamais question qu’il fasse intervenir sa subjectivité. Par exemple ses convictions religieuses ou politiques n’influent en rien sur son travail. Ce qui fait que tout physicien peut trouver les mêmes résultats que n’importe quel autre. Pour eux, l’ennemi, c’est la subjectivité, dont ne peut les garantir qu’un protocole expérimental particulièrement élaboré. On pourrait presque dire que dans les sciences exactes, ce n’est pas le scientifique qui fait la science: elle existe déjà en puissance, il suffit d’écarter la subjectivité pour qu’elle vienne à jour. Cantor disait en ce sens qu’il n’y a pas de différence entre un mathématicien qui dort et un mathématicien qui travaille!
L’historien, lui, ne peut pas faire l’économie de sa subjectivité. Ne serait-ce que parce qu’il a besoin de comprendre les hommes dont il parle, d’entrer en sympathie avec...
De cette comparaison, il semble qu’il faille en effet tirer la conclusion que l’histoire, et avec elle les sciences humaines en général, n’a que peu des titres requis pour être comptée comme science. Elle ferait figure de parent pauvre de la communauté scientifique. Mais est-ce qu’on ne peut pas nuancer ce point de vue?
2) cette comparaison a-t-elle un sens?
En fait, lorsqu’on se pose une question du type "l’histoire est-elle une science?", on suppose implicitement qu’il y a une science reine, les mathématiques, qui connaît une application privilégiée, la physique, et que au fur et à mesure qu’on s’éloigne de ces sciences modèles, on perd en rigueur et en scientificité. On établit ainsi, volontairement ou non, une hiérarchie des sciences. Et souvent la discussion consiste à débattre de la question de savoir où placer le seuil entre "vraie" science et "pseudo" science ou "simili" science... Par exemple, on s’accorde encore à la rigueur pour reconnaître une valeur épistémologique à la biologie, alors même qu’elle n’utilise pas les mathématiques, ne permet pas la prévision, se borne souvent à enregistrer des résultats de laboratoire dont on ne mesure pas les limites de validité... Mais la médecine? On parle bien de science médicale! Alors qu’il s’agit d’une pratique. Et la psychanalyse?
C’est-à-dire que lorsqu’on pose la question "ceci est-il une science?", on se réfère à une science modèle, ou à un groupe de science, mais pour des raisons qu’on ne mesure pas. Le choix de la science de référence reste arbitraire. A la limite, on peut presque admettre comme science tout ce qui se présente comme tel. Chaque science, en son domaine, crée de nouveaux critères de scientificité, c’est vrai pour la biologie, la psychanalyse, l’histoire...
Etudier la question de l’objectivité des historiens reviendra donc à montrer en quoi l’historien, dans sa pratique, crée une nouvelle conception de l’objectivité, remet en question la conception régnante de la science. Selon la science qu’on prend comme référence, notre conception même de ce qui est scientifique, de ce qui ne l’est pas bouge.
D’ailleurs, qu’est-ce qui peut justifier le privilège des mathématiques ou de la physique? La physique tient peut-être son prestige du fait qu’elle est susceptible d’application techniques, qu’elle augmente le pouvoir de l’homme sur la nature. En ce qui concerne les mathématiques, elles sont sans doute une connaissance royale, mais une connaissance vide comme le disait le mathématicien René Thom, connaissance de ce qui n’existe pas dans le monde naturel qui nous entoure, pure discipline de l’esprit qu’on peut voir comme un simple outil pour les autres sciences... Il est trop facile de critiquer la scientificité de l’histoire en la comparant aux mathématiques, c’est-à-dire en lui reprochant de ne pas être des mathématiques, de n’être que ce qu’elle est.
3) l’objectivité des historiens
Donc, il faut prendre au sérieux l’idée qu’il y a une objectivité historique, et qu’il s’agit d’un modèle concurrent de l’objectivité des sciences exactes.
Tout d’abord, nous disions plus haut que l’historien ne dispose d’aucune méthode constituée qui garantirait son objectivité. Est-ce bien un argument de non-scientificité? On peut dire aussi bien que l’historien est celui qui se sert des méthodes de toutes les autres sciences (démographie, statistiques, économie, etc.). Michel de Certeau (Histoire et psychanalyse entre science et fiction) disait en ce sens que l’historien est un contrebandier, un homme des frontières et des marches, qui va importer dans sa discipline tout ce qui, des autres sciences, peut lui servir. On ne peut donc pas dire qu’il n’a pas de méthodologie, il les a toutes, et il se sert de toutes, à tour de rôle, selon le sujet qu’il traite. L’essentiel, pour lui est de savoir de laquelle se servir, laquelle est la plus pertinente pour le sujet qui l’occupe. En ce sens, il est peut-être le seul "scientifique" à se poser la question de la pertinence des outils dont il dispose, le seul donc à pouvoir les remettre en question et à les maîtriser vraiment.
Nous disions également que l’historien n’atteint jamais aucune généralité. On peut retourner ce reproche, en faire même la définition de l’histoire. Elle serait, paradoxalement "la science du singulier". Toute autre discipline tend toujours à comprendre un fait ou un événement en le ramènent à autre chose, comme une loi générale. L’historien essaie plutôt de comprendre un événement dans ce qu’il a de plus propre, dans son caractère irréductible. Au fond, comprendre un événement historique, c’est toujours comprendre qu’on ne peut le ramener à rien d’autre, qu’il est unique. Plutôt que le dissoudre dans une "loi de l’histoire", comprendre en quoi il échappe à cette loi. Par exemple, Napoléon et Hitler ont tous deux échoué dans leur projet d’invasion de la Russie. Mais il faut comprendre qu’ils ont échoué pour des raisons différentes. En dégager une loi générale ("on ne peut pas envahir la Russie"), ce n’est pas faire de l’histoire.
Enfin, on reproche à l’historien d’être subjectif. Par son objet d’études (les hommes), l’historien ne pourrait pas éviter d’être subjectif. On entend généralement par là qu’il court le risque permanent de projeter sa propre subjectivité, sa personnalité sur son objet d’étude, de mélanger celui qui connaît (lui-même) et celui qui est à connaître (Napoléon, par exemple).
En fait, c’est méconnaître ce que fait réellement l’historien. Certes, il a pour méthodologie d’entrer en sympathie avec celui qu’il étudie. Comprendre ce que quelqu’un a fait n’est possible qu’en se demandant ce qu’il voulait faire. Il s’agit de s’identifier à lui, ce qui ouvre normalement la possibilité de tous les malentendus.
Mais comme le montre Paul Ricoeur (Histoire et Vérité), lorsque l’historien "sympathise" avec un personnage, il ne le fait pas comme il le ferait dans la vie courante. La subjectivité de l’historien est une subjectivité "élargie". Il s’agit pour lui de savoir faire un bon usage de sa subjectivité, ce qui implique de se méfier de sa propre subjectivité et de pouvoir endosser n’importe quelle personnalité.
De sorte que, si la subjectivité du scientifique en elle-même est un facteur d’erreur, il y a deux moyens de la corriger: soit de la rédimer (sciences exactes, au de protocoles expérimentaux), soit de la dépasser par encore plus de subjectivité. Dans son travail, l’historien corrige et retravaille sa propre subjectivité.
conclusion: nous avons vu que la question de la scientificité des sciences prend tout son sens dans la mesure où elle peut être une invitation à dépasser la conception courante, trop étroite, de ce que c’est qu’une science.
III. LE SENS DE L’HISTOIRE
Après avoir vu comment on "fait" de l’histoire, on peut en venir à une autre question qui sous-tend la précédente: pourquoi en fait-on? Quel est l’intérêt, pour l’homme de s’intéresser à un passé qui n’est plus? Ne vaut-il pas mieux laisser les morts enterrer les morts?
Ce qui revient dans tous les cas à se demander quel sens on peut donner à l’histoire. Simple curiosité? Ou passion essentielle?
Parmi toutes les réponses qu’on peut inventorier, il y en a une seule qui ne résiste pas à l’examen, et comme par hasard, c’est la conception la plus répandue; c’est par elle que nous allons commencer.
1) Y a-t-il des "leçons de l’histoire"?
Ce qu’on entend par "leçons de l’histoire", c’est l’idée que la connaissance du passé apporte une sorte de répertoire commode des erreurs commises par le passé, ce qui nous éviterait de refaire les mêmes erreurs. L’histoire aurait ainsi une utilité pratique: celle d’un ensemble de recettes.
Cette conception est critiquable de plusieurs points de vue. Tout d’abord, elle présuppose que tout se répète dans l’histoire, qu’il n’y a pas de différence notable entre, par exemple, la tentative d’invasion de la Russie par Napoléon et celle par Hitler. Or rien ne revient jamais, les conditions ne sont jamais exactement les mêmes.
On pourrait même dire que celui qui veut se repérer sur le passé est volontairement retardataire. Marx disait ironiquement de la tentative de coup d’état du futur Napoléon III ( le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte) que l’histoire se répétait toujours deux fois, une fois comme tragédie (Napoléon Ier), une autre fois comme comédie (Napoléon III). Il faut comprendre que la formule est ironique: lorsque Napoléon III a voulu s’inspirer du coup d’état du 18 brumaire, il n’a fait que le singer, il n’a pas su voir ce qu’il fallait faire pour arriver au même résultat, alors que les circonstances n’avaient plus rien à voir. (d’ailleurs, on peut imaginer que les opposants de Napoléon III connaissaient eux aussi leur histoire de France.)
Voyons un autre exemple qu’on invoque couramment à l’appui de la thèse de leçons de l’histoire: la seconde guerre mondiale. Quelles "leçons" en tirer?
Cela pourrait être une conclusion du type "les hommes n’ont pas su tirer les leçons de la première guerre mondiale". Quelle leçon? d’éviter les guerres mondiales? Ce serait méconnaître que, historiquement, la seconde guerre mondiale n’est pas une réédition bis d’une version antérieure: la seconde guerre mondiale est la conséquence de la première (humiliation de l’Allemagne, crise de 1929, réseaux d’alliance balkanique de la France qui devait empêcher une nouvelle guerre...), elles ne font quasiment qu’un seul événement.
Si la conclusion était qu’il faut éviter la guerre, était-ce bien la peine d’attendre la première guerre mondiale: la simple morale nous donne le même avertissement à moindre frais.
Les seuls enseignements pratiques qu’on pourrait en tirer, ce serait: pour éviter une guerre mondiale, il faut empêcher les assassinats d’archiducs autrichiens. Plus sérieusement: la seule leçon de l’histoire, c’est que les hommes n’ont jamais retenu ses leçons, ils ont toujours commis la même erreur monstrueuse, ils ont toujours fait la guerre. Si leçons de l’histoire il y a, c’est comme s’il n’y en avait pas: les hommes ne les comprennent pas, ou trop tard.
Autre argument: voyez cet extrait de Paul Valéry ("De l’histoire" , 1931, Cahiers.)
L’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines.
L’histoire justifie ce que l'on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient : "La Leçon de ceci, les Enseignements de cela !...". Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir.
Retenons du deuxième paragraphe les idées suivantes.
La question n’est même pas tellement de savoir si l’histoire donne effectivement des leçons. Si elle en donne, elle en donne trop. A chaque antécédent que je pourrais invoquer pour justifier une ligne de conduite, on peut m’opposer un contre-exemple, la leçon contraire. L’histoire, parce qu’elle contient tout, donne des leçons de tout et son contraire.
On pourrait aussi dire que la "bonne" leçon n’apparaîtra qu’à l’épreuve des faits, donc trop tard. Les leçons de l’histoire se ramènent au "je te l’avais bien dit" des donneurs de leçons: ils auront toujours raison, mais trop tard.
Retenons donc que l’histoire ne donne pas réellement de leçons, en tout cas pas au sens de recettes générales qu’il suffirait d’appliquer pour arriver à un résultat.
2) l’histoire comme culture
Si l’histoire ne donne pas de leçon toute faite pour construire notre avenir, en un certain sens elle contribue pourtant à nous aider à trouver des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. C’est l’histoire comme culture.
Qu’est-ce que la culture en général? Ce qu’on désigne comme "culture personnelle", c’est un peu une "connaissance inutile". C’est-à-dire que certaines connaissances sont destinées à être immédiatement applicables, à transformer notre environnement. D’autres sont désignées comme inutiles, sans application concrète. En tant que l’histoire ne donne pas de leçons, elle semblerait entrer dans cette deuxième catégorie, et ce d’autant plus qu’elle ne s’intéresse qu’à ce qui n’est plus: elle serait la connaissance vaine par excellence.
Mais il faut remarquer que toute connaissance "produit" une certaine culture. Une connaissance n’est pas un savoir inerte, elle a des conséquences pour celui qui la porte, transforme sa sensibilité, sa vision du monde. On peut même dire qu’une connaissance (par exemple connaître les lois de l’attraction universelle) sans la culture qui va avec (ne pas savoir ce que ces lois veulent dire concrètement dans le monde qui nous entoure) est une connaissance morte, inutilisable. Comme si toute science requérait une culture comme son mode d’emploi...
Plus généralement, on dit de la culture que c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Pourquoi cela? Parce que la culture n’est pas un savoir qu’on peut apprendre puis oublier. Elle est plutôt le rapport vivant qu’on entretient avec le savoir. C’est le savoir en tant que vécu, habité. C’est ce par quoi je rends réellement miennes les connaissances que j’ai pu acquérir par ailleurs. Par la culture, je rends réellement personnel ce que sais. La culture, c’est lorsqu’on se fait soi-même.
Et l’histoire est peut-être la culture par excellence. On a même pu dire que l’histoire n’est rien d’autre que "la technique de notre culture": elle est ce par quoi on se donne un passé, on se construit une identité. En tout cas elle occupe une place de choix. Parce que tout ce que fait l’homme a nécessairement une dimension historique. Etre cultivé dans un domaine précis, c’est toujours pouvoir dépasser l’actualité immédiate, mettre en rapport le présent avec son passé. La culture permet ainsi de dépasser les standards d’une époque, éviter le piège qui consiste à toujours juger de tout selon notre propre époque, comme si elle était un absolu. Par exemple, la culture historique nous permet de voir qu’il y a d’autres formes de société possibles, que celle-ci dans laquelle nous vivons n’est qu’une forme contingente et perfectible de société... Elle nous libère donc de notre perspective étroite, dégage de nouveaux horizons.
Conclusion: la valeur de l’histoire n’est donc pas tellement d’être une science, mais bel et bien d’être un vecteur de culture. Elle permet à un homme singulier d’une époque donnée de se faire soi en élargissant son horizon. Elle permet à chacun d’échapper à l’enfermement dans son propre présent!
3) Histoire et mémoire
C’est en ce sens que l’on compare souvent l’histoire à une mémoire collective. Pascal, dans la préface du Traité du vide, disait que "toute la suite des hommes, pendant le cours de tous les siècles, doit être considérée comme un seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement (...) Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l’enfance des hommes proprement; et comme nous avons joint à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres."
Ce qui sous-tend cette comparaison de l’humanité à un seul homme, c’est l’analogie entre la mémoire et l’histoire. L’histoire serait à l’humanité ce que la mémoire est à l’individu
Le sens de l’analogie proposée par Pascal est de mettre en valeur la continuité historique: de même qu’un individu se forme à partir de son histoire personnelle, l’humanité s’est faite à partir de son passé. Comme le disait Auguste Comte, "nul n’est humain que par les autres hommes" et "l’humanité est faite de plus de morts que de vivants". Contrairement à l’animal qui répète à chaque génération des comportements millénaires, l’homme se fait par l’histoire, remet en jeu à chaque génération ce que les précédentes ont construit, se détermine dans l’incertitude de ce que sera le lendemain.
L’histoire est donc fondatrice de notre identité, quelle meilleure raison donner pour s’intéresser au passé?
En quelque sorte le passé est toujours présent dans le présent. S’il y a évolution dans cette histoire, s’il y a nouveauté (les grandes dates de l’histoire), c’est que le présent se fait contre le passé, mais toujours à partir de lui.
Ensuite, lorsqu’on dit que l’histoire est une mémoire collective, il ne s’agit pas forcément d’une mémoire à concevoir sur le modèle de la faculté psychologique. Il s’agit plutôt de commémoration.
Par exemple, le 14 juillet est un acte de commémoration où l’on reproduit symboliquement un événement que l’on considère comme fondateur d’une identité nationale. Le 14 juillet ne célèbre pas tant la prise de la Bastille elle-même qu’il ne manifeste la volonté de vivre ensemble, ce par quoi une nation est une nation. Il ne s’agit donc pas tellement d’un acte de remémoration: il ne s’agit pas de se souvenir de ce qui s’est passé ce jour-là, mais de le répéter symboliquement, comme pour refonder notre identité collective. Le passé n’y est pas retrouvé tel quel, il est transfiguré en symbole, reconstruit (la prise de la Bastille n’était qu’un événement mineur) pour devenir un passé dans lequel le présent puisse se reconnaître, trouver son ancrage La différence mémoire/histoire, remémoration/commémoration, c’est qu’on ne se souvient pas vraiment, mais on veut se souvenir. Ce n’est pas le passé qui se prolonge dans le présent, c’est plutôt le présent qui se reconnaît dans son passé par une opération culturelle, pour se trouver un sens.
4) la catharsis historique
Mais cet attachement au passé, cette quête d’identité ne risque-t-elle pas de nous enfermer dans le passé?
Nietzsche dénonçait ainsi, dans les Secondes considérations inactuelles, qu’il peut y avoir un "inconvénient des études historiques pour la vie". L’intérêt pour le passé, peut être l’indice d’un refus de la vie. Un esprit morbide trouve dans un passé mort une fuite hors de la vie. D’où l’éloge de l’oubli par Nietzsche, synonyme à ses yeux de "légèreté" et de liberté.
Vérifions : l’intérêt pour le passé peut-il être considéré comme un enfermement?
Voyons ce texte de l’historien Marrou:
La prise de conscience historique réalise une véritable catharsis, une libération de notre inconscient sociologique un peu analogue à celle que sur le plan psychologique cherche à obtenir la psychanalyse : dans l'un et l'autre cas, nous observons ce mécanisme, à première vue surprenant, par lequel la connaissance de la cause passée modifie l'effet présent ; dans 1'un et l'autre cas, l'homme se libère du passé, qui jusque là pesait obscurément sur lui, non par oubli mais par l'effort pour le retrouver, l'assumer en pleine conscience de manière à l'intégrer. C'est en ce sens, comme on l'a souvent répété de Goethe à Dilthey et à Croce, que la connaissance historique libère l'homme du poids de son passé. Ici encore l'histoire apparaît comme une pédagogie, le terrain d'exercice et l’instrument de notre liberté.
H.-I. MARROU, De la connaissance historique, 1954
Que veut dire "catharsis"?
Dans sa Poétique, Aristote se posait la question de savoir pourquoi les hommes éprouvaient du plaisir à assister à une tragédie, où l’on voit pourtant portées sur la scène les passions humaines dans ce qu’elles ont de plus dévastateur. Pourquoi éprouve-t-on du plaisir à voir jouer des sentiments que l’on n’aimerait pas éprouver? Sa réponse est que voir ces sentiments sans les éprouver soi-même effectue une "purge" (catharsis, en grec), on participe aux sentiments des héros, sans en être soi-même affecté. On libère par là, en leur donnant satisfaction, ses propres passions, sans en subir les effets néfastes.
Freud a repris ce terme pour désigner un aspect de la cure de certaines maladies mentales. Les névroses seraient dans l’ensemble dues à un sentiment qu’on n’a pas pu extérioriser. Le sujet refoule un sentiment, il n’en a pas conscience, mais celui-ci veut revenir à la conscience par des voies détournées, en contournant la censure. D’où apparition de symptômes pathologiques, qui ne sont autres que l’expression déguisée d’un sentiment qu’on s’interdit d’éprouver. Le moyen qu’a trouvé Freud pour soigner ces maladies consiste à faire opérer par le patient un "transfert" sur la personne du psychanalyste. Celui-ci va être le substitut de la personne à qui ce sentiment était destiné. Exemple classique: un amour oedipien. De sorte que cet "affect coincé" va être libéré, "purgé".
Dans ce texte, Marrou fait le rapprochement entre la catharsis psychanalytique et une catharsis proprement historique. C’est-à-dire que nier son passé, l’oublier, ne nous y fait pas échapper, au contraire, c’est en subir obscurément le poids. Prenons l’exemple des jeunes allemands nés après la seconde guerre mondiale. Ils se sentaient l’objet d’une réprobation générale, d’un sentiment de culpabilité pour les atrocités commises en leur pays au cours de la seconde guerre mondiale, alors qu’eux-mêmes ne pouvaient en être tenus pour reponsables.
A ce sentiment de culpabilité, on peut réagir de deux manières. La plus simple est le négationisme: faire comme si rien ne s’était passé. Nier le passé, le rejeter dans l’oubli. Mais c’est encore en subir le poids, mais sans s’en rendre compte. Le passé reste actif en eux, les travaille de l’intérieur. D’où apparition de symptômes inquiétants: renouveau fascisant en Allemagne.
La deuxième manière, c’est d’essayer de prendre conscience de ce passé, de l’assumer en pleine connaissance de cause. Ce qui permet, par la claire connaissance qu’on en prend, de se purger, de désamorcer ce qu’il peut avoir de pathogène.
Retenons que oublier le passé, ce n’est pas s’y soustraire, c’est même y être soumis encore plus durement. Pour oublier vraiment, il faut d’abord se souvenir. Ceux qui ne connaissent pas le passé, y vivent encore. L’intérêt pour l’histoire, paradoxalement, est donc loin de témoigner d’un intérêt morbide pour ce qui n’est plus. Ce passé survit en nous, obscurément. Et ce n’est qu’en en prenant conscience qu’il est possible de lui échapper. L’histoire permet donc, pratiquement, d’échapper au passé. Autrement dit, ce qu’il y a de remarquable avec l’histoire, c’est qu’elle permet aussi bien de rapprocher ce qui est loin que d’éloigner ce qui est proche.
CONCLUSION: on voit donc que l’intérêt pour l’histoire est loin d’être l’effet d’une curiosité vaine. Si l’histoire ne permet pas de préparer l’avenir (pas de leçon de l’histoire), elle permet tout au moins de se débarrasser du passé pour accueillir l’avenir avec confiance. Il y a quelque chose de sérieux à s’intéresser à l’histoire: cela permet d’échapper au passé, de disposer à nouveau de ce que nous sommes.
Peut-être même d’être meilleurs? Sans doute, l’histoire des hommes est l’histoire de la folie humaine (guerres et massacres: "l’histoire s’écrit avec le sang des peuples"), mais le seul moyen de donner un sens à ce passé, c’est d’espérer qu’il permette d’accéder à un avenir meilleur. Le passé de l’humanité trouvera sa justification dans l’avenir ou n’en aura pas. Toute l’ambiguïté du travail de l’historien est là: alors que le passé est ce qu’il est, qu’on ne peut plus rien y changer, il reste encore à lui donner un sens humain. L’histoire, en ce sens est à la fois toujours-déjà faite (les faits sont ce qu’ils sont, on ne peut pas revenir en arrière pour les changer) et infiniment à refaire (à interpréter pour mieux en construire le sens qui nous échappe à chaque fois).
Liens utiles
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- La Guerre de Sept Ans (cours histoire)
- Histoire de la littérature française - cours
- Cours complet d'histoire africaine
- Cours d'histoire sur la seconde guerre mondiale