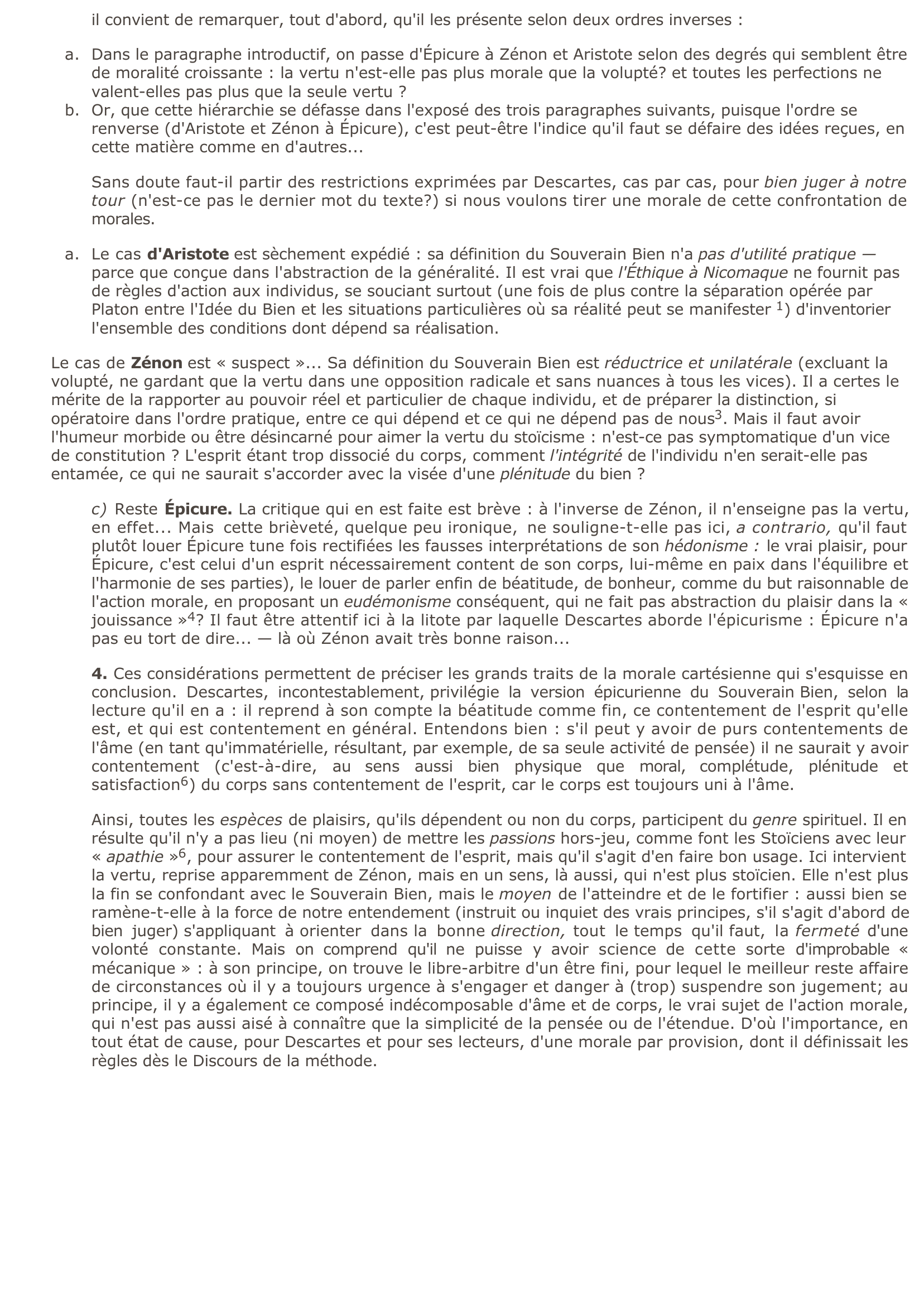DESCARTES: Qu'on ne peut se contenter des Anciens pour être heureux...
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
il convient de remarquer, tout d'abord, qu'il les présente selon deux ordres inverses :
Dans le paragraphe introductif, on passe d'Épicure à Zénon et Aristote selon des degrés qui semblent êtrede moralité croissante : la vertu n'est-elle pas plus morale que la volupté? et toutes les perfections nevalent-elles pas plus que la seule vertu ?
a.
Or, que cette hiérarchie se défasse dans l'exposé des trois paragraphes suivants, puisque l'ordre serenverse (d'Aristote et Zénon à Épicure), c'est peut-être l'indice qu'il faut se défaire des idées reçues, encette matière comme en d'autres...
b.
Sans doute faut-il partir des restrictions exprimées par Descartes, cas par cas, pour bien juger à notre tour (n'est-ce pas le dernier mot du texte?) si nous voulons tirer une morale de cette confrontation de morales.
Le cas d'Aristote est sèchement expédié : sa définition du Souverain Bien n'a pas d'utilité pratique — parce que conçue dans l'abstraction de la généralité.
Il est vrai que l'Éthique à Nicomaque ne fournit pas de règles d'action aux individus, se souciant surtout (une fois de plus contre la séparation opérée parPlaton entre l'Idée du Bien et les situations particulières où sa réalité peut se manifester 1) d'inventorier l'ensemble des conditions dont dépend sa réalisation.
a.
Le cas de Zénon est « suspect »...
Sa définition du Souverain Bien est réductrice et unilatérale (excluant la volupté, ne gardant que la vertu dans une opposition radicale et sans nuances à tous les vices).
Il a certes lemérite de la rapporter au pouvoir réel et particulier de chaque individu, et de préparer la distinction, siopératoire dans l'ordre pratique, entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de nous 3.
Mais il faut avoir l'humeur morbide ou être désincarné pour aimer la vertu du stoïcisme : n'est-ce pas symptomatique d'un vicede constitution ? L'esprit étant trop dissocié du corps, comment l'intégrité de l'individu n'en serait-elle pas entamée, ce qui ne saurait s'accorder avec la visée d'une plénitude du bien ?
c) Reste Épicure.
La critique qui en est faite est brève : à l'inverse de Zénon, il n'enseigne pas la vertu, en effet...
Mais cette brièveté, quelque peu ironique, ne souligne-t-elle pas ici, a contrario, qu'il faut plutôt louer Épicure tune fois rectifiées les fausses interprétations de son hédonisme : le vrai plaisir, pour Épicure, c'est celui d'un esprit nécessairement content de son corps, lui-même en paix dans l'équilibre etl'harmonie de ses parties), le louer de parler enfin de béatitude, de bonheur, comme du but raisonnable del'action morale, en proposant un eudémonisme conséquent, qui ne fait pas abstraction du plaisir dans la « jouissance » 4? Il faut être attentif ici à la litote par laquelle Descartes aborde l'épicurisme : Épicure n'a pas eu tort de dire...
— là où Zénon avait très bonne raison...
4.
Ces considérations permettent de préciser les grands traits de la morale cartésienne qui s'esquisse enconclusion.
Descartes, incontestablement, privilégie la version épicurienne du Souverain Bien, selon lalecture qu'il en a : il reprend à son compte la béatitude comme fin, ce contentement de l'esprit qu'elleest, et qui est contentement en général.
Entendons bien : s'il peut y avoir de purs contentements del'âme (en tant qu'immatérielle, résultant, par exemple, de sa seule activité de pensée) il ne saurait y avoircontentement (c'est-à-dire, au sens aussi bien physique que moral, complétude, plénitude etsatisfaction 6) du corps sans contentement de l'esprit, car le corps est toujours uni à l'âme.
Ainsi, toutes les espèces de plaisirs, qu'ils dépendent ou non du corps, participent du genre spirituel.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu (ni moyen) de mettre les passions hors-jeu, comme font les Stoïciens avec leur « apathie »6, pour assurer le contentement de l'esprit, mais qu'il s'agit d'en faire bon usage.
Ici intervient la vertu, reprise apparemment de Zénon, mais en un sens, là aussi, qui n'est plus stoïcien.
Elle n'est plusla fin se confondant avec le Souverain Bien, mais le moyen de l'atteindre et de le fortifier : aussi bien se ramène-t-elle à la force de notre entendement (instruit ou inquiet des vrais principes, s'il s'agit d'abord debien juger) s'appliquant à orienter dans la bonne direction, tout le temps qu'il faut, la fermeté d'une volonté constante.
Mais on comprend qu'il ne puisse y avoir science de cette sorte d'improbable «mécanique » : à son principe, on trouve le libre-arbitre d'un être fini, pour lequel le meilleur reste affairede circonstances où il y a toujours urgence à s'engager et danger à (trop) suspendre son jugement; auprincipe, il y a également ce composé indécomposable d'âme et de corps, le vrai sujet de l'action morale,qui n'est pas aussi aisé à connaître que la simplicité de la pensée ou de l'étendue.
D'où l'importance, entout état de cause, pour Descartes et pour ses lecteurs, d'une morale par provision, dont il définissait lesrègles dès le Discours de la méthode..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean Fernel 1497-1558 Comme Descartes, à qui certains ont voulu le comparer, Jean Fernel, déçu par l'inanité de l'enseignement scolastique, résolut de reprendre ses études en remontant aux sources et, pour un temps, se consacra à l'étude des Anciens.
- « Ceux qui ont assez de raison, ou de modestie, pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres, qu'en chercher eux-mêmes de meilleures. » DESCARTES, Discours de la méthode, 1637. ?
- Bienfaits et pièges des anciens - DESCARTES
- Le terme "heureux" dans l'oeuvre de DESCARTES
- Etre heureux, c'est savoir se contenter de peu. [ ] Epicure. Commentez cette citation.