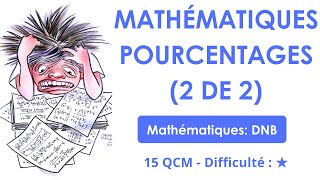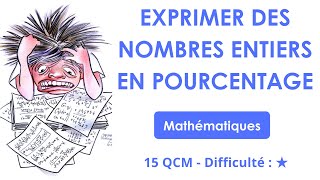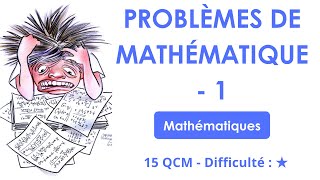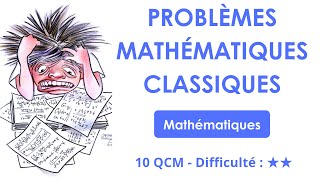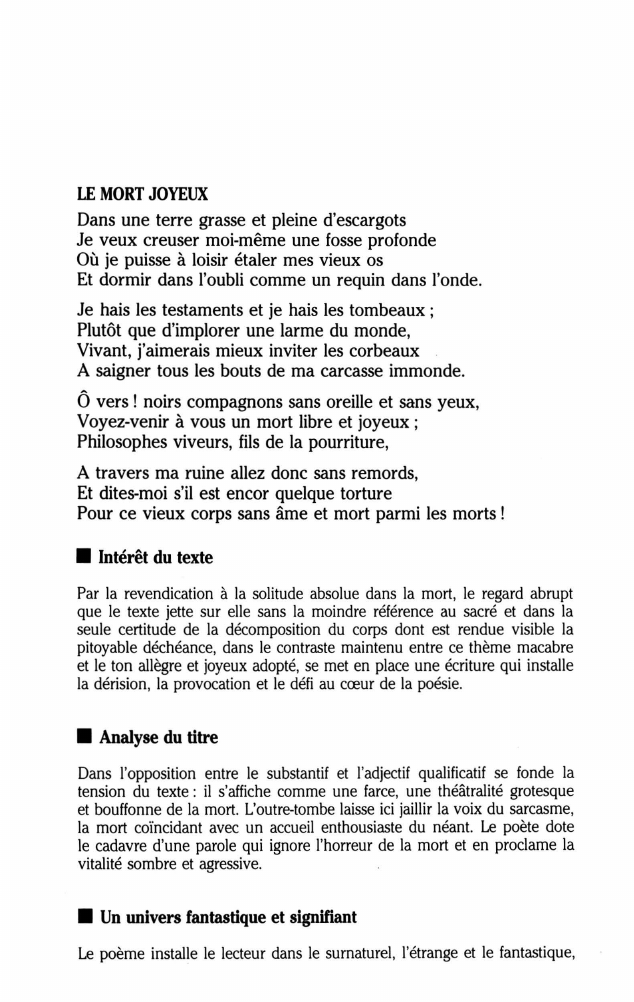Le mort joyeux, Baudelaire
Publié le 29/05/2011
Extrait du document
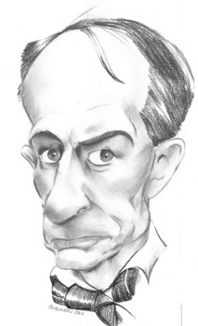
Explication linéaire du « Mort joyeux » « Le mort joyeux » fait partie de la section « Spleen et idéal » des Fleurs du Mal. Situé entre « Le revenant » et « Sépulture », il se rapporte comme eux à la mort. Ce sonnet aux rimes croisées peut se découper en trois parties : le premier quatrain met en scène l’enterrement du poète ; le second est sa vision sur les usages et les rites qui entourent la mort ; le sizain final parachève la mise en scène macabre du premier quatrain. Nous verrons d’une part comment Baudelaire utilise les animaux tout au long de son poème et nous nous attacherons d’autre part à comprendre son utilisation des mots du corps et ce à quoi il l’associe. Le titre, en associant la mort à la joie, a une allure d’oxymore. On ne sait encore s’il faut le prendre au premier ou au second degré. Il est en tout cas plus riche de sens que celui initialement retenu par Baudelaire lorsqu’il publia son poème en 1851 dans Le Messager de l’Assemblée : « Spleen ». Cette indication nous permet néanmoins de rapprocher « Le mort joyeux » des quatre textes portant le nom de Spleen dans l’édition finale et d’en relever les préoccupations communes ou connexes. Le poème semble commencer avec la même « allégresse » apparente que son titre. Une terre grasse (v. 1) est une terre fertile (nous en avons la confirmation avec la présence d’escargots), nourricière, ce qui paraît ironique puisque l’on pressent que c’est le corps du poète qui va nourrir les différents organismes souterrains. Le recours aux escargots est singulier ; ce sont en effet des animaux peu utilisés par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal : il s’agit même de l’unique apparition du mot… mais pas de l’animal. « Le coucher du soleil romantique » se termine en effet ainsi : « Des crapauds imprévus et de froids limaçons ». Le limaçon chez Baudelaire comme dans la poésie en général a une connotation péjorative[1] que l’on ne trouve pas (ou rarement) dans escargot. Ce premier quatrain se veut en effet paisible par rapport aux vers qui suivront la prise de position du poète sur les testaments et les tombeaux. Pour autant, les escargots peuvent être détritivores, voire nécrophages. Symboles de la terre (de la surface terrestre), ils annoncent donc les vers, « noirs compagnons » qui symbolisent eux aussi cet élément (souterrain cette fois) mais de façon plus crue. Comme les autres animaux du poème, ils sont une incarnation ambivalente du temps : la brièveté de leur vie tranche avec la spirale, symbole d’infini, de leur coquille. Le corps apparaît une première fois sous la forme de « vieux os » (v. 3). Le choix du mot os plutôt que celui du mot membres n’est pas innocent. Comme le confirmera la suite du sonnet (et surtout le dernier vers), le poète, qui s’enterre lui-même, est d’une certaine manière déjà bien mort[2]. De plus le mot os, homophone de eaux, constitue une « rime sémantique » avec le dernier terme du vers suivant, onde, en même temps qu’il s’oppose à lui par le registre. Os appartient au vocabulaire de la langue ordinaire tandis que onde appartient au vocabulaire de la langue poétique. L’idée d’étalement est rendue par le rythme ternaire de l’alexandrin. La deuxième espèce d’animal figurant dans le poème est le requin, hapax dans Les Fleurs du Mal. En dépit du fait que l’animal associé cette fois à l’élément aquatique perpétue cette représentation duelle du temps (commencement de la vie avec le requin-fœtus dans le liquide amniotique, fin de la vie donnée par le requin lui-même[3]), on peut s’interroger sur la présence ici de ce prédateur, qui n’est habituellement pas associé à la paix, au calme. C’est justement la définition de Littré qui peut nous apporter un élément de réponse. Nicholas Rand (Le Cryptage et la vie des œuvres) voit un possible jeu de mots entre requin et son étymon, requiem, auquel cas on peut rapprocher « “l’escargot qui s’encrypte [dans sa coquille]” du “requiem [requin] qui chante l’oubli dans l’onde” ». Le requiem est une prière, un chant pour les morts. Il pourrait d’ailleurs faire écho aux « De profundis » présents dans Les Fleurs du Mal, ceux-ci figurant fréquemment dans les requiem. C’est sa propre mort que chante le requin-requiem. Si le requin a une place à part parce qu’il représente le poète, contrairement aux autres animaux, susceptibles de le dévorer, mort ou vivant, c’est aussi (et c’est en cela qu’il les rejoint) un animal charognard. Là encore Baudelaire brouille les pistes : qui mange qui ? Dans le deuxième quatrain le poète laisse éclater sa colère contre les cérémonials qui entourent la mort. Hélène Cassou-Yager (La Polyvalence du thème de la mort dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire) établit un parallèle intéressant avec « De l’élection de son sépulcre », de Ronsard : Je defens qu’on ne rompe Le marbre pour la pompe De vouloir mon tombeau Bastir plus beau… Mais bien je veux qu’un arbre M’ombrage en lieu d’un marbre, Arbre qui soit couvert Tousjours de vert. Si le rejet de toute la pompe entourant la mort est le même, il ne procède pas cependant des mêmes sentiments : à la sagesse et à la quiétude d’un Ronsard répondent la colère et les angoisses d’un Baudelaire. L’un n’a point besoin de larmes, ses poésies lui conférant l’immortalité[4] ; l’autre les refuse (« Plutôt que d’implorer une larme du monde ») pour mieux se répandre dans l’oubli, le sommeil. Les deux décrivent la fusion de leur corps avec la nature, mais pour l’un c’est enchantement et pour l’autre dégoût (Baudelaire n’a-t-il pas banni le « végétal irrégulier » de son « Rêve parisien » ?). Chez ce dernier le corps est souffrance. Témoin les vers 7 et 8, qui s’imposent violemment au lecteur, d’autant plus que le poète entend subir le châtiment des corbeaux vivant, ce qui constitue un paradoxe avec l’utilisation du mot carcasse, qui dans son acception première désigne l’« ensemble des ossements décharnés du corps ». La force de cette scène est donc démultipliée par l’emploi d’un mot qui se rapporte usuellement aux morts et à des animaux. Comme si cela ne suffisait pas, la carcasse est qualifiée d’« immonde » ! Nous sommes donc dans une aversion du corps et dans une démolition de la dichotomie vie/mort. Dichotomie symbolisée cette fois par le corbeau, animal de l’air, associé à la longévité, mais aussi à la mort parce que charognard. Il y a peut-être également un clin d’œil à un poème de Poe (« Le corbeau ») traduit par Baudelaire. Dans le dernier sizain, le poète reprend la description de son enterrement. Le premier accent du vers 9 est mis sur vers, les dernières créatures non humaines de ce poème, qui, par leur noirceur, répondent aux corbeaux. Tous les éléments ayant été abordés par le truchement des animaux (mis à part le feu bien évidemment), nous revenons à la terre comme pour boucler la boucle. Le corps est de nouveau évoqué avec l’oreille et les yeux. L’absence curieuse du s à oreille semble de prime abord n’avoir pour justification que l’impératif de l’alexandrin. Mais on peut aussi penser que cette absence signifie que l’on parle moins de l’organe corporel que du sens, l’ouïe, et même l’écoute. Ces vers sont imperméables aux suppliques et aux cris de souffrance d’un corps qui paradoxalement ne peut déjà plus s’exprimer. Nous sommes toujours dans le renversement vie/mort. Les sens, omniprésents dans l’œuvre de Baudelaire, viennent appuyer ses descriptions. Dans un registre différent, on pense à ce vers de « Rêve parisien » : « Tout pour l’œil, rien pour les oreilles ! » Le vers 10 apporte l’explication au titre du poème. On peut toutefois se demander pourquoi il n’a pas été intitulé « Le mort libre » ou « Le mort libre et joyeux ». En fait, si la joie du poète d’en finir avec une vie illusoire et vaine est avérée, bien que désespérée, sa liberté est relative : il est libre de son corps mais pas de ses choix, la mort étant un passage obligé. Mais peut-être ce « libre » est-il un pied de nez à la mort — ici les vers —, sans yeux, car elle ne distingue pas le fort du faible, le riche du pauvre et surtout le beau du laid, mais également « sans nez » (« Danse macabre »). Tout le monde est donc sur un pied d’égalité face à elle (« Qu’importe le parfum, l’habit ou la toilette ? / Qui fait le dégoûté montre qu’il se croit beau », ibid.). Ces vers, justement, sont drôlement qualifiés de « philosophes viveurs », ce qui paraît contradictoire, mais qui illustre le partage entre la crainte mêlée de respect et l’ironie avec lesquelles le poète aborde la mort. Nous en voulons pour preuve le « fils de la pourriture » qui suit. Après fils de, on attendait (surtout dans un contexte poétique) le nom d’un dieu, d’un héros, d’un roi, d’une vertu… et on a la pourriture ! Cela dit, il se peut aussi que Baudelaire ait utilisé cette expression non comme une image mais au pied de la lettre. Jean Henri Fabre, son contemporain, dénonce en effet dans ses Souvenirs entomologiques (vol. X) la « sotte idée des vers fils de la pourriture », répandue en milieu paysan. Aujourd’hui, d’ailleurs, la dénomination vers a été bannie du langage scientifique, trop imprécise. Mais la poésie, de quelque époque qu’elle soit, ne se préoccupe pas de cela. Les vers, animaux misérables s’il en est, ont donc le redoutable pouvoir de faire disparaître la dépouille de tout être humain sans acception de statut. Ils constituent le dernier maillon — le plus insignifiant et le plus terrifiant — d’une chaîne commencée avec les escargots. Le vers 12 insiste sur la ruine, notamment grâce à la diérèse. Ce mot marque en effet l’apogée de la maltraitance que le poète fait subir à son corps en particulier et au corps en général. Parmi ses multiples significations, on peut ici lui donner celles de « mort », de « dégradation physique », de « déchéance morale », de « personne physiquement et parfois intellectuellement dégradée par l’âge ou la maladie ». Dans le dernier vers, on sent la fureur passée. Le « vieux corps » répond aux « vieux os » du vers 3. La paix du début semble être revenue. Ce qui est confirmé par les deux termes mis en relief par la construction en 4-2-2-4, qui crée un effet miroir et renvoie mort à sans âme. Ils sont en effet les plus importants de ce vers. Mort est même appuyé par un complément : « parmi les morts ». On peut ainsi voir dans cette insistance, plus qu’une constatation, une supplication au repos. En conclusion, nous pouvons dire que le poète dresse ici une description très réaliste de la mort, de la déchéance du corps, notamment à travers un bestiaire hétéroclite. La « joie du mort », si elle n’est pas feinte, n’est pas totale : elle sert à masquer le désespoir de celui qui est pris entre deux absurdités : celle du néant et celle que Nietzsche nommera « éternel retour du même » (qui apparaît de façon marquée dans les textes intitulés « Spleen »).
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE MORT JOYEUX DE CHARLES BAUDELAIRE
- Lecture linéaire la mort des amants baudelaire
- analyse linéaire la mort des amants baudelaire
- Le Masque de la Mort Rouge Traduction de Charles Baudelaire Edgar Allan Poe La Mort Rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée.
- analyse le mort joyeux