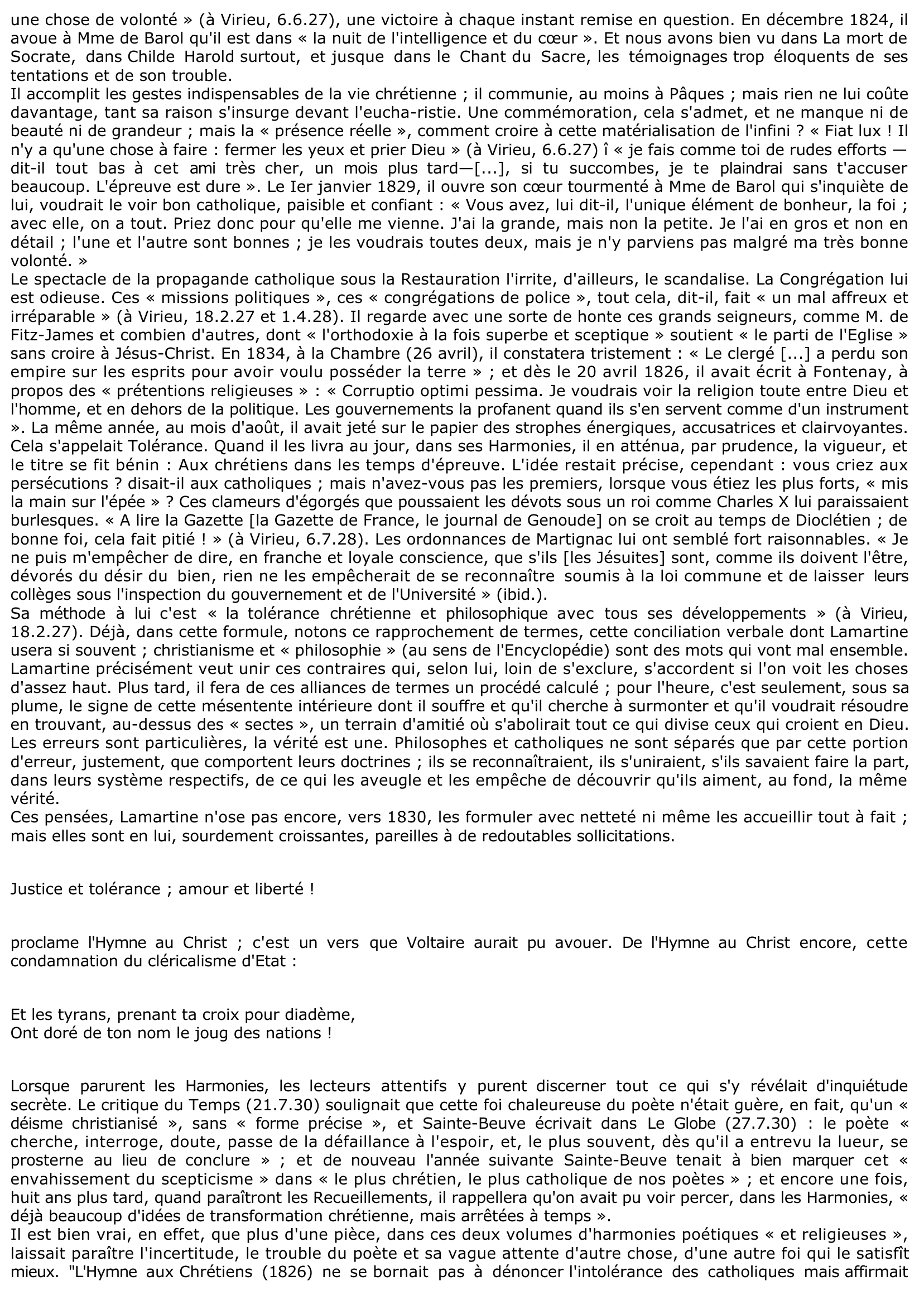LA PENSÉE RELIGIEUSE DE LAMARTINE
Publié le 30/06/2011
Extrait du document
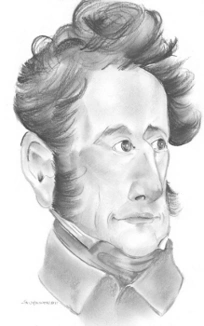
Nous touchons aux plus intimes régions de cette âme ardente et perpétuellement anxieuse. D'un bout à Pautre de sa vie, Lamartine a « cherché Dieu « sans jamais trouver le repos.
J'ai toujours dans mon sein roulé cette pensée ; J'ai toujours cherché Dieu ; mais mon âme lassée N'a jamais pu donner de forme à mes désirs !
Ce cri que Lamartine met sur les lèvres de Childe Harold en 1825, nous le lui entendrons jeter encore, en son propre nom, dans les vers fiévreux du Désert, trente ans plus tard lorsqu'il touchera au seuil de l'ombre. Ils pourraient servir d'épigraphe à toute l'histoire de sa pensée. En 1820, nous avons vu Lamartine accomplissant sur lui-même une manière de coup de force. Il s'est contraint à redevenir catholique, et catholique pratiquant. Il l'a fait pour « s'enchâsser dans l'ordre «, pour apporter à sa mère cette joie réparatrice; il l'a fait aussi parce qu'il pensait qu'en somme le catholicisme était l'approximation la moins inexacte, sans doute, de la vérité métaphysique. Voilà dix ans au moins qu'il rôdait autour de cette religion qu'il avait délaissée sous l'entraînement des passions, certes, mais aussi parce que les « philosophes « dont il s'était nourri lui en avaient démontré le caractère irrationnel, l'étroitesse, les puérilités. Il n'en pouvait plus d'être ainsi tâtonnant, incertain.
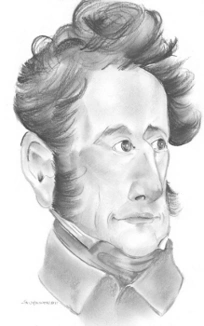
«
une chose de volonté » (à Virieu, 6.6.27), une victoire à chaque instant remise en question.
En décembre 1824, ilavoue à Mme de Barol qu'il est dans « la nuit de l'intelligence et du cœur ».
Et nous avons bien vu dans La mort deSocrate, dans Childe Harold surtout, et jusque dans le Chant du Sacre, les témoignages trop éloquents de sestentations et de son trouble.Il accomplit les gestes indispensables de la vie chrétienne ; il communie, au moins à Pâques ; mais rien ne lui coûtedavantage, tant sa raison s'insurge devant l'eucha-ristie.
Une commémoration, cela s'admet, et ne manque ni debeauté ni de grandeur ; mais la « présence réelle », comment croire à cette matérialisation de l'infini ? « Fiat lux ! Iln'y a qu'une chose à faire : fermer les yeux et prier Dieu » (à Virieu, 6.6.27) î « je fais comme toi de rudes efforts —dit-il tout bas à cet ami très cher, un mois plus tard—[...], si tu succombes, je te plaindrai sans t'accuserbeaucoup.
L'épreuve est dure ».
Le Ier janvier 1829, il ouvre son cœur tourmenté à Mme de Barol qui s'inquiète delui, voudrait le voir bon catholique, paisible et confiant : « Vous avez, lui dit-il, l'unique élément de bonheur, la foi ;avec elle, on a tout.
Priez donc pour qu'elle me vienne.
J'ai la grande, mais non la petite.
Je l'ai en gros et non endétail ; l'une et l'autre sont bonnes ; je les voudrais toutes deux, mais je n'y parviens pas malgré ma très bonnevolonté.
»Le spectacle de la propagande catholique sous la Restauration l'irrite, d'ailleurs, le scandalise.
La Congrégation luiest odieuse.
Ces « missions politiques », ces « congrégations de police », tout cela, dit-il, fait « un mal affreux etirréparable » (à Virieu, 18.2.27 et 1.4.28).
Il regarde avec une sorte de honte ces grands seigneurs, comme M.
deFitz-James et combien d'autres, dont « l'orthodoxie à la fois superbe et sceptique » soutient « le parti de l'Eglise »sans croire à Jésus-Christ.
En 1834, à la Chambre (26 avril), il constatera tristement : « Le clergé [...] a perdu sonempire sur les esprits pour avoir voulu posséder la terre » ; et dès le 20 avril 1826, il avait écrit à Fontenay, àpropos des « prétentions religieuses » : « Corruptio optimi pessima.
Je voudrais voir la religion toute entre Dieu etl'homme, et en dehors de la politique.
Les gouvernements la profanent quand ils s'en servent comme d'un instrument».
La même année, au mois d'août, il avait jeté sur le papier des strophes énergiques, accusatrices et clairvoyantes.Cela s'appelait Tolérance.
Quand il les livra au jour, dans ses Harmonies, il en atténua, par prudence, la vigueur, etle titre se fit bénin : Aux chrétiens dans les temps d'épreuve.
L'idée restait précise, cependant : vous criez auxpersécutions ? disait-il aux catholiques ; mais n'avez-vous pas les premiers, lorsque vous étiez les plus forts, « misla main sur l'épée » ? Ces clameurs d'égorgés que poussaient les dévots sous un roi comme Charles X lui paraissaientburlesques.
« A lire la Gazette [la Gazette de France, le journal de Genoude] on se croit au temps de Dioclétien ; debonne foi, cela fait pitié ! » (à Virieu, 6.7.28).
Les ordonnances de Martignac lui ont semblé fort raisonnables.
« Jene puis m'empêcher de dire, en franche et loyale conscience, que s'ils [les Jésuites] sont, comme ils doivent l'être,dévorés du désir du bien, rien ne les empêcherait de se reconnaître soumis à la loi commune et de laisser leurscollèges sous l'inspection du gouvernement et de l'Université » (ibid.).Sa méthode à lui c'est « la tolérance chrétienne et philosophique avec tous ses développements » (à Virieu,18.2.27).
Déjà, dans cette formule, notons ce rapprochement de termes, cette conciliation verbale dont Lamartineusera si souvent ; christianisme et « philosophie » (au sens de l'Encyclopédie) sont des mots qui vont mal ensemble.Lamartine précisément veut unir ces contraires qui, selon lui, loin de s'exclure, s'accordent si l'on voit les chosesd'assez haut.
Plus tard, il fera de ces alliances de termes un procédé calculé ; pour l'heure, c'est seulement, sous saplume, le signe de cette mésentente intérieure dont il souffre et qu'il cherche à surmonter et qu'il voudrait résoudreen trouvant, au-dessus des « sectes », un terrain d'amitié où s'abolirait tout ce qui divise ceux qui croient en Dieu.Les erreurs sont particulières, la vérité est une.
Philosophes et catholiques ne sont séparés que par cette portiond'erreur, justement, que comportent leurs doctrines ; ils se reconnaîtraient, ils s'uniraient, s'ils savaient faire la part,dans leurs système respectifs, de ce qui les aveugle et les empêche de découvrir qu'ils aiment, au fond, la mêmevérité.Ces pensées, Lamartine n'ose pas encore, vers 1830, les formuler avec netteté ni même les accueillir tout à fait ;mais elles sont en lui, sourdement croissantes, pareilles à de redoutables sollicitations.
Justice et tolérance ; amour et liberté !
proclame l'Hymne au Christ ; c'est un vers que Voltaire aurait pu avouer.
De l'Hymne au Christ encore, cettecondamnation du cléricalisme d'Etat :
Et les tyrans, prenant ta croix pour diadème,Ont doré de ton nom le joug des nations !
Lorsque parurent les Harmonies, les lecteurs attentifs y purent discerner tout ce qui s'y révélait d'inquiétudesecrète.
Le critique du Temps (21.7.30) soulignait que cette foi chaleureuse du poète n'était guère, en fait, qu'un «déisme christianisé », sans « forme précise », et Sainte-Beuve écrivait dans Le Globe (27.7.30) : le poète «cherche, interroge, doute, passe de la défaillance à l'espoir, et, le plus souvent, dès qu'il a entrevu la lueur, seprosterne au lieu de conclure » ; et de nouveau l'année suivante Sainte-Beuve tenait à bien marquer cet «envahissement du scepticisme » dans « le plus chrétien, le plus catholique de nos poètes » ; et encore une fois,huit ans plus tard, quand paraîtront les Recueillements, il rappellera qu'on avait pu voir percer, dans les Harmonies, «déjà beaucoup d'idées de transformation chrétienne, mais arrêtées à temps ».
Il est bien vrai, en effet, que plus d'une pièce, dans ces deux volumes d'harmonies poétiques « et religieuses »,laissait paraître l'incertitude, le trouble du poète et sa vague attente d'autre chose, d'une autre foi qui le satisfîtmieux.
"L'Hymne aux Chrétiens (1826) ne se bornait pas à dénoncer l'intolérance des catholiques mais affirmait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les comédies « profanes » Le théâtre de Marguerite dans son ensemble, et pas seulement la « tétralogie biblique » (la Nativité, les Trois Rois, les Innocents, le Désert), reprend toute sa pensée intime, toute l’inspiration religieuse de la poésie qui lui est parallèle; il est également marqué, de la manière la plus profonde, par la mort du frère de la reine. Ainsi, la Comédie sur le trépas du roy et la Comédie de Mont-de-Marsan disent-elles l’insupportable éloignement, mais aussi la s
- Qu'est-ce qu'une pensée religieuse ?
- La notion de témoignage dans la pensée religieuse de Kierkegaard.
- Comment concevoir la pensée religieuse à l'heure de la science ?
- LAMARTINE, Alphonse de (1790-1869) Après une jeunesse imprégnée de ferveur religieuse à Milly, il découvre l'Italie en 1811, puis se met au service de Louis XVIII.