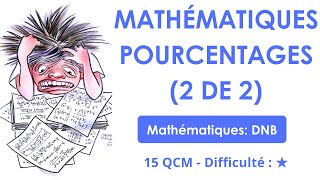La philisophie des Lumières.
Publié le 14/03/2011
Extrait du document
Sens général de la notion On a pris l'habitude de désigner sous cette expression la philosophie de l'Europe du XVIIIe siècle (le «siècle des Lumières» en français, die Aufklärung ou the Enlightment en allemand et en anglais), caractérisée par la confiance en la raison (au moyen de laquelle les hommes peuvent, seuls, accéder à la connaissance), la critique des autorités traditionnelles (religieuses et politiques), l'invitation à penser et à juger par soi-même, l'optimisme qui comprend le mouvement de l'histoire comme le progrès parallèle du savoir, du bonheur et de la vertu. Selon cette présentation habituelle, ces traits constituent un horizon de pensée partagé par les principales philosophies de cette époque, malgré leurs différences. Comme le dit Taine dans les \"Origines de la France contemporaine\": «Aux approches de 1789, il est admis que l'on vit dans le \"siècle des Lumières\", dans l'âge de raison, qu'auparavant le genre humain était dans l'enfance, qu'aujourd'hui il est devenu majeur.» Cette expression tire son sens de l'usage figuré du terme «lumière», lui-même appuyé sur une série de comparaisons traditionnelles en philosophie: la connaissance est comparée à la vision (on cherche alors à décrire l'acte de connaissance) ou à l'illumination (on cherche alors à caractériser l'effet de connaissance). Ces métaphores trouvent leur fondement philosophique maximal dans les théories intuitionnistes de la connaissance où la contemplation directe est considérée comme la forme achevée du savoir. Mais l'usage habituel est plus lâche, et s'en tient à la comparaison approximative du «voir» et du «connaître». Au XVIII e siècle, le sens de cette expression est déterminé par la distinction, issue de la théologie chrétienne, entre la lumière naturelle et la lumière surnaturelle. Deux règnes (ainsi chez Leibniz) ou deux ordres étaient traditionnellement distingués: le règne de la nature et le règne de la grâce. Si au sein de la nature (créée) les hommes disposent de la raison (la lumière naturelle), celle-ci, bien que relativement autonome, reste une faculté limitée, qui requiert en dernier lieu l'assistance de la lumière surnaturelle (celle du Créateur): la révélation. La raison reste dans une telle perspective subordonnée à la révélation: seule cette dernière est susceptible de fournir un savoir véritable. Dans une telle problématique, la philosophie est la servante de la théologie (ancilla theologiæ). Que cette assistance surnaturelle vienne à être comprise non plus comme une «lumière» mais, dans le cadre d'un combat antireligieux, comme un obscurcissement, que la lumière naturelle (la raison) s'autonomise, au point de devenir suffisante pour la connaissance, sans que soit requise l'assistance de la révélation: cette double transformation aboutit à la notion de lumières en vogue au XVIII e siècle. La religion et la théologie sont alors pensées comme les lieux principaux de l'irrationalité et de l'obscurantisme. La raison et l'autonomie L'expression « philosophie des Lumières » n'est pas l'invention tardive d'historiens des idées en quête de formules synthétiques: certains des philosophes du XVIII e siècle, parmi les principaux, ont inscrit explicitement leur réflexion dans cet horizon.
C'est le cas de Kant (1724-1804), dans un article de 1784, Qu'est-ce que les Lumières? : «Qu'est-ce que les Lumières. La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité à se servir de son entendement sans la direction d'autrui; minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere Aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des lumières.» C'est le cas aussi de Diderot, qui note dans l'Addition aux Pensées philosophiques : «Si je renonce à ma raison, je n'ai plus de guide: il faut que j'adopte en aveugle un principe secondaire, et que je suppose ce qui est en question. Egaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n'ai qu'une petite lumière pour me conduire. Survient un inconnu qui me dit: \"Mon ami, souffle la chandelle pour mieux trouver ton chemin.\" Cet inconnu est un théologien.» Un tel idéal d'autonomie devait nécessairement rencontrer la question sociale et politique: «Pour ces lumières il n'est rien requis d'autre que la liberté, et à vrai dire la liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de la raison dans tous les domaines. Mais j'entends présentement crier de tous côtés: \"Ne raisonnez pas !\" L'officier dit: \"Ne raisonnez pas, exécutez !\" Le financier: \"Ne raisonnez pas, payez !\" Le prêtre: \"Ne raisonnez pas, croyez !\"... Il y a partout limitation de la liberté» (Kant, Qu'est-ce que les Lumières?).
Al'horizon de cette revendication se profile la question républicaine: c'est sous ce concept de république, et non sous celui de démocratie, qu'est pensé un régime qui ne doive ses institutions et ses lois qu'à la volonté autonome de ses citoyens. La naïveté (sans doute feinte) de Kant ici, c'est seulement de penser que cette liberté est «inoffensive». En effet, la philosophie des Lumières ne peut être qu'un combat, contre les autorités et contre les préjugés. A écouter les discours de cette époque, on se risquerait même à parler de «mission»: «Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, approchons le peuple du point où en sont les philosophes» (Diderot). Une notion problématique La notion de «philosophie des Lumières», malgré l'usage généralisé qui en est fait, pose toutefois problème, et cela pour plusieurs raisons: 1. L'unité ainsi présumée des différentes philosophies du XVIIIe siècle est-elle effective? A-t-on réellement affaire à une convergence, à une unité, sinon des doctrines, du moins des problématiques philosophiques? La référence à la raison constitue ainsi, autour de 1750, un véritable «lieu commun». Mais est-ce bien au même concept de raison que se réfèrent, par exemple, d'Alembert et Diderot, les deux principaux promoteurs de l'Encyclopédie? Le premier s'inscrit explicitement dans la tradition cartésienne, valorise la rigueur et la clarté mathématiques; le second se méfie des mathématiques, et, soucieux d'accompagner les avancées de la biologie naissante, revendique le droit de la conjecture, de l'imagination scientifique, du rêve et de l'approximation.
Le postulat unitaire impliqué dans cette notion risque de faire oublier la diversité, les divergences et les conflits qui font de cette philosophie un «champ de bataille» ( Kant). Dans cet ordre d'idées, il faut se rappeler par exemple les critiques virulentes de Rousseau à l'égard de l'optimisme de ses contemporains: dira-t-on que Rousseau n'appartient pas à la philosophie des Lumières, alors que sa pensée de l'Etat est tout entière dirigée contre le complexe théologico-politique? Ou les transformations d'une philosophie comme celle de Diderot, qui cherche sa voie entre le déisme et l'athéisme, entre l'empirisme et le matérialisme: est-ce lorsqu'il en vient à concevoir la vie et la conscience comme les produits des transformations de la matière que Diderot est vraiment un philosophe des Lumières? La place d'un philosophe comme Montesquieu est elle aussi singulière: à la différence de ses contemporains, qui réfléchissent sur la vie sociale et politique dans le cadre des théories du contrat, en se posant la question de l'origine de la société (du passage de l'état de nature à l'état social), Montesquieu, lui, interroge sur les «principes» qui relient entre eux les «faits» de la politique. La problématique est radicalement autre.
2. A supposer même qu'il existe une unité et une spécificité du XVIII e siècle en philosophie, la conçoit-on adéquatement en parlant de philosophie des Lumières? Cette notion n'est-elle pas trop lâche? N'est-ce pas plutôt toute philosophie qui, dans la lignée socratique, pourrait être caractérisée comme philosophie des Lumières? L'usage semble sur ce point particulièrement flottant; ainsi certains historiens, ou certains philosophes, parlent-ils volontiers d'une Aufklärung grecque: le V e siècle av. J.-C. (Dilthey). Est-ce à dire que l'histoire s'«éclaire» chaque fois que la raison cherche à s'émanciper de la tutelle théologique? S'agit-il alors d'une tendance constante (l'effort de la raison vers l'autonomie), présente dans toute l'histoire de la philosophie qui s'épanouirait au XVIII e siècle? Mais qu'est-ce alors qui spécifie cette époque de la philosophie, si l'on reconnaît qu'il existe d'autres «siècles des Lumières», ou que cette «tendance» est constante ? Il apparaît en tout cas que la référence aux seules «lumières» ne saurait suffire.
3. On confond fréquemment, en recourant à un sens très lâche du mot «philosophie», idéologie des Lumières et philosophie des Lumières. Si par idéologie on entend un système de représentations et de valeurs, dominant dans une époque donnée, on reconnaîtra sans peine une «idéologie des Lumières» au XVIII e siècle, dont les thèmes les plus fréquents sont effectivement la confiance en la raison, la dévalorisation du dogmatisme religieux, la croyance en un avenir heureux de l'humanité sous la direction des sciences et des techniques en progrès. De telles constantes idéologiques ne suffisent pas à définir un horizon philosophique. Si l'on cherche le sens philosophique de la notion de « philosophie des Lumières », il faut se demander à quelle conjoncture philosophique, à quels problèmes spécifiques, à quels concepts déterminés cette expression renvoie. La transformation du concept de philosophie Ainsi parle d'Alembert dans ses Eléments de philosophie (1759): «Notre siècle s'est appelé par excellence le siècle de la Philosophie (...). Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La Science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses; la Géométrie, en reculant ses limites, a porté le flambeau dans les parties de la Physique qui se trouvaient le plus près d'elle; le vrai système du monde a été connu (...). L'invention et l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espèce d'enthousiasme qui accompagne les découvertes (...), toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive.»
Les exemples choisis dans ce texte sont éclairants: les progrès de la «philosophie», ce sont d'abord ceux des sciences positives, et, en évoquant une «nouvelle méthode», il est probable que d'Alembert se réfère ici à Newton, et à ses Principes de la philosophie naturelle. Chez d'Alembert, cette référence converge avec une critique de la métaphysique traditionnelle, «philosophie première», ou «sciences des principes»: «Que nous importe au fond de pénétrer l'essence des corps, pourvu que la matière étant supposée telle que nous la concevons, nous puissions déduire des propriétés que nous regardons comme primitives, les autres propriétés secondaires que nous apercevons en elle, et que le système général des phénomènes, toujours uniforme et continu, ne nous présente nulle part de contradiction? Arrêtons-nous donc, et ne cherchons pas à diminuer par des sophismes subtils le nombre déjà trop petit de nos connaissances claires et certaines. C'est un triste sort pour notre curiosité et notre amour-propre; amis, c'est le sort de l'humanité. Nous devons au moins en conclure que les systèmes, ou plutôt les rêves des philosophes sur la plupart des questions métaphysiques, ne méritent aucune place dans un ouvrage destiné à renfermer les connaissances réelles acquises par l'esprit humain» (D'Alembert, op. cit.).
D'Alembert est probablement le plus cartésien des philosophes du XVIII e siècle. Mais on comprend chez lui comment l'inspiration cartésienne se retourne contre Descartes lui-même: la règle qui veut que l'esprit s'en tienne à des connaissances «claires et certaines» impose de renoncer à deux projets (solidaires) qui sont constitutifs de la philosophie cartésienne: celui d'une connaissance de l'essence des choses (des premiers principes) et celui d'un système du savoir universel. Ces projets apparaissent comme autant de fantasmes qui menacent la progression du savoir effectif.
Sans aller jusqu'à dire que la philosophie des Lumières représente un moment de rupture dans l'histoire de la philosophie, on peut faire l'hypothèse d'une mutation importante: la métaphysique, qui constitue depuis Aristote le centre et le dénominateur commun des recherches philosophiques, devient problématique. Il n'est plus évident qu'elle soit même possible. A tout le moins (car d'Alembert est un de ceux qui poussent le plus loin cette critique), elle change de sens et de statut. Quels en sont les nouveaux contours?
Parmi les tâches qui retiennent l'attention des philosophes des Lumières, deux apparaissent particulièrement importantes: introduire en philosophie le concept d'expérience et celui d'histoire. L'idée de «philosophie expérimentale» C'est la thèse cartésienne, selon laquelle toute bonne science doit être a priori, qui est remise en question. Nombreux sont ceux qui, au XVIII e siècle, vont reprendre à leur compte le projet formulé par Bacon un siècle plus tôt, d'une «philosophie expérimentale». On désigne par là, d'une part, une nouvelle manière de pratiquer la physique, mais au-delà, une nouvelle attitude de pensée. Cassirer parle à ce sujet d'une transformation dans la méthode, et d'un passage de la déduction à l'analyse. Ainsi Voltaire (qui contribue avec Mme du Châtelet à introduire Newton en France) puis Buffon se démarqueront nettement de l'idée que la physique peut être physique a priori. Dans la préface de son Histoire naturelle (1749), Buffon se prémunit contre le risque d'une physique «romanesque» et imaginaire: «Le seul moyen de connaître est celui des expériences raisonnées et suivies.» Les principes ne sont plus à découvrir a priori, par l'«inspection de l'esprit», mais à dégager, progressivement, de la multiplication des expériences. Tel est le mouvement de l'analyse.
Si la philosophie reste conçue comme un système, nombreuses sont les critiques formulées à l'encontre de l'«esprit de système». C'est le principal reproche que Condillac adresse aux philosophies des siècles précédents: avoir procédé déductivement à partir d'un concept arbitrairement érigé en principe. Le philosophe, c'est celui qui sait se tenir à distance de tout système, y compris le sien propre.
C'est le statut même des «idées» qui se trouve alors transformé: l'empirisme se développe vivement au XVIII e siècle, en s'appuyant sur les travaux de Locke. Il faut réfléchir sur l'origine des idées, expliquer leur genèse. C'est à quoi s'attache Condillac, et c'est dans cette perspective que s'inscriront les «idéologues» de la fin du siècle. Au-delà du dualisme cartésien s'ouvre la perspective d'un matérialisme, qui se donne pour but de dériver la pensée, y compris ses principes les plus abstraits (comme les lois morales et la religion), de la matière et de la nature ( Helvétius, La Mettrie, d'Holbach). Le concept de matière est lui-même remis en chantier; on refuse l'identification cartésienne de la matière et de l'étendue pour y introduire le dynamisme et la vitalité. Les références à Leibniz et à Spinoza sont fréquentes (chez Diderot et Maupertuis par exemple): elles servent de point d'appui pour dépasser le cartésianisme.
On voit que le projet de l'Encyclopédie (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), dont la rédaction commence en 1745 et la publication en 1751, correspond parfaitement à cette nouvelle conception de la raison; pour être systématique sans être abstrait, il faut exposer le travail effectif de la raison, dans tous les domaines où elle s'exerce. Le choix de l'ordre alphabétique, qui est déjà celui de Bayle dans son Dictionnaire (publié en 1696-1697, il sert d'outil de travail à tous les philosophes de l'époque), indique, par son arbitraire même, qu'aucun ordre ne détermine a priori le travail positif de la raison. La pensée de l'histoire La seconde tâche déterminante, c'est la pensée de l'histoire. Que l'histoire ne soit plus seulement un récit, ayant pour fonction d'immortaliser des grandes et belles actions, mais qu'elle devienne, à part entière, une science, chargée comme la physique de dégager des lois, tel est l'horizon de travail d'une époque qui découvre avec l'histoire un «nouveau continent».
C'est d'abord l'émergence hésitante de l'idée d'une histoire de la nature. Le concept semble acquis vers le milieu du siècle, et l'Histoire naturelle de Buffon (qui date de 1759) s'efforce, indépendamment de tout postulat théologique, de faire l'inventaire des règnes de la nature (d'où l'importance des questions de classification) et de leurs transformations.
Qu'en est-il alors de l'histoire des hommes? Les sociétés humaines sont-elles, comme la nature, aussi soumises à des lois? Peut-on assigner une raison aux différentes transformations qui affectent les sociétés humaines? De nouveaux objets se constituent: l'histoire des «mœurs» chez Voltaire, et la tentative pour dégager «l'esprit du temps» (le Siècle de Louis XIV et surtout l'Essai sur les mœurs), et avec eux se dessine la perspective d'une rationalité historique englobante. La philosophie tend à devenir une philosophie de l'histoire. Mais la difficulté est immédiate: si l'histoire comporte des lois, est-ce à dire qu'il y règne, comme dans la nature, une nécessité? Penser en historien, n'est-ce pas justement réintroduire la contingence et l'indétermination y compris dans la compréhension de la nature? Une nature parfaitement réglée par des lois aurait-elle une histoire?
C'est dans cette lignée que s'inscrivent les pensées du progrès, qui voient dans l'avènement des Lumières la possibilité d'une humanité plus heureuse et plus vertueuse: ainsi Condorcet, dans son Esquisse des progrès de l'esprit humain. Mais l'optimisme est d'emblée un problème pour la philosophie; Rousseau s'efforcera de penser ensemble le progrès des Lumières et celui de la servitude et du malheur ( Discours sur les Sciences et les Arts). Que l'homme soit par nature perfectible n'implique pas que son histoire ait globalement la forme d'un progrès vers le mieux: il faut aussi penser le progrès, paradoxalement comme mouvement vers le pire. Les limites de la philosophie des Lumières Cette question a été posée, d'emblée. Elle l'est déjà, de l'intérieur de la philosophie des Lumières, par les tenants de la pensée critique. Par des voies différentes, Berkeley, Rousseau, Hume et Kant s'interrogent en effet sur les limites de la raison. Le rationalisme des Lumières est un rationalisme critique à l'égard des pouvoirs de la raison. Mais c'est surtout Hegel qui mènera contre les Lumières une critique violente (la Phénoménologie de l'esprit, VI e partie). Les principaux reproches visent le sectarisme et l'abstraction; le sectarisme, parce que les philosophes des Lumières auraient opéré un partage tranché entre le rationnel et l'irrationnel (l'obscurantisme religieux), incapable de concevoir la rationalité à l'œuvre dans la culture religieuse. L'abstraction, car, emportés par la revendication d'autonomie, ils auraient négligé de penser les conditions positives d'effectuation de la liberté. Les tentatives pour ériger une «religion naturelle», «dans les limites de la simple raison», témoigneraient de ce formalisme, qui n'aurait eu d'autre effet que de provoquer le mysticisme et le retour romantique du sentiment. Au fond, la volonté de «penser par soi-même» n'est pas, en elle-même, une garantie suffisante de rationalité. «S'attacher à l'autorité des autres ou à sa conviction propre diffère seulement par la vanité inhérente à la seconde manière.» Rien n'est donc joué lorsqu'on a proclamé l'autonomie de la raison: encore faut-il que le contenu de pensée devienne effectivement rationnel.
Au rationalisme des Lumières on peut reprocher une certaine naïveté: ne pas avoir suffisamment interrogé ses propres limites et réfléchi sur ses propres présupposés. Il est clair par exemple que ce rationalisme participe pour une part de la croyance (en la valeur de la raison) et que la croyance en un progrès historique s'est parfois substituée à l'ancienne eschatologie. Les « libres penseurs » ne seraient-ils, comme le dit parfois Nietzsche, que des théologiens qui s'ignorent?
Il s'est en tout cas depuis deux siècles constitué une « mythologie des Lumières ». La reconduire sans l'examiner reviendrait à trahir les exigences premières des philosophes de ce temps. Une des formes les plus avancées de cet examen se trouve dans les analyses qu'Adorno et Horkheimer, philosophes de l'école de Francfort, ont consacrées à l'histoire de la rationalité: «De tout temps, l'Aufklärung, au sens le plus large de pensée en progrès, a eu pour but de libérer les hommes de la peur et de les rendre souverains. Le programme de l'Aufklärung avait pour but de libérer le monde de la magie. Elle se proposait de détruire les mythes, d'apporter à l'imagination l'appui du savoir. Mais la terre, entièrement \"éclairée\", resplendit sous le signe des calamités triomphant partout.» Et pourtant, lorsqu'il s'agit de fonder la critique de l'aliénation et de la réification, c'est toujours au principe de l'autonomie qu'Adorno et Horkheimer se réfèrent. La philosophie des Lumières serait-elle indépassable?
«Nous sommes aujourd'hui conscients de ce que le rationalisme du XVIIIe siècle, sa façon de vouloir assurer la solidité et la tenue requise pour l'humanité européenne, était une naïveté. Mais faut-il abandonner en même temps que ce rationalisme naïf et même, si on le pense jusqu'au bout, contradictoire, également le sens authentique de ce rationalisme?»
Liens utiles
- Chronologie de Lumières (1685 - 1799)
- XVIIIe siècle: les Lumières
- questions sur les lumières
- Les Lumières : auteurs, œuvres et idées
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?