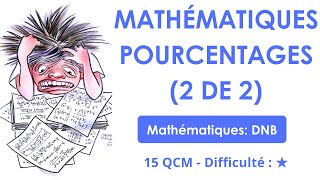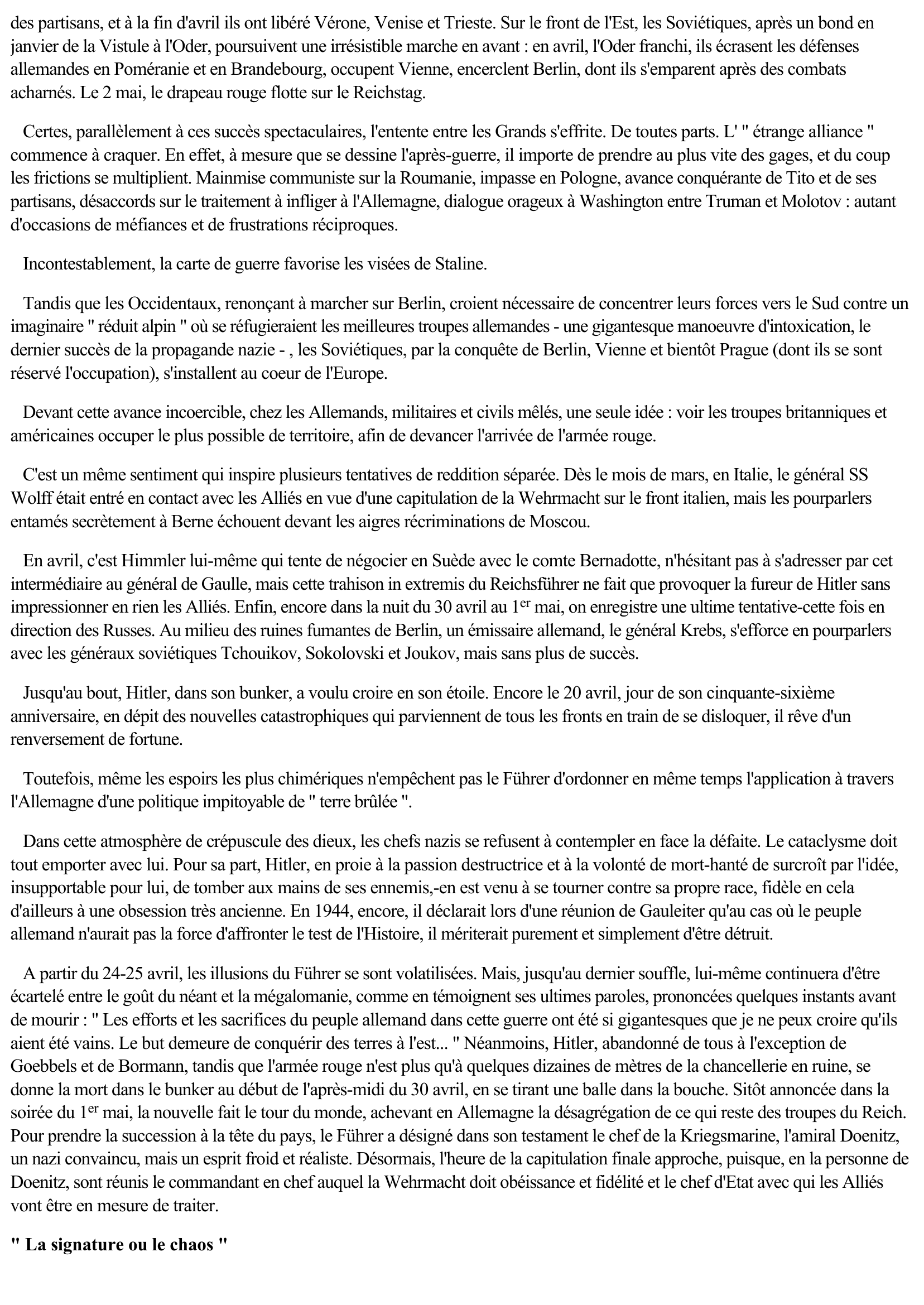7-8 mai 1945 - En signant le protocole de capitulation à Reims le 7 mai, puis en répétant symboliquement cette signature dans la capitale du Reich, à Berlin, dans la nuit du 8 au 9 mai, les chefs militaires allemands avouaient à la face du monde la défaite complète et sans rémission de leur pays. Pour le Alliés, à une guerre totale répondait une victoire totale. Le 9 mai à 0 heure, après 2 077 jours de combats, de souffrances et de deuils, la seconde guerre mondiale prenait fin.
La capitulation des 7-8 mai 1945, loin de découler des hasards imprévus de la bataille ou d'une improvisation des vainqueurs, constitue le point d'aboutissement d'un triple processus historique. Trois données en effet y confluent : la première, vieille de plus de deux ans, c'est le mot d'ordre allié de capitulation sans conditions la deuxième, c'est l'effondrement militaire et la désagrégation de la machine de guerre du Reich entre le début de mars et la fin d'avril 1945 enfin, troisième élément décisif, avec la mort de Hitler le 30 avril et son remplacement par l'amiral Doenitz, il n'y a plus d'obstacle à une reddition de l'Allemagne aux mains des Alliés.
C'est en janvier 1943, à la conférence de Casablanca, qu'avait été adoptée la formule de capitulation sans conditions (unconditional surrender) pour l'Allemagne, l'Italie et le Japon.
Une idée lancée par Roosevelt, qui l'impose à Churchill, puis entérinée, non sans réserves, par Staline à la conférence de Téhéran à la fin de l'année. Dans l'esprit de Roosevelt, il s'agissait d'abord de ne pas répéter l'erreur commise en 1918 en laissant les Allemands exploiter sans vergogne le thème d'un pays abattu non par la défaite mais par la trahison. Ensuite, une reddition inconditionnelle laisserait les mains libres pour négocier un règlement de paix, sans se lier à l'avance comme Wilson l'avait fait avec les " quatorze points ". A l'appui d'un tel mot d'ordre, l'on pouvait encore invoquer d'autres arguments : n'était-ce point la preuve de la résolution inébranlable des Alliés, bien décidés à aller ensemble jusqu'au bout ?
L'expression de leur certitude absolue en la victoire ? Le signe que les membres de la Grande Alliance ne se prêteraient à aucune négociation, à aucun compromis, à aucune paix séparée ? Bref, la seule riposte possible à une guerre totale.
Effectivement, érigée en doctrine officielle, la formule ne variera plus. En sens inverse, on n'a pas manqué de critiquer sévèrement la stratégie de la capitulation inconditionnelle.
D'abord parce qu'elle a abouti sur le plan psychologique à l'effet contraire à celui que l'on recherchait, en raidissant et en prolongeant la résistance de l'adversaire. Ensuite parce que la propagande nazie a trouvé là une chance inespérée. Pour Goebbels, c'est la démonstration éclatante que les Alliés veulent purement et simplement anéantir la nation allemande : dès lors, il n'y a que le Führer pour empêcher l'Allemagne d'être submergée par " les hordes slaves du bolchevisme ".
D'où un sursaut dans l'opinion et un coup fatal porté à l'opposition à Hitler, que ce soit avant ou après le complot du 20 juillet 1944, puisque les Alliés, renonçant à distinguer entre les dirigeants nazis et le peuple allemand, déclarent que même l'élimination du Führer ne modifierait pas leur ligne de conduite.
Seules l'invasion totale du pays et la dislocation des armées du Reich imposeront la capitulation.
Pendant longtemps, Hitler s'était bercé d'un tenace espoir : l'entrée en scène d'armes nouvelles qui renverseraient le cours de la guerre en faveur de l'Allemagne. Mais au printemps 1945, force est bien de se rendre à l'évidence. Aucun miracle n'est à attendre de ce côté-là : ni les chasseurs à réaction, ni les nouveaux sous-marins, ni les VI et V2 n'ont atteint un niveau de production suffisant pour être vraiment opérationnels.
Quant à l'arme atomique, il y a beau temps que l'Allemagne a perdu toute chance dans la course de vitesse engagée avec les Alliés.
Sur le plan militaire, sous les coups de boutoir des Alliés, les armées allemandes sont en train de s'effondrer sur tous les fronts. A l'ouest, l'offensive déclenchée par Eisenhower depuis le début de mars, après avoir franchi le Rhin et encerclé la Ruhr, se déploie au coeur de l'Allemagne : tandis que le XXIe groupe d'armées, commandé par Montgomery, marche sur Brême, Hambourg et Lübeck, au centre, les Américains de Bradley avancent successivement à travers la Hesse, la Thuringe et la Saxe, et, le 25 avril, une patrouille blindée de la Ire armée fait sa jonction sur l'Elbe, à Torgau, avec les éléments avancés de la Ire armée d'Ukraine du maréchal Koniev.
Combats acharnés
Plus au sud, les Franco-américains s'emparent de Stuttgart et de Nuremberg, et pénètrent en Autriche. En Italie, les Alliés, après avoir brisé la résistance allemande sur la " ligne gothique ", déferlent sur la plaine du Pô, aidés par l'insurrection générale des partisans, et à la fin d'avril ils ont libéré Vérone, Venise et Trieste. Sur le front de l'Est, les Soviétiques, après un bond en janvier de la Vistule à l'Oder, poursuivent une irrésistible marche en avant : en avril, l'Oder franchi, ils écrasent les défenses allemandes en Poméranie et en Brandebourg, occupent Vienne, encerclent Berlin, dont ils s'emparent après des combats acharnés. Le 2 mai, le drapeau rouge flotte sur le Reichstag.
Certes, parallèlement à ces succès spectaculaires, l'entente entre les Grands s'effrite. De toutes parts. L' " étrange alliance " commence à craquer. En effet, à mesure que se dessine l'après-guerre, il importe de prendre au plus vite des gages, et du coup les frictions se multiplient. Mainmise communiste sur la Roumanie, impasse en Pologne, avance conquérante de Tito et de ses partisans, désaccords sur le traitement à infliger à l'Allemagne, dialogue orageux à Washington entre Truman et Molotov : autant d'occasions de méfiances et de frustrations réciproques.
Incontestablement, la carte de guerre favorise les visées de Staline.
Tandis que les Occidentaux, renonçant à marcher sur Berlin, croient nécessaire de concentrer leurs forces vers le Sud contre un imaginaire " réduit alpin " où se réfugieraient les meilleures troupes allemandes - une gigantesque manoeuvre d'intoxication, le dernier succès de la propagande nazie - , les Soviétiques, par la conquête de Berlin, Vienne et bientôt Prague (dont ils se sont réservé l'occupation), s'installent au coeur de l'Europe.
Devant cette avance incoercible, chez les Allemands, militaires et civils mêlés, une seule idée : voir les troupes britanniques et américaines occuper le plus possible de territoire, afin de devancer l'arrivée de l'armée rouge.
C'est un même sentiment qui inspire plusieurs tentatives de reddition séparée. Dès le mois de mars, en Italie, le général SS Wolff était entré en contact avec les Alliés en vue d'une capitulation de la Wehrmacht sur le front italien, mais les pourparlers entamés secrètement à Berne échouent devant les aigres récriminations de Moscou.
En avril, c'est Himmler lui-même qui tente de négocier en Suède avec le comte Bernadotte, n'hésitant pas à s'adresser par cet intermédiaire au général de Gaulle, mais cette trahison in extremis du Reichsführer ne fait que provoquer la fureur de Hitler sans impressionner en rien les Alliés. Enfin, encore dans la nuit du 30 avril au 1er mai, on enregistre une ultime tentative-cette fois en direction des Russes. Au milieu des ruines fumantes de Berlin, un émissaire allemand, le général Krebs, s'efforce en pourparlers avec les généraux soviétiques Tchouikov, Sokolovski et Joukov, mais sans plus de succès.
Jusqu'au bout, Hitler, dans son bunker, a voulu croire en son étoile. Encore le 20 avril, jour de son cinquante-sixième anniversaire, en dépit des nouvelles catastrophiques qui parviennent de tous les fronts en train de se disloquer, il rêve d'un renversement de fortune.
Toutefois, même les espoirs les plus chimériques n'empêchent pas le Führer d'ordonner en même temps l'application à travers l'Allemagne d'une politique impitoyable de " terre brûlée ".
Dans cette atmosphère de crépuscule des dieux, les chefs nazis se refusent à contempler en face la défaite. Le cataclysme doit tout emporter avec lui. Pour sa part, Hitler, en proie à la passion destructrice et à la volonté de mort-hanté de surcroît par l'idée, insupportable pour lui, de tomber aux mains de ses ennemis,-en est venu à se tourner contre sa propre race, fidèle en cela d'ailleurs à une obsession très ancienne. En 1944, encore, il déclarait lors d'une réunion de Gauleiter qu'au cas où le peuple allemand n'aurait pas la force d'affronter le test de l'Histoire, il mériterait purement et simplement d'être détruit.
A partir du 24-25 avril, les illusions du Führer se sont volatilisées. Mais, jusqu'au dernier souffle, lui-même continuera d'être écartelé entre le goût du néant et la mégalomanie, comme en témoignent ses ultimes paroles, prononcées quelques instants avant de mourir : " Les efforts et les sacrifices du peuple allemand dans cette guerre ont été si gigantesques que je ne peux croire qu'ils aient été vains. Le but demeure de conquérir des terres à l'est... " Néanmoins, Hitler, abandonné de tous à l'exception de Goebbels et de Bormann, tandis que l'armée rouge n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de la chancellerie en ruine, se donne la mort dans le bunker au début de l'après-midi du 30 avril, en se tirant une balle dans la bouche. Sitôt annoncée dans la soirée du 1er mai, la nouvelle fait le tour du monde, achevant en Allemagne la désagrégation de ce qui reste des troupes du Reich. Pour prendre la succession à la tête du pays, le Führer a désigné dans son testament le chef de la Kriegsmarine, l'amiral Doenitz, un nazi convaincu, mais un esprit froid et réaliste. Désormais, l'heure de la capitulation finale approche, puisque, en la personne de Doenitz, sont réunis le commandant en chef auquel la Wehrmacht doit obéissance et fidélité et le chef d'Etat avec qui les Alliés vont être en mesure de traiter.
" La signature ou le chaos "
A partir du moment où Doenitz a succédé à Hitler, une lutte acharnée oppose, par-delà les péripéties des combats, le nouveau chef de l'Allemagne aux Alliés. Dans l'esprit de Doenitz, il s'agit de sauver pour l'avenir ce qui peut l'être encore. Résister au maximum face aux Russes, de manière à gagner du temps et à transférer du côté de l'Ouest le plus grand nombre possible de soldats et de civils, quitte à signer des armistices limités ou des redditions partielles avec les Occidentaux, tel est le calcul du président du gouvernement du Reich réfugié dans la petite ville de Flensburg à la frontière danoise. Pour les Alliés, au contraire, il n'y a qu'une ligne à suivre : continuer de se battre jusqu'à la capitulation totale sans conditions de toutes les forces allemandes sur tous les fronts. Si des redditions partielles sont consenties, c'est seulement sur le plan tactique et afin de hâter l'acte final. De fait, avant le protocole de Reims, trois redditions partielles sont signées. D'abord en Italie, à la fin d'avril où les pourparlers engagés entre le commandant en chef allemand, von Vietinghoff, en dépit des ordres de Berlin, et le général Alexander aboutissent le 29 avril à un document mettant fin aux hostilités sur ce front à dater du 2 mai à midi. Autres négociation de reddition : en Bavière et en Autriche où, à Innsbrück, le 5 mai, la XIXe armée allemande se rend aux Américains de Devers et aux Français de de Lattre.
Mais l'épisode le plus marquant se situe au nord-ouest de l'Allemagne, à Lüneburg, où Montgomery a installé son quartier général. Là arrive, le 3 mai, une délégation de quatre plénipotentiaires allemands conduits par l'amiral von Friedeburg (qui a succédé à Doenitz comme chef de la Kriegsmarine) Venus négocier une capitulation des armées battant en retraite devant les Russes, ils se heurtent à la fermeté sèche de Montgomery, qui exige à l'inverse la reddition des troupes qui lui font face, de la Hollande à la Frise et au Danemark. Le 4 mai, ils signent dans la roulotte de " Monty " la reddition de toutes les armées du Nord-Ouest : prélude direct à la capitulation générale, puisque la reddition englobe le secteur où est installé le gouvernement allemand.
C'est à Reims, dans le décor d'un bâtiment sans caractère, une modeste " école industrielle " de briques rouges, que prend place la scène historique mettant fin à la seconde guerre mondiale.
Les négociations ont commencé le 5 mai avec l'arrivée d'une délégation allemande dirigée, comme à Lüneburg, par l'amiral von Friedeburg. Du côté allié, c'est le général Bedell Smith ( " Beetle " ), le chef d'état-major d'Eisenhower, qui mène les pourparlers, assisté d'un représentant soviétique, le général Susloparov. Les négociations achoppent devant les manoeuvres dilatoires des Allemands, qui ne se résignent pas à accepter l'exigence alliée d'un arrêt général et simultané des hostilités sur tous les théâtres d'opérations et qui, de surcroît, ne disposent pas des pouvoirs nécessaires. Il faut que, le lendemain.
Doenitz délègue le général Jodl, chef d'état-major de l'OKW, pour que les négociations reprennent. Il faut surtout que, dans la soirée du 6 mai. Eisenhower fasse parvenir un véritable ultimatum aux plénipotentiaires allemands en les menaçant de fermer le front occidental à la masse des soldats allemands qui fuient devant les Russes. " Je ne vois pas d'autre alternative que la signature ou le chaos ", télégraphie alors Jodl à Doenitz. Désormais, il n'y a plus de barrière à une capitulation totale et sans conditions.
Celle-ci a lieu à partir de 1h 30 du matin le 7 mai. Dans la salle des opérations du quartier général allié. Une petite pièce aux murs tapissés de cartes multicolores, sous la lumière aveuglante des lampes installées par les photographes. Au centre, une longue table peinte en noir, plutôt branlante, entourée de quatorze chaises.
Après qu'eurent pris place les chefs alliés, Bedell Smith, représentant d'Eisenhower, Susloparov pour l'URSS, les généraux Robb et Strong pour la Grande-Bretagne, le général Servez, sous-chef d'état-major de la défense nationale, pour la France, entre la délégation allemande : le général Jodl, l'amiral Friedeburg et le major Oxenius. Les documents dactylographiés sont placés devant les délégués allemands qui signent en silence.
Dans ces clauses au nombre de cinq, deux sont capitales : l'article premier, par lequel les Allemands font acte de capitulation inconditionnelle et simultanée auprès du comandant en chef allié et du haut commandement soviétique : l'article 2, stipulant que les hostilités prendront fin le 9 mai à 0 heure.
Ainsi à 2 h 41 du matin, tout était terminé.
On peut se demander pourquoi, après le protocole de Reims, il était besoin de répéter la cérémonie à Berlin. En fait, qualifiée d'acte final de la capitulation allemande, la séance de signature organisée dans la capitale du Reich a d'abord et avant tout une signification symbolique. On en trouve la preuve dans les instructions que Staline adresse au maréchal Joukov en le désignant comme représentant suprême de l'armée rouge : " C'est le peuple soviétique qui a porté sur ses épaules la plus grande partie du poids de la guerre, la capitulation doit donc être signée devant le commandement supérieur de tous les pays de la coalition anti-hitlérienne et non devant le seul commandement suprême des troupes alliées. " De plus, on ne saurait accepter que l'acte ne prenne point place à Berlin " centre d'où est partie l'agression fasciste ". Dans ces conditions, affirme-t-il, " nous sommes convenus avec les Alliés que l'acte signé à Reins serait considéré comme un protocole de capitulation provisoire ".
Du coup l'ordonnance, le style, l'esprit de la cérémonie de Berlin vont la constituer en une affaire avant tout soviétique. Tout comme à Reims le déroulement avait été principalement une affaire d'Occidentaux.
A l'instar de Reims, le lieu choisi est dépourvu de tout décorum. Un bâtiment gris en béton qui a servi pendant des années d'école de formation des sous-officiers du génie : c'est là, dans la banlieue pavillonnaire de Karlhorst au nord-est de Berlin, que Joukov a installé son quartier général.
Un " rideau de fer "
Au cours de la journée du 7 mai arrivent à l'aérodrome de Tempelhof les délégués occidentaux : le maréchal de l'air Tedder, adjoint au commandement en chef allié, un Britannique qui représente le général Eisenhower : le général Spaatz, l'un des chefs de l'US Air Force, le général de Lattre de Tassigny, désigné par de Gaulle pour représenter la France. De longs palabres s'engagent alors sur les termes de la capitulation. Surtout les discussions butent sur le protocole de la cérémonie. Finalement, il est convenu que les représentants des deux commandements suprêmes, Joukov et Tedder, signeront comme parties contractantes.
Spaatz pour les Etats-Unis et de Lattre pour la France signant comme témoins.
La scène finale commence à 0 h 6, dans la nuit du 8 au 9 mai.
Sont assis à la table des vainqueurs Joukov, au centre, Tedder et Vychinski, vice-commissaire soviétique aux affaires étrangères, à sa droite, Spaatz et de Lattre à sa gauche. Devant eux une petite table pour les plénipotentiaires allemands : Keitel, le chef de l'OKW, l'amiral Friedeburg pour la marine, le général Stumpf pour la Luftwaffe. Dans un silence historique, ceux-ci sont alors introduits.
Sans attendre que soit accompli l'acte final de Berlin, la nouvelle de la capitulation allemande s'était répandue comme une traînée de poudre. A Londres, à Paris, à New-York, dans toutes les villes, les bourgs et les villages de l'Ancien et du Nouveau Monde, des foules en liesse célèbrent la victoire. A 15 heures, le 8 mai, de Gaulle, Churchill et Truman prennent la parole à la radio pour annoncer formellement et saluer la victoire. En revanche, à Moscou, rien ne se produit avant le matin du 9 mai, date officielle du jour V pour les Soviétiques. Mais alors ce sont les mêmes déferlements de joie.
Toutefois, dans les milieux dirigeants, malgré le sentiment intense de délivrance-un sentiment renforcé encore par les révélations quotidiennes sur les horreurs du système nazi-l'atmosphère est assombrie par les difficultés qui s'amoncellent de plus en plus. Derrière l'euphorie, les tensions entre les Grands à propos de l'Allemagne, de la Pologne, des Balkans, de l'Extrême-Orient, vont grandissant. De Gaulle, dans ses Mémoires de guerre, évoque le caractère grave et contenu de cette victoire, bien différente de celle de 1918.
Mais c'est surtout Churchill qui manifeste le plus ouvertement ses alarmes. Après avoir adressé, le 12 mai, au président Truman le fameux télégramme dit du " rideau d fer " ( " La situation européenne m'inquiète énormément... Un rideau de fer s'est abaissé sur le front soviétique. Nous ignorons tout ce qui se passe derrière. Il semble bien probable que l'ensemble des régions situées à l'est de la ligne Lübeck-Trieste-Corfou sera bientôt complètement entre les mains des Russes. " ), le premier Britannique lance, le 13 mai, dans un grand discours radiodiffusé au peuple du Royaume-Uni, un avertissement à peine voilé. Sur une note grave, il ne cache pas que, loin que les sacrifices soient terminés, il reste encore beaucoup à faire. Et il poursuit d'un ton prophétique: à travers l'Europe, il faut " nous assurer que les buts simples et honorables pour lesquels nous sommes entrés en guerre ne seront pas brutalement mis de côté ni oubliés au cours des mois qui vont suivre notre victoire, que les mots " liberté " , " démocratie " et " libération " ne seront pas déformés et garderont leur vrai sens, celui que nous leur attribuons. A quoi servirait-il de punir les hitlériens pour leurs crimes si le règne de la loi et la justice ne s'établissait pas, si des gouvernement totalitaires et policiers devaient prendre la place des envahisseurs allemands ? "