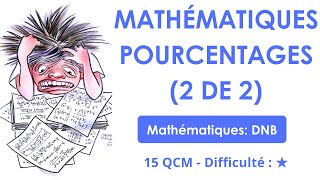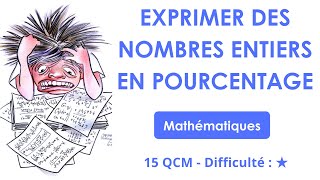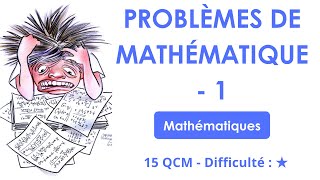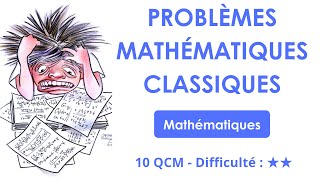stendhal, Lucien Leuwen
Publié le 27/02/2011
Extrait du document
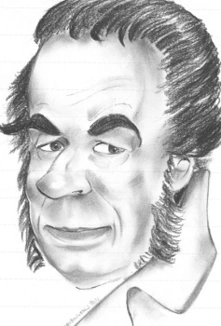
Roman commencé par Stendhal en 1834 et resté inachevé, Lucien Leuwen s’ouvre sur l’arrivée à Nancy du héros éponyme, un
jeune sous-lieutenant parisien. Tout roman comporte traditionnellement des topoi (clichés), épisodes riches en émotion,
quasiment obligatoires, et attendus par le public, au nombre desquels figurent en bonne place les premières rencontres
amoureuses. Lucien Leuwen n’échappe pas à la règle et nous offre, une à deux pages après l’incipit, une scène de première
vue qui pourrait être bien banale puisque Stendhal y raconte la première rencontre de son héros, Lucien, avec « une jeune
femme blonde ». Cependant la manière dont le narrateur aborde le topos est originale. La rencontre a en effet lieu dans un
cadre qui, bien que réel, est loin d’être anodin et qui confère à la scène un rythme relativement enlevé, sans que le jeu des
regards en soit pour autant négligé.
Sans doute la description du lieu apparaît-elle d’abord très réaliste. Cependant, une lecture plus approfondie permet de
constater que cet effet de réel est trompeur car les détails choisis sont tous porteurs de signification et permettent en outre
d’imprimer à la scène une certaine dynamique.
La rencontre se déroule dans une ville, comme le souligne l’évocation de « Nancy ». Ce toponyme inscrit ainsi la scène de
première vue dans un décor réaliste. Mais le narrateur délimite volontairement cet espace par « une voûte, au bout de la rue »
et, latéralement, par la « grande maison » au « grand mur blanc ». Ainsi restreint, l’espace donne plus d’intensité à la rencontre.
Réaliste, le décor l’est aussi en raison de certains détails. Le narrateur prend soin de noter d’emblée les effets de couleurs :
« au milieu d’un grand mur blanc », la persienne « peinte en vert perroquet » ne peut qu’attirer le regard. Il note aussi ensuite
des détails sordides : les murs « écorchés et sales » des autres maisons et la boue « noire ». Cependant, il n’omet pas non plus
de prendre en compte la présence de la beauté en évoquant le « rideau de mousseline brodée » qui cache la jeune femme. Le
narrateur crée donc un effet de réel pour entraîner l’adhésion d’un lecteur qui aurait dû d’ailleurs être contemporain de Lucien –
si le livre avait été achevé et publié en 1835 – puisque l’intrigue se déroule sous la Monarchie de Juillet.
Cependant, le jeu des oppositions dans cet espace est trop évident pour ne renvoyer qu’à un espace réaliste anodin. On
remarque une première opposition entre l’espace clos que créent les murs, le pavé et la voûte et l’ouverture que constitue la
fenêtre entrouverte – malgré la persienne, autre symbole d’enfermement. Le jeune Parisien enfermé dans un espace hideux qui
renvoie à la laideur de la ville tout entière trouve dans cette fenêtre une voie salvatrice, celle de l’amour. Cependant, le
pléonasme « s’entr’ouvrir un peu », qui souligne l’étroitesse de l’ouverture, semble déjà annoncer les difficultés à venir. Une
seconde opposition est visible, tout aussi symbolique. Le bas de la rue est réservé au pavé « méchant », à la boue « noire »,
aux embarras, c’est-à-dire à tout ce qui est trivial. Par contre, c’est en hauteur que se situe la jeune femme, seul élément positif
de la scène. On peut souligner aussi le fait que Lucien lui-même, juché sur son cheval, domine la rue. Enfin une dernière
opposition permet d’affirmer que l’espace n’est pas vraiment réaliste : c’est celle de l’ombre et de la lumière. En effet, le mur de
la maison de la jeune femme se distingue des autres par sa blancheur. De plus, même si la couleur « vert perroquet » de la
persienne n’est pas le signe d’un bon goût absolu, elle apporte tout de même une touche de gaieté dans cet environnement
sinistre. La maison annonce donc la jeune femme, lumineusement « blonde », seule femme dans cet univers masculin.
En même temps qu’il est symbolique, l’espace dans lequel se déroule la rencontre est aussi dynamique car il détermine
la scène et son rythme. Certes le texte présente des pauses descriptives. Elles pourraient ralentir le rythme de la scène, mais
elles sont si brèves qu’elles s’imbriquent parfaitement dans l’action. Ainsi la ville est-elle décrite à la faveur des actions de
Lucien. Le fait qu’il lève les yeux donne lieu à la description de la maison de la jeune femme. Les éléments du décor sont euxmêmes
le prétexte à l’insertion par petites touches du portrait de la femme. Cette dernière est en effet décrite lorsqu’elle ouvre
et referme la fenêtre. Les pauses de description sont, par ailleurs, l’occasion de donner libre cours aux souvenirs de Lucien. La
description n’est donc pas vraiment statique. D’autre part, l’espace détermine le commencement et la fin de cette scène de
première vue puisque l’« embarras » sous la voûte provoque un arrêt qui permet de découvrir la présence féminine et que le
dégagement de cette même voûte permet au régiment de repartir, provoquant de ce fait la chute de Lucien, qui clôt le texte.
Enfin, parce qu’il est restreint, l’espace de la rue permet un jeu des regards qui fait de cette scène une scène de première vue.
C’est donc une scène enlevée que nous offre Stendhal. Ce rythme naît non seulement de la commotion du coup de foudre qui,
vécue au présent, balaie le passé, mais aussi de l’avancée mécanique imposée à Lucien par le régiment.
De fait, la scène ne manque pas de dynamisme car le schéma narratif en est simple, efficace. En situation initiale, le
narrateur présente l’ennui de Lucien, qui s’appuie sur un présupposé, à savoir l’opposition entre la province et la capitale. Le
mépris de Lucien, visible à travers l’insulte « marauds de provinciaux », rend sensible cet ennui, qu’un événement perturbateur,
à savoir l’ouverture de la fenêtre, rompt. L’apparition de la jeune femme peut contribuer à nuancer les a priori de Lucien sur la
province. Cependant la situation finale, par le biais de la péripétie de la chute, nous ramène presque à la situation initiale :
Lucien est renvoyé à la réalité triviale de la province. Le récit est donc construit en boucle, démentant de façon grotesque
l’ouverture entrevue avec l’apparition de la jeune femme. D’autre part, les passés simples du texte lui confèrent aussi un rythme
enlevé. Ils signalent toujours une rupture, qu’il s’agisse des premiers – « leva » et « vit » – ou de ceux que l’on trouve dans le
second paragraphe – « s’envolèrent », « fut ranimée » et « disparut ». Les passages descriptifs freinent d’ailleurs à peine
l’enchaînement des actions : ouverture de la fenêtre, fermeture de cette même fenêtre, remise en marche du régiment et chute
finale. On note même une accélération du rythme dans le dernier paragraphe grâce à l’énumération des verbes d’action en un
rythme ternaire qui, paradoxalement, permet de voir la fin de la scène au ralenti, théâtralisant ainsi la chute.
Ce qui donne à la scène son rythme enlevé, c’est aussi le fait que le coup de foudre efface curieusement la perception
première de la ville. D’emblée, on note une opposition entre le passé simple et le plus-que-parfait, renforcée par l’indicateur
temporel « jusque là ». Cette opposition se retrouve dans le second paragraphe, entre le verbe « donner » et le verbe
« disparaître ». Il semble bien que tout ce qui est antérieur à l’apparition soit définitivement effacé. Les passés simples
soulignent d’ailleurs la rapidité de la métamorphose de Lucien. L’opposition entre la longue énumération accumulative de ses
griefs et l’extrême concision du pronom indéfini « tout » qui lui succède contribue également à mettre en évidence la rupture
entre le passé, ennuyeux, et le présent qui le balaie de façon radicale, comme en témoigne l’emploi des indéfinis de la totalité
sous leurs deux formes, adjectivale et pronominale : « toutes les idées tristes de Lucien s’envolèrent », « tout disparut ». La
couleur « vert perroquet » subit elle-même une rapide réévaluation : alors qu’elle était jugée « voyante » au début du texte, elle
devient curieusement en peu de lignes un objet de fascination.
Enfin, la scène trouve aussi son rythme dans l’opposition entre Lucien et le régiment. Ce dernier porte Lucien, sans qu’il
participe de plein gré à ce mouvement mécanique. L’expression « avait forcé le régiment à s’arrêter » souligne l’aspect
mécanique de la marche. Le régiment est d’ailleurs conçu comme un ensemble où tous se fondent dans l’anonymat, excepté
Lucien. La reprise de la marche est tout aussi mécanique : le régiment repart à l’improviste, sans qu’on sache pourquoi, comme
le souligne l’emploi du passé simple et celui de l’adverbe « tout à coup ». Or Lucien n’est pas en accord avec ce rythme
mécanique. Sur ce point, il s’accorde avec la jeune femme. Ils semblent être tous deux les seuls à présenter des signes
d’humanité. La répétition du verbe « voir » ou du nom « yeux » ainsi que l’importance du champ lexical du regard dans lequel
entrent ces mots et les termes « voyantes » ou « regarda » soulignent la marginalité de ces deux personnages. Ils sont en effet
spectateurs, et de ce fait en retrait de l’action. Cette passivité coûte d’ailleurs à Lucien une chute grotesque qui le réintègre au
sein de la communauté à laquelle il tente d’échapper.
La scène de la rencontre est racontée selon le point de vue de Lucien, ce qui permet au lecteur non seulement de voir ce que
voit le personnage principal, mais aussi de connaître ce qu’il pense. Cependant le narrateur, ironique, n’est jamais
complètement absent.
Le regard est donc au centre de la scène, comme dans tout récit de première rencontre amoureuse. Afin de privilégier ce
regard, le narrateur choisit la focalisation interne. Il adopte en effet le point de vue de son personnage juché sur un cheval et
défilant avec son régiment. À cet égard, le début du passage précise nettement la règle du jeu : « Lucien leva les yeux et vit... ».
Nous sommes donc placés dans une position privilégiée puisque nous pouvons voir avec lui jusqu’aux broderies du rideau,
mais nous ne percevons la scène que selon son point de vue. C’est pourquoi la description de Nancy est très négative. Les
adjectifs qualificatifs sont tous marqués par une connotation dépréciative : les maisons sont « mesquine[s] », les couleurs
« voyantes », les murs « écorchés et sales ». Pour qualifier la boue, le narrateur utilise un adjectif presque hyperbolique :
« noire ». Le pavé lui-même est « méchant », à l’image des camarades qui provoquent Lucien en duel ou ne lui laissent qu’une
« rosse » comme monture. Cette personnification met en évidence la paranoïa à laquelle l’a conduit son ennui. L’incise « peutêtre
exprès » est à cet égard très significative. Ce jugement largement dépréciatif englobe ses camarades, à « l’esprit envieux
et jaloux », comme les Nancéens, qui sont des « marauds de provinciaux ». Ce point de vue négatif est en totale opposition
avec l’appréciation qu’il porte sur la jeune femme. Celle-ci est certes à peine décrite, mais les quelques détails qui la
caractérisent sont significatifs. Elle est blonde, contrastant comme on l’a vu précédemment avec la laideur de son
environnement. Ses cheveux sont « magnifiques » – le superlatif est ici éloquent –, et sa figure est « jolie ». Bien qu’elle soit
lacunaire en dépit de la position privilégiée de Lucien, la description de la jeune femme trahit un intérêt soutenu. Ainsi Lucien
cherche-t-il en cette femme des points qui la relieraient plus sûrement à lui-même : un âge proche du sien – « vingt-quatre ou
vingt-cinq ans » – et une attitude devant la société identique à la sienne puisqu’elle a « l’air dédaigneux » et qu’elle pourrait
éprouver sinon « de la haine, au moins « de l’ironie ». Cette jeune femme se démarque totalement de son environnement qui lui
sert de faire-valoir.
Non seulement nous ne voyons que ce que voit le personnage, mais nous suivons au plus près les fluctuations de sa
pensée. En témoignent nettement le fragment de monologue intérieur qui clôt le premier paragraphe – « Quel choix de couleurs
voyantes ont ces marauds de provinciaux ! » – et le passage au discours indirect libre, à la fin du second paragraphe. Le
discours indirect libre se fait sur le mode du questionnement. Ainsi le verbe modalisateur « pouvoir » trahit-il le doute. Il en est
de même de la question qui clôt le paragraphe : elle énumère les différentes hypothèses élaborées par Lucien pour expliquer
l’ « expression singulière » qu’il croit lire dans les yeux de la jeune femme. En effet comme elle ne livre qu’un mouvement de
curiosité retenue et un regard porté sur le régiment, Lucien en est réduit à interpréter son « air » et à déchiffrer son « expression
singulière ». Cet emploi du discours indirect libre contraste avec l’emploi du discours direct sur lequel se termine le premier
paragraphe et qui trahit au contraire une pensée brutale. Le jugement est rendu encore plus abrupt par la forme exclamative de
la phrase et par l’utilisation péjorative du démonstratif. Cette forme de discours était possible au début du récit dans la mesure
où Lucien n’avait pas encore été transformé par l’apparition féminine.
Cependant, bien que masqué par la focalisation interne, le narrateur ne manque pas de se manifester en se désolidarisant
de son personnage par le biais d'un commentaire discret et amusé. Le discours direct est ainsi un moyen de faire assumer
par le seul personnage la brutalité de ses propos. Il est d’ailleurs assorti d’un commentaire du narrateur qui marque bien sa
volonté de prendre ses distances : « Lucien, écrit-il, se complaisait dans cette idée peu polie ». Si tous les effets de
distanciation ne sont pas aussi manifestes, ils n’en sont pas moins présents. Relevons d’abord la malice avec laquelle Stendhal
souligne la métamorphose subite de Lucien Leuwen. Sa mauvaise humeur et ses préventions contre Nancy ou la vie de
régiment s’évaporent miraculeusement. L’emploi de termes absolus et exagérés est clairement destiné à nous faire sourire :
ainsi, nous est-il dit, « toutes les idées tristes de Lucien s’envolèrent... ». Plus caractéristique encore est l’expression
hyperbolique, nettement marquée par l’ironie : « son âme en fut ranimée ». Dans le même ordre d’idées, il faut noter
l’application incontestablement taquine avec laquelle l’auteur énumère, sur plusieurs lignes, les griefs de Lucien et la rapidité
avec laquelle ils sont balayés sans retour par les deux derniers mots : « tout disparut ». On notera ensuite le retour de
l’indication concernant la couleur « vert perroquet ». Alors que la vue de cette couleur vive avait d’abord provoqué les
sarcasmes du jeune homme, fort de son bon goût de Parisien, son rappel prend cependant une autre valeur quand ladite
fenêtre s’entrouvre, et ce n’est pas sans un certain humour que, dans le dernier paragraphe, la mention de la couleur revient
impitoyablement pour nous montrer le Parisien, naguère méprisant, désormais en état de fascination et comme hypnotisé :
« Lucien, les yeux fixés sur la fenêtre vert perroquet, donna un coup d’éperon à son cheval... » Enfin on peut dire que Stendhal
se désolidarise complètement et plaisamment de son héros lorsqu’à la fin du texte, il nous le montre « par terre ». Cette
« chute », dans tous les sens du terme, brise le romanesque pour introduire le ridicule d’un fiasco. Le plaisir du narrateur est
sensible à travers l’énumération appliquée des étapes de la chute. Ces signes d’intelligence adressés au lecteur, par dessus la
tête, si l’on peut dire, du personnage, sont destinés à souligner la plaisante inconséquence d’un coeur bien prompt à
s’enflammer pour ce qu’il venait de mépriser.
Ainsi, Stendhal a choisi dans cette page de traiter de façon particulière la « grande scène » de la rencontre. S’il commence par
utiliser toutes les ressources de l’espace, tant réaliste que symbolique, pour donner à la scène un rythme enlevé qui lui confère
un charme particulier, il délaisse par ailleurs le pouvoir omniscient du romancier classique. Il nous fait apparemment adopter le
point de vue de Lucien dont nous épousons la vision et les pensées et dont nous partageons les ignorances. Mais il raffine :
sacrifiant la complicité avec son héros, il établit discrètement une connivence avec son lecteur, invité à s’amuser des
inquiétudes d’un cavalier mal monté, bloqué par le hasard sous la fenêtre d’une beauté sans indulgence. Pour finir, c’est la
chute, bien inopportune ! À une scène classique et conventionnelle, Stendhal a su conférer une saveur aussi inattendue que
délicate. Le séducteur, bien mal monté, se noie dans le ridicule. Des écrivains modernes ne manqueront pas d’exploiter à leur
tour les ressources de cette intervention du grotesque au coeur de LA rencontre : ainsi en est-il de Romain Gary dans l’incipit de
Liens utiles
- LUCIEN LEUWEN de Stendhal (résumé)
- CHASTELLER Bathilde de Stendhal, Lucien Leuwen
- Lucien Leuwen de Stendhal
- LUCIEN LEUWEN de Stendhal (analyse détaillée)
- LEUWEN Lucien. Personnage du roman posthume homonyme (écrit en 1834-36), de Stendhal