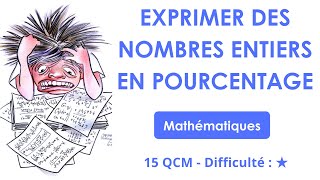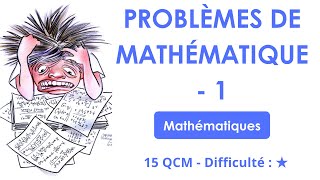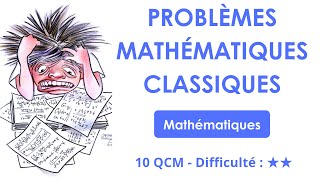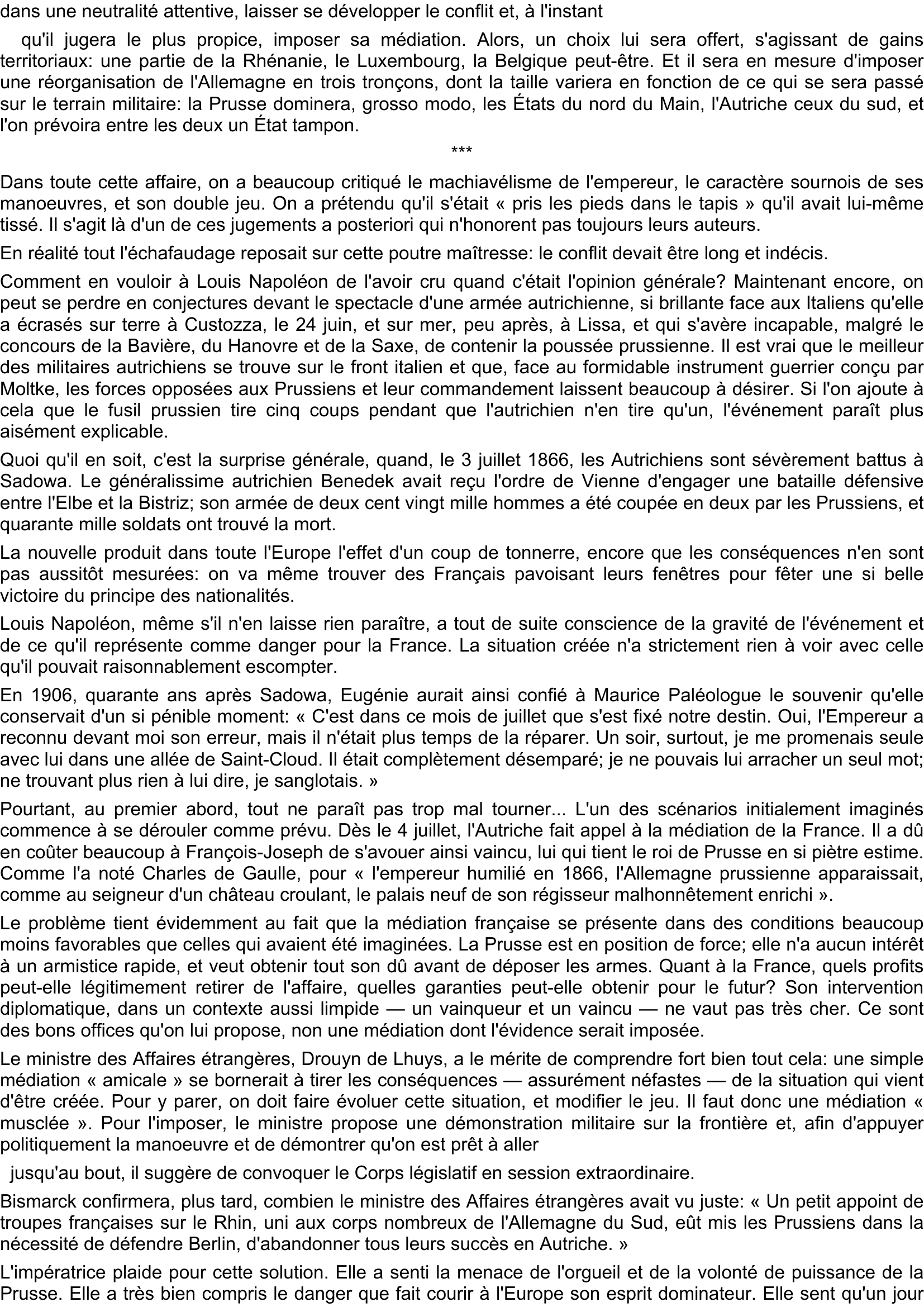On y invite le président du Conseil prussien au vu et au su de tous. Rien à voir avec le secret et les précautions d'il y a sept ans, à Plombières. ismarck n'est certes pas un inconnu en France. Il y a été ambassadeur et a su séduire malgré ses manières parfois un peu brutales. Ce passionné, cet impulsif, sait aussi se contrôler et se montrer le plus charmant et le plus accommodant des compagnons. A Biarritz, entre les deux interlocuteurs, le contraste est criant, et devrait suffire à alerter l'entourage. Bismarck est le cadet de Louis Napoléon. Sept ans les séparent, mais bien d'autres choses encore. Ses gros sourcils en broussaille renforcent le regard dur et audacieux de ses yeux bleus lumineux. C'est un colosse d'un mètre quatre-vingt-huit qui s'applique alors à aligner modestement son pas sur celui d'un homme aux petites jambes et aux longs bras, au visage ravagé, aux joues effondrées, aux yeux vitreux, épuisé par la souffrance et les médications. Car Louis Napoléon va à ce moment fort mal. Il est affaibli par des pertes de sang, il est en pleine anémie. Des crises douloureuses dans le bas-ventre le laissent sans énergie. Rien de tout cela n'échappe à Bismarck. Il note ce manque de vivacité, et le flottement de l'esprit, toutes choses auxquelles l'entourage semble rester aveugle et sourd. Il pressent le parti qu'il pourra en tirer... La confrontation des deux hommes apparaît ainsi comme l'un de ces événements qui transforment en inéluctable destin une histoire encore non écrite. Elle est comme une révélation pour Bismarck, dont la venue se plaçait sous le signe du doute et de l'humilité et qui va repartir plein de certitude et de détermination. Car avant l'entrevue, qui s'est déroulée dans sa majeure partie sur une terrasse au bord du rivage, Bismarck était pour le moins inquiet, persuadé que la pensée de Louis Napoléon comportait de mystérieux desseins qu'il était d'ailleurs venu découvrir... Pour la bonne cause, c'est-à-dire celle de l'Allemagne, il était peut-être prêt à écouter cet homme qui s'exprimait encore avec l'accent allemand. Désormais, à ses yeux, le dialogue a perdu toute importance. D'autant qu'ils se sont dit peu de choses. Louis Napoléon est resté dans le vague. N'ayant pas encore établi sa religion, il n'a pas parlé de compensations, soit qu'il n'ait rien à demander, soit qu'il estime prématuré, sur le moment, de le faire. Visiblement, il ne veut s'engager formellement envers aucun des deux futurs belligérants, cherchant à obtenir de chacun d'eux des garanties en cas de victoire. Il occupe une position de force, et estime ne pas avoir à se découvrir trop tôt. D'ailleurs, la déclaration de guerre n'est pas pour demain, et le conflit promet d'être long et indécis, comme le lui ont assuré ses généraux. Ceux-ci ne pronostiquent-ils pas pour la plupart la victoire de l'Autriche? Dès lors que les choses se passeraient comme chacun semble le penser, tout serait si simple: il empêcherait l'écrasement des Prussiens et obtiendrait en récompense une rectification de frontières sur le Rhin. Alors, pourquoi s'engager à fond tout de suite? Après coup, lorsque les faits auront déjoué toutes les prévisions, y compris les siennes, on voit bien que c'est à ce moment et à ce moment seulement qu'il était en position de force, puisque Bismarck avait besoin d'assurances de sa part et qu'il était prêt à les payer au prix fort. Or, sur le principe des compensations, Louis Napoléon se montre à Biarritz tout à fait évasif. Pour jouer sur les deux tableaux, il a choisi sur ce point la prudence. Il en dit assez, cependant, pour que Bismarck prenne le chemin du retour avec une triple certitude: Louis Napoléon n'a pas conclu d'alliance avec l'Autriche; il est sans doute prêt à favoriser l'alliance de l'Italie avec la Prusse, et celle-ci peut désormais s'engager entièrement contre l'Autriche sans craindre de voir l'armée française se déployer sur le Rhin. Peu après avoir quitté Biarritz, Bismarck écrira : « Avant de le voir, j'avais peur. Depuis, je suis rassuré. Derrière son mystère, il n'y a rien... L'Empereur des Français est une grande incapacité méconnue. « Biarritz s'avérera donc, après coup, un échec diplomatique pour Louis Napoléon. Un échec qui aurait pu être réparé dans les semaines suivantes. Mais pourquoi aurait-on alors changé de stratégie, rien ne semblant de nature à remettre en cause les éléments de l'analyse sur laquelle elle se fondait? Ainsi, lorsque Bismarck, peu avant le déclenchement des hostilités, offre formellement à la France le Luxembourg et les bords de la haute Moselle, Louis Napoléon élude la proposition. Quelle raison aurait-il de l'accepter alors qu'il peut espérer bien davantage? Son action suit son cours logique. Il conseille à Victor-Emmanuel de s'allier aux Prussiens. Parallèlement, il obtient des Autrichiens la promesse de l'abandon de la Vénétie. De ce côté-là, les choses sont claires: quoi qu'il arrive, il aura apporté la Vénétie aux Italiens ; certes, l'alliance italo-prussienne ne vaut que pour trois mois. Même dans cette hypothèse, le résultat est atteint: le retour de l'Italie à la neutralité ne la priverait pas des territoires de Venise. Dès lors, semble-t-il, Louis Napoléon est en droit d'attendre avec sérénité les événements. Il peut se cantonner dans une neutralité attentive, laisser se développer le conflit et, à l'instant qu'il jugera le plus propice, imposer sa médiation. Alors, un choix lui sera offert, s'agissant de gains territoriaux: une partie de la Rhénanie, le Luxembourg, la Belgique peut-être. Et il sera en mesure d'imposer une réorganisation de l'Allemagne en trois tronçons, dont la taille variera en fonction de ce qui se sera passé sur le terrain militaire: la Prusse dominera, grosso modo, les États du nord du Main, l'Autriche ceux du sud, et l'on prévoira entre les deux un État tampon. *** Dans toute cette affaire, on a beaucoup critiqué le machiavélisme de l'empereur, le caractère sournois de ses anoeuvres, et son double jeu. On a prétendu qu'il s'était « pris les pieds dans le tapis « qu'il avait lui-même issé. Il s'agit là d'un de ces jugements a posteriori qui n'honorent pas toujours leurs auteurs. n réalité tout l'échafaudage reposait sur cette poutre maîtresse: le conflit devait être long et indécis. omment en vouloir à Louis Napoléon de l'avoir cru quand c'était l'opinion générale? Maintenant encore, on eut se perdre en conjectures devant le spectacle d'une armée autrichienne, si brillante face aux Italiens qu'elle écrasés sur terre à Custozza, le 24 juin, et sur mer, peu après, à Lissa, et qui s'avère incapable, malgré le oncours de la Bavière, du Hanovre et de la Saxe, de contenir la poussée prussienne. Il est vrai que le meilleur es militaires autrichiens se trouve sur le front italien et que, face au formidable instrument guerrier conçu par oltke, les forces opposées aux Prussiens et leur commandement laissent beaucoup à désirer. Si l'on ajoute à ela que le fusil prussien tire cinq coups pendant que l'autrichien n'en tire qu'un, l'événement paraît plus isément explicable. uoi qu'il en soit, c'est la surprise générale, quand, le 3 juillet 1866, les Autrichiens sont sévèrement battus à adowa. Le généralissime autrichien Benedek avait reçu l'ordre de Vienne d'engager une bataille défensive ntre l'Elbe et la Bistriz; son armée de deux cent vingt mille hommes a été coupée en deux par les Prussiens, et uarante mille soldats ont trouvé la mort. a nouvelle produit dans toute l'Europe l'effet d'un coup de tonnerre, encore que les conséquences n'en sont as aussitôt mesurées: on va même trouver des Français pavoisant leurs fenêtres pour fêter une si belle ictoire du principe des nationalités. ouis Napoléon, même s'il n'en laisse rien paraître, a tout de suite conscience de la gravité de l'événement et e ce qu'il représente comme danger pour la France. La situation créée n'a strictement rien à voir avec celle u'il pouvait raisonnablement escompter. n 1906, quarante ans après Sadowa, Eugénie aurait ainsi confié à Maurice Paléologue le souvenir qu'elle onservait d'un si pénible moment: « C'est dans ce mois de juillet que s'est fixé notre destin. Oui, l'Empereur a econnu devant moi son erreur, mais il n'était plus temps de la réparer. Un soir, surtout, je me promenais seule vec lui dans une allée de Saint-Cloud. Il était complètement désemparé; je ne pouvais lui arracher un seul mot; e trouvant plus rien à lui dire, je sanglotais. « ourtant, au premier abord, tout ne paraît pas trop mal tourner... L'un des scénarios initialement imaginés ommence à se dérouler comme prévu. Dès le 4 juillet, l'Autriche fait appel à la médiation de la France. Il a dû n coûter beaucoup à François-Joseph de s'avouer ainsi vaincu, lui qui tient le roi de Prusse en si piètre estime. omme l'a noté Charles de Gaulle, pour « l'empereur humilié en 1866, l'Allemagne prussienne apparaissait, comme au seigneur d'un château croulant, le palais neuf de son régisseur malhonnêtement enrichi «. e problème tient évidemment au fait que la médiation française se présente dans des conditions beaucoup oins favorables que celles qui avaient été imaginées. La Prusse est en position de force; elle n'a aucun intérêt un armistice rapide, et veut obtenir tout son dû avant de déposer les armes. Quant à la France, quels profits peut-elle légitimement retirer de l'affaire, quelles garanties peut-elle obtenir pour le futur? Son intervention diplomatique, dans un contexte aussi limpide -- un vainqueur et un vaincu -- ne vaut pas très cher. Ce sont des bons offices qu'on lui propose, non une médiation dont l'évidence serait imposée. Le ministre des Affaires étrangères, Drouyn de Lhuys, a le mérite de comprendre fort bien tout cela: une simple médiation « amicale « se bornerait à tirer les conséquences -- assurément néfastes -- de la situation qui vient d'être créée. Pour y parer, on doit faire évoluer cette situation, et modifier le jeu. Il faut donc une médiation « musclée «. Pour l'imposer, le ministre propose une démonstration militaire sur la frontière et, afin d'appuyer politiquement la manoeuvre et de démontrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, il suggère de convoquer le Corps législatif en session extraordinaire. Bismarck confirmera, plus tard, combien le ministre des Affaires étrangères avait vu juste: « Un petit appoint de troupes françaises sur le Rhin, uni aux corps nombreux de l'Allemagne du Sud, eût mis les Prussiens dans la nécessité de défendre Berlin, d'abandonner tous leurs succès en Autriche. « L'impératrice plaide pour cette solution. Elle a senti la menace de l'orgueil et de la volonté de puissance de la Prusse. Elle a très bien compris le danger que fait courir à l'Europe son esprit dominateur. Elle sent qu'un jour ou l'autre celle-ci s'en prendra à la France: Jamais, dira l'ambassadeur d'Autriche, depuis que je connais le couple impérial, je n'ai vu l'Empereur si nexistant, ni l'Impératrice prendre nos intérêts à coeur avec tant d'acharnement et de zèle. « De son côté, Eugénie se lamente: « Ma voix n'a aucun poids et je suis à peu près seule de mon avis. On exagère les dangers d'aujourd'hui pour nous faire oublier ceux de demain. « Effectivement, en Conseil des ministres, Rouher et d'autres que lui plaident contre la solution de Drouyn de Lhuys. Le ministre de l'Intérieur, La Valette, est particulièrement véhément: n'est-ce pas l'empereur lui-même qui a préconisé l'alliance italo-prussienne? Comment dès lors intervenir sans paraître se renier? L'empereur s'est retiré, sans se prononcer. Le tour du débat a pu donner à penser que Drouyn l'avait emporté. Fausse impression. Pendant la nuit, peut-être Louis Napoléon a-t-il fait l'objet d'une ultime pression de la part des adversaires de la démonstration armée? Toujours est-il que, le lendemain, la convocation du Corps législatif ne paraît pas au Moniteur. La France ne bougera pas. Officielle médiatrice, elle ne sera en fait que simple spectatrice. Plus encore que celle de Sadowa, c'est la date du 5 juillet 1866 qui s'inscrit au calendrier comme une journée noire pour la France. Pourquoi Louis Napoléon a-t-il renoncé à intervenir? Traverse-t-il alors une phase de crise physique particulièrement aiguë, qui amoindrit sa capacité de décision? C'est plus que probable: il venait de quitter précipitamment Vichy. On avait dû le sonder et il était rentré à Saint-Cloud pour y prendre le lit, sur l'ordre de ses médecins. L'ambassadeur de Prusse, Goltz, en informa son gouvernement par télégramme chiffré: « J'ai trouvé l'Empereur secoué, presque brisé... Il paraît avoir perdu sa boussole de route. « Autant la maladie n'affecte en rien sa résolution sur le moyen et le long terme, autant dès qu'il y a lieu de prendre des mesures immédiates, le sort paraît suspendu à l'état de son mal. Il maintient ainsi fermement son cap sur le plan de la politique intérieure, mais en politique étrangère, où les réponses doivent être souvent données dans l'instant, son état de santé peut provoquer des dommages. Il est possible, aussi, qu'il n'ait guère cru aux affirmations du maréchal Randon, qui se faisait fort d'amener immédiatement quatre-vingt mille hommes sur le Rhin et deux cent cinquante mille dans les vingt jours, et qu'il les ait considérées comme autant de rodomontades. Ce qui est certain, c'est qu'il a déjà conscience des insuffisances de l'armée française, une conscience angoissée face au nouveau défi auquel, immanquablement, elle va se trouver confrontée. Enfin, n'est pas à exclure une réaction d'orgueil de sa part à l'idée de sembler fléchir devant les tenants de ce parti pro-autrichien qui l'a toujours combattu et qu'il n'est guère tenté de satisfaire. Quoi qu'il en soit, et comme il n'était que trop prévisible, les conditions de la paix vont être dictées par la Prusse. Lors des négociations préliminaires de Nickolsburg, le 26 juillet, que confirmera la paix signée à Prague un mois plus tard, il est décidé de procéder à la dissolution de la Confédération germanique, ce qui revient à exclure complètement l'Autriche des affaires allemandes. Une Confédération de l'Allemagne du Nord est immédiatement constituée, dotée d'une armée et d'un budget communs, dont le roi de Prusse devient le président héréditaire. Enfin, la France reçoit de l'Autriche la Vénétie qu'elle rétrocède à l'Italie. Louis Napoléon a donc obtenu du moins satisfaction sur un premier point. Les apparences sont encore sauves. Il est vrai qu'il est allé de lui-même au-delà des demandes initiales de Bismarck qui, pour relier entre elles les provinces prussiennes, souhaitait s'approprier les seuls territoires intermédiaires représentant quelque trois cent mille habitants. Or, Bismarck s'en voit offrir dix fois plus, avec l'annexion du Hanovre, du HesseCassel, du Nassau et de Francfort. Sans doute l'empereur espère-t-il que la bonne volonté dont il a fait preuve lui permettra de trouver pour la France quelques-unes des « compensations « sur lesquelles il croit se souvenir d'avoir obtenu, à Biarritz, un accord de principe. Ce sera pire que peine perdue. Non seulement Bismarck ne donnera rien mais, ne reculant devant aucune déloyauté, aucun coup bas, il va se servir de l'affaire pour placer la France en posture d'accusée sur la scène internationale et contribuer à son isolement. Il parviendra aussi à persuader l'opinion française que l'empereur et avec lui son pays ont subi une grave offense tout en sombrant dans le ridicule. Un première demande fut promptement introduite par Drouyn de Lhuys: elle portait sur certains territoires de la rive gauche du Rhin -- donc des territoires allemands -- et sur le Luxembourg dont on voulait, dans un premier temps, obtenir pour le moins la démilitarisation. Bismarck refusa. Mieux, il fit publier son refus dans un journal français, le Siècle -- divulgation qui avait