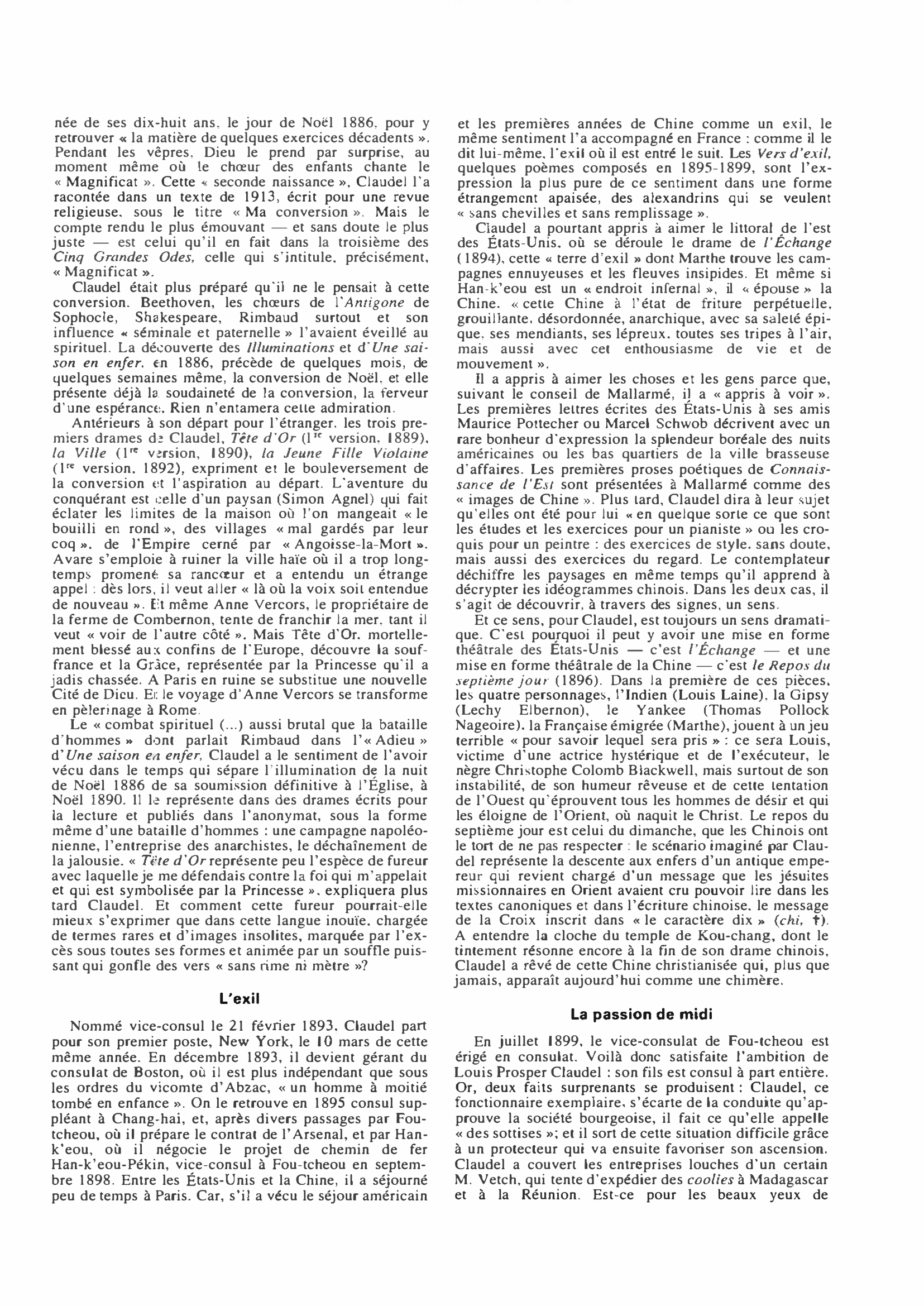CLAUDEL Paul : sa vie et son oeuvre
Publié le 20/11/2018
Extrait du document

CLAUDEL Paul (1868-1955). Claudel s’est lui-même défini comme un poète catholique. Ou, plus exactement, comme un écrivain « qui envisage tout avec un cœur catholique » (« l’Esprit et l’Eau »). Ce catholicisme-là n’est pas celui, plus confiné, des « chères églises rococo » de Rome ou de Prague, ni de l’église où, dans la Troisième Journée du Soulier de satin, se sont donné rendez-vous saint Nicolas, saint Boniface, saint Denys d’Athènes et le fantaisiste saint Adlibitum. « Catholique » retrouve chez Claudel son sens étymologique d’« universel ». « Ma fonction était surtout de voir l’univers », dira-t-il, au soir de sa vie, dans ses entretiens radiophoniques avec Jean Amrouche publiés sous le titre de Mémoires improvisés.
Cette fonction universelle est celle du poète. Mais elle est, parallèlement, celle du diplomate. Une vocation authentique a poussé Claudel à choisir de faire carrière à l’étranger, d’embrasser la Carrière. Il n’aurait pas écrit le Repos du septième jour ou Connaissance de l’Est s’il n’avait été en poste en Chine au même moment, et les Conversations dans le Loir-et-Cher sont toutes pleines de l’expérience nouvelle qu’il fait aux Etats-Unis depuis qu’il est ambassadeur de France à Washington. En 1917, le souci des échanges commerciaux entre la France et le Brésil, où il est alors ministre plénipotentiaire, s'unit à ses chères études bibliques quand il écrit, dans la Messe là-bas : « Je suis là, et pendant que, la plume à la main je transforme ces sacs de café en milreis et que je dépouille la Bible... »
Dans l’emploi du temps de sa journée, les deux activités semblent pourtant dissociées. On n’aurait pas vu l’ambassadeur s’éclipser d’une réunion ou d’une réception pour aller noter sa dernière trouvaille poétique. Il consacrait à son travail d’écrivain les seules premières heures du jour, jusqu’au moment où la retraite — retraite d’ailleurs fort active — lui a laissé le temps d’échafauder l’édifice monumental de ses commentaires bibliques.
Mais, avant cette date, il avait déjà produit une œuvre considérable et diverse.
Les années d'apprentissage
Paul Claudel, né le 6 août 1868 dans le petit village de Villeneuve-sur-Fère (Aisne), est le fils de Louis Prosper Claudel, un fonctionnaire de l’enregistrement. « Ce que l’odeur de la saumure et du goudron sont pour un fils de marin, celle de la paperasse l’a été pour [lui], et cette occulte fermentation qui se dégage des écritures superposées. » Louis Prosper ne pouvait donc que le voir d’un bon œil désireux d’entrer dans la fonction publique, une fois ses études secondaires achevées. Républicain, craignant toujours de se compromettre, il a des appuis dans le clan Ferry et n’hésite pas à en user pour favoriser la carrière de son fils.
Un jeune homme de beaucoup de mérite, ce fils. « Je ne dois rien ni à la fortune ni à la situation que j’ai trouvée en me donnant la peine de naître, écrira-t-il, j’ai acquis tous mes grades soit par les concours, soit par des séjours prolongés dans les pays éloignés et difficiles. » Diplômé de l’Ecole libre des sciences politiques en 1888, il renonce à préparer le Conseil d’État, envisage un instant les Langues orientales, et c’est le directeur de cette école qui lui conseille de préparer le « grand concours » pour l’admission dans les carrières diplomatiques et consulaires. Il y est reçu premier et, pensant être plus indépendant, il choisit la carrière consulaire. Dans un document qui a été conservé, Jules Ferry se porte garant « de l’honorabilité et des idées républicaines de M. Claudel ».
Pendant ces mêmes années, Claudel avait pourtant suivi un itinéraire intérieur bien différent. Élevé dans une famille où l’on était volontiers agnostique, instruit par des maîtres qui ne juraient que par « le tétrasyllabe Taine-et-Renan », il se rend à Notre-Dame de Paris, l’année de ses dix-huit ans, le jour de Noël 1886, pour y retrouver « la matière de quelques exercices décadents ». Pendant les vêpres, Dieu le prend par surprise, au moment même où le chœur des enfants chante le « Magnificat ». Cette « seconde naissance », Claudel l’a racontée dans un texte de 1913, écrit pour une revue religieuse, sous le titre « Ma conversion ». Mais le compte rendu le plus émouvant — et sans doute le plus juste — est celui qu’il en fait dans la troisième des Cinq Grandes Odes, celle qui s’intitule, précisément, « Magnificat ».
Claudel était plus préparé qu'il ne le pensait à cette conversion. Beethoven, les chœurs de V Antigone de Sophocle, Shakespeare, Rimbaud surtout et son influence « séminale et paternelle » l’avaient éveillé au spirituel. La découverte des Illuminations et d'Une saison en enfer, en 1886, précède de quelques mois, de quelques semaines même, la conversion de Noël, et elle présente déjà la soudaineté de la conversion, la ferveur d'une espérance. Rien n’entamera cette admiration.
Antérieurs à son départ pour l’étranger, les trois premiers drames de Claudel, Tête d'Or (lrc version, 1889), la Ville (lre version, 1890), la Jeune Fille Violaine (lre version. 1892), expriment et le bouleversement de la conversion et l’aspiration au départ. L'aventure du conquérant est celle d’un paysan (Simon Agnel) qui fait éclater les limites de la maison où l’on mangeait « le bouilli en rond », des villages « mal gardés par leur coq », de l’Empire cerné par « Angoisse-la-Mort ». Avare s’emploie à ruiner la ville haïe où il a trop longtemps promené sa rancœur et a entendu un étrange appel : dès lors, il veut aller « là où la voix soit entendue de nouveau ». Et même Anne Vercors, le propriétaire de la ferme de Combernon, tente de franchir la mer, tant il veut « voir de l’autre côté ». Mais Tête d’Or. mortellement blessé aux confins de l'Europe, découvre la souffrance et la Grâce, représentée par la Princesse qu'il a jadis chassée. A Paris en ruine se substitue une nouvelle Cité de Dieu. Et le voyage d’Anne Vercors se transforme en pèlerinage à Rome.
Le « combat spirituel (...) aussi brutal que la bataille d’hommes » dont parlait Rimbaud dans l’« Adieu » d'Une saison en enfer, Claudel a le sentiment de l’avoir vécu dans le temps qui sépare l’illumination de la nuit de Noël 1886 de sa soumission définitive à l’Église, à Noël 1890. Il le représente dans des drames écrits pour la lecture et publiés dans l’anonymat, sous la forme même d’une bataille d’hommes : une campagne napoléonienne, l’entreprise des anarchistes, le déchaînement de la jalousie. « Tête d’Or représente peu l’espèce de fureur avec laquelle je me défendais contre la foi qui m’appelait et qui est symbolisée par la Princesse », expliquera plus tard Claudel. Et comment cette fureur pourrait-elle mieux s’exprimer que dans cette langue inouïe, chargée de termes rares et d’images insolites, marquée par l’excès sous toutes ses formes et animée par un souffle puissant qui gonfle des vers « sans rime ni mètre »?
L'exil
Nommé vice-consul le 21 février 1893, Claudel part pour son premier poste, New York, le 10 mars de cette même année. En décembre 1893, il devient gérant du consulat de Boston, où il est plus indépendant que sous les ordres du vicomte d’Abzac, « un homme à moitié tombé en enfance ». On le retrouve en 1895 consul suppléant à Chang-hai, et, après divers passages par Fou-tcheou, où il prépare le contrat de l’Arsenal, et par Han-k'eou, où il négocie le projet de chemin de fer Han-k’eou-Pékin, vice-consul à Fou-tcheou en septembre 1898. Entre les États-Unis et la Chine, il a séjourné peu de temps à Paris. Car, s’il a vécu le séjour américain et les premières années de Chine comme un exil, le même sentiment l’a accompagné en France : comme il le dit lui-même, l'exil où il est entré le suit. Les Vers d'exil, quelques poèmes composés en 1895-1899, sont l’expression la plus pure de ce sentiment dans une forme étrangement apaisée, des alexandrins qui se veulent « sans chevilles et sans remplissage ».
Claudel a pourtant appris à aimer le littoral de l’est des États-Unis, où se déroule le drame de l'Échange ( 1894), cette « terre d'exil » dont Marthe trouve les campagnes ennuyeuses et les fleuves insipides. Et même si Han-k'eou est un « endroit infernal », il « épouse » la Chine, « cette Chine à l’état de friture perpétuelle, grouillante, désordonnée, anarchique, avec sa saleté épique, ses mendiants, ses lépreux, toutes ses tripes à l’air, mais aussi avec cet enthousiasme de vie et de mouvement ».
Il a appris à aimer les choses et les gens parce que, suivant le conseil de Mallarmé, il a « appris à voir ». Les premières lettres écrites des États-Unis à ses amis Maurice Pottecher ou Marcel Schwob décrivent avec un rare bonheur d'expression la splendeur boréale des nuits américaines ou les bas quartiers de la ville brasseuse d’affaires. Les premières proses poétiques de Connaissance de l'Est sont présentées à Mallarmé comme des « images de Chine ». Plus tard, Claudel dira à leur sujet qu’elles ont été pour lui « en quelque sorte ce que sont les études et les exercices pour un pianiste » ou les croquis pour un peintre : des exercices de style, sans doute, mais aussi des exercices du regard. Le contemplateur déchiffre les paysages en même temps qu’il apprend à décrypter les idéogrammes chinois. Dans les deux cas, il s’agit de découvrir, à travers des signes, un sens.
Et ce sens, pour Claudel, est toujours un sens dramatique. C'est pourquoi il peut y avoir une mise en forme théâtrale des États-Unis — c’est l'Échange — et une mise en forme théâtrale de la Chine — c’est le Repos du septième jour (1896). Dans la première de ces pièces, les quatre personnages, l’Indien (Louis Laine), la Gipsy (Lechy Elbernon), le Yankee (Thomas Pollock Nageoire), la Française émigrée (Marthe), jouent à un jeu terrible « pour savoir lequel sera pris » : ce sera Louis, victime d’une actrice hystérique et de l’exécuteur, le nègre Christophe Colomb Blackwell, mais surtout de son instabilité, de son humeur rêveuse et de cette tentation de l’Ouest qu'éprouvent tous les hommes de désir et qui les éloigne de l'Orient, où naquit le Christ. Le repos du septième jour est celui du dimanche, que les Chinois ont le tort de ne pas respecter : le scénario imaginé par Claudel représente la descente aux enfers d’un antique empereur qui revient chargé d'un message que les jésuites missionnaires en Orient avaient cru pouvoir lire dans les textes canoniques et dans l’écriture chinoise, le message de la Croix inscrit dans « le caractère dix » (chi, t). A entendre la cloche du temple de Kou-chang, dont le tintement résonne encore à la fin de son drame chinois, Claudel a rêvé de cette Chine christianisée qui, plus que jamais, apparaît aujourd'hui comme une chimère.
La passion de midi
En juillet 1899, le vice-consulat de Fou-tcheou est érigé en consulat. Voilà donc satisfaite l’ambition de Louis Prosper Claudel : son fils est consul à part entière. Or, deux faits surprenants se produisent : Claudel, ce fonctionnaire exemplaire, s’écarte de la conduite qu’approuve la société bourgeoise, il fait ce qu’elle appelle « des sottises »; et il sort de cette situation difficile grâce à un protecteur qui va ensuite favoriser son ascension. Claudel a couvert les entreprises louches d’un certain M. Vetch, qui tente d’expédier des coolies à Madagascar et à la Réunion. Est-ce pour les beaux yeux de Mme Vetch? Toujours est-il qu’en 1900, au retour d’un voyage en France où il a pu faire l’épreuve — négative — de sa vocation monastique, il retrouve Mme Vetch sur le bateau. C’est le point de départ d’une liaison scandaleuse et orageuse qui dure jusqu’en août 1904 : pendant que Vetch court la Chine, sa femme s’installe sous le toit de Claudel avec ses quatre garçons. Pour rester près d’elle, Claudel refuse en janvier 1902 le consulat de Hongkong où l’a nommé le ministère. A la suite d’une lettre de dénonciation, on envoie deux inspecteurs à Fou-tcheou pour enquêter sur la vie privée du consul. C’est alors qu’intervient Philippe Berthelot, attaché à la Direction des consulats et chargé d’une mission en Extrême-Orient. Pendant que Mme Vetch, attendant un enfant, quitte Fou-tcheou précipitamment, et que Claudel, pour la rejoindre, réussit enfin à obtenir un congé (février 1905), poursuit une ombre et se retrouve seul à Paris, Berthelot est devenu chef adjoint du cabinet du président du Conseil, qui est en même temps ministre des Affaires étrangères : son ami et protégé obtient la croix de la Légion d’honneur et le grade de consul de première classe.
Cette passion qui l’a frappé au milieu du chemin de la vie, Claudel l’a confiée, toute brûlante encore, à quelques-uns de ses plus beaux textes : l’invocation à Erato à la fin de la première des Cinq Grandes Odes, l’apparition de la muse de la poésie lyrique confondue avec « (s)on amie sur le navire », le dialogue des eaux désirantes et des larmes amères dans la deuxième ode, « l’Esprit et l'Eau », la fin de « Connaissance du temps » dans l'Art poétique.
Partage de midi (1905) est la mise en forme théâtrale du drame de ses années méridiennes. Publiée en 1906 dans une édition limitée à 150 exemplaires et uniquement destinée à des proches et à des amis, cette œuvre majeure restera longtemps confidentielle, par la volonté même de son auteur.
Partage de midi est un quatuor, comme l’Échange : Ysé est entourée, sur le bateau qui fend les eaux de l’océan Indien, par trois hommes : son mari, de Ciz, un homme d’affaires qu’elle a connu autrefois, Amalric, et un jeune homme solitaire, Mésa, qui va découvrir, grâce à elle, qu’un corps peut prendre un corps, qu’une âme peut prendre une âme, « comme la chaux astreint le sable en brûlant et en sifflant ». C’est une œuvre autobiographique, mais où l’autobiographie est souvent déguisée et finalement éclatée. La rencontre d’une femme mariée et mère de famille, la réponse passionnée qu’elle donne à l’appel de Mésa, au moment où Dieu lui a répondu non, leur liaison tumultueuse dans une ville chinoise, leur séparation, interprétée de part et d’autre en termes de trahison, la naissance d’un enfant bâtard : ces épisodes sont communs aux protagonistes du drame. Mais le dénouement est purement fantasmatique : Ysé rejoint Mésa dans la maison d’Amalric entourée par les indigènes en révolte et minée; elle accepte d’entrer avec lui dans la mort, pour l’y retrouver, mais, après avoir conduit leurs âmes en travail par des routes divergentes, l’enfant est mort.
S’agit-il, comme on l’a parfois prétendu, d’un dénouement tristanesque plaqué sur l’aventure vécue? Claudel reste-t-il sous le charme du philtre wagnérien, dont il dénoncera plus tard les méfaits? Sans doute peut-on souligner l’analogie des noms (Ysé/Isolde), la présence de motifs communs (la petite lampe) ou de leitmotive (« Mésa, je suis Ysé, c’est moi »). Mais tout parallèle suivi se révèle trompeur : car Ysé et Mésa n’entrent pas dans la mort comme dans le dernier refuge, fût-il le néant schopenhauérien, où sont possibles les délices à deux. Le thème du drame n’est ni le nocturne romantique ni le débat entre l’adultère et le devoir, entre la Loi et la Grâce, entre la chair et l’esprit, mais une nouvelle naissance que les deux amants se sont donnée l’un à l’autre et que Dieu aussi leur donnera par la « transfiguration de midi ».
Vers un classicisme claudélien
Le drame une fois passé, il faut trouver l’apaisement, et peut-être le créer. Claudel se marie, en 1906, avec la fille de l'architecte de Fourvière, Reine Sainte-Marie Perrin. Sur le conseil de son confesseur, il commence à tenir son Journal. Plus que jamais, sa carrière le requiert. Il est nommé premier secrétaire par intérim à Pékin, consul à T’ien-tsin (1906-1909), puis, toujours défendu par Berthelot, il rentre en Europe, comme consul à Prague ( 1909-1911), puis à Francfort-sur-le-Main (1911 -1913) et consul général à Hambourg (1913-1914). Un article publié dans le Temps du 14 juillet 1914 parle ironiquement de lui comme du « premier Consul ». La guerre l’oblige à quitter l’Allemagne. Il sera chargé d’une mission économique en Italie, à défaut du poste qu’il souhaitait obtenir à Rome.
Il achève l’édifice monumental des Cinq Grandes Odes en 1908. La Cantate à trois voix (1913), dialogue entre trois femmes qui aiment un fiancé, un époux mort ou un époux absent, indique par son titre même un retour au classicisme. Un autre signe est l’abandon du grand vers libre (parfois appelé, improprement, « verset claudélien ») au profit d’un vers plus court et assonancé dans Corona benignitatis Anni Dei (1908-1914). L’« Hymne de la Pentecôte », par exemple, est composé en strophes de trois vers, les rimes des troisièmes vers se répondant d’une strophe à l’autre.
Dans la deuxième décennie du siècle, le drame claudélien évolue, lui aussi, vers un certain classicisme. Il tend à sacrifier le lyrisme exubérant et à s’imposer des contraintes plus étroites. Celles, tout d’abord, du drame historique : l'Annonce faite à Marie (1911) transpose au Moyen Age l’action de la Jeune Fille Violaine : dans le lointain passent « le Roi qui va-t-à-Rheims » et une petite pastourelle qui le conduit. Symétrique moderne de l’antique trilogie d’Eschyle, que Claudel a traduite, la moderne trilogie des Coûfontaine couvre un siècle d’histoire : la Révolution et l’Empire dans T Otage (1910), « la France de Louis-Philippe livrée aux appétits antagonistes de loups-cerviers », avec l’évocation de la conquête de l’Algérie dans le Pain dur (1914), et celle de Rome de 1869 à 1871, au moment où se fait l’unité italienne, dans le Père humilié (1916).
Dans ces drames de la maturité, le thème du sacrifice occupe une place centrale. Exemplaire est l’attitude de Violaine dans l'Annonce faite à Marie. Elle renonce à son fiancé, Jacques Hury, et l’abandonne, malgré son amour, à sa sœur, la jalouse Mara, parce qu’elle a contracté la lèpre en acceptant le baiser du lépreux Pierre de Craon. Ce sacrifice lui confère une force surnaturelle, celle qui lui permettra de ressusciter l’enfant de Mara. Le sacrifice de Sygne de Coûfontaine, dans l’Otage, peut paraître moins lumineux. Il s’agit en effet d’un sacrifice forcé. L’abbé Badilon, « l’imbécile, le gros homme chargé de matière et de péchés », oblige la jeune fille à renoncer à son amour pour son cousin Georges de Coûfontaine, le royaliste, et à épouser un hideux roturier, Toussaint de Turelure, bourreau de sa famille et préfet de l’Empire. Ce sacrifice est nécessaire pour arracher le pape, retenu en France, à ses ravisseurs. Il faudra aller jusqu’au bout de la trilogie, dans le Père humilié, pour que le sacrifice de Sygne trouve sa contrepartie et comme sa récompense quand le fils adoptif du pape nouveau, Orian de Homodarmes, arrache aux ténèbres l’âme de l’aveugle Pensée de Coûfontaine, la descendante de Sygne et de Turelure.

«
née
de ses dix-huit ans, le jour de Noël 1886, pour y
retrouver « la matière de quelques exercices décadents ».
Pendant les vêpres, Dieu le prend par surprise, au
moment même où le chœur des enfants chante le
>.
Et même Anne Vercors, le propriétaire de
la ferme de Combernon, tente de franchir la mer, tant il
veut «voir de l'autre côté>>.
Mais Tête d'Or.
mortelle
ment blessé au:< confins de l'Europe, découvre la souf
france et la Grâce, représentée par la Princesse qu'il a
jadis chassée.
A Paris en ruine se substitue une nouvelle
Cité de Dieu.
Er.
le voyage d'Anne Vercors se transforme
en pèlerinage à Rome.
Le « combat spirituel ( ...
) aussi brutal que la bataille
d'hommes>> dont parlait Rimbaud dans l'« Adieu>>
d'Une saison e11 enfer, Claudel a le sentiment de l'avoir
vécu dans le temps qui sépare l'illumination dç la nuit
de Noël 1886 de sa soumission définitive à l'Eglise, à
Noël 1890.
11 le représente dans des drames écrits pour
la lecture et publiés dans l'anonymat, sous la forme
même d'une bataille d'hommes : une campagne napoléo
nienne, l'entreprise des anarchistes, le déchaînement de
la ja1ousie.
.
On le retrouve en 1895 consul sup
pléant à Chang-haî, et, après divers passages par Fou
tcheou, où il prépare le contrat de l'Arsenal, et par Han
k'eou, où il négocie le projet de chemin de fer
Han-k'eou-Pékin, vice-consul à Fou-tcheou en septem
bre 1898.
Entre les États-Unis et la Chine, il a séjourné
peu de temps à Paris.
Car, s'il a vécu le séjour américain et
les premières années de Chine comme un exil, le
même sentiment l'a accompagné en France : comme ille
dit lui-même, l'exil où il est entré le suit.
Les Vers d'exil,
quelques poèmes composés en 1895-1899, sont l'ex
pression la plus pure de ce sentiment dans une forme
étrangement apaisée, des alexandrins qui se veulent.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BONNETAIN Paul : sa vie et son oeuvre
- TÊTE D'OR de Paul Claudel (résumé et analyse de l'oeuvre)
- ANNONCE FAITE À MARIE (L') Paul CLAUDEL. Mystère en quatre actes et un prologue (exposé de l’oeuvre)
- PARTAGE DE MIDI de Paul Claudel (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- POÈTE REGARDE LA CROIX (Un).Paul Claudel (résumé et analyse de l’oeuvre)