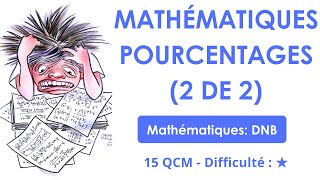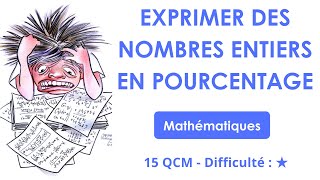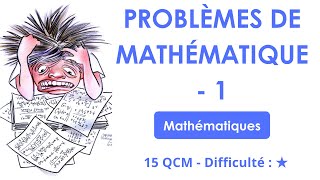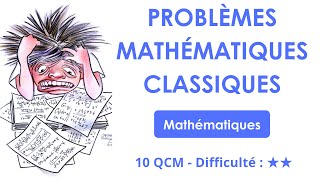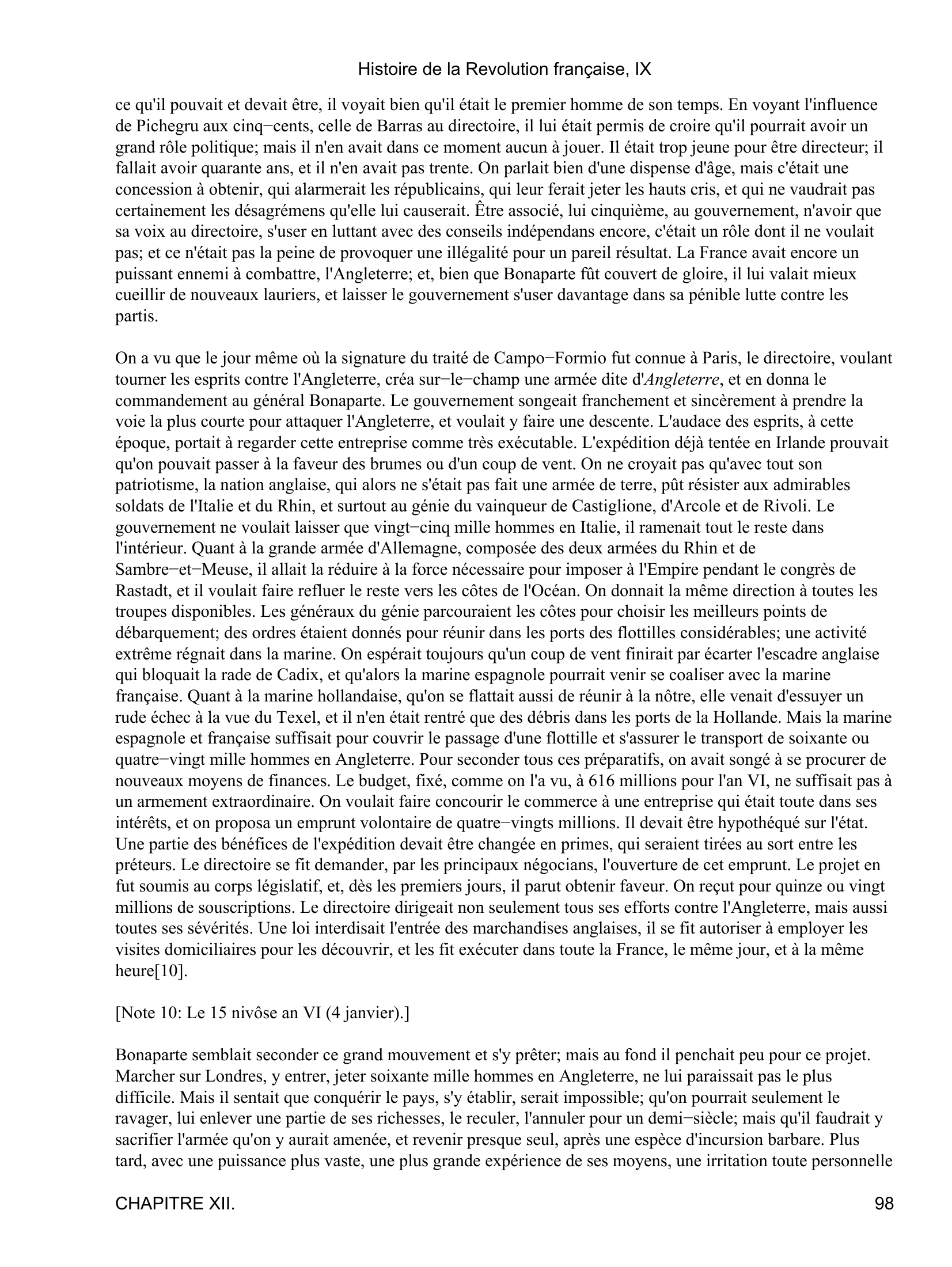Histoire de la Revolution française, IX directoire feignant la franchise, lui montrait ces rapports, et affectait de les traiter avec mépris, comme s'il avait cru le général incapable d'ambition.
Publié le 11/04/2014
Extrait du document


«
ce qu'il pouvait et devait être, il voyait bien qu'il était le premier homme de son temps.
En voyant l'influence
de Pichegru aux cinq-cents, celle de Barras au directoire, il lui était permis de croire qu'il pourrait avoir un
grand rôle politique; mais il n'en avait dans ce moment aucun à jouer.
Il était trop jeune pour être directeur; il
fallait avoir quarante ans, et il n'en avait pas trente.
On parlait bien d'une dispense d'âge, mais c'était une
concession à obtenir, qui alarmerait les républicains, qui leur ferait jeter les hauts cris, et qui ne vaudrait pas
certainement les désagrémens qu'elle lui causerait.
Être associé, lui cinquième, au gouvernement, n'avoir que
sa voix au directoire, s'user en luttant avec des conseils indépendans encore, c'était un rôle dont il ne voulait
pas; et ce n'était pas la peine de provoquer une illégalité pour un pareil résultat.
La France avait encore un
puissant ennemi à combattre, l'Angleterre; et, bien que Bonaparte fût couvert de gloire, il lui valait mieux
cueillir de nouveaux lauriers, et laisser le gouvernement s'user davantage dans sa pénible lutte contre les
partis.
On a vu que le jour même où la signature du traité de Campo-Formio fut connue à Paris, le directoire, voulant
tourner les esprits contre l'Angleterre, créa sur-le-champ une armée dite d'Angleterre, et en donna le
commandement au général Bonaparte.
Le gouvernement songeait franchement et sincèrement à prendre la
voie la plus courte pour attaquer l'Angleterre, et voulait y faire une descente.
L'audace des esprits, à cette
époque, portait à regarder cette entreprise comme très exécutable.
L'expédition déjà tentée en Irlande prouvait
qu'on pouvait passer à la faveur des brumes ou d'un coup de vent.
On ne croyait pas qu'avec tout son
patriotisme, la nation anglaise, qui alors ne s'était pas fait une armée de terre, pût résister aux admirables
soldats de l'Italie et du Rhin, et surtout au génie du vainqueur de Castiglione, d'Arcole et de Rivoli.
Le
gouvernement ne voulait laisser que vingt-cinq mille hommes en Italie, il ramenait tout le reste dans
l'intérieur.
Quant à la grande armée d'Allemagne, composée des deux armées du Rhin et de
Sambre-et-Meuse, il allait la réduire à la force nécessaire pour imposer à l'Empire pendant le congrès de
Rastadt, et il voulait faire refluer le reste vers les côtes de l'Océan.
On donnait la même direction à toutes les
troupes disponibles.
Les généraux du génie parcouraient les côtes pour choisir les meilleurs points de
débarquement; des ordres étaient donnés pour réunir dans les ports des flottilles considérables; une activité
extrême régnait dans la marine.
On espérait toujours qu'un coup de vent finirait par écarter l'escadre anglaise
qui bloquait la rade de Cadix, et qu'alors la marine espagnole pourrait venir se coaliser avec la marine
française.
Quant à la marine hollandaise, qu'on se flattait aussi de réunir à la nôtre, elle venait d'essuyer un
rude échec à la vue du Texel, et il n'en était rentré que des débris dans les ports de la Hollande.
Mais la marine
espagnole et française suffisait pour couvrir le passage d'une flottille et s'assurer le transport de soixante ou
quatre-vingt mille hommes en Angleterre.
Pour seconder tous ces préparatifs, on avait songé à se procurer de
nouveaux moyens de finances.
Le budget, fixé, comme on l'a vu, à 616 millions pour l'an VI, ne suffisait pas à
un armement extraordinaire.
On voulait faire concourir le commerce à une entreprise qui était toute dans ses
intérêts, et on proposa un emprunt volontaire de quatre-vingts millions.
Il devait être hypothéqué sur l'état.
Une partie des bénéfices de l'expédition devait être changée en primes, qui seraient tirées au sort entre les
préteurs.
Le directoire se fit demander, par les principaux négocians, l'ouverture de cet emprunt.
Le projet en
fut soumis au corps législatif, et, dès les premiers jours, il parut obtenir faveur.
On reçut pour quinze ou vingt
millions de souscriptions.
Le directoire dirigeait non seulement tous ses efforts contre l'Angleterre, mais aussi
toutes ses sévérités.
Une loi interdisait l'entrée des marchandises anglaises, il se fit autoriser à employer les
visites domiciliaires pour les découvrir, et les fit exécuter dans toute la France, le même jour, et à la même
heure[10].
[Note 10: Le 15 nivôse an VI (4 janvier).]
Bonaparte semblait seconder ce grand mouvement et s'y prêter; mais au fond il penchait peu pour ce projet.
Marcher sur Londres, y entrer, jeter soixante mille hommes en Angleterre, ne lui paraissait pas le plus
difficile.
Mais il sentait que conquérir le pays, s'y établir, serait impossible; qu'on pourrait seulement le
ravager, lui enlever une partie de ses richesses, le reculer, l'annuler pour un demi-siècle; mais qu'il faudrait y
sacrifier l'armée qu'on y aurait amenée, et revenir presque seul, après une espèce d'incursion barbare.
Plus
tard, avec une puissance plus vaste, une plus grande expérience de ses moyens, une irritation toute personnelle Histoire de la Revolution française, IX
CHAPITRE XII.
98.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire de la Revolution française, IX Le directoire, mécontent de Moreau, avait résolu de le rappeler, mais il reçut de lui une lettre qui fit la plus grande sensation.
- Histoire de la Revolution française, IX gravité qu'on lui supposait.
- Histoire de la Revolution française, IX Lafond-Ladebat, à cause, non de leur culpabilité, car ils étaient sincèrement attachés à la république, mais de leur influence dans le conseil des anciens; enfin Brottier et Laville-Heurnois, à cause de leur conspiration.
- BUSSY, Roger de Rabutin, comte de, connu sous le nom de Bussy-Rabutin (1618-1693) Général et écrivain de l'Académie française, cousin de Mme de Sévigné, il est l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules.
- La place du général de Gaulle dans la politique française de 1940 à 1969. Histoire