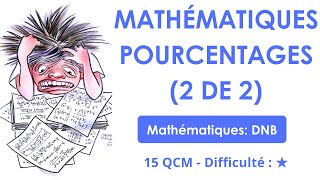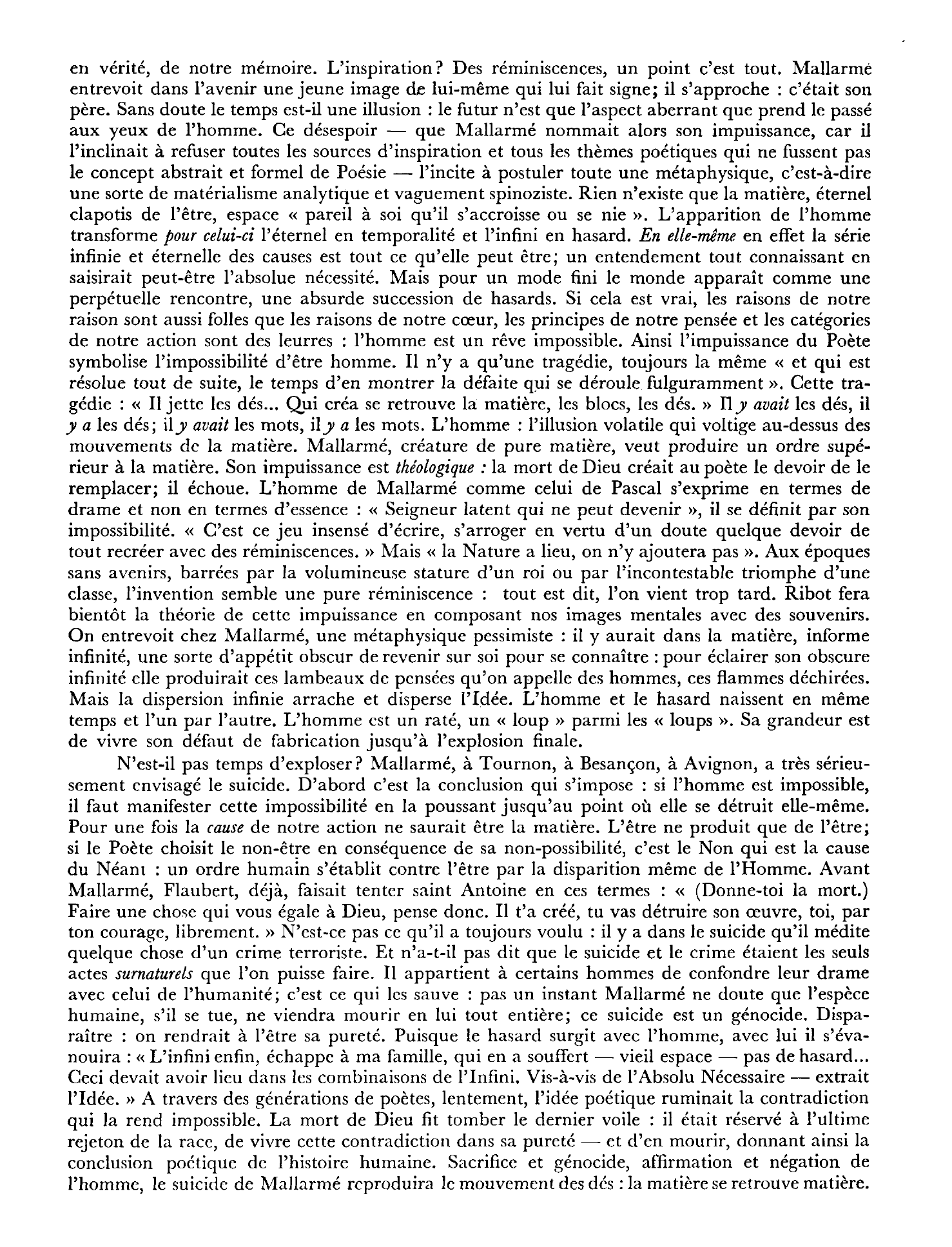MALLARMÉ (Étienne, dit Stéphane)
Publié le 24/01/2019
Extrait du document
MALLARMÉ (Étienne, dit Stéphane), écrivain français (Paris 1842 - Valvins 1898). C'est sur le fond terne d'une existence sans éclat que se détache l'œuvre de Mallarmé, unique, étincelante, et qui marque une révolution dans les lettres. Cette vie fut vouée à la passion de la poésie, et la célèbre lettre autobiographique à Verlaine (1885) évoque l'aventure spirituelle d'un homme prêt à se consumer, à « sacrifier toute vanité et toute satisfaction » à son dessein artistique, « comme on brûlait jadis son mobilier et les parties de son toit, pour alimenter le fourneau du Grand Œuvre ». Mallarmé n'aurait-il pas vécu ? Il fut toujours discret, voire secret sur sa vie et l'on peut seulement signaler la perte de sa mère quand il a sept ans et celle de sa sœur alors qu'il est adolescent. On trouvera dans ses premiers vers de 1859 (« Sa fosse est creusée, sa fosse est fermée » ) la marque de cette dernière absence, d'autant plus cruelle que Maria fut sa confidente ; on la repérera dans les textes plus tardifs, et il est probable que la figure de la morte aimée fournit à l’œuvre (comme l'ont montré L. Cellier et Ch. Mauron) un de ses thèmes majeurs. Le jeune bachelier doit travailler et devient surnuméraire chez un receveur ; il cultive des amitiés littéraires comme celle de Mendès et courtise une demoiselle de compagnie allemande, Maria Gerhard, avec laquelle il part pour Londres avant de l'épouser. Devenu chargé de cours à Tournon, il commence une laborieuse carrière de professeur martyr, en butte aux soucis administratifs et aux ennuis d'argent. Le soutiennent des amitiés comme celles d'Emmanuel des Essarts, d'Henri Caza-lis ou d'Eugène Lefébure, ses principaux correspondants, ou des sympathies comme celle de Coppée, de Glatigny (qui lui ouvre les colonnes de la Semaine de Vichy en 1864, lui permettant de publier ses premiers poèmes en prose), de Mistral, ou de Villiers de l'Isle-Adam, un des rares contemporains qui l'aient compris. Il est déjà bien loin des influences des poètes qui l'enchantèrent adolescent : Gautier, dont l'esthétique lui semble rapidement insuffisante et dangereuse, dans la mesure où elle ouvre la voie à « un certain amour du beau vers, la pire des choses », tout en demeurant trop soucieuse de l'objet, et Baudelaire surtout. Les dix poèmes qu'il a envoyés en 1866 au Parnasse contemporain et qui ont été tous acceptés s'inscrivent dans cette dernière veine : c'étaient œuvres de jeunesse ; pourtant le poète partagera longtemps encore le goût baudelairien des bijoux somptueux, des toilettes raffinées, tout un dandysme que l'on retrouve dans la revue qu'il compose seul en 1874, la Dernière Mode, où il conseille bibelots et parures avec une légère préciosité et dont les « huit ou dix numéros parus, écrit-il bien plus tard, servent encore quand il les dévêt de leur
poussière à le faire rêver longtemps ». Il a déjà commencé « le Livre », cette somme qu'il dit impossible pour une vie et à laquelle il tente néanmoins d'arracher quelques bribes comme cette « Scène » d'Hérodiade publiée dans le deuxième Parnasse ; mais cette œuvre, la plus importante, celle à laquelle il s'attachera le plus, ne sera jamais achevée. L'Après-midi d'un faune est refusé par Lemerre en 1874 et le poète semble alors se tourner vers des travaux plus aisés ; il préface Vathek (1876), un conte oriental écrit en français en 1782 par le fantasque lord anglais Beckford ; il traduit les Poèmes (1877) d'Edgar Poe, auteur qu'il admire au même titre que Baudelaire au point qu'il veut un moment leur consacrer à tous deux une thèse. Il entreprend des ouvrages qui mêlent érudition et réflexion comme les Mots anglais, introduction à l'étude de la langue et recueil de vocabulaire, ou les Dieux antiques (1880), essai de mythologie. Il s'intéresse à la peinture et son ami intime, Manet, lui fait connaître Degas, Monet, Renoir, O. Redon et Gauguin. Sa production poétique, peu abondante, se raréfie encore avec la mort de son jeune fils de huit ans ; l'écriture ne saurait être une consolatrice (Pour un tombeau d'Anatole, qui réunit des fragments, sera publié en 1962). Mais, peu à peu, il se fait connaître; la même année, en 1884, deux écrivains attirent l'attention sur lui : Verlaine, qui lui consacre un volet de ses Poètes maudits, et Huysmans qui fait de lui, dans À Rebours, un auteur de prédilection de son héros décadent, Des Esseintes, envoûté par « cette littérature condensée, ce coulis essentiel, ce sublimé d'art ». Malgré les sarcasmes de journalistes offusqués par la nouveauté d'une écriture qui ne vise pas à plaire et qui leur semble obscure donc mystificatrice, il s'affirme dans un milieu restreint et attire à ses réunions de la rue de Rome, ses « mardis » bientôt célèbres, de jeunes poètes comme G. Kahn, Vielé-Griffin, Saint-Pol Roux, H. de Régnier ou R. Ghil (dont il préface le Traité du verbe}, auxquels s'adjoindront ensuite Valéry, Gide et P. Louÿs, qu'il captive par de longues causeries, émanations de ses méditations poétiques. Il a obtenu tôt sa retraite, fait quelques conférences (sur Villiers, à Bruges, à Oxford) et préfère se retirer solitaire, dans une petite maison louée à Valvins, près de la Seine, où il décide d'élaborer enfin sa grande œuvre. Il lui faut dix ans, qu'il n'aura pas : un spasme de la gorge qui lui laisse seulement le temps de rédiger un testament pathétique (« il n’y aura pas d'héritage littéraire... croyez que ce devait être très beau... ») l'étouffe et l'emporte. Une édition complète de ses poésies paraîtra en 1913, ses Vers de circonstance en 1920 et Igitur en 1925.
Le défaut des langues. L'aventure mallarméenne commence par un rêve fou d'unité, par la nostalgie de Babel, d'une langue souveraine, transparente réduplication de l'univers. Hélas, les langues sont « imparfaites en cela que plusieurs », constat amer qui devient fécond, premier pas d'une réflexion et d'une création autonomes. La séparation des idiomes met en évidence le clivage qui sépare langage et réel. Le monde se trouble, le référent devient incertain et les mots parviennent à acquérir comme une indépendance étrange. De cet écart devenu sensible surgit au xixe s. une science nouvelle, la linguistique ; à partir de lui, s'ébauche la réflexion théorique de Mallarmé : ses Mots anglais, par exemple, ne sont plus travaux de pure philologie, ne retracent plus l'évolution de la langue, mais tentent de cerner, à partir d'analogies sémantiques, une justification du phonème, une limitation de l'arbitraire du signe. Est-ce là une quête de l'essence ? Le poète sait qu'elle est impossible et c'est pourquoi, si la tentation philosophique et métaphysique existe chez lui, ses recherches sur le langage interdisent toute solution de cet ordre, tout véritable cratylisme. La vérité ne saurait s'atteindre sans les mots et pourtant ceux-ci ne sont plus ces liens invisibles qui nous relient à elle. Leur opacité va même devenir objet d'étude et de plaisir pour le poète, qui a parfois tendance à leur réification — le mot devenant objet, joyau, avec le risque d'engloutir en lui qui l'énonce. Le
poème en prose du Démon de l'analogie, publié en 1874 dans la Revue du monde nouveau montre que la malheureuse pénultième, vocable qui, disséqué, procure une « pénible jouissance », agit comme un véritable persécuteur, source non seulement d'envoûtement mais d'« angoisse » dissolvante. À côté du nom destructeur, Mallarmé s'appuie sur des noms fondateurs, noms propres essentiellement, comme celui d'Héro-diade autour duquel il construit tout le poème et qui semble en être l'unique support (« La plus belle page de mon œuvre sera celle qui ne contiendra que ce nom divin d'Hérodiade. Le peu d'inspiration que j'ai eu, je le dois à ce nom et je crois que si mon héroïne s’était appelée Salomé, j'eusse inventé ce mot sombre et rouge comme une grenade ouverte »). Les traductions, exercices propres à faire surgir le décalage entre les mots et les choses (puisque le mot ne recoupe dans aucune langue le même lambeau de réel), ont permis en outre à Mallarmé de s'imprégner de Poe, et en particulier de ses poèmes lancinants et euphoniques (« le Corbeau », « les Cloches », ou « Annabel Lee »). Nul doute qu'il ne se découvre là une soudaine filiation et que son attention à la texture des mots, à leurs phénomènes d'échos réciproques, à leur nécessaire disposition qui fait échec au hasard s'en soit accrue. De même que se défait son rapport avec le monde, que s'accentue cet acte de dépossession du réel, du vécu : ne faut-il pas se référer essentiellement à lui lorsqu'on évoque cette poésie qui « cherchera toujours, pour mieux saisir ce qu elle aime, à se défaire du monde » ? Le voici donc qui décide, selon Bonnefoy, « par intransigeance d'esprit, sans doute aussi par décision de méthode, d'abondonner presque tout ». Cette renonciation douloureuse, toujours à reprendre, est pleine de promesses et, en privilégiant le signifiant par rapport au signifié, elle ouvre démesurément à la poésie le champ mouvant, mais d'une richesse prodigieuse, des connotations. Ce qui s'opère avec Mallarmé est pourtant une disparition et ce qui est irrémédiablement perdu désormais, c'est le sens. Jamais les exégèses n'auront semblé plus dérisoires que celles, maladroitement et laborieusement plaquées sur des textes énigmatiques et scintillants, des poèmes mallar-méens. Car le mot n'est plus univoque et Babel est bien morte. La poésie de Mallarmé se dresse sur les fondations détruites de la tour impossible, avec l’infini désir pourtant d'étre un langage absolu, dont il ne nous reste qu'une version affaiblie et pauvre, cet instrument utilisé quotidiennement pour communiquer. Et c'est pour cela que Mallarmé, malgré ses premières collaborations, n’est pas un parnassien et sans doute bien peu un simple symboliste : derrière les mots, il n'est pour lui ni silhouette froide de marbre grec ni bruissement cosmique de symboles, bien plutôt en premier lieu, un vide.
Le néant. Car le mot débouche sur une absence et toute la poésie de Mallarmé le souligne, qui voit d'abord en lui un « aboli bibelot d’inanité sonore ». « En creusant le vers », le poète débouche sur « le Néant ». L'influence de Hegel, si privilégiée parfois qu'on a fait de Mallarmé un idéaliste, lui fait tenter une synthèse qui l'amène à asseoir l'idée ; il semblerait alors que sa pensée, après avoir vaincu la vie, terrassé le démon de la représentation, resurgisse, purifiée, dans le monde quasi platonicien des Idées ; mais faut-il vraiment voir en Mallarmé un « mystique de l'Être en tant qu'il est suggéré par le non-être » ? Et l'esthétique est-elle bien l'Être qu'il cherchait, comme le suggère ce propos « Après avoir trouvé le néant, j'ai trouvé le Beau »? Ce qui s'effectue avec plus de certitude dans l'œuvre, et il serait inutile de séparer ici les textes explicitement théoriques ( Variations sur un sujet, Quant au livre) des poèmes, c'est une mort, celle du personnage et celle du locuteur; celle du sujet de l'énoncé. « L'œuvre pure, écrit Mallarmé, implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l'initiative aux mots » : c’est aller bien plus loin qu'un simple rejet du lyrisme et l'on comprend que, dans cette défaillance soudaine, de nombreux critiques aient voulu voir la naissance d'une
nouvelle ère pour la littérature. Après Mallarmé, pourra-t-on faire autrement que feindre de croire à la plénitude du sujet ? Ses héros semblent néantisés à l'intérieur; Hamlet incarne un drame universel de non-épanouissement, de non-accès à la création, et reste le « seigneur latent qui ne peut devenir », l'« adolescent évanoui de nous » ; il est la quintessence de l'ébauche. Hérodiade, enfermée comme lui dans les murs de la songerie, accumule les refus d'accéder à la vie, sinon par sa négation, le meurtre de Jean-Baptiste, qu'elle ordonne. Igitur enfin, le plus abstrait puisqu'il est réduit à n'avoir pour nom qu’une particule latine (« donc »), en proie à la « maladie d'idéalité », se cherchant comme Hérodiade « dans la glace devenue ennui et se voyant vague et prêt de disparaître comme s'il allait s'évanouir en le temps », errant comme elle dans un décor plus défunt que présent, jette seulement un coup de dés avant de se fondre dans la nuit.
À tant poursuivre l'absence, Mallarmé lui-même ne peut éviter, malgré la volonté d'impersonnalité qu'il prône (« Je suis maintenant impersonnel »), ou à cause d'elle, une grave crise existentielle qui commence par de violentes névralgies, se poursuit par des insomnies et se traduit par une persistante tentation du suicide. Il est bien, selon la définition qu'il donne du poète, « un homme qui s'isole pour creuser son propre tombeau » et qui doit toujours lutter pour n'y pas sombrer. On retrouve dans l'œuvre cette interrogation désespérée de soi, cette obsession de l'anéantissement, cette hantise de se retrouver dans la fascination du miroir. Celui-ci, absorbant le reflet, reste essentiellement une « eau froide dans son cadre gelée » (Hérodiade) qui ne dévoile rien. « La destruction fut ma Béatrice », dit celui qui, à tant vouloir approcher le néant, frôle constamment la folie et la mort.
Construire. Absences vécue et théorique, manques mis à nu : sur ces gouffres, Mallarmé édifie une stratégie qui vise à les combler. Sa poésie est aussi une lutte contre le néant ; ainsi le vers est-il conçu de façon que « lui, philosophiquement, rémunère le défaut des langues », car « de plusieurs vocables » il « refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire » ; il se joue de la signification, de la communication, de toute linéarité. Il est le lieu du multiple. Dans le vers, les mots s'appellent; et, plus que selon la loi des correspondances baudelairiennes, ils « s'allument de reflets réciproques ». Les vers aussi se répondent ; l'ensemble du poème est structure d'échos plutôt que dire. C'est pour cela que le problème du temps est peu pertinent chez Mallarmé, au contraire de celui de l'espace, dans la mesure où le temps est support de narration. Or la poésie mallarméenne joue contre une poésie narrative ou descriptive. Le parallèle avec la musique, puisqu'il s'agit pour les poètes de « reprendre à la musique leur bien », ne met pas en scène le thème de la durée ; c'est l'espace qui prime, l'écart spatial entre les notes, leur constellation ; la musique n'est donc pas enviée pour son déploiement, mais pour sa fulguration (ce que reprend le Coup de dés}. Un indice de cette atemporalité se trouve dans la rareté des verbes, signes de la situation sur l'axe passé-futur et marques de la personne ; quelques infinitifs ou participes, les plus neutres d'entre les formes verbales, et le présent, le moins temporel des temps, sont préférés. Révélatrice à ce sujet la genèse à'Hérodiade (« J'en étais à une phrase de 22 vers, tournant sur un seul verbe, et encore très effacé la seule fois qu'il se présente », écrit Mallarmé). Ce qui est visé en réalité, c'est l'éternité.
Cette poésie nominale n'est pas nominative ; elle ne prétend pas dire le monde pour le créer, ou plutôt le poète ne s'avère démiurge qu'après avoir purgé le monde de l'impureté de sa nomination première ; il faut vider le mot de son acception triviale pour le faire résonner, étinceler, en le nommant. Il y a là quelque terrorisme : la volonté de détruire le sens commun. Contre la dénotation, Mallarmé préconise les connotations, contre la nomination, il met en avant la suggestion, d'où l'axiome fameux : « nommer un objet, c'est
supprimer les trois quarts de la jouissance qui est faite de deviner peu à peu », qu'on retrouvera dans la non moins célèbre formule : « Je dis : une fleur ! et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous bouquets. » Si donc, par sa lutte contre la temporalité, Mallarmé peut être considéré comme un anti-Proust, par son refus de la nomination il est aussi un anti-Ponge pour qui, « le nom de mimosa étant déjà parfait », il devient « difficile de trouver mieux pour définir la chose que ce mot même ».
Le vers s'oppose donc au langage traditionnel comme au monde ; il échappe à leurs lois, se dresse contre l'usure du temps, contre le hasard, et détermine un autre pôle de la langue. Grâce à lui, Mallarmé peut définir, en le hiérarchisant, le « double état de la parole, brut ou immédiat ici, là essentiel ». C'est poser qu'il existe un langage poétique presque indépendant du langage de communication courant auquel il ne devrait rien. Une telle distinction, qui annonce les recherches de poétique ou la notion de « fonction poétique » du langage établie par Jakobson, ouvre la voie à une poésie non rhétorique. La syntaxe n'est plus considérée comme une armature visant à ordonner et à clarifier la pensée ; elle devient plus dense, et cela malgré les avis de Cazalis (qui, dès 1866, se plaignait des « périodes beaucoup trop longues », de la multiplicité des « phrases incidentes qui s'accrochent l'une à l'autre ») ou les ricanements des railleurs ; elle change de statut : comme l'a noté justement Valéry, elle reprend « rang de Muse », devenant elle-même composante poétique et jouant parfois sur l'ambiguïté. La figure de style n'est plus ornementale ; la périphrase ouvre la porte à de nouveaux sens et la métaphore, qui « fonde toute la poétique mallarméenne », ne privilégie aucun terme. Le lexique relativement simple, sans les multiples enluminures fréquentes dans le goût symboliste (si l'on excepte l'utilisation du mot rare dans le « sonnet en -yx » : « Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx »), est utilisé de manière à pouvoir sursignifier. D'où la perplexité et la virtuosité des commentateurs qui se sont souvent rabattus sur une interprétation allégorique. On peut remarquer que le procédé de l'ellipse, du détour, en même temps que la tendance à la polysémie se retrouvent dans l'activité du rêve, telle que l'envisage la théorie freudienne, avec les phénomènes de déplacement, de condensation ou de surdétermination. Peut-être pourrait-on concevoir alors le « rêve » mallarméen comme autre chose qu'un vague idéal imaginaire et mieux saisir les risques de folie ou de suicide pour qui frôle ainsi les berges de l’inconscient.
À la recherche d'un nouveau langage, cette poésie a voulu englober tous les langages ; elle a tenté d'intégrer tous les arts en elle, mais en les épurant. Ainsi Mallarmé, qui appréciait Wagner (il lui consacra un article et un poème) pour avoir su allier la musique et le drame, lui reprocha-t-il cependant de trop s'appuyer sur la légende. La danse était pour lui comme une évanescence du corps, elle permettait l'envol de l'idée, son écriture dans l'espace ; c'est pourquoi Hérodiade, dans les projets, devait danser devant la tête de Jean-Baptiste et pourquoi la danseuse, qui « livre la nudité des concepts », « n'est pas une femme mais une métaphore ». Certes, les arts se répondent : Mallarmé n'a-t-il pas conçu ses poèmes, et en premier lieu le Coup de dés, comme des drames ? Mais à cette condition de se dépouiller de l'anecdotique et de n'être plus des représentants de l’expression. Ils pourront alors tous rayonner et converger dans « le Livre ». Le poète s'est fait un peu critique d'art (Crayonné au théâtre) pour formuler une synthèse nécessaire à l'édification de cet ouvrage qui reste probablement pour lui un objet mythique, même si, dit-il, « tout au monde existe pour aboutir à un livre » ; il ne fallait pas renier cet idéal, garant de la qualité de toutes les productions qui s'y rattacheraient, et les poèmes de Mallarmé auraient dû être les fragments de ce projet impossible mais indispensable,
son asymptote. L'impossibilité d'écrire le Livre a souvent conduit à parler d'un « échec » mallarméen : c'est oublier que le poète avait déclaré à Mauclair : « La récompense est d'être précisément sur le plan supérieur un raté. » Il proclamait ainsi la nécessité de ne jamais renoncer au Livre.
Si un tel espoir, par définition irréalisable, fut par la suite bien peu caressé ou partagé — excepté peut-être par Borges, qui reprend cette conception du livre-microcosme, et par Jabès —, la postérité de Mallarmé ne manqua pas d'importance. Le poète n'eut qu'un disciple immédiat, Valéry, plus élégant, plus fluide et s’écartant de l'éclat glacé qui le caractérise ; mais toute la poésie moderne s'est nourrie de lui à travers le statut nouveau qu'il donne au vers, et cela sans souci de versification. Car Mallarmé n'innove pas en ce domaine ; il accumule au contraire les contraintes, utilisant le plus souvent alexandrins, sonnets, rimes riches. Mais il renonce à l'expressivité et à la prolixité ; il est le poète de 1 500 vers environ (dont 200, jugeait-il, pouvaient passer à la postérité), de quelques poèmes qu'il appelle « études en vue de mieux ». Il touche l'impersonnel, il tue le sujet et mène, en parallèle avec son travail de composition, une activité critique de réflexion. Il accepte d'être une victime soumise de la « Muse moderne de l'impuissance », faisant du blanc sur la page un élément intrinsèque de la poésie. Il détruit la notion de plénitude de l'être, pour les mots comme pour les choses. Massacreur d'illusions, théoricien de la langue, bien en avance sur son temps qui ne put le comprendre, il est le vrai fondateur de la poésie pure, de la poésie moderne, et, plus largement, d'une conception renouvelée de la littérature.
«
en vérité, de notre mémoire.
L'inspiration? Des rémm1scences, un point c'est tout.
Mallarmé
entrevoit dans l'avenir une jeune image de lui-même qui lui fait signe; il s'approche : c'était son
père.
Sans
doute le temps est-il une illusion : le futur n'est que l'aspect aberrant que prend le passé
aux yeux de l'homme.
Ce désespoir - que Mallarmé nommait alors son impuissance, car il
l'inclinait à refuser toutes les sources d'inspiration et tous les thèmes poétiques qui ne fussent pas
le
concept abstrait et formel de Poésie - l'incite à postuler toute une métaphysique, c'est-à-dire
une sorte de matérialisme analytique et vaguement spinoziste.
Rien n'existe que la matière, éternel
clapotis de l'être, espace
« pareil à soi qu'il s'accroisse ou se nie ».
L'apparition de l'homme
transforme pour celui-ci l'éternel en temporalité et l'infini en hasard.
En elle-même en effet la série
infinie et éternelle des causes est
tout ce qu'elle peut être; un entendement tout connaissant en
saisirait peut-être l'absolue nécessité.
Mais pour un mode fini le monde apparaît comme une
perpétuelle rencontre, une absurde succession de hasards.
Si cela est vrai, les raisons de notre
raison sont aussi folles que les raisons de notre cœur, les principes de notre pensée et les catégories
de notre action sont des leurres : l'homme est un rêve impossible.
Ainsi l'impuissance du Poète
symbolise l'impossibilité d'être homme.
Il n'y a qu'une tragédie, toujours la même « et qui est
résolue
tout de suite, le temps d'en montrer la défaite q:ui se déroule.
fulguramment ».
Cette tra
gédie : (( Il jette les dés ...
Qui créa se retrouve la matière, les blocs, les dés.
» ny avait les dés, il
y a les dés; il y avait les mots, il y a les mots.
L'homme : l'illusion volatile qui voltige au-dessus des
mouvements
de la matière.
Mallarmé, créature de pure matière, veut produire un ordre supé
rieur à la matière.
Son impuissance est théologique :la mort de Dieu créait au poète le devoir de le
remplacer; il échoue.
L'homme de Mallarmé comme celui de Pascal s'exprime en termes de
drame et non en termes d'essence : « Seigneur latent qui ne peut devenir », il se définit par son
impossibilité.
« C'est ce jeu insensé d'écrire, s'arroger en vertu d'un doute quelque devoir de
tout recréer avec des réminiscences.» 1ais «la Nature a lieu, on n'y ajoutera pas».
Aux époques
sans avenirs, barrées
par la volumineuse stature d'un roi ou par l'incontestable triomphe d'une
classe, l'invention semble une pure réminiscence : tout est dit, l'on vient trop tard.
Ribot fera
bientôt la théorie de cette impuissance en composant nos images mentales avec des souvenirs.
On entrevoit chez Mallarmé, une métaphysique pessimiste : il y aurait dans la matière, informe
infinité,
une sorte d'appétit obscur de revenir sur soi pour se connaître :pour éclairer son obscure
infinité elle
produirait ces lambeaux de pensées qu'on appelle des hommes, ces flammes déchirées.
Mais
la dispersion infinie arrache et disperse l'Idée.
L'homme et le hasard naissent en même
temps
et l'un par l'autre.
L'homme est un raté, un « loup >> parmi les « loups ».
Sa grandeur est
de vivre son défaut de fabrication jusqu'à l'explosion finale.
N'est-il pas temps d'exploser?
Mallarmé, à Tournon, à Besançon, à Avignon, a très sérieu
sement envisagé le suicide.
D'abord c'est la conclusion qui s'impose : si l'homme est impossible,
il
faut manifester cette impossibilité en la poussant jusqu'au point où elle se détruit elle-même.
Pour une fois la cause de notre action ne saurait être la matière.
L'être ne produit que de l'être;
si le Poète choisit le non-êt!'e en conséquence de sa non-possibilité, c'est le Non qui est la cause
du Néant : un ordre humain s'établit contre l'être par la disparition même de l'Homme.
Avant
Mallarmé, Flaubert, déjà, faisait tenter saint Antoine en ces termes : « (Donne-toi la mort.)
Faire une chose qui vous égale à Dieu, pense donc.
Il t'a créé, tu vas détruire son œuvre, toi, par
ton courage, librement.
» N'est-ce pas cc qu'il a toujours voulu : il y a dans le suicide qu'il médite
quelque chose d'un crime terroriste.
Et n'a-t-il pas dit que le suicide et le crime étaient les seuls
actes
surnaturels que l'on puisse faire.
Il appartient à certains hommes de confondre leur drame
avec celui de l'humanité; c'est cc qui les sauve : pas un instant Mallarmé ne doute que l'espèce
humaine, s'il se tue, ne viendra mourir en lui tout entière; ce suicide est un génocide.
Dispa
raître : on rendrait à l'être sa pureté.
Puisque le hasard surgit avec l'homme, avec lui il s'éva
nouira :«L'infini enfin, échappe à ma famille, qui en a souffert- vieil espace- pas de hasard ...
Ceci devait avoir lieu dans les combinaisons
de l'Infini.
Vis-à-vis de l'Absolu Nécessaire- extrait
l'Idée.
» A travers des générations de poètes, lentement, l'idée poétique ruminait la contradiction
qui la rend impossible.
La mort de Dieu fit tomber le dernier voile : il était réservé à l'ultime
rejeton de la race, de vivre cette contradiction dans sa pureté- et d'en mourir, donnant ainsi la
conclusion poétique de l'histoire
humaine.
Sacrifice et génocide, affirmation et négation de
l'homme, le suicide
de Mallarmé reproduira le mouvement des dés :la matière se retrouve matière..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MALLARMÉ Étienne, dit Stéphane : sa vie et son oeuvre
- Fiche de lecture : POÉSIES de Stéphane Mallarmé
- IGITUR OU LA FOLIE D’ELBEHNON de Stéphane Mallarmé
- POÉSIES de Stéphane Mallarmé (résumé et analyse de l'oeuvre)
- APRÈS-MIDI D'UN FAUNE (L') de Stéphane Mallarmé