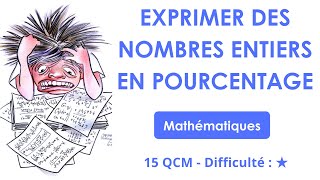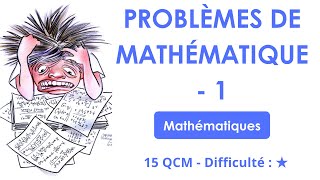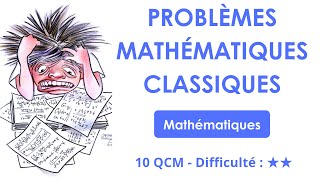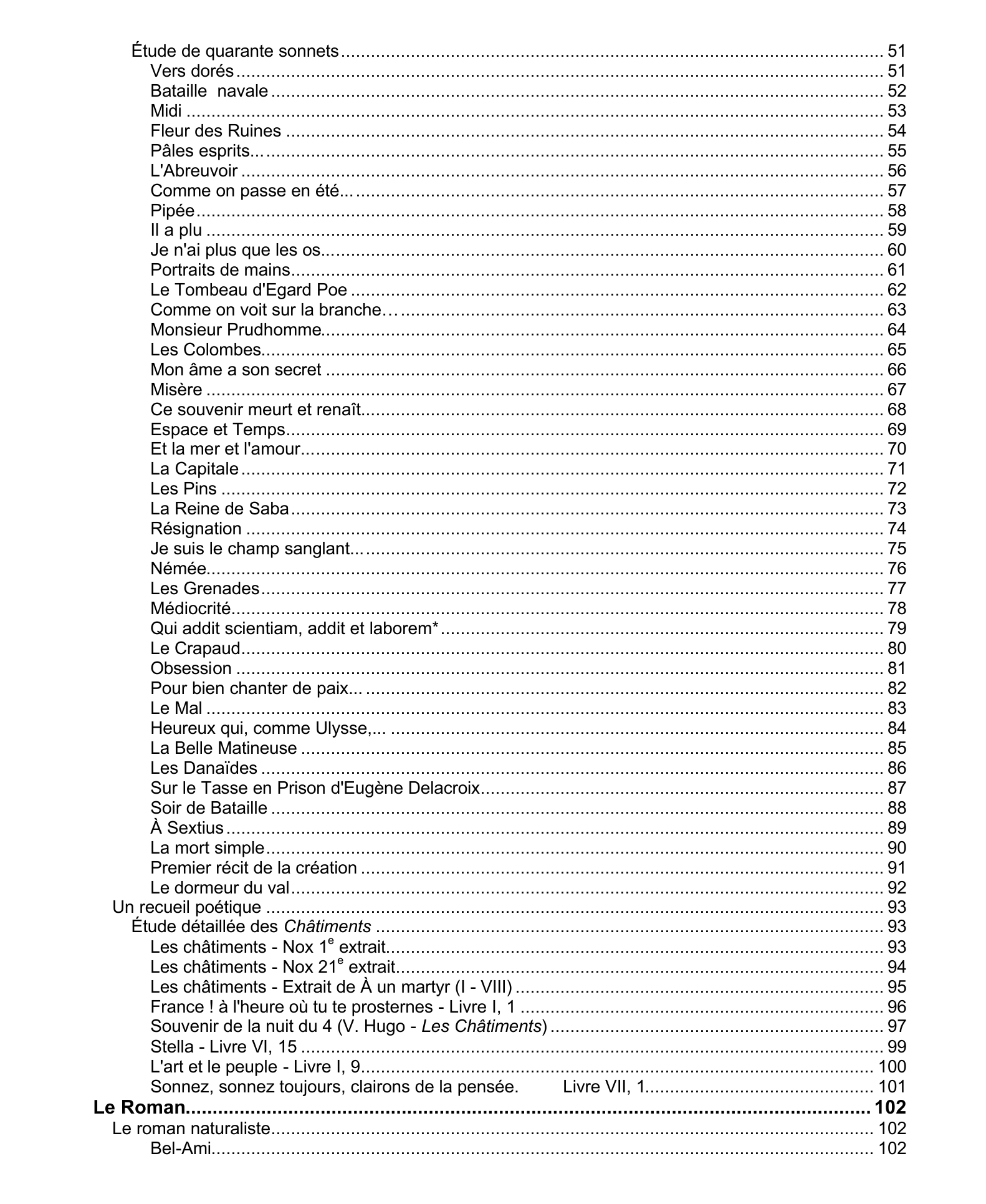Texte du bac francais (EAF)
Publié le 06/04/2016
Extrait du document
SOMMAIRE
Épreuves écrites
....................................................................................................
................... 5
De la lecture analytique au Commentaire
............................................................................................. 5
Approche progressive de la lecture analytique
...................................................................................... 5
Le Pont Mirabeau
....................................................................................................
..................... 5
La mort du
loup................................................................................................
............................. 6
Madame Bovary
....................................................................................................
....................... 7
Le dormeur du
val.................................................................................................
........................ 8
Les pauvres gens
....................................................................................................
..................... 9
Némée...............................................................................................
......................................... 10
L’assommoir
....................................................................................................
........................... 11
Naissance de l’Odyssée
....................................................................................................
......... 12
Germinal............................................................................................
......................................... 13
Phèdre..............................................................................................
.......................................... 14
Génie du christianisme
....................................................................................................
........... 16
Politique tirée de l’écriture
sainte..............................................................................................
... 17
Le
Commentaire.........................................................................................
........................................ 18
Mélancholia -
EXTRAIT.............................................................................................
................... 18
Médiocrité..........................................................................................
......................................... 19
Les
Étoiles.............................................................................................
..................................... 20
Lorenzaccio
....................................................................................................
............................ 21
Le Mal
....................................................................................................
.................................... 24
Sujets préparatoires aux nouvelles
épreuves...................................................................................... 25
Corpus 1
....................................................................................................
.................................... 25
Heureux qui, comme Ulysse,
....................................................................................................
.. 25
Les deux Pigeons
....................................................................................................
................... 26
La chèvre de M. Seguin
....................................................................................................
.......... 28
Hannon..............................................................................................
......................................... 30
Corpus 2
....................................................................................................
.................................... 31
Premier récit de la création
(extraits)..........................................................................................
. 31
Disproportion de
l'Homme.............................................................................................
.............. 32
Les Étoiles (vers 49 à 72)
....................................................................................................
...... 33
À la fenêtre pendant la nuit
....................................................................................................
..... 34
Crépuscule de Dimanche d'été
...................................................................................................
37
Corpus 3
....................................................................................................
.................................... 38
Disproportion de
l'Homme.............................................................................................
.............. 38
Hugo - Les Châtiments - \"Stella\" - (Livre VI, poème
XV).............................................................. 39
Des astres, de la vie et des
hommes...........................................................................................
40
Médiocrité..........................................................................................
......................................... 41
L’Apologue
....................................................................................................
.......................... 42
La
Fable...............................................................................................
.............................................. 42
Étude détaillée de deux fables
....................................................................................................
.... 42
Les Animaux malades de la Peste (Livre VII, fable
I).................................................................. 42
Le Loup et l'Agneau (Livre I, fable X)
.......................................................................................... 44
D’autres formes d’apologues
....................................................................................................
.......... 45
Souvenir de la nuit du 4
....................................................................................................
.......... 45
Choses
vues................................................................................................
............................... 47
La légende de l’homme à la cervelle d’or
.................................................................................... 48
La parabole de l’enfant prodigue
.................................................................................................
50
La Poésie
....................................................................................................
............................. 51
Le sonnet, poème à forme fixe
....................................................................................................
....... 51
Étude de quarante sonnets
....................................................................................................
......... 51
Vers dorés
....................................................................................................
.............................. 51
Bataille navale
....................................................................................................
....................... 52
Midi
....................................................................................................
........................................ 53
Fleur des Ruines
....................................................................................................
.................... 54
Pâles esprits...
....................................................................................................
........................ 55
L'Abreuvoir
....................................................................................................
............................. 56
Comme on passe en été...
....................................................................................................
...... 57
Pipée
....................................................................................................
...................................... 58
Il a plu
....................................................................................................
.................................... 59
Je n'ai plus que les
os..................................................................................................
............... 60
Portraits de
mains...............................................................................................
........................ 61
Le Tombeau d'Egard Poe
....................................................................................................
....... 62
Comme on voit sur la branche…
.................................................................................................
63
Monsieur
Prudhomme...........................................................................................
...................... 64
Les
Colombes............................................................................................
................................. 65
Mon âme a son secret
....................................................................................................
............ 66
Misère
....................................................................................................
.................................... 67
Ce souvenir meurt et
renaît..............................................................................................
........... 68
Espace et
Temps...............................................................................................
......................... 69
Et la mer et
l'amour.............................................................................................
........................ 70
La Capitale
....................................................................................................
............................. 71
Les Pins
....................................................................................................
................................. 72
La Reine de Saba
....................................................................................................
................... 73
Résignation
....................................................................................................
............................ 74
Je suis le champ sanglant...
....................................................................................................
.... 75
Némée...............................................................................................
......................................... 76
Les Grenades
....................................................................................................
......................... 77
Médiocrité..........................................................................................
......................................... 78
Qui addit scientiam, addit et laborem*
......................................................................................... 79
Le
Crapaud.............................................................................................
.................................... 80
Obsession
....................................................................................................
.............................. 81
Pour bien chanter de paix...
....................................................................................................
.... 82
Le Mal
....................................................................................................
.................................... 83
Heureux qui, comme Ulysse,...
...................................................................................................
84
La Belle Matineuse
....................................................................................................
................. 85
Les Danaïdes
....................................................................................................
......................... 86
Sur le Tasse en Prison d'Eugène
Delacroix................................................................................. 87
Soir de Bataille
....................................................................................................
....................... 88
À Sextius
....................................................................................................
................................ 89
La mort simple
....................................................................................................
........................ 90
Premier récit de la création
....................................................................................................
..... 91
Le dormeur du
val.................................................................................................
...................... 92
Un recueil poétique
....................................................................................................
........................ 93
Étude détaillée des Châtiments
....................................................................................................
.. 93
Les châtiments - Nox 1e
extrait.............................................................................................
....... 93
Les châtiments - Nox 21e
extrait.............................................................................................
..... 94
Les châtiments - Extrait de À un martyr (I - VIII)
.......................................................................... 95
France ! à l'heure où tu te prosternes - Livre I, 1
......................................................................... 96
Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments)
................................................................... 97
Stella - Livre VI, 15
....................................................................................................
................. 99
L'art et le peuple - Livre I,
9...................................................................................................
.... 100
Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. Livre VII,
1.............................................. 101
Le
Roman...............................................................................................
................................ 102
Le roman
naturaliste.........................................................................................
................................ 102
Bel-Ami.............................................................................................
........................................ 102
Pierre et Jean
....................................................................................................
....................... 104
Approches de l’œuvre de Zola
....................................................................................................
.. 105
Incipit de l'Assommoir
....................................................................................................
........... 105
L'Assommoir - Gueule d'Or - extrait du chapitre VI
.................................................................... 106
L'Assommoir - l'Oie - extrait du chapitre VII
............................................................................... 107
L'Assommoir - le début de la déchéance - extrait du chapitre
X................................................ 108
La Faute de l'Abbé Mouret - extrait
........................................................................................... 109
Théâtre.............................................................................................
...................................... 110
La Comédie au XVIIIe siècle
....................................................................................................
......... 110
LE MARIAGE DE FIGARO ACTE I SCENE 10
............................................................................... 110
LE MARIAGE DE FIGARO Acte II Scène 1
............................................................................... 113
LE MARIAGE DE FIGARO Acte III Scène
5.............................................................................. 115
L’Argumentation
....................................................................................................
............... 119
Argumenter par la
description.........................................................................................
.................. 119
L'Interdiction
....................................................................................................
......................... 119
Candide (chapitre troisième)
....................................................................................................
. 120
Les Misérables
....................................................................................................
..................... 121
Portrait de Madame
Saint-Estève........................................................................................
...... 122
La famille Vervelle
....................................................................................................
................ 123
Portrait de Madame Jeanrenaud
............................................................................................... 124
Portrait de
Scrooge.............................................................................................
...................... 125
Portrait de monsieur de
Nemours.............................................................................................
. 126
Argumenter par l’Énonciation : Éprouver ou susciter un sentiment violent (s’indigner, s’émouvoir
ou émouvoir, choquer, scandaliser,
ironiser)..........................................................................................
127
Homère - Iliade, chant
XXIV................................................................................................
...... 127
Hernani, Acte II, scène IV
....................................................................................................
..... 129
Le Baptême
....................................................................................................
.......................... 131
Une Famille
....................................................................................................
.......................... 132
Hernani, Acte III, scène
I...................................................................................................
........ 134
La Tête des Autres - Acte I, scène 1
......................................................................................... 135
Pensées
....................................................................................................
............................... 137
Souvenir de la nuit du 4
....................................................................................................
........ 138
De l'esprit des
lois................................................................................................
..................... 140
Andromaque, Acte III, scène
VII................................................................................................
141
De l'Art de persuader
....................................................................................................
............ 143
Argumenter par l’autorité du discours
............................................................................................... 144
L’Éloge et le
Blâme...............................................................................................
.................... 145
Vive le Solex !
....................................................................................................
....................... 145
Éloge du voyage à pied
....................................................................................................
........ 146
Voyages réels ou voyages virtuels ?
......................................................................................... 147
Les artistes contre la Tour Eiffel
................................................................................................
148
Argumenter par la logique
....................................................................................................
............ 149
Extrait de l'article Traite des nègres
.......................................................................................... 149
Argumenter par la composition
....................................................................................................
..... 150
Madame Bovary
....................................................................................................
................... 150
Études détaillées
....................................................................................................
.......................... 152
Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments)
................................................................. 152
L’argumentation dans l’apologue
..................................................................................................
154
Préambule aux fables Le Lion et le Rat / La Colombe et la Fourmi (La Fontaine)
.......................... 154
Se construire une opinion personnelle – Thème : La Condition féminine
........................................... 155
La confrontation de points de vue littéraires et
politiques............................................................... 155
Physiologie du mariage - Extrait
1............................................................................................. 155
Physiologie du mariage - Extrait
2............................................................................................. 155
Physiologie du mariage - Extrait
3............................................................................................. 156
L'École des femmes - (vers 87 à 96, et 100
à102).................................................................... 157
L'École des femmes - (vers 123 à 146)
..................................................................................... 157
L'École des femmes (III, 2 - vers 747 à
801)............................................................................. 158
Les femmes savantes - Extrait 1 - vers 26 à 52.
........................................................................ 160
Les femmes savantes - Extrait 2 - vers 15 à 25.
....................................................................... 160
Modeste Mignon
....................................................................................................
................... 161
Première neige
....................................................................................................
..................... 162
L'Assommoir.........................................................................................
.................................... 163
Les Lettres de mon
moulin..............................................................................................
.......... 164
Les Femmes et le Secret
....................................................................................................
...... 165
Hernani, Acte II, scène IV, - Extrait
1........................................................................................ 166
Hernani, Acte III, scène I - Extrait
2........................................................................................... 168
Madame Bovary (deuxième partie, chapitre
3)............................................................................... 169
Amar, un conventionnel, Discours à la Convention de novembre
1793..................................... 170
Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène 16).
................................................................ 171
Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène XVI)
............................................................... 171
Le Barbier de
Séville.............................................................................................
.................... 172
Jacques le fataliste
....................................................................................................
............... 173
Préambule de l'article 1124 du Code Napoléonien
.................................................................... 174
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne -1791
..................................................... 174
Épreuves écrites
De la lecture analytique au Commentaire
Approche progressive de la lecture analytique
Le Pont Mirabeau
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Guillaume Apollinaire
Alcools
La mort du loup
Les nuages couraient sur la lune enflammée Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée, Et les bois
étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,
5 Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine
10 Et le pas suspendu. - Ni le bois ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les airs ; seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
15 Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés, Sur leurs coudes semblaient endormis et
couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; bientôt,
20 Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
25 Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, Nous allions pas à pas en écartant
les branches.
Extrait de \"La mort du loup\", du recueil Les Destinées (1864) d’Alfred de Vigny
Madame Bovary
(Cet extrait est le discours que prononce un conseiller de la préfecture, à l’occasion des Comices
agricoles.)
\"Messieurs\",
\"Qu’il me soit permis d’abord (avant de vous entretenir de l’objet de cette réunion d’aujourd’hui,
et ce sentiment, j’en suis sûr, sera partagé par vous tous), qu’il me soit permis, dis-je, de
rendre justice à l’administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre
souverain, à ce roi bien-aimé à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n’est
indifférente, et qui dirige à la fois d’une main si ferme et si sage le char de l’Etat parmi les
périls incessants d’une mer orageuse, sachant d’ailleurs faire respecter la paix comme la guerre,
l’industrie, le commerce, l’agriculture et les beaux-arts. (...)
Et qu’aurais-je à faire, messieurs, de vous démontrer ici l’utilité de l’agriculture ? Qui donc
pourvoit à nos besoins ? Qui donc fournit à notre subsistance ? N’est-ce pas l’agriculteur ?
L’agriculteur, messieurs, qui, ensemençant d’une main laborieuse les sillons féconds des campagnes,
fait naître le blé, lequel broyé est mis en poudre au moyen d’ingénieux appareils, en sort sous le
nom de farine, et, de là, transporté dans les cités, est bientôt rendu chez le boulanger, qui en
confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche. N’est-ce pas l’agriculteur encore qui
engraisse, pour nos vêtements, ses abondants troupeaux dans les pâturages ? Car comment nous
vêtirions-nous, car comment nous nourririons-nous sans l’agriculteur ? Et même, messieurs, est-il
besoin d’aller si loin chercher des exemples ? Qui n’a souvent réfléchi à toute l’importance que
l’on retire de ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller
moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables, et des oeufs ? Mais je n’en
finirais pas, s’il fallait énumérer les uns après les autres les différents produits que la terre
bien cultivée, telle qu’une mère généreuse, prodigue à ses enfants. Ici, c’est la vigne ;
ailleurs, ce sont les pommiers à cidre ;
là, le colza ; plus loin, les fromages ; et le lin ; messieurs, n’oublions pas le lin ! qui a pris
dans ces dernières années un accroissement considérable et sur lequel j’appellerai plus
particulièrement votre attention.\"
Texte III : extrait de Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert - Deuxième partie, chapitre VIII.
Le dormeur du val
C’est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Extrait de Poésies (oct. 1870)
de A. RIMBAUD
Les pauvres gens
Dans ce passage, V. Hugo met en scène une femme de pêcheur attendant, la nuit, le retour de son
mari parti seul sur l’océan.
Elle prie, et la mauve au cri rauque et moqueur
45 L’importune, et, parmi les écueils en décombres, L’océan l’épouvante, et toutes sortes
d’ombres Passent dans son esprit : la mer, les matelots Emportés à travers la colère des flots ;
Et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l’artère,
50 La froide horloge bat, jetant dans le mystère,
Goutte à goutte, le temps, saisons, printemps, hivers ; Et chaque battement, dans l’énorme univers,
Ouvre aux âmes, essaims d’autours et de colombes, D’un côté les berceaux et de l’autre les tombes.
55 (.....................................................................)
62 C’est l’heure où, gai danseur, minuit rit et folâtre
Sous le loup de satin qu’illuminent ses yeux,
Et c’est l’heure où minuit, brigand mystérieux,
65 Voilé d’ombre et de pluie et le front dans la bise, Prend un pauvre marin frissonnant, et
le brise Aux rochers monstrueux apparus brusquement.
Horreur ! l’homme, dont l’onde éteint le hurlement, Sent fondre et s’enfoncer le bâtiment qui
plonge ;
70 Il sent s’ouvrir sous lui l’ombre et l’abîme, et songe
Au vieil anneau de fer du quai plein de soleil ! Ces mornes visions troublent son coeur, pareil A
la nuit. Elle tremble et pleure.
Texte V extrait de \"Les Pauvres Gens\", du recueil La Légende des Siècles (1859-1877-1883) de Victor
Hugo.
Némée
Depuis que le Dompteur entra dans la forêt En suivant sur le sol la formidable empreinte, Seul, un
rugissement a trahi leur étreinte. Tout s’est tu. Le soleil s’abîme et disparaît.
À travers le hallier, la ronce et le guéret,
Le pâtre épouvanté qui s’enfuit vers Tirynthe Se tourne, et voit d’un oeil élargi par la crainte
Surgir au bord du bois le grand fauve en arrêt.
Il s’écrie. Il a vu la terreur de Némée
Qui sur le ciel sanglant ouvre sa gueule armée, Et la crinière éparse et les sinistres crocs ;
Car l’ombre grandissante avec le crépuscule
Fait, sous l’horrible peau qui flotte autour d’Hercule, Mêlant l’homme à la bête, un monstrueux
héros.
Texte VI : sonnet \"Némée\", du recueil Les Trophées (1893), de José-Maria de Heredia
(partie \"la Grèce et la Sicile\" consacrée à \"Hercule et les Centaures\")
L’assommoir
(une blanchisseuse vient d’épouser un ouvrier zingueur ; la noce, composée de parents, de voisins
et d’ouvriers, pour tuer le temps se rend au Louvre, guidée par l’un des invités.)
M. Madinier, poliment, demanda à prendre la tête du cortège. C’était très grand, on pouvait se
perdre ; et lui, d’ailleurs,
connaissait les beaux endroits, parce qu’il était souvent venu avec un artiste, un garçon bien
intelligent, auquel une grande maison de cartonnage achetait des dessins pour les mettre sur des
boîtes. En bas, quand la noce se fut engagée dans le musée assyrien, elle eut un petit frisson.
Fichtre ! il ne faisait pas chaud ; la salle aurait fait une fameuse cave. Et, lentement, les
couples avançaient, le menton levé, les paupières battantes, entre les colosses de pierre, les
dieux de marbre noir muets dans leur raideur hiératique, les bêtes monstrueuses, moitié chattes et
moitié femmes, avec des figures de mortes, le nez aminci, les lèvres gonflées. Ils trouvaient tout
ça très vilain. On travaillait joliment mieux la pierre au jour d’aujourd’hui. Une inscription en
caractères phéniciens les stupéfia. Ce n’était pas possible, personne n’avait jamais lu ce
grimoire. Mais M. Madinier, déjà sur le premier palier avec Mme Lorilleux, les appelait, criait
sous les voûtes :
\"Venez donc. Ce n’est rien,ces machines... C’est au premier qu’il faut voir.\"
La nudité sévère de l’escalier les rendit graves. Un huissier superbe, en gilet rouge, la livrée
galonnée d’or, qui semblait les attendre sur le palier, redoubla leur émotion. Ce fut avec respect,
marchant le plus doucement possible, qu’ils entrèrent dans la galerie française.
Alors, sans s’arrêter, les yeux emplis de l’or des cadres, ils suivirent l’enfilade des petits
salons, regardant passer les images
trop nombreuses pour être bien vues. Il aurait fallu une heure devant chacune, si l’on avait voulu
comprendre. Que de tableaux, sacredié ! ça ne finissait pas. Il devait y en avoir pour de l’argent.
Puis, au bout, M. Madinier les arrêta brusquement devant le Radeau de la Méduse
; et il leur expliqua le sujet. Tous, saisis, immobiles, se taisaient. Quand on se remit à marcher,
Boche résuma le sentiment général : c’était tapé.
Dans la galerie d’Apollon, le parquet surtout émerveilla la société, un parquet luisant, clair
comme un miroir, où les pieds des banquettes se reflétaient. Mlle Remanjou fermait les yeux, parce
qu’elle croyait marcher sur de l’eau.
(...................................................................................................
.........
...) (...) Coupeau s’arrêta devant la Joconde , à laquelle il trouva une
ressemblance avec une de ses tantes. Boche et Bibi-la Grillade ricanaient, en se montrant du coin
de l’oeil les femmes nues ; les cuisses de l’Antiope surtout leur causèrent un saisissement.
Texte VII : extrait de l’Assommoir (1877) de E. Zola
Naissance de l’Odyssée
Le chemin, comme une trace de couleuvre, déroulait ses anneaux au milieu de l’oseraie. Il faisait
chaud : dans l’air visqueux, des touffes de mouches dessinaient les molles ondulations de leur
danse nuptiale. Ulysse aspirait goulûment des flocons de
vent tiède, espérant une vaine fraîcheur. On entendait
gronder le fleuve sous son pelage de bélier.
Le rideau flexible des joncs s’ouvrit sur une étroite plaine qui mimait la chair liquide de la mer.
Des vagues de froment brisaient contre le flanc rugueux de la montagne où l’écume des oliviers
grésillait ; dans ces calanques ombrées et profondes dormait le flot étale des prés. Une bastidette
à forme de nef était à l’ancre sur un champ de trèfles. Ainsi, sous le visage de la terre, Ulysse
trouvait toujours les traits aimés de la mer.
(......................................................................................
...........................)
Il dépassa le front nord des pinèdes. Le crépuscule marchait devant lui sur les champs d’herbe
tachés de gentiane. L’onde claire du jour refluait vers
le sommet de la montagne ; là-haut, enfouie dans le bois crépu, l’auberge dressa sa tête blanche
dessus les genévriers, et, comme d’un récif s’envolent les
flocons d’écume, le vol des colombes giclait autour de son toit.
(......................................................................................
..........................)
La maison basse et le pigeonnier rond étaient mussés dans les taillis. Deux longs murs de pierres
sèches embrassaient en guise de cour préambulaire un arpent de terre rase où subsistaient seuls les
chicots des genévriers mal arrachés. Au centre, s’arrondissait comme un cal la tache grisâtre d’un
grand foyer qu’on allumait tous les soirs. Présentement, des valets d’écurie y entassaient des
fascines d’oliviers rongées par les chèvres. Sur le visage de l’auberge, une porte s’ouvrit,
découvrant le regard rouge de l’âtre : un homme sortit qui portait un brandon fumant. Les ailes
bleues du soir battaient autour de lui.
Texte VIII - extraits de Naissance de l’Odyssée (1930)
de Jean Giono (trois extraits du chapitre I de la Première Partie).
Germinal
Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d’une obscurité et d’une épaisseur d’encre, un
homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout
droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il
n’avait la sensation
de l’immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une
mer, glacées d’avoir balayé des lieues de marais et de
terres nues. Aucune ombre d’arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d’une
jetée, au milieu de l’embrun aveuglant des ténèbres.
L’homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d’un pas allongé, grelottant sous
le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à
carreaux, le gênait beaucoup ; et il le serrait contre ses flancs, tantôt d’un coude, tantôt de
l’autre, pour glisser au
fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d’est
faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d’ouvrier sans travail et sans gîte,
l’espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour.
Texte IX : incipit de Germinal (1885) d’Emile Zola
Phèdre
Phèdre (1677) - Acte II - Scène V
Dans cette pièce dont les personnages sont des héros de l’Antiquité grecque (époque légendaire),
Racine fait la peinture des ravages de la passion et de la vanité du combat humain contre elle.
PHEDRE, HIPPOLYTE, OENONE. Phèdre, à Oenone.
581 Le voici. Vers mon coeur tout mon sang se retire.
J’oublie, en le voyant, ce que je viens lui dire.
Oenone
Souvenez-vous d’un fils qui n’espère qu’en vous.
Phèdre
On dit qu’un prompt départ vous éloigne de nous,
585 Seigneur. À vos douleurs je viens joindre mes larmes.
Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n’a plus de père, et le jour n’est pas
loin Qui de ma mort encor doit le rendre témoin.
Déjà mille ennemis attaquent son enfance.
590 Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense.
Mais un secret remords agite mon esprit.
Je crains d’avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère
Ne poursuive bientôt une odieuse mère.
Hippolyte
595 Madame, je n’ai point de sentiments si bas.
Phèdre
Quand vous me haïriez, je ne me plaindrais pas, Seigneur. Vous m’avez vue attachée à vous nuire :
Dans le fond de mon coeur vous ne pouviez pas lire. A votre inimitié j’ai pris soin de m’offrir.
600 Aux bords que j’habitais je n’ai pu vous souffrir.
En public, en secret, contre vous déclarée, J’ai voulu par des mers en être séparée ; J’ai même
défendu, par une expresse loi,
Qu’on osât prononcer votre nom devant moi.
605 Si pourtant à l’offense on mesure la peine, Si la haine peut seule attirer votre haine,
Jamais femme ne fut plus digne de pitié,
Et moins digne, Seigneur, de votre inimitié.
Hippolyte
Des droits de ses enfants une mère jalouse
610 Pardonne rarement au fils d’une autre épouse.
Madame, je le sais. Les soupçons importuns
Sont d’un second hymen les fruits les plus communs. Toute autre aurait pour moi pris les mêmes
ombrages, Et j’en aurais peut-être essuyé plus d’outrages.
Phèdre
615 Ah! Seigneur, que le ciel, j’ose ici l’attester,
De cette loi commune a voulu m’excepter !
Qu’un soin bien différent me trouble et me dévore !
Hippolyte
Madame, il n’est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour ;
620 Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour.
Neptune le protège, et ce dieu tutélaire
Ne sera pas en vain imploré par mon père.
Phèdre
On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords,
625 En vain vous espérez qu’un Dieu vous le renvoie ;
Et l’avare Achéron ne lâche point sa proie.
Que dis-je ? Il n’est point mort, puisqu’il respire en vous. Toujours devant mes yeux je crois voir
mon époux.
Je le vois, je lui parle, et mon coeur ... Je m’égare,
630 Seigneur, ma folle ardeur malgré moi se déclare.
L’extrait proposé est la première partie de la scène V de l’acte II de Phèdre de Racine.
Génie du christianisme
On ne peut guère supposer que des hommes aussi sensibles que les anciens eussent manqué d’yeux pour
voir la nature et de talent pour la peindre si quelque cause puissante ne les avait aveuglés. Or
cette cause était la mythologie, qui, peuplant l’univers d’élégants fantômes, ôtait à la création
sa gravité, sa grandeur et sa solitude. Il a fallu que le christianisme vînt chasser ce peuple de
faunes, 1 de satyres1 et de nymphes, 1 pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur
rêverie. Les déserts ont pris sous notre culte un caractère plus triste, plus grave, plus sublime :
le dôme des forêts s’est exhaussé ; les fleuves ont brisé leurs petites urnes, pour ne plus verser
que les eaux de l’abîme du sommet des montagnes : le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a
donné son immensité à la nature.
Le spectacle de l’univers ne pouvait faire sentir aux Grecs et aux Romains les émotions qu’il porte
à notre âme.
(...................................................................................................
...................................)
Si le poète s’égarait dans les vallées duTaygète, (...) il ne rencontrait que des faunes, 1 il
n’entendait que des dryades1; Priape1 était là sur un tronc d’olivier, et Vertumne1 avec les
zéphyrs1 menait des danses éternelles. Des sylvains1 et des naïades1 peuvent frapper
agréablement l’imagination, pourvu qu’ils ne soient pas sans cesse reproduits ;
(.................................................)
(...)Libres de ce troupeau de dieux ridicules qui les bornaient de toutes parts, les bois se sont
remplis d’une Divinité immense. Le don de prophétie et de sagesse, le mystère et la religion
semblent résider éternellement dans leurs profondeurs sacrées.
Pénétrez dans ces forêts américaines aussi vieilles que le monde : quel profond silence dans ces
retraites quand les vents reposent ! quelles voix inconnues quand les vents viennent à s’élever !
Êtes-vous immobile, tout est muet ; faites-vous un pas, tout soupire. La nuit s’approche, les
ombres s’épaississent : on entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres ; la
terre murmure sous vos pas ; quelques coups de foudre font mugir les déserts ; la forêt s’agite,
les arbres tombent, un fleuve inconnu coule devant vous. La lune sort enfin de l’Orient ; à mesure
que vous passez au pied des arbres, elle semble errer devant vous dans leur cime et suivre
tristement vos yeux. Le voyageur s’assied sur le tronc d’un chêne pour attendre le jour ; il
regarde tour à tour l’astre des nuits, les ténèbres, le fleuve ; il se sent inquiet, agité, et,
dans l’attente de quelque chose d’inconnu, un plaisir inouï, une crainte extraordinaire
font palpiter son sein comme s’il allait être admis à quelque secret de la Divinité : il est seul
au fond des forêts, mais l’esprit de l’homme remplit aisément les espaces de la nature, et toutes
les solitudes de la terre sont moins vastes qu’une seule pensée de son cœur.
Oui, quand l’homme renierait la Divinité, l’être pensant, sans cortège et sans spectateur, serait
encore
plus auguste au milieu des mondes solitaires que s’il y paraissait environné des petites déités de
la fable ; le désert vide aurait encore quelques convenances avec l’étendue de ses idées, la
tristesse de ses passions et le dégoût même d’une vie sans illusion et sans espérance.
Il y a dans l’homme un instinct qui le met en rapport avec les scènes de la nature. Eh ! qui n’a
passé des heures entières assis, sur le rivage d’un fleuve, à voir s’écouler les ondes ! Qui ne
s’est plu, au bord de la mer, à regarder blanchir l’écueil éloigné ! Il faut plaindre les anciens,
qui n’avaient trouvé dans l’Océan que le palais de Neptune1 et la grotte de Protée1; il était dur
de ne voir que les aventures des tritons1 et des néréides1 dans cette immensité des mers, qui
semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre âme, dans cette immensité qui fait
naître en nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre avec son
auteur.
1 tous ces personnages sont des divinités inférieures, protectrices des bois, des sources, des
jardins (cf:
repérage culturel)
Texte XI : extrait du Génie du Christianisme (1802) (II,IV,I)
de Chateaubriand.
Politique tirée de l’écriture sainte
Vous voyez l’image de Dieu dans les rois, et vous avez l’idée de la majesté royale.
Dieu est la sainteté même, la bonté même, la puissance même, la raison même. En ces choses est la
majesté de Dieu. En l’image de ces choses est la majesté du prince.
Elle est si grande, cette majesté, qu’elle ne peut être dans le prince comme dans sa source ; elle
est empruntée de Dieu, qui la lui donne pour le bien des peuples, à qui il est bon d’être contenus
par une force supérieure.
Je ne sais quoi de divin s’attache au prince, et inspire la crainte aux peuples. Que le roi ne
s’oublie pas pour cela lui-même. \"Je l’ai dit, c’est Dieu qui
parle, je l’ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du Très-Haut ; mais vous
mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme les grands1.\" Je l’ai dit : Vous êtes des dieux,
c’est-à-dire : vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. Vous
êtes les enfants du Très-Haut : c’est lui qui a établi votre puissance, pour le bien du genre
humain. Mais, ô dieux de chair et de sang, ô dieux de boue et de poussière, vous mourrez comme des
hommes,
vous tomberez comme les grands. La grandeur sépare les hommes pour un peu de temps ; une chute
commune à la fin les égale tous.
Ô rois ! exercez donc hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre humain ;
mais exercez-la avec humilité. Elle vous est appliquée par le dehors. Au fond, elle vous laisse
faibles, elle vous laisse mortels, elle vous laisse pécheurs et vous charge devant Dieu d’un plus
grand compte.
(1 citation de la Bible, \"Psaume 81\") Texte XII - Extrait de Politique tirée de l’Ecriture sainte,
de Bossuet
Le Commentaire
Méla ncholia - EXTRAIT
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs, que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ; Ils vont, de l’aube au soir, faire
éternellement
Dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. Il
fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu :\"Petits comme nous sommes, Notre père, voyez ce que nous font les hommes
!\"
Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, La beauté sur les fronts, dans les cœurs la
pensée, Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain - D’Apollon un bossu, de Voltaire un
crétin !
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !
Les Contemplations (1856) Victor Hugo
Médiocrité
Dans l’Infini criblé d’éternelles splendeurs, Perdu comme un atome, inconnu, solitaire,
Pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre
Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs.
Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, Marchent, insoucieux de l’immense mystère,
Et quand ils voient passer un des leurs qu’on enterre, Saluent, et ne sont pas hérissés de
stupeurs.
La plupart vit et meurt sans soupçonner l’histoire
Du globe, sa misère en l’éternelle gloire, Sa future agonie au soleil moribond.
Vertiges d’univers, cieux à jamais en fête !
Rien, ils n’auront rien su. Combien même s’en vont
Sans avoir seulement visité leur planète.
(1902) Jules Laforgue
Les Étoiles
(vers 49 à 72)
Cependant la nuit marche, et sur l’abîme immense
Tous ces mondes flottants gravitent en silence,
Et nous-même1, avec eux emportés dans leurs cours, Vers un port inconnu nous avançons toujours.
Souvent pendant la nuit, au souffle du zéphire,
On sent la terre aussi flotter comme un navire ; D’une écume brillante on voit les monts couverts
Fendre d’un cours égal le flot grondant des airs ; Sur ces vagues d’azur où le globe se joue,
On entend l’aquilon se briser sous la proue,
Et du vent dans les mâts les tristes sifflements,
Et de ses flancs battus les sourds gémissements ; Et l’homme, sur l’abîme où sa demeure flotte,
Vogue avec volupté sur la foi du2 pilote !
Soleils, mondes errants qui voguez avec nous, Dites, s’il vous l’a dit, où donc allons-nous tous ?
Quel est le port céleste où son souffle nous guide ? Quel terme assigna-t-il à notre vol rapide ?
Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, Echouant dans la nuit sur quelque vaste écueil,
Semer l’immensité des débris du naufrage ?
Ou, conduits par sa main sur un brillant rivage, Et sur l’ancre éternelle à jamais affermis,
Dans un golfe du ciel aborder endormis ?
1 nous-même : forme et orthographe de Lamartine ;
il faudrait \"nous-mêmes\"
2 sur la foi de :\"confiant dans\"
Lamartine : Nouvelles Méditations poétiques (1823)
Lorenz accio
Le bord de l’Arno.1
Marie Soderini, Catherine.
Catherine. - Le soleil commence à baisser. De larges bandes de pourpre traversent le feuillage, et
la grenouille fait sonner sous les roseaux sa
petite cloche de cristal. C’est une singulière chose que toutes les harmonies du soir, avec le
bruit lointain de cette ville.
5 Marie. - Il est temps de rentrer ; noue ton voile autour de ton cou.
Catherine. - Pas encore, à moins que vous n’ayez froid. Regardez, ma mère chérie2 ; que le ciel est
beau ! que tout cela est vaste et
tranquille ! comme Dieu est partout ! Mais vous baissez la tête ; vous êtes inquiète depuis ce
matin.
10 Marie. - Inquiète, non, mais affligée. N’as-tu pas entendu répéter cette fatale histoire de
Lorenzo ? Le voilà la fable de Florence3.
Catherine. - Ô ma mère, la lâcheté n’est point un crime ; le courage n’est pas une vertu. Pourquoi
la faiblesse est-elle blâmable ? Répondre des battements de son coeur est un triste privilège ;
Dieu
15 seul peut le rendre noble et digne d’admiration. Et pourquoi cet enfant n’aurait-il pas le
droit que nous avons toutes, nous autres femmes ? Une femme qui n’a peur de rien n’est pas aimable,
dit-on.
Marie. - Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu rougis, Catherine ; Lorenzo est ton neveu, tu ne peux
pas l’aimer. Mais figure-toi qu’il
20 s’appelle de tout autre nom, qu’en penserais-tu ? Quelle femme voudrait s’appuyer sur son
bras pour monter à cheval ? quel homme lui serrerait la main ?
Catherine. - Cela est triste ; et cependant ce n’est pas de cela que je le plains. Son coeur n’est
peut-être pas celui d’un Médicis ; mais, hélas !
25 c’est encore moins celui d’un honnête homme.
Marie. - N’en parlons pas, Catherine ; il est assez cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son
fils.
Catherine. - Ah ! cette Florence ! c’est là qu’on l’a perdu. N’ai -je pas vu briller quelquefois
dans ses yeux le feu d’une noble ambition ? Sa
30 jeunesse n’a-t-elle pas été l’aurore d’un soleil levant ? Et souvent encore aujourd’hui il
me semble qu’un éclair rapide... - Je me dis malgré moi que tout n’est pas mort en lui.
Marie. - Ah ! Tout cela est un abîme. Tant de facilité, un si doux amour de la solitude ! Ce ne
sera jamais un guerrier que mon Renzo, disais-je
35 en le voyant rentrer de son collège, tout baigné de sueur, avec
ses gros livres sous le bras ; mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses
yeux noirs ; il lui fallait s’inquiéter de tout, dire sans cesse :\"Celui-là est pauvre, celui-là
est ruiné ; comment faire ? \" Et cette admiration pour les grands hommes de son
40 Plutarque4 ! Catherine, Catherine, que de fois je l’ai baisé au front, en pensant au père
de la patrie5 !
Catherine. - Ne vous affligez pas.
Marie. - Je dis que je ne veux pas parler de lui, et j’en parle sans cesse. Il y a de certaines
choses, vois-tu, les mères ne s’en taisent que
45 dans le silence éternel. Que mon fils eût été un débauché
vulgaire ; que le sang des Soderini6 eût été pâle dans cette faible goutte tombée de mes veines,
je ne me désespérerais pas ; mais j’ai espéré,
et j’ai eu raison de le faire. Ah ! Catherine, il n’est même plus beau ;
comme une fumée malfaisante, la souillure de son cœur lui est
50 montée au visage. Le sourire, ce doux épanouissement qui rend la jeunesse semblable aux
fleurs, s’est enfui de ses joues couleur de soufre, pour y laisser grommeler une ironie ignoble, et
le mépris de tout. Catherine. - Il est encore beau quelquefois dans sa mélancolie étrange. Marie. -
Sa naissance ne l’appelait-elle pas au trône7 ? N’aurait-il
55 pas pu y faire monter un jour avec lui la science d’un docteur, la plus elle jeunesse du
monde, et couronner d’un diadème d’or tous mes songes chéris ? Ne devais-je pas m’attendre à cela ?
Ah ! Cattina8, pour dormir tranquille, il faut n’avoir jamais fait certains rêves. Cela est trop
cruel d’avoir vécu dans un palais de fées, où murmuraient les
60 cantiques des anges, de s’y être endormie, bercée par son fils, et de se éveiller dans une
masure ensanglantée, pleine de débris d’orgie et de restes humains, dans les bras d’un spectre
hideux qui vous tue en vous appelant encore du nom de mère.
Catherine. - Des ombres silencieuses commencent à marcher sur la
65 route ; rentrons, Marie, tous ces bannis me font peur.
Marie. - Pauvres gens ! ils ne doivent que faire pitié ! Ah ! ne puis-je voir un seul objet qu’il
ne m’entre une épine dans le cœur ? Ne puis-je plus ouvrir les yeux ? Hélas ! ma Cattina, ceci est
encore l’ouvrage de
70 Lorenzo. Tous ces pauvres bourgeois ont eu confiance en lui ; il
n’en est pas un, parmi tous ces pères de famille chassés de leur patrie,
que mon fils n’ait pas trahi. Leurs lettres, signées de leur nom, sont montrées au duc. C’est ainsi
qu’il fait tourner à un infâme usage jusqu’à la glorieuse mémoire de ses aïeux. Les républicains
s’adressent à lui
75 comme à l’antique rejeton de leur protecteur ; sa maison leur est ouverte, les Strozzi
eux-mêmes y viennent. Pauvre Philippe ! il y aura une triste fin pour tes cheveux gris ! Ah ! ne
puis-je voir une fille sans pudeur, un malheureux privé de sa famille, sans que tout cela ne me
crie : Tu es la mère de nos malheurs ! Quand serai-je là ? (Elle frappe
80 la terre)
Catherine. - Ma pauvre mère, vos larmes se gagnent.
(Elles s’éloignent. - Le soleil est couché. - Un groupe de bannis se
forme au milieu d’un champ.)
Un des Bannis. - Où allez-vous ?
85 Un Autre. - À Pise ; et vous ?
Le Premier - À Rome.
Un Autre. - Et moi à Venise ; en voilà deux qui vont à Ferrare ; que deviendrons-nous ainsi
éloignés les uns des autres ?
Un Quatrième. - Adieu, voisin, à des temps meilleurs.
90 (Il s’en va)
Le Second. - Adieu ; pour nous, nous pouvons aller ensemble jusqu’à la croix de la Vierge.
(Il sort avec un autre. - Arrive Maffio.)
Le Premier Banni. - C’est toi, Maffio ? Par quel hasard es-tu ici ?
95 Maffio. - Je suis des vôtres. Vous saurez que le duc a enlevé ma soeur ; j’ai tiré l’épée ;
une espèce de tigre avec des membres de fer s’est jeté à mon cou, et m’a désarmé ; après quoi j’ai
reçu l’ordre de sortir de la ville, et une bourse à moitié pleine de ducats.
100 Le Second Banni. - Et ta soeur, où est-elle ?
Maffio. - On me l’a montrée ce soir sortant du spectacle, dans une robe comme n’en a pas
l’impératrice ; que Dieu lui pardonne ! Une vieille l’accompagnait, qui a laissé trois de ses dents
à la sortie. Jamais je n’ai donné de ma vie un coup de poing qui m’ait fait ce plaisir-là.
105 Troisième Banni. - Qu’ils crèvent tous dans leur fange
crapuleuse, et nous mourrons contents.
Le Quatrième. - Philippe Strozzi nous écrira à Venise ; quelque jour nous serons tous étonnés de
trouver une armée à nos ordres. Le Troisième. - Que Philippe vive longtemps ! Tant qu’il y aura un
110 cheveu sur sa tête, la liberté de l’Italie n’est pas morte. (Une partie du groupe se détache
; tous les bannis s’embrassent.) Une voix. - À des temps meilleurs.
Une Autre. - À des temps meilleurs. (Deux bannis montent sur une plate-forme d’où l’on découvre la
ville.)
115 Le Premier. - Adieu, Florence, peste de l’Italie ; adieu, mère stérile, qui n’as plus de
lait pour tes enfants.
Le Second. - Adieu, Florence la bâtarde, spectre hideux de l’antique
Florence ; adieu, fange sans nom.
Tous les Bannis. - Adieu , Florence ! maudites soient les mamelles de
120 tes femmes ! maudits soient tes sanglots ! maudites les prières de tes églises, le pain de
tes blés, l’air de tes rues ! Malédiction sur
la dernière goutte de ton sang corrompu !
Lorenzaccio (1834)
Le Mal
Tandis que les crachats rouges de la mitraille Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;
Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu’une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ;
- Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie, Nature ! ô toi qui fis ces hommes
saintement !...
— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ;
Qui dans le bercement des hosannah s’endort,
Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !
Arthur Rimbaud.(sept./oct. 1870)
Sujets préparatoires aux nouvelles épreuves
Corpus 1
Heureux qui, comme Ulysse,
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestui-là qui conquit la toison ,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je
le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains le front audacieux ; Plus que
le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, Plus mon petit Liré que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.
Du Bellay - Les Regrets
\"Heureux qui, comme Ulysse\" - Regrets XXXI
Les deux Pigeons
Deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre : L'un d'eux, s'ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L'autre lui dit : \"Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère ? L'absence est le plus
grand des maux :
Non pas pour vous, cruel ! Au moins, que les travaux, Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage.
Encor, si la saison s'avançait d'avantage !
Attendez les zéphyrs : qui vous presse ? un corbeau Tout à l'heure annonçait malheur à quelque
oiseau : Je ne songerai plus que rencontre funeste,
Que faucons, que réseaux. \"Hélas ! dirai-je, il pleut : \"Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,
\"Bon souper, bon gîte, et le reste ?\"
Ce discours ébranla le cœur
De notre imprudent voyageur ;
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète L'emportèrent enfin. Il dit : \"Ne pleurez point ; Trois
jours au plus rendront mon âme satisfaite ; Je reviendrai dans peu conter de point en point Mes
aventures à mon frère ;
Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint Vous sera
d'un plaisir extrême.
Je dirai : \"J'étais là ; telle chose m'avint\" ;
Vous y croirez être vous-même\".
À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne ; et voilà qu'un nuage L'oblige
de chercher retraite en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage Maltraita le
Pigeon en dépit du feuillage.
L'air devenu serein, il part tout morfondu,
Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie, Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,
Voit un pigeon auprès : cela lui donne envie ; Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d'un las
Les menteurs et traîtres appas.
Le las était usé : si bien que, de son aile,
De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin : Quelque plume y périt ; et le pis du destin
Fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle Et
les morceaux du las qui l'avait attrapé, Semblait un forçat échappé.
Le vautour s'en allait le lier, quand des nues Fond à son tour un aigle aux ailes étendues. Le
Pigeon profita du conflit des voleurs, S'envola, s'abattit auprès d'une masure, Crut, pour ce coup,
que ses malheurs Finiraient par cette aventure ;
Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié) Prit sa fronde et, du coup, tua plus d'à moitié La
volatile malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité, Traînant l'aile et tirant le pied, Demi-morte et demi-boiteuse, Droit
au logis s'en retourna : Que bien, que mal, elle arriva Sans autre aventure fâcheuse.
Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.
La Fontaine - Fables
\"Les deux Pigeons\" - Livre IX, fable II (extrait)
La chèvre de M. Seguin
[M. Seguin a perdu successivement six chèvres qui, après avoir cassé leur corde, se sont enfuies
dans la montagne où le loup les a dévorées. Pourtant, sans céder au découragement, il en achète une
septième, qu'il choisit très jeune pour qu'elle s'habitue à son territoire ; il la nomme
Blanquette.]
M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle
pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser
beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait
très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi.
\"Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi
!\"
M. Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya.
Un jour, elle se dit en regardant la montagne :
\"Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite
longe qui vous écorche le cou ! … C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos ! …
Les chèvres, il leur faut du large.\"
À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se
fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la
montagne, la narine ouverte, en faisant Mê ! … tristement.
M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que
c'était… Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois
:
\"Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne.
- Ah ! mon Dieu ! … Elle aussi !\" cria M. Seguin stupéfait, et du coup il laissa tomber son écuelle
; puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre :
\"Comment, Blanquette, tu veux me quitter !\" Et Blanquette répondit :
\"Oui, monsieur Seguin.
- Est-ce-que l'herbe te manque ici ?
- Oh ! non ! monsieur Seguin.
- Tu es peut-être attachée de trop court ; veux-tu que j'allonge la corde ?
- Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin.
- Alors, qu'est-ce-qu'il te faut ! qu'est-ce-que tu veux ?
- Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin.
- Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne…que feras-tu quand il
viendra ? …
- Je lui donnerai des coups de cornes, monsieur Seguin.\"
[Blanquette réussit à schapper et va dans la montagne]
La chèvre blanche, à moitié soûle, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des
talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes… Puis, tout à coup, elle se redressait
d'un bond sur ses pattes. Hop ! la voilà partie la tête en avant, à travers les maquis et les
buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout … On aurait dit
qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne.
C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette.
Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide
et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelque roche plate et se faisait
sécher par le soleil… Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents,
elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela
la fit rire aux larmes.
\"Que c'est petit ! dit-elle ; comment ai-je pu tenir là-dedans ?\" […]
Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette ; c'était le soir… […]
Elle pensa au loup ; de tout le jour la folle n'y avait pas pensé…
[…]
Blanquette eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle
pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester.
Daudet - Les Lettres de mon moulin
\"La chèvre de M. Seguin\" (extraits)
Hannon
[L'action se situe à la suite de la première guerre punique (241 av. J.C) ; les mercenaires
recrutés par Carthage pour combattre les armées romaines en Sicile n'ont pas été payés. Ils
entreprennent contre elle une guerre ; il y a dans leurs rangs des hommes de tous les pays ;
certains
souffrent particulièrement de ce siège dans les sables du désert.]
Souvent, au milieu du jour, le soleil perdait ses rayons tout à coup. Alors, le golfe et la pleine
mer semblaient immobiles comme du plomb fondu. Un nuage de poussière brune, perpendiculairement
étalé, accourait en tourbillonnant ; les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait, on
entendait rebondir des pierres sur la croupe des animaux ; et le Gaulois, les lèvres collées contre
les trous de sa tente, râlait d'épuisement et de mélancolie. Il songeait à la senteur des pâturages
par les matins d'automne, à des flocons de neige, aux beuglements des aurochs perdus dans le
brouillard, et fermant ses paupières, il croyait apercevoir les feux des longues cabanes, couvertes
de paille, trembler sur les marais, au fond des bois.
Flaubert - Salammbô
\"Hannon\" (extrait)
Corpus 2
Premier récit de la création (extraits)
[ Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, crée la lumière, la sépare des ténèbres et les nomme
jour et nuit]
Dieu dit : \"Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux\"
et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec
les eaux qui sont au- dessus du firmament et Dieu appela le firmament \"ciel\". Il y eut un soir et
il y eut un matin : deuxième jour.
[Dieu fait apparaître les continents, puis crée les végétaux.]
Dieu dit : \"Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit :
qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années : qu'ils soient des
luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre\" et il en fut ainsi. Dieu fit les deux
luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme
puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour.
[ Dieu crée ensuite les êtres vivants, puis en dernier l'homme et la femme qu'il crée à son image.]
Dieu les bénit et leur dit : \"Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ;
dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la
terre. (…)\"
.
La Bible - La Genèse
\"Premier récit de la création\" (extraits)
Disproportion de l' Homme
Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue
des objets bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe
éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour
que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe
délicate à l'égard de celui que ces astres, qui roulent dans le firmament, embrassent. Mais si
notre vue s'arrête là que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la
nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la
nature. Nulle idée n'en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces
imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère
infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c'est le plus grand
caractère sensible de la toute-puissance de
Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée.
Que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme
égaré, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer
la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même, son juste prix.
Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ?
Pascal - Pensées [199 72] \"Disproportion de l'Homme\"
Les Étoiles (vers 49 à 72)
Cependant la nuit marche, et sur l'abîme immense
Tous ces mondes flottants gravitent en silence,
Et nous-même, avec eux emportés dans leur cours, Vers un port inconnu nous avançons toujours.
Souvent pendant la nuit, au souffle du zéphire,
On sent la terre aussi flotter comme un navire ; D'une écume brillante on voit les monts couverts
Fendre d'un cours égal le flot grondant des airs ; Sur ces vagues d'azur où le globe se joue,
On entend l'aquilon se briser sous la proue,
Et du vent dans les mâts les tristes sifflements,
Et de ses flancs battus les sourds gémissements ; Et l'homme, sur l'abîme où sa demeure flotte,
Vogue avec volupté sur la foi du pilote !
Soleils, mondes errants qui voguez avec nous, Dites, s'il vous l'a dit, où donc allons-nous tous ?
Quel est le port céleste où son souffle nous guide ? Quel terme assigna-t-il à notre vol rapide ?
Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, Échouant dans la nuit sur quelque vaste écueil,
Semer l'immensité des débris du naufrage ?
Ou, conduits par sa main sur un brillant rivage, Et sur l'ancre éternelle à jamais affermis,
Dans un golfe du ciel aborder endormis ?
Lamartine - Les Nouvelles Méditations
\"Les Étoiles\" (extrait)
À la fenêtre pendant la nuit
III
Dieu n'a-t-il plus de flamme à ses lèvres profondes ? N'en fait-il plus jaillir des tourbillons de
mondes ?
Parlez, Nord et Midi !
N'emplit-il plus de lui sa création sainte ?
Et ne souffle-t-il plus que d'une bouche éteinte
Sur l'être refroidi ?
Quand les comètes vont et viennent, formidables, Apportant la lueur des gouffres insondables
À nos fronts soucieux,
Brûlant, volant, peut-être âme, peut-être monde, Savons-nous ce que font toutes ces vagabondes
Qui courent dans nos cieux ?
Qui donc a vu la source et connaît l'origine ? Qui donc, ayant sondé l'abîme, s'imagine
En être mage et roi ?
Ah ! fantômes humains, courbés sous les désastres ! Qui donc a dit : - C'est bien, Éternel, assez
d'astres.
N'en fais plus. Calme-toi !-
L'effet séditieux limiterait la cause ?
Quelle bouche ici-bas peut dire à quelque chose : Tu n'iras pas plus loin ?
Sous l'élargissement sans fin, la borne plie ; La création vit, croît et se multiplie ;
L'homme n'est qu'un témoin.
L'homme n'est qu'un témoin frémissant d'épouvante. Les firmaments sont pleins de la sève vivante
Comme les animaux.
L'arbre prodigieux croise, agrandit, transforme,
Et mêle aux cieux profonds, comme une gerbe énorme,
Ses ténébreux rameaux.
Car la création est devant, Dieu derrière. L'homme, du côté noir de l'obscure barrière,
Vit, rôdeur curieux ;
Il suffit que son front se lève pour qu'il voie
À travers la sinistre et morne claire-voie
Cet œil mystérieux.
IV
Donc ne nous disons pas : - Nous avons nos étoiles.- Des flottes de soleils peut-être à pleines
voiles
Viennent en ce moment ;
Peut-être que demain le créateur terrible
Refaisant notre nuit, va contre un autre crible
Changer le firmament.
Qui sait ? que savons-nous ? Sur notre horizon sombre,
Que la création impénétrable encombre
De ses taillis sacrés,
Muraille obscure où vient battre le flot de l'être, Peut-être allons-nous voir brusquement
apparaître Des astres effarés ;
Des astres éperdus arrivant des abîmes,
Venant des profondeurs ou descendant des cimes, Et, sous nos noirs arceaux,
Entrant en foule, épars, ardents, pareils au rêve,
Comme par un grand vent s'abat sur une grève
Une troupe d'oiseaux ;
Surgissant, clairs flambeaux, feux purs, rouges fournaises,
Aigrettes de rubis ou tourbillons de braises,
Sur nos bois, sur nos monts,
Et nous pétrifiant de leurs aspects étranges ;
Car dans le gouffre énorme il est des mondes anges
Et des soleils démons !
Peut-être en ce moment, du fond des nuits funèbres, Montant vers nous, gonflant ses vagues de
ténèbres Et ses flots de rayons,
Le muet Infini, sombre mer ignorée, Roule vers notre ciel une grande marée
De constellations !
Marine-Terrace, avril 1854
Hugo - Les Contemplations \"À la fenêtre pendant la nuit\" (extrait)
Crépuscule de Dimanche d'été
[…]
Et peu à peu je songe aux choses éternelles, Au-dessus des rumeurs qui montent de Paris.
Oh ! tout là-bas… par la nuit du mystère,
Où donc es-tu, depuis tant d'astres, à présent… Ô fleuve chaotique, ô Nébuleuse-mère,
Dont sortit le Soleil, notre père puissant ?
Où sont tous les soleils qui sur ta longue route
Bondirent, radieux, de tes flancs jamais las ?
Ah ! ces frères du nôtre, ils sont heureux sans doute
Et nous ont oubliés, ou ne nous savent pas.
Comme nous sommes seuls, pourtant sur notre terre, Avec notre infini, nos misères, nos dieux,
Abandonnés de tout, sans amour et sans père,
Seuls dans l'affolement universel des Cieux !
Jules Laforgue - Poèmes posthumes divers
\"Crépuscule de Dimanche d'été\" (extrait)
Corpus 3
Disproportion de l'Homme
Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue
des objets bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe
éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour
que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe
délicate à l'égard de celui que ces astres, qui roulent dans le firmament, embrassent. Mais si
notre vue s'arrête là que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la
nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la
nature. Nulle idée n'en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces
imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère
infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c'est le plus grand
caractère sensible de la toute-puissance de
Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée.
Que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme
égaré, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer
la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même, son juste prix.
Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ?
Pascal - Pensées [199 72] \"Disproportion de l'Homme\"
Hugo - Les Châtiments - \"Stella\" - (Livre VI, poème XV)
Je m'étais endormi la nuit près de la grève. Un vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve,
J'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin.
Elle resplendissait au fond du ciel lointain
05 Dans une blancheur molle, infinie et charmante.
Aquilon s'enfuyait emportant la tourmente. L'astre éclatant changeait la nuée en duvet. C'était une
clarté qui pensait, qui vivait ;
Elle apaisait l'écueil où la vague déferle ;
10 On croyait voir une âme à travers une perle.
Il faisait nuit encore, l'ombre régnait en vain, Le ciel s'illuminait d'un sourire divin.
La lueur argentait le haut du mât qui penche ; Le navire était noir, mais la voile était blanche ;
15 Des goélands debout sur un escarpement, Attentifs, contemplaient l'étoile gravement Comme
un oiseau céleste et fait d'une étincelle ; L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle, Et,
rugissant tout bas, la regardait briller,
20 Et semblait avoir peur de la faire envoler.
Un ineffable amour emplissait l'étendue. L'herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue, Les oiseaux
se parlaient dans les nids ; une fleur Qui s'éveillait me dit : c'est l'étoile ma sœur.
25 Et pendant qu'à longs plis l'ombre levait son voile, J'entendis une voix qui venait de
l'étoile
Et qui disait :- je suis l'astre qui vient d'abord.
Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort. J'ai lui sur le Sina, j'ai lui sur le Taygète
;
30 Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, Comme avec une fronde, au front noir de
la nuit. Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit. O nations ! je suis la poésie ardente.
J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante.
35 Le lion océan est amoureux de moi.
J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi ! Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles !
Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles, Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,
40 Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit, C'est celui qui m'envoie en avant la
première, C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière !
31 août. Jersey.
Victor Hugo
Des astres, de la vie et des hommes
Tâchons de mieux nous représenter ces distances démesurées en usant d'une analogie. Imaginons que
le Soleil soit une orange ; à cette échelle, la Terre est un grain de sable qui tourne autour de
l'orange à une distance de neuf mètres ; Jupiter, la planète géante,
onze fois plus grosse que la Terre, un noyau de cerise gravitant à une distance de soixante
mètres, soit un pâté de maisons ; Saturne est un autre noyau de
cerise à deux pâtés de maisons du Soleil.
À la même échelle, la distance moyenne qui sépare les étoiles est de trois mille cinq cents
kilomètres. Le voisin le plus proche du Soleil, une étoile nommée Alpha Proxima du Centaure, en
est éloigné de deux mille kilomètres. L'espace entourant le Soleil et ses voisins ne contient
qu'un semis clairsemé d'atomes d'hydrogène, et forme un vide bien plus absolu que tous ceux que
l'on peut réaliser sur terre. À cette échelle, la Galaxie est un tas d'oranges séparées les unes
des autres par une distance moyenne de trois mille cinq cents kilomètres, ce tas mesurant dans sa
totalité trente-cinq millions de kilomètres de diamètre.
Une orange, quelques grains de sable à quelques mètres, puis deux ou trois noyaux de cerises
tournant lentement autour de l'orange à la distance d'un pâté de maisons. À trois mille cinq cents
kilomètres de là tourne une autre orange environnée, qui sait, de quelques fragments de matière
gravitant autour d'elle. C'est cela, le vide de l'espace.
Robert Jastrow
Médiocrité
Dans l’Infini criblé d’éternelles splendeurs, Perdu comme un atome, inconnu, solitaire,
Pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre
Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs.
Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, Marchent, insoucieux de l’immense mystère,
Et quand ils voient passer un des leurs qu’on enterre, Saluent, et ne sont pas hérissés de
stupeurs.
La plupart vit et meurt sans soupçonner l’histoire
Du globe, sa misère en l’éternelle gloire, Sa future agonie au soleil moribond.
Vertiges d’univers, cieux à jamais en fête !
Rien, ils n’auront rien su. Combien même s’en vont
Sans avoir seulement visité leur planète.
(1902) Jules Laforgue
L’Apologue
La Fable
Étude détaillée de deux fables
Les Animaux malades de la Peste (Livre VII, fable I)
Un mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom), Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : On n'en voyait point d'occupés
À chercher le soutien d'une mourante vie; Nul mets n'excitait leur envie ;
Ni loups ni renards n'épiaient La douce et l'innocente proie ; Les tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : \"Mes chers amis, Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux ; Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire
nous apprend qu'en de tels accidents On fait de pareils dévouements.
Ne nous flattons donc point: voyons sans indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, J'ai dévoré force moutons.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense ;
Même il m'est arrivé quelquefois de manger
Le berger.
Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi
: Car on doit souhaiter, selon toute justice,
Que le plus coupable périsse.
- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon roi ; Vos scrupules font voir trop de délicatesse.
Eh bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, En les croquant, beaucoup d'honneur ;
Et quant au berger, l'on peut dire
Qu'il était digne de tous maux,
Étant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.\"
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances, Les moins pardonnables offenses :
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, Au dire de chacun étaient de petits saints.
L'Âne vint à son tour, et dit : \"J'ai souvenance
Qu'en un pré de moines passant,
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.\" À ces mots on cria haro sur le Baudet.
Un Loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
La Fontaine
Le Loup et l'Agneau (Livre I, fable X)
La raison du plus fort est toujours la meilleure : Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure, Et que la faim en ces lieux attirait.
\"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond l'agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ; Mais plutôt qu'elle considère Que je me vas désaltérant Dans le courant
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle :
Et que, par conséquent, en aucune façon, Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle ; Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau ; je tette encor ma mère.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit: il faut que je me venge.\" Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
La Fontaine
D’autres formes d’apologues
Souvenir de la nuit du 4
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand'mère était là qui pleurait.
05 Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil
farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
10 Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend.
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant : - Comme il est blanc ! approchez donc la lampe ! Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés
sur sa tempe ! -
15 Et quand se fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
-- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer.
20 L'aïeule cependant l'approchait du foyer,
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,
25 Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une
lettre,
30 C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être !
35 Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte
; Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
40 Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
-- Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas
! je n'avais plus de sa mère que lui.
45 Pourquoi l'a-t-on tué ? je veux qu'on me l'explique.
L'enfant n'a pas crié vive la République. -
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.
Vous ne compreniez point, mère, la politique.
50 Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique,
Est pauvre et même prince ; il aime les palais ; Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
55 La Famille, l'Église et la Société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères, De leurs pauvres doigts gris que fait
trembler le temps,
60 Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 décembre 1852
V. Hugo - Les Châtiments
Choses vues
Hier, 22 février 1846, j'allais à la Chambre des Pairs. Il faisait très froid, malgré le soleil et
midi. Je vis venir rue de Tournon un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond,
pâle, maigre, hagard ; trente ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et
écorchés dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pourtenir lieu de
bas ; une blouse courte, souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait
habituellement sur le pavé ; la tête nue et hérissée. Il avait sous le bras un pain. Le peuple
disait autour de
lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la
caserne de gendarmerie, un des soldats y entra, et l'homme resta à la porte, gardé par l'autre
soldat.
Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée portant aux
lanternes une couronne ducale, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les
glaces étaient levées, mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas bouton d'or. Le regard de
l'homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme en chapeau
rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un
charmant petit enfant de seize mois enfoui sous les rubans, les dentelles et les fourrures.
Cette femme ne voyait pas l'homme terrible qui la regardait.
Je demeurai pensif.
Cet homme n'était plus pour moi un homme, c'était le spectre de la misère, c'était l'apparition,
difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d'une révolution encore plongée dans les
ténèbres, mais qui vient. Autrefois le pauvre coudoyait le riche, ce spectre rencontrait cette
gloire ; mais on ne se regardait pas. On passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Du moment où
cet homme s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne s'aperçoit pas que cet homme
est là, la catastrophe est inévitable.
- Victor Hugo (1802-1885)
La légende de l’homme à la cervelle d’or
[Daudet s'adresse à un destinataire avoué, une dame, et se reproche de raconter une fois encore
\"une légende mélancolique\".]
Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or ; oui, madame, une cervelle toute en or.
Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était
lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil, comme un beau plant
d'olivier ; seulement sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à
tous les meubles en marchant… Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut du perron et vint
donner du front contre un degré de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort ;
mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure, avec deux ou trois gouttelettes d'or
caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une
cervelle en or. (…)
[Les parents de l'enfant tiennent la chose secrète ; ils lui font mener une vie à l'écart des
autres enfants, et ne lui révèlent son secret qu'à l'âge de dix-huit ans ; et eux les premiers, ils
lui demandent un peu de son or en retour des sacrifices qu'ils ont fait pour l'élever. Le jeune
homme n'hésite pas ; il s'arrache du crâne un morceau d'or et le donne à ses parents. Puis il va
mener joyeuse vie. Il vit dans une perpétuelle débauche et dilapide son trésor jusqu'au jour où il
réalise combien son lingot est entamé. Il change alors d'existence, devient solitaire, soupçonneux.
Une nuit pourtant, un ami qui lui reste du temps de sa magnificence lui vole encor de l'or de son
crâne. Enfin l'homme à la cervelle d'or tombe amoureux de toute son âme d'une jeune femme charmante
mais superficielle et frivole. Pour elle il dépense sans compter et se détruit.]
- Nous sommes donc bien riches ? disait-elle. Le pauvre homme répondait :
- Oh ? oui…bien riches !
Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment.
Quelquefois cependant la peur le prenait, il avait des envies d'être avare ; mais alors la petite
femme venait vers lui en sautillant, et lui disait :
- Mon mari, qui êtes si riche ! achetez-moi quelque chose de bien cher…
[Cet état de choses dure ainsi pendant deux années, au bout desquelles la jeune femme meurt. Il
reste à l'homme à la cervelle d'or assez d'argent pour un bel enterrement. Il distribue autour de
lui ce qui lui reste de son or, qui n'offre pour lui plus d'intérêt, maintenant.]
Alors on le vit s'en aller dans les rues, l'air égaré, les mains en avant, trébuchant comme un
homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine
dans laquelle tout un fouillis d'étoiles et de parures reluisait aux lumières, et resta là
longtemps à regarder deux bottines de satin bleu bordées de duvet de cygne. \"Je sais quelqu'un à
qui ces bottines feraient plaisir\", se disait-il en souriant : et, ne se souvenant déjà plus que la
petite femme était morte, il entra pour les acheter.
Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri ; elle
accourut et recula de peur en voyant un homme debout, qui s'accotait au comptoir et la regardait
douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne, et
présentait l'autre main toute sanglante, avec des raclures d'or au bout des ongles.
Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or.
Malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre…Il y a par le
monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau, et payent en bel or fin, avec
leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque
jour ; et puis, quand ils sont las de souffrir…
Les Lettres de mon moulin – Daudet
La parabole de l’enfant prodigue
La parabole de l'enfant prodigue est la dernière des trois paraboles de la miséricorde, les deux
autres étant \"la brebis perdue\" et \"la drachme perdue\".
Cependant les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de lui [Jésus] pour l'entendre. Et les
Pharisiens et les scribes de murmurer : \"Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil aux pécheurs et
mange avec eux !\" Il leur dit alors cette parabole :
(la brebis perdue, la drachme perdue)
Il dit encore : \"Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :
\"Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.\" Et le père partagea son bien. Peu de jours
après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et y dissipa
son bien dans une vie de prodigue.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il commença à sentir la
privation. Il alla se mettre au service de l'un des habitants de la contrée, qui l'envoya dans ses
champs garder ses cochons. Il aurait bien voulu se remplir
le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors
en lui-même, il se dit : \"Combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance, et moi je
suis ici à mourir de faim ! Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire : Père, j'ai péché
contre le Ciel et contre toi ; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de
tes journaliers.\" Il partit donc et s'en retourna chez son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion ; il courut se jeter à
son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit : \"Père, j'ai péché contre le Ciel et
contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils.\" Mais le père dit à ses serviteurs : \"Vite,
apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez- lui un anneau au doigt et des chaussures aux
pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il
est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé !\" Et ils se mirent à festoyer.
Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la
musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci
lui dit : \"C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a
recouvré en bonne santé.\" Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit pour l'en
prier. Mais il répondit à son père : \"Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais
transgressé un seul de tes ordres,
et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi, pour festoyer avec mes amis ; et puis ton fils que
voilà revient-il, après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras
!\"
Mais le père lui dit : \"Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à
toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est
revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé !\"
(La Bible - le nouveau testament, évangile de Luc, 15 - 1 à 32)
La Poésie
Le sonnet, poème à forme fixe
Étude de quarante sonnets
Vers dorés
Eh quoi ! tout est sensible. Pythagore
Homme, libre penseur ! te crois-tu seul pensant Dans ce monde où la vie éclate en toute chose ? Des
forces que tu tiens ta liberté dispose,
Mais de tous tes conseils l'univers est absent.
Respecte dans la bête un esprit agissant : Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ; Un mystère
d'amour dans le métal repose ;
\"Tout est sensible !\" Et tout sur ton être est puissant.
Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie : À la matière même un verbe est attaché...
Ne la fais pas servir à quelque usage impie !
Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché ;
Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des
pierres !
Les Chimères – 1854
Gérard de Nerval
Bataille navale
Fragment
Les flottes d'un élan se sont jointes : le choc Retentit formidable, et roule, et se disperse ; Le
ciel s'est obscurci sous une noire averse
De traits, et les flots lourds se heurtent tout d'un bloc.
De nos vaisseaux Arès se sert comme d'un soc Pour labourer ses champs. Les navires du Perse Se sont
cabrés, et sous le rostre qui les perce, Refoulés vers la rive, éclatent sur le roc.
La nuit monte, et toujours luttent les plus illustres... Sur le pont, à la proue, accrochés aux
aplustres*. Mais voici que la lune épanche sa clarté...
Et l'on voit, tout à coup, resplendir la Patrie, Les sommets glorieux et le golfe argenté,
Et la mer, libre enfin, de cadavres fleurie.
*aplustres : ornements de poupe du vaisseau
La Cithare – 1897
Valère Gille
Midi
La nature se tait.- La rivière et la plaine Ont l'immobilité muette de la mort ; L'anéantissement,
pesant comme un remords, Écrase les rumeurs dont la terre était pleine ;
Nul bruit ; l'on entendrait le vol d'une phalène ; Les oiseaux haletants éteignent leurs voix d'or
;
Et l'homme, au bercement de son hamac, s'endort
Sous les feuilles qu'effleure une fiévreuse haleine.
Ainsi le sommeil lourd, enivrant, anxieux, Porté par les rayons, glisse le long des cieux Où le
soleil lassé mollement se balance...
Tandis que la paresse impassible descend Sur les sens assoupis du monde languissant, Ma pensée
engourdie écoute le silence.
Fleurs du Mé-Kong – 1894
Maurice Olivaint
Fleur des Ruines
Mon cœur vaincu n'est plus que ruine et décombres, Tel qu'un vieux burg* battu des hiboux au vol
noir. Entre les quatre murs dévastés, chaque soir, Tournent des revenants effrayants et sans
nombre.
Le jour, les hautes tours d'autrefois font tant d'ombre Que, même en plein midi, l'on peut à peine
y voir ; La solitude y donne asile au désespoir ;
Un silence accablant pèse sur le roc sombre.
Tout est ténèbres, deuil, désert, effondrement ; Tout s'effrite et s'écroule, et l'on ne sait
comment La pierre peut encor s'accrocher à la pierre.
Mais là, dans les débris désolants du passé, Sous un rayon glissant par une meurtrière, Une petite
fleur - ton amour - a poussé.
*Burg : forteresse
Astarté – 1903
Victor d'Auriac
Pâles esprits...
Pâles esprits, et vous, ombres poudreuses, Qui, jouissant de la clarté du jour,
Fîtes sortir cet orgueilleux séjour
Dont nous voyons les reliques cendreuses ;
Dites, esprits (ainsi les ténébreuses Rives du Styx non passable au retour Vous enlaçant d'un trois
fois triple tour,
N'enferment point vos images ombreuses !),
Dites-moi donc ( car quelqu'une de vous, Possible encor, se cache ici dessous),
Ne sentez-vous augmenter votre peine,
Quand quelquefois de ces coteaux romains Vous contemplez l'ouvrage de vos mains N'être plus rien
qu'une poudreuse plaine ?
Antiquités de Rome, sonnet XV – 1558
Joachim du Bellay
L'Abreuvoir
En un creux de terrain aussi profond qu'un antre, Les étangs s'étalaient dans leur sommeil moiré,
Et servaient d'abreuvoir au bétail bigarré
Qui s'y baignait, le corps dans l'eau jusqu'à mi-ventre.
Les troupeaux descendaient, par des chemins penchants
Vaches à pas très lents, chevaux menés à l'amble,
Et les bœufs noirs et roux qui souvent, tous ensemble, Beuglaient, le cou tendu, vers les soleils
couchants.
Tout s'anéantissait dans la mort coutumière,
Dans la chute du jour : couleurs, parfums, lumière, Explosions de sève et splendeurs d'horizons ;
Des brouillards s'étendaient en linceuls aux moissons, Les routes s'enfonçaient dans le soir -
infinies,
Et les grands bœufs semblaient râler ces agonies.
Les Flamandes – 1883
Émile Verhaeren
Comme on passe en été...
Comme on passe en été le torrent sans danger, Qui soulait* en hiver être roi de la plaine
Et ravir par les champs, d'une fuite hautaine, L'espoir du laboureur et l'espoir du berger ;
Comme on voit les couards animaux outrager Le courageux lion gisant dessus l'arène, Ensanglanter
leurs dents et d'une audace vaine Provoquer l'ennemi qui ne se peut venger ;
Et comme devant Troie on vit des Grecs encor Braver les moins vaillants autour du corps d'Hector :
Ainsi ceux qui jadis soulaient *, à tête basse,
Du triomphe romain la gloire accompagner,
Sur ces poudreux tombeaux exercent leur audace, Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner.
Antiquités de Rome, XIV – 1558
Du Bellay
Pipée
À Charles Nodier.
J'aime en rimeur, presque en amant, Les sonnets, dont la troupe ailée S'ébat dans mon ciel, par
volée, Avec un frais gazouillement.
Appelant leur essaim charmant, Ma folâtre muse, isolée,
Au fond de la forêt voilée
Les pipe* à moi bien doucement.
Quand j'en tiens un, je le caresse
Avec bonheur, avec tendresse. Je le sens longtemps palpiter ;
Puis, en lissant sa jeune plume, Je l'encage dans mon volume, Le beau sonnet, pour y chanter.
Sonnets de la vie humaine – 1852
Evariste Boulay-Paty
*Piper : prendre à la pipée les oiseaux, en les attirant avec un pipeau, un appeau
Il a plu
Il a plu. Soir de juin. Écoute, Par la fenêtre large ouverte, Tomber le reste de l'averse
De feuille en feuille, goutte à goutte.
C'est l'heure choisie entre toutes Où flotte à travers la campagne L'odeur de vanille qu'exhale
La poussière humide des routes.
L'hirondelle joyeuse jase.
Le soleil déclinant se croise
Avec la nuit sur les collines ;
Et son mourant sourire essuie
Sur la chair pâle des glycines
Les cheveux d'argent de la pluie.
Le Cœur solitaire – 1898
Charles Guérin.
Je n'ai plus que les os...
Je n'ai plus que les os, un squelette je semble, Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé*,
Que le trait de la mort sans pardon a frappé ;
Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble.
Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, Ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé ;
Adieu, plaisant soleil ! Mon œil est étoupé*,
Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble.
Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, Ne remporte au logis un œil triste et mouillé, Me
consolant au lit et me baisant la face,
En essuyant mes yeux par la mort endormis ?
Adieu, chers compagnons ! Adieu, mes chers amis ! Je m'en vais le premier vous préparer la place.
Derniers Vers ,ed posth. – 1586
Pierre de Ronsard
*dépoulpé : sans pulpe - * étoupé : bouché, comme par de l'étoupe.
Po rtraits de mains
Si le Temps à jamais effaça dans l'oubli
Le sourire perdu de leurs bouches vivantes Son caprice a laissé les formes indolentes De leurs
mains se survivre en un pastel pâli.
Celle-ci tient encor l'œillet qu'elle a cueilli Toutes, tièdes de paix ou fébriles d'attentes,
Mains de mères, mains de vierges ou mains
d'amantes,
Cambrent leur grâce fière ou leur galbe joli.
Sur le jaune papier où ressort la sanguine
Le flexible bouquet de ces mains consanguines
Allonge de blancs doigts dont l'ongle fardé luit,
Et qui sait si jadis, au cadran des pendules, Elles n'ont pas touché par hâte ou par ennui
L'aiguille où l'heure avance et où le temps recule ?
Les Médailles d'argile – 1900
Henri de Régnier
Le Tombeau d'Egard Poe
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change, Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief !
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne,
Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur ,
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur !
Poésies –1877
Stéphane Mallarmé
Comme on voit sur la branche…
Comme on voit sur la branche, au mois de mai, ma rose,
En sa belle jeunesse, en sa première fleur, Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l'aube, de ses pleurs, au point du jour l'arrose ;
La Grâce dans sa feuille, et l'Amour se repose Embaumant les jardins et les arbres d'odeur Mais,
battue ou de pluie ou d'excessive ardeur,
Languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose ;
Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, La Parque
t'a tuée, et cendre tu reposes.
Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,
Afin que, vif et mort, ton corps ne soit que roses.
Amours de Marie, II, 4 – 1578
Pierre de Ronsard
Monsieur Prudhomme
Il est grave : il est maire et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux Dans
un rêve sans fin flottent insoucieux
Et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille.
Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille
Où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux, Et les prés verts et les gazons silencieux
?
Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille
Avec monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste-milieu, botaniste et pansu.
Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles,
Ces fainéants barbus, mal peignés, il les a
Plus en horreur que son éternel coryza,
Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles.
Poèmes Saturniens, Caprices V – 1866
Paul Verlaine
Les Colombes
Partout la mer unique étreint l'horizon nu, L'horizon désastreux où la vieille arche flotte ; Au
pied du mât penchant l'Espérance grelotte, Croisant ses bras transis sur son cœur ingénu.
Depuis mille et mille ans pareils, le soir venu, L'Âme assise à la barre, immobile pilote, Regarde
éperdument dans l'ombre qui sanglote Ses colombes s'enfuir vers le port inconnu.
Elles s'en vont là-bas, éparpillant leurs plumes À travers le vent fou qui les cingle d'écumes,
Ivres du vol sublime enfermé dans leurs flancs ;
Et, chaque lendemain, au jour blême et cynique, L'arche voit surnager leurs doux cadavres blancs,
Les deux ailes en croix sur la mer ironique.
Au jardin de l'Infante – 1893
Albert Samain
Mon âme a son secret
Imité de l'Italien
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère : Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
Hélas ! j'aurai passé près d'elle inaperçu, Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, Elle ira son chemin, distraite, et sans
entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas ;
À l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle :
\"Quelle est donc cette femme ?\" et ne comprendra pas.
Mes Heures perdues – 1833
Felix Arvers
Misère
Le vent rabat sur nous les brouillards de l'usine,
Tout craque au tournoiement sinistre des marteaux. Le soleil se refuse à luire aux hôpitaux,
Épouvanté du cri des femmes en gésine.
La maladie, active à tendre ses réseaux,
De mansarde en mansarde obstinément chemine. La prostitution au masque de famine
Traîne à ses pieds meurtris la fange des ruisseaux.
Comme un bétail qu'on pousse aux abattoirs, en ville, Tout ruisselant de pluie, un régiment défile
;
Une rosse s'abat sur les pavés glissants ;
Le juge continue à sévir au prétoire,
Et le Crucifié, tordant ses bras d'ivoire,
Crie à tous : \"On condamne ici les innocents !\"
La Couronne des Jours –1905
Ernest Raynaud
Ce souvenir meurt et renaît...
Ce souvenir meurt et renaît... C'est ici que se promenait,
Dans un temps lointain, l'inquiète
Et l'adorable Mariette.
Devant son air triste et coquet, Pourquoi mon cœur fut-il muet ? Aujourd'hui l'épouse muette
Ne peut que plaindre le poète.
À voir encor son délicat
Et vraiment superbe incarnat,
Je deviens rouge un peu comme elle.
À voir sa robe pâle et frêle,
Mon cœur pâlit, mon cœur se tait. Mon cœur défaille de regret.
Les Grâces Inemployées –1904
Charles-Adolphe Cantacuzène
Espace et Temps
I
La barque funéraire est, parmi les étoiles, longue comme le songe et glisse sans voilure, et le
regard du voyageur horizontal
s'étale, nénuphar, au fil de l'aventure.
Cette nuit, vais-je enfin tenter le jeu royal, renverser dans mes bras le fleuve qui murmure, Et me
dresser, dans ce contour d'un linceul pâle,
comme une tour qui croule aux bords des sépultures ?
L'opacité, déjà, où je passe frissonne,
et comme si son nom était encor Personne,
tout mon cadavre en moi tressaille sous ses liens.
Je sens me parcourir et me ressusciter,
de mon front magnétique à la proue de mes pieds, un cri silencieux, comme une âme de chien.
Trente-trois sonnets composés au secret
Jean Cassou (1897-1986)
Et la mer et l'amour...
Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage, Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage, Celui qui craint les maux qu'on souffre pour
aimer, Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l'amour eut la mer pour berceau, Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Recueil de vers –1628
Pierre de Marbeuf
La Capitale
L'énorme capitale est un fruit douloureux.
Son écorce effondrée et ses pulpes trop mûres Teignent opulemment leurs riches pourritures D'or
vert, de violet et de roux phosphoreux.
Lâchant un jus épais, douceâtre et cancéreux,
Ses spongieuses chairs fondent sous les morsures, Et ses poisons pensifs font germer les luxures
Et les péchés malsains dans les cerveaux fiévreux.
Tel est son goût exquis, tel son piment bizarre,
- Gingembre macéré dans un élixir rare,- Que j'y plongeai mes dents avec avidité.
J'ai mangé du vertige et bu de la folie.
Et c'est pourquoi je traîne un corps débilité
Où ma jeunesse meurt dans ma force abolie.
La Nuit – 1897
Iwan Gilkin
Les Pins
Sous un léger manteau d'ajoncs et de bruyères,
- Un incendie ayant, hier, meurtri son sol, - Une lande s'étend de Pontenx à Saint-Paul, Stérile,
désolée, immense et solitaire.
Et tout là-bas, très loin, et fermant l'horizon, Leurs troncs nus encadrant de grands pans de
lumière,
Les immobiles pins, en files régulières, Déroulent sous le ciel leur verte frondaison.
Or, certain jour que le couchant les ensanglante, Leurs silhouettes se profilent plus dolentes,
Leur feuillage s'agite avec un bruit de fer,
Et, si loin, sur la lande immense et désolée,
On dirait, masse énorme, et de point d'or criblée, Une armée de géants en marche vers la mer.
Mimizan, août 1902. Le Temple – 1903
J. Valmy-Baysse
La Reine de Saba
Le cœur qui s'est calmé t'épie comme un ciel derrière un envol puisque sont faibles les paroles
après que tu t'en es servi.
Je me repose en ton répit pour m'abreuver de ton éveil. La nuit j'ai soif de ton soleil
et le jour j'aspire à tes nuits.
Mais si vers toi je me hasarde je tremble que tu me regardes ou que tu ne t'en soucies point.
Il faudrait bien que tu me soignes Car mon cœur meurt si tu t'éloignes mais il est mourant quand tu
viens.
La Reine de Saba, XIII – 1987
Jean Grosjean (1912 - )
Résignation
Tout enfant, j'allais rêvant Ko-Hinnor' Somptuosité persane et papale, Héliogabale et Sardanapale !
Mon désir créait sous des toits en or, Parmi les parfums, au son des musiques, Des harems sans fin,
paradis physiques !
Aujourd'hui, plus calme et non moins ardent, Mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie, J'ai dû
réfréner ma belle folie,
Sans me résigner par trop cependant.
Soit ! le grandiose échappe à ma dent, Mais, fi de l'aimable et fi de la lie !
Et je hais toujours la femme jolie, La rime assonante et l'ami prudent.
Poèmes Saturniens - Melancholia, 1866
Paul Verlaine
Je suis le champ sanglant...
Oui, mais ainsi qu'on voit, en la guerre civile
Les débats des plus grands, du faible et du vainqueur
De leur douteux combat laisser tout le malheur
Au corps mort du pays, aux cendres d'une ville.
Je suis le champ sanglant où la fureur hostile Vomit le meurtre rouge, et la scythique horreur Qui
saccage le sang, richesse de mon cœur
Et en se débattant font leur terre stérile.
Amour, fortune, hélas ! apaisez tant de traits
Et touchez dans la main d'une amiable paix !
Je suis celui pour qui vous faites tant la guerre !
Assiste, amour, toujours à mon cruel tourment ! Fortune, apaise-toi d'un heureux changement Ou vous
n'aurez bientôt ni dispute ni terre.
Le Printemps, L'Hécatombe à Diane - vers 1570
Agrippa d'Aubigné
Némée
Depuis que le Dompteur entra dans la forêt En suivant sur le sol la formidable empreinte, Seul, un
rugissement a trahi leur étreinte. Tout s’est tu. Le soleil s’abîme et disparaît.
À travers le hallier, la ronce et le guéret,
Le pâtre épouvanté qui s’enfuit vers Tirynthe Se tourne, et voit d’un oeil élargi par la crainte
Surgir au bord du bois le grand fauve en arrêt.
Il s’écrie. Il a vu la terreur de Némée
Qui sur le ciel sanglant ouvre sa gueule armée, Et la crinière éparse et les sinistres crocs ;
Car l’ombre grandissante avec le crépuscule
Fait, sous l’horrible peau qui flotte autour d’Hercule, Mêlant l’homme à la bête, un monstrueux
héros.
Texte VI : sonnet \"Némée\", du recueil Les Trophées (1893), de José-Maria de Heredia
(partie \"la Grèce et la Sicile\" consacrée à \"Hercule et les Centaures\")
Les Grenades
Dures grenades entr'ouvertes
Cédant à l'excès de vos grains,
Je crois voir des fronts souverains
Éclatés de leurs découvertes !
Si les soleils par vous subis, Ô grenades entre-bâillées,
Vous ont fait d'orgueil travaillées
Craquer les cloisons de rubis,
Et que si l'or sec de l'écorce
À la demande d'une force
Crève en gemmes rouges de jus,
Cette lumineuse rupture
Fait rêver une âme que j'eus
De sa secrète architecture.
Charmes – 1922
Paul Valéry
Médiocrité
Dans l'Infini criblé d'éternelles splendeurs, Perdu comme un atome, inconnu, solitaire,
Pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre
Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs.
Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, Marchent, insoucieux de l'immense mystère,
Et quand ils voient passer un des leurs qu'on enterre, Saluent, et ne sont pas hérissés de
stupeurs.
La plupart vit et meurt sans soupçonner l'histoire
Du globe, sa misère en l'éternelle gloire, Sa future agonie au soleil moribond.
Vertiges d'univers, cieux à jamais en fête !
Rien, ils n'auront rien su. Combien même s'en vont
Sans avoir seulement visité leur planète.
Poèmes posthumes divers – 1902
Jules Laforgue
Qui addit scientiam, addit et laborem*
Il faut prendre pendant la vie Tout le plaisir qu'on peut avoir ; La clarté que Dieu nous fait voir
D'une longue nuit est suivie.
Il n'est que faire chère lie*
Pour faire fort bien son devoir, Peu de bon sens, point de savoir, Nargue* de la philosophie.
Je me dégrade de raison, Je veux devenir un oison
Et me sauver dans l'ignorance
En buvant toujours du meilleur. Celui qui croît en connaissance Ne fait qu'accroître sa douleur.
J. Vallée des Barreaux
* \"qui augmente sa science, augmente aussi sa peine\"
* mener joyeuse vie
Le Crapaud
Un chant dans une nuit sans air... La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre.
... Un chant ; comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif ...
Ça se tait : Viens, c'est là, dans l'ombre...
Un crapaud ! -- Pourquoi cette peur, Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile, Rossignol de la boue... - Horreur ! -
... Il chante. - Horreur ! ! -- Horreur pourquoi ? Vois-tu pas son œil de lumière...
Non : il s'en va, froid, sous sa pierre.
........................................................................ Bonsoir - ce crapaud-là
c'est moi.
Les Amours jaunes – 1873
Tristan Corbière
Obsession
Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales ;
Vous hurlez comme l'orgue ; et dans nos coeurs maudits,
Chambres d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, Répondent les échos de vos De profundis.
Je te hais, Océan ! tes bonds et tes tumultes, Mon esprit les retrouve en lui ; ce rire amer
De l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, Je l'entends dans le rire énorme de la mer.
Comme tu me plairais, ô nuit ! sans ces étoiles
Dont la lumière parle un langage connu ! Car je cherche le vide, et le noir, et le nu !
Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, Des
êtres disparus aux regards familiers.
Les Fleurs du mal - 1857 et 1861 - Spleen et Idéal
Charles Baudelaire
Pour bien chanter de paix...
Pour bien chanter de paix et dire ses louanges
Aucun esprit ou voix humaine ne suffit :
Il nous faut rechanter ce que naissant le Christ, Ce très grand Roi de paix, chantaient au ciel les
Anges.
Gloire fait au plus haut par les chants des Archanges
Au Dieu seul, qui jadis et ciel et terre fit : Mais soit en terre paix à tout homme qui mit Ses
pensées en Dieu de toute fraude étranges.
Ainsi nous faut la paix et louer et chanter,
Ainsi nous faut les coeurs doucement enchanter
De ceux qui haient la paix et désirent la guerre.
Car tout le plus grand bien qu'on puisse souhaiter, Pour ou l'esprit divin ou humain contenter,
Est au ciel gloire à Dieu, aux humains paix en terre.
Poematia – 1586
Jean Dorat
Le Mal
Tandis que les crachats rouges de la mitraille Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ;
Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, Croulent les bataillons en masse dans le feu ;
Tandis qu'une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ;
--Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, Nature ! ô toi qui fis ces hommes
saintement ! ...
-- Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ;
Qui dans le bercement des hosanna s'endort,
Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !
Poésie – 1870
Arthur Rimbaud
Heureux qui, comme Ulysse,...
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou comme cestuy-là* qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre
entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je
le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, Que des palais Romains le front audacieux, Plus que
le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.
Les Regrets, XXXI - 1558
Du Bellay
* celui-là
La Belle Matineuse
Le silence régnait sur la terre et sur l'onde ; L'air devenait serein et l'Olympe vermeil ;
Et l'amoureux Zéphyr, affranchi du sommeil, Ressuscitait les fleurs d'une haleine féconde ;
L'Aurore déployait l'or de sa tresse blonde Et semait de rubis le chemin du Soleil ; Enfin ce dieu
venait au plus grand appareil
Qu'il soit jamais venu pour éclairer le monde,
Quand la jeune Philis au visage riant, Sortant de son palais plus clair que l'Orient, Fit voir une
lumière et plus vive et plus belle.
Sacré flambeau du jour, n'en soyez point jaloux ; Vous parûtes alors aussi peu devant elle,
Que les feux de la nuit avaient fait devant vous.
La Guirlande de Julie – 1634
Claude de Malleville
Les Danaïdes
Toutes, portant l'amphore, une main sur la hanche, Théano, Callidie, Amymone, Agavé,
Esclaves d'un labeur sans cesse inachevé, Courent du puits à l'urne où l'eau vaine s'épanche.
Hélas ! le grès rugueux meurtrit l'épaule blanche, Et le bras faible est las du fardeau soulevé :
\"Monstre, que nous avons nuit et jour abreuvé,
Ô gouffre, que nous veut ta soif que rien n'étanche ?\"
Elles tombent, le vide épouvante leurs cœurs ;
Mais la plus jeune alors, moins triste que ses sœurs, Chante, et leur rend la force et la
persévérance.
Tels sont l'œuvre et le sort de nos illusions : Elles tombent toujours, et la jeune Espérance
Leur dit toujours : \"Mes sœurs, si nous recommencions !\"
Les Épreuves – 1866
Sully Prudhomme
Sur le Tasse en Prison d'Eugène Delacroix
Le poëte au cachot, débraillé, maladif,
Roulant un manuscrit sous son pied convulsif, Mesure d'un regard que la terreur enflamme L'escalier
de vertige où s'abîme son âme.
Les rires enivrants dont s'emplit la prison Vers l'étrange et l'absurde invitent sa raison ; Le
Doute l'environne, et la Peur ridicule, Hideuse et multiforme, autour de lui circule.
Ce génie enfermé dans un taudis malsain,
Ces grimaces, ces cris, ces spectres dont l'essaim
Tourbillonne, ameuté derrière son oreille,
Ce rêveur que l'horreur de son logis réveille,
Voilà bien ton emblème, Âme aux songes obscurs, Que le Réel étouffe entre ses quatre murs !
Les Fleurs du Mal, Les Épaves – 1866
Charles Baudelaire
Soir de Bataille
Le choc avait été très rude. Les tribuns
Et les centurions, ralliant les cohortes,
Humaient encor dans l'air où vibraient leurs voix fortes
La chaleur du carnage et ses âcres parfums.
D'un œil morne, comptant leurs compagnons défunts, Les soldats regardaient, comme des feuilles
mortes, Au loin, tourbillonner les archers de Phraortes ;
Et la sueur coulait de leurs visages bruns.
C'est alors qu'apparut, tout hérissé de flèches, Rouge du flux vermeil de ses blessures fraîches,
Sous la pourpre flottante et l'airain rutilant,
Aux fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare, Superbe, maîtrisant son cheval qui s'effare,
Sur le ciel enflammé, l'Imperator sanglant.
Les Trophées – 1893
José-Maria de Heredia
À Sextius
Le ciel est clair. La barque a glissé sur les sables. Les vergers sont fleuris et le givre argentin
N'irise plus les prés au soleil du matin.
Les bœufs et le bouvier désertent les étables.
Tout renaît. Mais la Mort et ses funèbres fables Nous pressent, et, pour toi, seul le jour est
certain Où les dés renversés en un libre festin
Ne t'assigneront plus la royauté des tables.
La vie, ô Sextius, est brève. Hâtons-nous
De vivre. Déjà l'âge a rompu nos genoux.
Il n'est pas de printemps au froid pays des Ombres.
Viens donc. Les bois sont verts, et voici la saison
D'immoler à Faunus, en ses retraites sombres, Un bouc noir ou l'agnelle à la blanche toison.
Les Trophées – 1893
José-Maria de Heredia
La mort simple
Je prenais mon café, ni bougon ni joyeux,
ce matin, quand j'ai lu dans mon journal cinq lignes qui annonçaient ma mort. La surprise passée,
je me suis dit qu'on me donnait enfin le droit
de n'être plus personne. Ainsi je me sens libre d'aller où je l'entends, d'aimer qui je rencontre,
d'agir sans le souci d'aucune éthique. Au fond, pour un vieil écrivain, savoir qu'il est posthume
ne manque pas d'attrait. L'anonymat me va
comme un linceul de luxe. Et tout à coup j'y songe :
pourquoi n'irais-je pas lundi à mes obsèques ?
Les fleurs seront jolies. Une actrice lira un poème de moi. Je dirai aux amis
que je suis très heureux de les avoir quittés.
Sonnets pour une fin de siècle – 1980
Alain Bosquet
Premier récit de la création
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et vide, les ténèbres
couvraient l'abîme, l'esprit de Dieu planait sur les eaux.
Dieu dit : \"Que la lumière soit\" et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu
sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière \"jour\" et les ténèbres \"nuit\". Il y eut
un soir et il y eut un matin : premier jour.
Dieu dit : \"Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec
les eaux\" et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament
d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament \"ciel\". Il y eut un
soir et il y eut un matin : deuxième jour.
Dieu dit : \"Que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le
continent\" et il en fut ainsi. Dieu appela le continent \"terre\" et la masse des eaux \"mers\", et
Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : \"Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des
arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits contenant leur semence\" et il en fut ainsi. La
terre produisit de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant
selon leur espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un
soir et il y eut un matin : troisième jour.
Dieu dit : \"Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit :
qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années : qu'ils soient des
luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre\" et il en fut ainsi. Dieu fit les deux
luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme
puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour.
Dieu dit : \"Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent
au-dessus de la terre contre le firmament du ciel\" et il en fut ainsi. Dieu créa les grands
serpents et tous les êtres vivants qui glissent dans les eaux selon leur espèce, et toute la gent
ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit : \"Soyez féconds,
multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre.\" Il y eut un
soir et il y eut un matin : cinquième jour.
Dieu dit : \"Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, bestioles, bêtes
sauvages selon leur espèce\" et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les
bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela
était bon.
Dieu dit : \"Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les
bestioles qui rampent sur la terre.\"
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
Dieu les bénit et leur dit : \"Soyez féconds, multipliez et emplissez la terre et soumettez- la ;
dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la
terre.\" Dieu dit : \"Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface
de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture. A
toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe et qui est animé de
vie, je donne pour nourriture la verdure des plantes\" et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il
avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour
l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait alors chômé après tout son ouvrage de
création.
Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés.
Le dormeur du val
C’est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Extrait de Poésies (oct. 1870)
de A. RIMBAUD
Un recueil poétique
Étude détaillée des Châtiments
Les châtiments - Nox 1 e extrait
NOX
C'est la date choisie au fond de ta pensée, Prince ! il faut en finir, - cette nuit est glacée,
Viens, lève-toi ! Flairant dans l'ombre les escrocs, Le dogue Liberté gronde et montre ses crocs ;
05 Quoique mis par Carlier à la chaîne, il aboie.
N'attends pas plus longtemps ! c'est l'heure de la proie. Vois, décembre épaissit son brouillard le
plus noir ; Comme un baron voleur qui sort de son manoir, Surprends, brusque assaillant, l'ennemi
que tu cernes.
10 Debout ! les régiments sont là dans les casernes, Sac au dos, abrutis de vin et de fureur,
N'attendant qu'un bandit pour faire un empereur.
Mets ta main sur ta lampe et viens d'un pas oblique ; Prends ton couteau, l'instant est bon : la
République,
15 Confiante, et sans voir tes yeux sombres briller, Dort, avec ton serment, prince, pour
oreiller.
Cavaliers, fantassins, sortez ! dehors les hordes ! Sus aux représentants ! soldats, liez de cordes
Vos généraux jetés dans la cage aux forçats
20 Poussez, la crosse aux reins, l'Assemblée à Mazas !
Chassez la Haute-cour à coups de plat de sabre !
Changez-vous, preux de France, en brigands de Calabre ! Vous, bourgeois, regardez, vil troupeau,
vil limon,
Comme un glaive rougi qu'agite un noir démon,
25 Le coup d'État qui sort flamboyant de la forge !
Les tribuns pour le droit luttent : qu'on les égorge ! Routiers, condottieri. vendus, prostitués,
Frappez ! tuez Baudin ! tuez Dussoubs ! tuez !
Que fait hors des maisons ce peuple ? Qu'il s'en aille !
30 Soldats, mitraillez-moi toute cette canaille !
Feu ! feu ! Tu voteras ensuite, ô peuple-roi ! Sabrez le droit, sabrez l'honneur, sabrez la loi !
Que sur les boulevards le sang coule en rivières
Du vin plein les bidons ! des morts plein les civières !
35 Qui veut de l'eau-de-vie ? En ce temps pluvieux
Il faut boire. Soldats, fusillez-moi ce vieux !
Tuez-moi cet enfant ! Qu'est-ce que cette femme ? C'est la mère ? tuez ! Que tout ce peuple infâme
Tremble, et que les pavés rougissent ses talons !
40 Ce Paris odieux bouge et résiste. Allons !
Qu'il sente le mépris, sombre et plein de vengeance,
Que nous, la force, avons pour lui, l'intelligence ! L'étranger respecta Paris : soyons nouveaux !
Traînons-le dans la boue aux crins de nos chevaux !
45 Qu'il meure ! qu'on le broie et l'écrase et l'efface !
Noirs canons, crachez-lui vos boulets à la face !
Les châtiments - Nox 21 e extrait
C'est fini ! Le silence est partout, et l'horreur. Vive Poulmann césar et Soufflard empereur ! On
fait des feux de joie avec les barricades ;
50 La Porte Saint-Denis sous ses hautes arcades Voit les brasiers trembler au vent et
rayonner. C'est fait, reposez-vous ; et l'on entend sonner
Dans les fourreaux le sabre et l'argent dans les poches. De la banque aux bivouacs on vide les
sacoches.
55 Ceux qui tuaient le mieux et qui n'ont pas bronché
Auront la croix d'honneur par dessus le marché.
Les vainqueurs en hurlant dansent sur les décombres.
Des tas de corps saignants gisent dans les coins sombres. Le soldat, gai, féroce, ivre, complice
obscur,
60 Chancelle, et, de la main dont il s'appuie au mur, Achève d'écraser quelque cervelle
humaine.
On boit, on rit, on chante, on ripaille ; on amène
Des vaincus qu'on fusille, hommes, femmes, enfants.
Les généraux dorés galopent triomphants,
65 Regardés par les morts tombés à la renverse.
Bravo ! César a pris le chemin de traverse ! Courons féliciter l'Élysée à présent.
Du sang dans les maisons, dans les ruisseaux du sang, Partout ! Pour enjamber ces effroyables
mares,
70 Les juges lestement retroussent leurs simarres, Et l'Église joyeuse en emporte un caillot
Tout fumant, pour servir d'écritoire à Veuillot. Oui, c'est bien vous qu'hier, riant de vos
férules, Un caporal chassa de vos chaises curules,
75 Magistrats ! Maintenant que, reprenant du cœur, Vous êtes bien certains que Mandrin est
vainqueur, Que vous ne serez pas obligés d'être intègres,
Que Mandrin dotera vos dévoûments allègres, Que c'est lui qui paiera désormais, et très-bien,
80 Qu'il a pris le budget, que vous ne risquez rien, Qu'il a bien étranglé la loi, qu'elle est
bien morte, Et que vous trouverez ce cadavre à sa porte, Accourez, acclamez, et chantez Hosanna !
Oubliez le soufflet qu'hier il vous donna,
85 Et, puisqu'il a tué vieillards, mères et filles,
Puisqu'il est dans le meurtre entré jusqu'aux chevilles,
Prosternez-vous devant l'assassin tout-puissant, Et léchez-lui les pieds pour effacer le sang !
Les châtiments - Extrait de À un martyr (I - VIII)
80 Ils vendent l'arche auguste où l'hostie étincelle !
Ils vendent Christ, te dis-je ! et ses membres liés ! Ils vendent la sueur qui sur son front
ruisselle,
Et les clous de ses mains, et les clous de ses pieds !
Ils vendent au brigand qui chez lui les attire
85 Le grand crucifié sur les hommes penché ;
Ils vendent sa parole, ils vendent son martyre, Et ton martyre à toi par-dessus le marché !
Tant pour les coups de fouet qu'il reçut à la porte ! César ! tant pour l'amen ! tant pour
l'alléluia !
90 Tant pour la pierre où vint heurter sa tête morte !
Tant pour le drap rougi que sa barbe essuya !
Ils vendent ses genoux meurtris, sa palme verte, Sa plaie au flanc, son œil tout baigné d'infini,
Ses pleurs, son agonie, et sa bouche entr'ouverte,
95 Et le cri qu'il poussa, Lamma Sabacthani !
Ils vendent le sépulcre ! ils vendent les ténèbres ! (...)
108 Ils vendent, ô martyr, le Dieu pensif et pâle
. . .
France ! à l'heure où tu te prosternes - Livre I, 1
France ! à l'heure où tu te prosternes, Le pied d'un tyran sur ton front,
La voix sortira des cavernes
Les enchaînés tressailleront.
Le banni, debout sur la grève, Contemplant l'étoile et le flot, Comme ceux qu'on entend en rêve,
Parlera dans l'ombre tout haut ;
Et ses paroles qui menacent, Ses paroles dont l'éclair luit,
Seront comme des mains qui passent
Tenant des glaives dans la nuit.
Elles feront frémir les marbres Et les monts que brunit le soir, Et les chevelures des arbres
Frissonneront sous le ciel noir ;
Elles seront l'airain qui sonne, Le cri qui chasse les corbeaux,
Le souffle inconnu dont frissonne
Le brin d'herbe sur les tombeaux ;
Elles crieront : Honte aux infâmes, Aux oppresseurs, aux meurtriers ! Elles appelleront les âmes
Comme on appelle des guerriers !
Sur les races qui se transforment, Sombre orage, elles planeront ;
Et si ceux qui vivent s'endorment, Ceux qui sont morts s'éveilleront.
Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments )
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand'mère était là qui pleurait.
05 Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil
farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
10 Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend.
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant : - Comme il est blanc ! approchez donc la lampe ! Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés
sur sa tempe ! -
15 Et quand se fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
-- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer.
20 L'aïeule cependant l'approchait du foyer,
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,
25 Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une
lettre,
30 C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être !
35 Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte
; Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
40 Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
-- Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas
! je n'avais plus de sa mère que lui.
45 Pourquoi l'a-t-on tué ? je veux qu'on me l'explique.
L'enfant n'a pas crié vive la République. -
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.
Vous ne compreniez point, mère, la politique.
50 Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, Est pauvre et même prince ; il aime les
palais ; Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, De l'argent pour son jeu, sa table, son
alcôve,
Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
55 La Famille, l'Église et la Société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères, De leurs pauvres doigts gris que fait
trembler le temps,
60 Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 décembre 1852
V. Hugo - Les Châtiments
Stella - Livre VI, 15
Je m'étais endormi la nuit près de la grève. Un vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve,
J'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin.
Elle resplendissait au fond du ciel lointain
Dans une blancheur molle, infinie et charmante. 5
Aquilon s'enfuyait emportant la tourmente. L'astre éclatant changeait la nuée en duvet. C'était une
clarté qui pensait, qui vivait ;
Elle apaisait l'écueil où la vague déferle ;
On croyait voir une âme à travers une perle. 10
Il faisait nuit encore, l'ombre régnait en vain,
Le ciel s'illuminait d'un sourire divin.
La lueur argentait le haut du mât qui penche ; Le navire était noir, mais la voile était blanche ;
Des goélands debout sur un escarpement, 15
Attentifs, contemplaient l'étoile gravement Comme un oiseau céleste et fait d'une étincelle ;
L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle, Et, rugissant tout bas, la regardait briller,
Et semblait avoir peur de la faire envoler . 20
Un ineffable amour emplissait l'étendue. L'herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue, Les oiseaux
se parlaient dans les nids ; une fleur Qui s'éveillait me dit : c'est l'étoile ma sœur .
.Et pendant qu'à longs plis l'ombre levait son voile, 25
J'entendis une voix qui venait de l'étoile
Et qui disait :- je suis l'astre qui vient d'abord.
Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort. J'ai lui sur le Sinaï, j'ai lui sur le Taygète
;
Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, 30
Comme avec une fronde, au front noir de la nuit. Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit.
Ô nations ! je suis la poésie ardente.
J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante.
Le lion océan est amoureux de moi. 35
J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi ! Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles !
Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles, Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,
Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit, 40
C'est celui qui m'envoie en avant la première, C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière !
31 août. Jersey.
V. Hugo - Les Châtiments
L'art et le peuple - Livre I, 9
I
L'art, c'est la gloire et la joie ; Dans la tempête il flamboie,
Il éclaire le ciel bleu.
L'art, splendeur universelle, Au front du peuple étincelle, Comme l'astre au front de Dieu.
L'art est un chant magnifique Qui plaît au cœur pacifique, Que la cité dit aux bois,
Que l'homme dit à la femme, Que toutes les voix de l'âme Chantent en choeur à la fois !
L'art, c'est la pensée humaine Qui va brisant toute chaîne ! L'art, c'est le doux conquérant ! À
lui le Rhin et le Tibre !
Peuple esclave, il te fait libre ; Peuple libre, il te fait grand !
II
Ô bonne France invincible, Chante ta chanson paisible ! Chante, et regarde le ciel ! Ta voix
joyeuse et profonde Est l'espérance du monde,
Ô grand peuple fraternel !
Bon peuple, chante à l'aurore ! Quand vient le soir, chante encore ! Le travail fait la gaîté.
Ris du vieux siècle qui passe ! Chante l'amour à voix basse, Et tout haut la liberté !
Chante la sainte Italie
La Pologne ensevelie,
Naples qu'un sang pur rougit, La Hongrie agonisante ! ...
Ô tyrans ! le peuple chante
Comme le lion rugit !
V. Hugo - Les Châtiments
Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. Livre VII, 1
Sonnez, Sonnez toujours, clairons de la pensée. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée,
Suivi des siens, marchait, et, prophète irrité, Sonnait de la trompette autour de la cité,
Au premier tour qu'il fit le roi se mit à rire ; 5
Au second tour, riant toujours, il lui fit dire :
--Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?
À la troisième fois, l'arche allait en avant,
Puis les trompettes, puis toute l'armée en marche,
Et les petits enfants venaient cracher sur l'arche, 10
Et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon ; Au quatrième tour, bravant les fils d'Aaron,
Entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, Les femmes s'asseyaient en filant leur
quenouille,
Et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux ; 15
À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, Aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées,
Raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées ;
À la sixième fois, sur sa tour de granit
Si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid, 20
Si dure que l'éclair l'eût en vain foudroyée, Le roi revint, riant à gorge déployée,
Et cria :- ces Hébreux sont bons musiciens ! - Autour du roi joyeux, riaient tous les anciens
Qui le soir sont assis au temple et délibèrent. 25
À la septième fois, les murailles tombèrent.
19 mars 1853, Jersey
V. Hugo - Les Châtiments
Le Roman
Le roman naturaliste
Bel- Ami
Madeleine s’appuya à la cheminée, et ayant allumé une cigarette, elle raconta ses nouvelles, puis
exposa ses idées, et le plan de l’article qu’elle rêvait.
Il l’écoutait avec attention, tout en griffonnant des notes ; et quand il eut fini il souleva des
objections, reprit la question, l’agrandit, développa à son tour non plus un plan d’article, mais
un plan de campagne contre le ministère actuel. Cette
attaque serait le début. Sa femme avait cessé de fumer, tant son intérêt s’éveillait, tant elle
voyait large et loin en suivant la pensée de Georges.
Elle murmurait de temps en temps : - Oui... oui... C’est très bon... C’est excellent... C’est très
fort...
Et quand il eut achevé, à son tour, de parler : - Maintenant écrivons, dit-elle. Mais il avait
toujours le début difficile et il cherchait ses mots avec peine. Alors elle vint doucement se
pencher sur son épaule et elle se mit à lui souffler ses phrases tout bas, dans l’oreille.
De temps en temps elle hésitait et demandait :
- Est-ce bien ça que tu veux dire ? Il répondait :
- Oui, parfaitement.
Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef du Conseil ; et
elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique, d’une façon drôle qui faisait
rire et saisissait en même temps par la justesse de l’observation.
Du Roy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante la portée
d’une attaque. Il savait, en outre, l’art des sous-entendus perfides, qu’il avait appris en
aiguisant des échos ; et quand un fait donné pour certain par Madeleine lui paraissait douteux ou
compromettant, il excellait à le faire deviner et à l’imposer à l’esprit avec plus de force que
s’il l’eût affirmé.
Quand leur article fut terminé, Georges le relut tout haut, en le déclamant. Ils le jugèrent
admirable d’un commun accord et ils se souriaient, enchantés et surpris, comme s’ils venaient de se
révéler l’un à l’autre. Ils se regardaient au fond des yeux, émus d’admiration et d’attendrissement
; et ils s’embrassèrent avec élan, avec une ardeur d’amour communiquée de leurs esprits à leurs
corps.
[…]
L’article parut sous la signature de Georges Du Roy de Cantel, et fit grand bruit. On s’en émut à
la Chambre. Le père Walter en félicita l’auteur et le chargea de la rédaction politique de la Vie
Française. Les échos revinrent à Boisrenard.
Alors commença, dans le journal, une campagne habile et violente contre le ministère qui dirigeait
les affaires. L’attaque, toujours adroite et nourrie de faits, tantôt ironique, tantôt sérieuse,
parfois plaisante, parfois virulente, frappait avec une sûreté et une continuité dont tout le monde
s’étonnait. Les autres feuilles citaient sans cesse la Vie Française, y coupaient des passages
entiers, et les hommes du pouvoir s’informèrent si on ne pouvait pas bâillonner avec une préfecture
cet ennemi inconnu et acharné.
Extrait de Bel-Ami (1885) de G. de Maupassant
Pierre et Jean
Ayant fait encore quelques pas, il (Pierre) s’arrêta pour contempler la rade. Sur sa droite,
au-dessus de Sainte Adresse, les deux phares électriques du cap de la Hève, semblables à deux
cyclopes monstrueux et jumeaux, jetaient sur la mer leurs longs et puissants regards. Partis des
deux foyers voisins, les deux rayons parallèles, pareils aux queues géantes de deux comètes,
descendaient suivant une pente droite et démesurée, du sommet de la côte au fond de
l’horizon. Puis sur les deux jetées, deux autres feux, enfants de ces colosses, indiquaient
l’entrée du Havre ; et là-bas, de l’autre côté de la Seine, on en voyait d’autres encore, beaucoup
d’autres, fixes ou clignotants, à éclats et à éclipses, s’ouvrant et se
fermant comme des yeux, les yeux des ports, jaunes, rouges, verts, guettant la mer obscure couverte
de navires, les yeux vivants de la terre hospitalière disant, rien que par le mouvement mécanique
invariable et régulier de leurs paupières : “ C’est moi. Je suis Trouville, je suis Honfleur, je
suis la rivière de Pont- Audemer. ” Et dominant tous les autres, si haut que,
de si loin, on le prenait pour une planète, le phare aérien d’Etouville montrait la route de Rouen,
à travers les bancs de sable de l’embouchure du grand fleuve .
Puis sur l’eau profonde, sur l’eau sans limites, plus sombre que le ciel, on croyait voir çà et là,
des étoiles. Elles tremblotaient dans la brume nocturne, petites, proches ou lointaines, blanches,
vertes ou rouges aussi. Presque toutes étaient immobiles, quelques- unes, cependant, semblaient
courir ; c’étaient les feux des bâtiments à l’ancre attendant la marée prochaine, ou des bâtiments
en marche venant chercher un mouillage.
Juste à ce moment la lune se leva derrière la ville ; elle avait l’air du phare énorme et divin
allumé dans le firmament pour guider la flotte infinie des vraies
étoiles.
Extrait de Pierre et jean (1888) de G. de Maupassant
Approches de l’œuvre de Zola
Incipit de l'Assommoir
Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à deux heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée
en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse,
les joues trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du Veau à Deux Têtes, où ils mangeaient,
il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant
qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir
vu entrer au bal du Grand-Balcon, dont les dix fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe
d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs ; et, derrière lui, elle avait aperçu
la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à cinq ou
six pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer
ensemble sous la clarté crue des globes de la porte.
Quand Gervaise s'éveilla, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots.
Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit,
sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et,
lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie,
meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une petite
table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pour les enfants, un
lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers de la pièce. La malle de Gervaise et
de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout
au fond, enfoui sous des chemises
et des chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendaient un
châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne
voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un
paquet de reconnaissances du mont-de-piété, d'un rose tendre. C'était la belle Chambre de l'hôtel,
la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard.
Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les deux enfants dormaient. Claude, qui avait
huit ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis
qu'Etienne, âgé de quatre ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le
regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots, elle tamponna
un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans
songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre, elle reprit son
attente de la nuit, interrogeant les trottoirs, au loin.
Émile Zola
L'Assommoir - Gueule d'Or - extrait du chapitre VI
Et Gervaise, en face de la Gueule-d'Or, regardait avec un sourire attendri. Mon Dieu ! que les
hommes étaient donc bêtes ! Est-ce que ces deux-là ne tapaient pas sur leurs boulons pour lui faire
la cour ! Oh ! elle comprenait bien, ils se la disputaient à coups de marteau, ils étaient comme
deux grands coqs rouges qui font les gaillards devant une petite poule blanche. Faut-il avoir des
inventions, n'est-ce pas ? Le cœur a tout de même, parfois, des façons drôles de se déclarer.
Oui, c'était pour elle, ce tonnerre de Dédèle et de Fifine sur l'enclume ; c'était pour elle, tout
ce fer écrasé ; c'était pour elle, cette forge en branle, flambante d'un incendie, emplie d'un
pétillement d'étincelles vives. IIs lui forgeaient là un amour, ils se la disputaient, à qui
forgerait le mieux. Et, vrai, cela lui faisait plaisir au fond ; car enfin les femmes aiment les
compliments. Les coups de marteau de la
Gueule-d'Or surtout lui répondaient dans le cœur ; ils y sonnaient, comme sur l'enclume, une
musique claire, qui accompagnait les gros battements de son sang. Ça semble une bêtise, mais elle
sentait que ça lui enfonçait quelque chose là, quelque chose de solide, un peu du fer du boulon. Au
crépuscule, avant d'entrer, elle avait eu, le long des trottoirs humides, un désir vague, un besoin
de manger un bon morceau ; maintenant, elle se trouvait satisfaite, comme si les coups de marteau
de la Gueule-d'Or l'avaient nourrie. Oh ! elle ne doutait pas de sa victoire. C'était à lui qu'elle
appartiendrait. Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif, était trop laid, dans sa cotte et son bourgeron
sales, sautant d'un air de singe échappé. Et elle attendait, trés rouge, heureuse de la grosse
chaleur pourtant, prenant une jouissance à être secouée des pieds à la tête par les dernières
volées de Fifine.
Émile Zola
L'Assommoir - l'Oie - extrait du chapitre VII
Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette ; c'est-à-dire que personne de la société ne
se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme,
tassé sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une
bouchée ; et elle était seulement un peu honteuse devant Goujet, ennuyée de se montrer ainsi,
gloutonne comme une chatte. Goujet, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même, à la voir toute rose de
nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne ! Elle ne parlait pas,
mais elle se dérangeait à chaque instant, pour soigner le père Bru et lui passer quelque chose de
délicat sur son assiette. C'était même touchant de
regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche, pour le donner au vieux, qui ne
semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse, abêti de tant bâfrer, lui dont le
gésier avait perdu le goût du pain. Les Lorilleux passaient leur rage sur le rôti ; ils en
prenaient pour trois jours, ils auraient englouti le plat, la table et la boutique, afin de ruiner
la Banban du coup. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse ; la carcasse, c'est le morceau
des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que maman Coupeau,
qui adorait le cou, en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la
peau, quand elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie ; si bien
que Poisson jetait à sa femme des regards sévères, en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'elle en
avait assez comme ça : une fois déjà, pour avoir mangé trop d'oie rôtie, elle était restée quinze
jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant
que, tonnerre de Dieu ! si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que l'oie
avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, l'oie guérissait les maladies de rate. On
croquait ça sans pain, comme un dessert. Lui, en aurait bouffé toute le nuit, sans être incommodé ;
et, pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son
croupion, le suçait
avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise, à cause de
Boche qui lui disait tout bas des indécences. Ah ! nom de Dieu ! oui, on s'en flanqua une bosse !
Quand on y est, on y est, n'est-ce pas ? et si l'on ne se paie qu'un gueuleton par-ci, par-là, on
serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se
gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres ! La
bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières,
et si rouges, qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité.
Émile Zola
L'Assommoir - le début de la déchéance - extrait du chapitre X
[…] Deux années s'écoulèrent, pendant lesquelles ils s'enfoncèrent de plus en plus. Les hivers
surtout les nettoyaient. S'ils mangeaient du pain au beau temps, les fringales arrivaient avec la
pluie et le froid, les danses devant le buffet, les dîners par cœur, dans la petite Sibérie de leur
cambuse. Ce gredin de décembre entrait chez eux par-dessous la porte, et il apportait tous les
maux, le chômage des ateliers, les fainéantises engourdies des gelées, la misère noire des temps
humides. Le premier hiver, ils firent encore du feu quelquefois, se pelotonnant autour du poêle,
aimant mieux avoir chaud que de manger ; le second hiver, le poêle ne se dérouilla seulement pas,
il glaçait la pièce de sa mine lugubre de
borne de fonte. Et ce qui leur cassait les jambes, ce qui les exterminait, c'était par- dessus tout
de payer leur terme. Oh ! le terme de janvier, quand il n'y avait pas un radis à la maison et que
le père Boche prenait la quittance ! Ça soufflait davantage de froid, une tempête du Nord. M.
Marescot arrivait, le samedi suivant, couvert d'un bon paletot, ses grandes pattes fourrées dans
des gants de laine ; et il avait toujours le mot d'expulsion à la bouche, pendant que la neige
tombait dehors, comme si elle leur préparait un lit sur le trottoir, avec des draps blancs. Pour
payer le terme, ils auraient vendu de leur chair. C'était le terme qui vidait le buffet et le
poêle. Dans la maison entière, d'ailleurs, une lamentation montait. On pleurait à tous les étages,
une musique de malheur ronflant le long de l'escalier et des corridors. Si chacun avait eu un mort
chez lui, ça n'aurait pas produit un air d'orgues aussi abominable. Un vrai jour de jugement
dernier, la fin des fins, la vie impossible, l'écrasement du pauvre monde. […]
Deux années s'écoulèrent pendant lesquelles ils s'enfoncèrent de plus en plus. Les hivers surtout
les nettoyaient. S'ils mangeaient du pain au beau temps, les fringales arrivaient avec la pluie et
le froid, les danses devant le buffet, les dîners par cœur, dans la petite Sibérie de leur cambuse.
Ce gredin de décembre entrait chez eux par-dessous la porte, et il apportait tous les maux, le
chômage des ateliers, les fainéantises engourdies des gelées, la misère noire des temps humides. Le
premier hiver, ils firent encore du feu quelquefois, se pelotonnant autour du poêle, aimant mieux
avoir chaud que de manger ; le second hiver, le poêle ne se dérouilla seulement pas, il glaçait la
pièce de sa mine lugubre de borne de fonte. Et ce qui leur cassait les jambes, ce qui les
exterminait, c'était par- dessus tout de payer leur terme. Oh ! le terme de janvier, quand il n'y
avait pas un radis à la maison et que le père Boche présentait la quittance ! Ça soufflait
davantage de froid, une tempête du Nord. M. Marescot arrivait, le samedi suivant, couvert d'un bon
paletot, ses grandes pattes fourrées dans des gants de laine ; et
il avait toujours le mot d'expulsion à la bouche, pendant que la neige tombait dehors, comme si
elle leur préparait un lit sur le trottoir, avec des draps blancs. Pour payer le terme, ils
auraient vendu de leur chair. C'était le terme qui vidait le buffet et le poêle. Dans la maison
entière, d'ailleurs, une lamentation montait. On pleurait à tous les étages, une musique de malheur
ronflant le long de l'escalier et des corridors. Si chacun avait eu un mort chez lui, ça n'aurait
pas produit un air d'orgues aussi abominable. Un vrai jour du jugement dernier, la fin des fins, la
vie impossible, l'écrasement du pauvre monde.
Émile Zola
L a Faute de l'Abbé Mouret - extrait
Cependant, Albine et Serge marchaient au milieu des prairies, ayant de la verdure jusqu’aux genoux.
Il leur semblait avancer dans une eau fraîche qui leur battait les mollets. Ils se trouvaient par
instants au travers de véritables courants, avec des ruissellements de hautes tiges penchées dont
ils entendaient la fuite rapide
entre leurs jambes. Puis, des lacs sommeillaient, des bassins de gazons courts, où ils trempaient à
peine plus haut que les chevilles. Ils jouaient en marchant ainsi (...) à s’attarder, les pieds
liés par les doigts souples des plantes, goûtant là une pureté, une caresse de ruisseau. Albine
s’écarta, alla se mettre au fond d’une herbe géante qui lui arrivait au menton. Elle ne passait que
la tête. Elle se tint un instant bien tranquille, appelant Serge :
- Viens donc ! On est comme dans un bain. On a de l’eau verte partout.
Extrait de La Faute de l'Abbé Mouret (1875) de E. Zola
Théâtre
La Comédie au XVIIIe siècle
a)
@ Le héros romantique au théâtre a) Le héros romantique
b) Lorenzaccio (extrait) – cf. Commentaire c) Hernani (2 extraits)
LE MARIAGE DE FIGARO ACTE I SCENE 10
CHÉRUBIN, SUZANNE, FIGARO, LA COMTESSE, LE COMTE, FANCHETTE, BAZILE. Beaucoup de valets, paysannes,
paysans vêtus de blanc
FIGARO, tenant une loque de femme, garnie de plumes
blanches et de rubans blancs, parle à la Comtesse. Il n’y a que vous, madame, qui puissiez nous
obtenir cette faveur. LA COMTESSE. Vous le voyez, monsieur le Comte, ils me
5 supposent un crédit que je n’ai point, mais comme leur demande n’est pas déraisonnable...
LE COMTE, embarrassé. Il faudrait qu’elle le fût beau- coup...
FIGARO, bas à Suzanne. Soutiens bien mes efforts.
10 SUZANNE, bas à Figaro. Qui ne mèneront à rien.
FIGARO, bas. Va toujours.
LE COMTE, à Figaro. Que voulez-vous ?
FIGARO. Monseigneur, vos vassaux, touchés de l’abolition d’un certain droit fâcheux, que votre
amour pour madame...
15 LE COMTE. Hé bien, ce droit n’existe plus, Que veux-tu dire ?
FIGARO, malignement. Qu’il est bien temps que la vertu d’un si bon maître éclate ; elle m’est d’un
tel avantage aujourd’hui, que je désire être le premier à la célébrer à
20 mes noces.
LE COMTE, plus embarrassé. Tu te moques, ami ! L’abo- lition d’un droit honteux n’est que l’acquit1
d’une dette envers l’honnêteté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté par des soins2 ; mais
en exiger le premier, le plus
25 doux emploi, comme une servile redevance3, ah ! c’est la tyrannie d’un Vandale4, et non le
droit avoué d’un noble Castillan.
FIGARO, tenant Suzanne par la main. Permettez donc que cette jeune créature, de qui votre sagesse a
préservé l’hon-
30 neur, reçoive de votre main, publiquement, la toque virgi- nale, ornée de plumes et de
rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions : adoptez-en la cérémonie pour tous les
mariages, et qu’un quatrain chanté en chœur rap- pelle à jamais le souvenir...
35 LE COMTE, embarrassé. Si je ne savais pas qu’amoureux,
poète et musicien sont trois titres d’indulgence pour toutes les folies...
FIGARO. Joignez-vous à moi, mes amis !
TOUS ENSEMBLE. Monseigneur ! Monseigneur !
40 SUZANNE, au Comte. Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien ?
LE COMTE, à part. La perfide !
FIGARO. Regardez-la donc, Monseigneur. Jamais plus jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de
votre sacrifice.
45 SUZANNE. Laisse là ma figure, et ne vantons que sa vertu.
LE COMTE, à part. C’est un jeu que tout ceci.
LA COMTESSE. je me joins à eux, monsieur le Comte ; et cette cérémonie me sera toujours chère,
puisqu’elle doit son motif à l’amour charmant que vous aviez pour moi.
50 LE COMTE. Que j’ai toujours, madame ; et c’est à ce titre que je me rends.
TOUS ENSEMBLE. Vivat5 !
LE COMTE, à part. Je suis pris. (Haut.) Pour que la céré- monie eût un peu plus d’éclat, je
voudrais seulement
55 qu’on la remît à tantôt. (A part.) Faisons vite chercher
Marceline.
FIGARO à Chérubin. Eh bien, espiègle, vous n’applaudis- sez pas ?
SUZANNE. Il est au désespoir ; Monseigneur le renvoie.
60 LA COMTESSE. Ah ! monsieur, je demande sa grâce.
LE COMTE. Il ne la mérite point.
LA COMTESSE. Hélas ! il est si jeune ! LE COMTE. Pas tant que vous le croyez.
CHÉRUBIN, tremblant. Pardonner généreusement n’est pas
65 le droit du seigneur auquel vous avez renoncé en épou- sant madame.
LA COMTESSE. Il n’a renoncé qu’à celui qui vous affligeait tous.
SUZANNE. Si Monseigneur avait cédé le droit de pardon-
70 ner, ce serait sûrement le premier qu’il voudrait racheter
en secret.
LE COMTE, embarrassé. Sans doute.
LA COMTESSE. Et pourquoi le racheter ?
CHÉRUBIN. au Comte. Je fus léger dans ma conduite, il est
75 vrai, Monseigneur ; mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles...
LE COMTE, embarrassé. Eh bien, c’est assez... FIGARO. Qu’entend-il6 ?
LE COMTE, vivement. C’est assez, c’est assez. Tout le
80 monde exige son pardon, je l’accorde ; et j’irai plus loin :
je lui donne une compagnie dans ma légion. TOUS ENSEMBLE. Vivat !
LE COMTE. Mais c’est à condition qu’il partira sur-le- champ pour joindre en Catalogne7.
85 FIGARO. Ah ! Monseigneur, demain.
LE COMTE insiste. Je le veux. CHÉRUBIN. J’obéis.
LE COMTE. Saluez votre marraine, et demandez sa pro- tection. (Chérubin met un genou en terre
devant la Comtesse,
90 et ne peut parler.)
LA COMTESSE, émue. Puisqu’on ne peut vous garder seule- ment aujourd’hui, partez, jeune homme. Un
nouvel état
vous appelle ; allez le remplir dignement. Honorez votre
bienfaiteur. Souvenez-vous de cette maison, où votre jeu-
95 nesse a trouvé tant d’indulgence. Soyez soumis, honnête et brave ; nous prendrons part à
vos succès. (Chérubin se relève et retourne à sa place.)
LE COMTE. Vous êtes bien émue, madame !
LA COMTESSE. je ne m’en défends pas. Qui sait le sort
100 d’un enfant jeté dans une carrière aussi dangereuse ? Il est allié de mes parents ; et de
plus, il est mon filleul.
LE COMTE à part, Je vois que Bazile avait raison. (Haut.) Jeune homme, embrassez Suzanne... pour la
dernière fois. FIGARO. Pourquoi cela, Monseigneur ? Il viendra passer
105 ses hivers. Baise-moi donc aussi, capitaine ! (il l’embrasse.) Adieu, mon petit Chérubin. Tu
vas mener un train de vie bien différent, mon enfant : dame ! tu ne rôderas plus tout
le jour au quartier des femmes, plus d’échaudés8, de goû- tés à la crème ; plus de main-chaude9 ou
de colin-
110 maillard. De bons soldats, morbleu ! basanés, mal vêtus ; un grand fusil bien lourd : tourne
à droite, tourne à gauche, en avant, marche à la gloire ; et ne va pas bron- cher en chemin ; à
moins qu’un bon coup de feu... SUZANNE. Fi donc, l’horreur !
115 LA COMTESSE. Quel pronostic !
LE COMTE. Où donc est Marceline ? Il est bien singulier qu'elle ne soit pas des vôtres !
FANCHETTE. Monseigneur, elle a pris le chemin du bourg, par le petit sentier de la ferme.
120 LE COMTE. Et elle en reviendra ?…
...
Acte I Scène 10 : 1 acquit : acquittement (l. 22) / 2 soins : attentions (l. 24) / 3 redevance :
obligation (l. 25) / 4 Vandale : barbare (l.
26) / 5 vivat : bravo (l. 52) / 6 qu’entend-il ? : que sous-entend-il ? (l. 78) / 7 joindre en
Catalogne : rejoindre sa compagnie basée en
Catalogne l. 84) / 8 échaudés : beignets ébouillantés (l. 108) / 9 main chaude : jeu où il faut
reconnaître, les yeux bandés, celui qui vous touche la main attachée derrière le dos (l. 109)
LE MARIAGE DE FIGARO Acte II Scène 1
Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcôve, une estrade au-devant.
La porte pour
entrer s’ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite ; celle d’un cabinet, à la première
coulisse à gauche. Une porte dans
le fond va chez les femmes. Une fenêtre s’ouvre de l’autre côté. SUZANNE, LA COMTESSE, entrent par
la porte
à droite
LA COMTESSE se jette dans une bergère1. Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus
grand détail. SUZANNE. Je n’ai rien caché à madame.
LA COMTESSE. Quoi ! Suzon, il voulait te séduire ?
5 SUZANNE. Oh, que non ! Monseigneur n’y met pas tant de façon avec sa servante : il voulait
m’acheter.
LA COMTESSE. Et le petit page était présent ? SUZANNE. C’est-à-dire caché derrière le grand
fauteuil. Il venait me prier de vous demander sa grâce.
10 LA COMTESSE. Hé, pourquoi ne pas s’adresser à moi- même ? est-ce que je l’aurais refusé2,
Suzon ?
SUZANNE. C’est ce que j’ai dit : mais ses regrets de partir,
et surtout de quitter madame ! Ah Suzon, qu’elle est noble et belle ! mais qu’elle est imposante !
15 LA COMTESSE. Est-ce que j’ai cet air-là, Suzon ? Moi qui
l’ai toujours protégé.
SUZANNE. Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais :
il s’est jeté dessus...
LA COMTESSE, souriant. Mon ruban ?... Quelle enfance3 !
20 SUZANNE. J’ai voulu le lui ôter, madame, c’était un lion ; ses yeux brillaient... Tu ne
l’auras qu’avec ma vie, disait-il en forçant sa petite voix douce et grêle.
LA COMTESSE, rêvant. Eh bien, Suzon ?
SUZANNE. Eh bien, madame, est-ce qu’on peut faire finir
25 ce petit démon-là ? Ma marraine par-ci ; je voudrais bien par l’autre4 ; et parce qu’il
n’oserait seulement baiser la robe de madame, il voudrait toujours m’embrasser, moi. LA COMTESSE,
rêvant. Laissons... laissons ces folies... Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te
30 dire ?...
SUZANNE. Que si je ne voulais pas l’entendre, il allait protéger Marceline.
LA COMTESSE se lève et se promène en se servant fortement de l’éventail. Il ne m’aime plus du tout.
35 SUZANNE. Pourquoi tant de jalousie ?
LA COMTESSE. Comme tous les maris, ma chère ! uni- quement par orgueil, Ah ! je l’ai trop aimé ! je
l’ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour ; voilà mon seul tort avec lui : mais je
n’entends pas que cet honnête aveu
40 te nuise, et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il ?
SUZANNE. Dès qu’il verra partir la chasse.
LA COMTESSE, se servant de l’éventail. Ouvre un peu la croisée5 sur le jardin. Il fait une chaleur
ici !...
45 SUZANNE. C’est que madame parle et marche avec action. (Elle va ouvrir la croisée du fond.)
LA COMTESSE, rêvant longtemps. Sans cette constance à
me fuir... Les hommes sont bien coupables !
SUZANNE crie de la fenêtre. Ah ! voilà Monseigneur qui
50 traverse à cheval le grand potager, suivi de Pédrille, avec deux, trois, quatre lévriers.
LA COMTESSE. Nous avons du temps devant nous. (Elle s’assied.) On frappe, Suzon ?
SUZANNE court ouvrir en chantant. Ah ! c’est mon Figaro !
55 ah ! c’est mon Figaro !
...
Acte II Scène 1 : 1 bergère : fauteuil profond (l. 1) / 2 je l’aurais refusé : je lui aurais refusé
sa grâce (l. 11) / 3 enfance : enfantillage
(l. 19) / 4 par-ci par l’autre : par-ci par là (l. 26) / 5 croisée : fenêtre (l. 44)
LE MARIAGE DE FIGARO Acte III Scène 5
Le COMTE, FIGARO FIGARO, à part. Nous y voilà.
LE COMTE. ... S’il en sait par elle un seul mot... FIGARO, à part. Je m’en suis douté.
LE COMTE. ... je lui fais épouser la vieille.
5 FIGARO, à part. Les amours de monsieur Bazile ?
LE COMTE. ... Et voyons ce que nous ferons de la jeunes- se1.
FIGARO, à part. Ah ! ma femme, s’il vous plait.
LE COMTE se retourne. Hein ? quoi ? qu’est-ce que c’est ?
10 FIGARO s’avance. Moi, qui me rends à vos ordres.
LE COMTE. Et pourquoi ces mots ?… FIGARO. Je n’ai rien dit.
LE COMTE répète. Ma femme, s’il vous plait ?
FIGARO. C’est... la fin d’une réponse que je faisais : allez
15 le dire à ma femme, s’il vous plait.
LE COMTE se promène. Sa femme ! … Je voudrais bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur,
quand je le fais appeler ?
FIGARO, feignant d’assurer son habillement. Je m’étais
20 sali sur ces couches en tombant ; je me changeais.
LE COMTE. Faut-il une heure ? FIGARO. Il faut le temps.
LE COMTE. Les domestiques ici... sont plus longs à s’habiller que les maîtres !
25 FIGARO. C’est qu’ils n’ont point de valets pour les y aider.
LE COMTE. … je n’ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger inutile, en
vous jetant... FIGARO. Un danger ! on dirait que je me suis engouffré
30 tout vivant...
LE COMTE. Essayer de me donner le change en feignant
de le prendre2, insidieux3 valet ! Vous entendez fort bien que ce n’est pas le danger qui
m’inquiète, mais le motif. FIGARO. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renver-
35 sant tout, comme le torrent de la Morena4 ; vous cherchez un homme, il vous le faut, ou
vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons ! Je me trouve là par hasard : qui sait dans
votre emportement si...
LE COMTE, interrompant. Vous pouviez fuir par l’escalier.
40 FIGARO. Et vous, me prendre au corridor.
LE COMTE, en colère. Au corridor5 ! (À part.) Je m’empor- te, et nuis à ce que je veux savoir.
FIGARO, à part. Voyons-le venir, et jouons serré.
LE COMTE, radouci. Ce n’est pas ce que je voulais dire ;
45 laissons cela. J’avais... oui, j’avais quelque envie de t’emmener à Londres courrier de
dépêches... mais, toutes réflexions faites...
FIGARO. Monseigneur a changé d’avis ?
LE COMTE. Premièrement, tu ne sais pas l’anglais.
50 FIGARO. Je sais God-dam6.
LE COMTE. Je n’entends pas. FIGARO. Je dis que je sais God-dam.
LE COMTE. Hé bien ?
FIGARO. Diable ! c’est une belle langue que l’anglais ! il
55 faut peu pour aller loin. Avec God-dam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part.
-Voulez-vous tâter d’un bon poulet gras ? entrez dans une taverne, et faites seule-
ment ce geste au garçon. (Il tourne la broche.) God-dam ! on vous apporte un pied de bœuf salé,
sans pain. C’est admi-
60 rable ! Aimez-vous à boire un coup d’excellent bourgogne
ou de clairet7 ? rien que celui-ci. (Il débouche une bouteille.) God-dam ! on vous sert un pot de
bière, en bel étain, la mousse aux bords. Quelle satisfaction ! Rencontrez-vous une de ces jolies
personnes qui vont trottant menu, les
65 yeux baissés, coudes en arrière, et tortillant un peu des hanches ? mettez mignardement
tous les doigts unis sur la bouche. Ah God-dam ! elle vous sangle8 un soufflet de crocheteur9 :
preuve qu’elle entend. Les Anglais, à la véri- té , ajoutent par-ci, par-là, quelques autres mots
en conver-
70 sant ; mais il est bien aisé de voir que God-dam est le fond de la langue ; et si
Monseigneur n’a pas d’autre motif de
me laisser en Espagne...
LE COMTE, à part. Il veut venir à Londres ; elle n’a pas
parlé.
75 FIGARO, à part. Il croit que je ne sais rien ; travaillons-le un peu dans son genre.
LE COMTE. Quel motif avait la Comtesse pour me jouer un pareil tour ?
FIGARO. Ma foi, Monseigneur, vous le savez mieux que
80 moi.
LE COMTE. Je la préviens sur tout10, et la comble de pré- sents.
FIGARO. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. Sait-on gré du superflu à qui nous prive du
nécessaire ?
85 LE COMTE. ... Autrefois tu me disais tout.
FIGARO. Et maintenant je ne vous cache rien.
LE COMTE. Combien la Comtesse t’a-t-elle donné pour cette belle association ?
FIGARO, Combien me donnâtes-vous pour la tirer des
90 mains du docteur11 ? Tenez, Monseigneur, n’humilions pas l’homme qui nous sert bien,
crainte d’en faire un mauvais valet.
LE COMTE. Pourquoi faut-il qu’il y ait toujours du louche en ce que tu fais ?
95 FIGARO. C’est qu’on en voit partout quand on cherche des torts.
LE COMTE. Une réputation détestable !
FIGARO. Et si je vaux mieux qu’elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ?
100 LE COMTE. Cent fois je t’ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit.
FIGARO. Comment voulez-vous ? la foule est là : chacun veut courir, on se presse, on pousse, on
coudoie, on ren- verse, arrive qui peut ; le reste est écrasé. Aussi c’est fait ;
105 pour moi, j’y renonce,
LE COMTE. À la fortune ? (À part.) Voici du neuf. FIGARO, à part. A mon tour maintenant. (Haut.)
Votre Excellence m’a gratifié de la conciergerie du château ; c’est
un fort joli sort : à la vérité, je ne serai pas le courrier
110 étrenné des nouvelles12 intéressantes ; mais en revanche, heureux avec ma femme au fond de
l’Andalousie...
LE COMTE. Qui t’empêcherait de l’emmener à Londres ? FIGARO. Il faudrait la quitter si souvent, que
j’aurais bientôt du mariage par-dessus la tête.
115 LE COMTE. Avec du caractère et de l’esprit, tu pourrais un jour t’avancer dans les bureaux.
FIGARO. De l’esprit pour s’avancer ? Monseigneur se rit du mien. Médiocre et rampant, et l’on
arrive à tout,
LE COMTE. ... Il ne faudrait qu’étudier un peu sous moi
120 la politique.
FIGARO. Je la sais.
LE COMTE. Comme l’anglais, le fond de la langue ! FIGARO. Oui, s’il y avait ici de quoi se vanter.
Mais feindre d’ignorer ce qu’on sait, de savoir tout ce qu’on
125 ignore ; d’entendre1 ce qu’on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu’on entend ; surtout de
pouvoir au-delà de ses forces ; avoir souvent pour grand secret de cacher qu’il n’y en a point ;
s’enfermer pour tailler des plumes, et paraître profond quand on n’est, comme on dit, que vide
130 et creux ; jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres
; amollir des cachets13, intercepter des lettres, et tâcher d’ennoblir la pauvreté des moyens par
l’importance des objets : voilà toute la poli- tique, ou je meure14 !
135 LE COMTE. Eh ! c’est l’intrigue que tu définis FIGARO. La politique, l’intrigue, volontiers
; mais, comme je les crois un peu germaines15, en fasse qui
voudra ! J’aime mieux ma mie, ô gué ! comme dit la chanson du bon Roi.
140 LE COMTE, à part. Il veut rester. J’entends... Suzanne m’a
trahi,
FIGARO, à part. Je l’enfile6, et le paye en sa monnaie. LE COMTE. Ainsi tu espères gagner ton
procès contre Marceline ?
145 FIGARO. Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille, quand Votre Excellence se
permet de nous souffler toutes les jeunes !
LE COMTE, raillant. Au tribunal le magistrat s’oublie, et ne voit plus que l’ordonnance.
150 FIGARO. Indulgente aux grands, dure aux petits...
LE COMTE. Crois-tu donc que je plaisante ?
FIGARO. Eh ! qui le sait, Monseigneur ? Tempo è galant’
uomo16, dit l’Italien ; il dit toujours la vérité : c’est lui qui m apprendra qui me veut du mal,
ou du bien.
155 LE COMTE, à part. Je vois qu’on lui a tout dit ; il épouse- ra la duègne.
FIGARO, à part. Il a joué au fin avec moi, qu’a-t-il appris ?
Extraits de Le Mariage de Figaro (1784) de P. A. Beaumarchais
Acte III Scène 5 : 1 la vieille : Marceline... la jeunesse : Suzanne (l. 4 - 6) / 2 donner le
change : amener sur une fausse piste... prendre le change : se tromper volontairement (l. 31 / 32)
/ 3 insideux : qui cherche à tromper (l. 32) / 4 la Morena : sommet andalou (l. 35) / 5 corridor :
couloir étroit (l . 41) / 6 God-dam : juron anglais : Dieu me damne (l. 50) / 7 clairet : vin rouge
de Bordeaux (l. 61) /
8 sangle : donne un coup de sangle (l. 67) / 9 crocheteur : porteur de bagages (l. 68) / 10 je la
préviens sur tout : j’anticipe ses désirs
(l. 81) / 11 docteur : Bartholo (l. 90) / 12 étrenné des nouvelles : qui est le premier au courant
des nouvelles qu’il porte (l. 110) / 13 amollir des cachets : décacheter une lettre en faisant
fondre la cire, pour la lire en secret (l. 131) / 14 je meure : que je meure (l. 134)
/ 15germaines : cousines - parentes (l. 137) / 16 Tempo è galant’ uomo : le Temps est galant -
honnête homme ( proverbe italien ) (l.
152)
L’Argumentation
Argumenter par la description
L'Interdiction
[Le juge Popinot, accompagné dans la première visite par son neveu le médecin Horace Bianchon, se
rend d'abord chez madame d'Espard qui demande l'interdiction de son mari (c'est-à-dire qu'il soit
privé de la libre disposition et de l'administration de ses biens) pour cause de folie, puis chez
le marquis d'Espard. Les deux époux vivent séparés depuis plusieurs années.]
Chez la marquise d'Espard
L'hôtel d'Espard exigeait un nombreux domestique, le train de la marquise était considérable. Les
grandes réceptions avaient lieu au rez-de-chaussée, mais la marquise habitait le premier étage de
sa maison. La tenue d'un escalier magnifiquement orné, des appartements décorés dans le goût noble
qui jadis respirait à Versailles, annonçaient une immense fortune. Quand le juge vit la porte
cochère s'ouvrant devant le cabriolet de son neveu, il examina par un rapide coup d'œil la loge, le
suisse, la cour, les écuries, les dispositions de cette
demeure, les fleurs qui garnissaient l'escalier, l'exquise propreté des rampes, des murs, des
tapis, et compta les valets en livrée qui, au coup de cloche, arrivèrent sur le palier (…)
--Monsieur Popinot. - Monsieur Bianchon.
Ces deux noms furent dits à l'entrée du boudoir où se trouvait la marquise, jolie pièce récemment
remeublée et qui donnait sur le jardin de l'hôtel. En ce moment, madame d'Espard était assise
dans un de ces anciens fauteuils rococo que Madame avait mis à la mode. Rastignac occupait près
d'elle, à sa gauche, une chauffeuse dans laquelle il s'était établi comme le primo d'une dame
italienne. Debout, à l'angle de la cheminée, se tenait un troisième personnage. (…) la marquise
était d'un tempérament sec et nerveux : sans son régime, son teint eût pris la couleur rougeâtre
que donne un constant échauffement ; mais elle ajoutait encore à sa blancheur factice par les
nuances et les tons vigoureux des étoffes dont elle s'entourait ou avec lesquelles elle
s'habillait. Le brun-rouge, le marron, le bistre à reflets d'or, lui allaient à merveille. Son
boudoir, copié sur celui d'une célèbre lady alors à la mode à Londres, était en velours couleur
tan ; mais elle y avait ajouté de nombreux agréments dont les jolis dessins atténuaient la pompe
excessive de cette royale couleur.
Honoré de Balzac, L'Interdiction (1836)
Candide (chapitre troisième)
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le
parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par?dessus des tas de morts et
de mourants, et gagna d'abord un village voisin; il était en cendres : c'était un village abare
que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups
regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes,
là des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les
derniers soupirs; d'autres, à demi brûlées, criaient qu'on
achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de
jambes coupés.
Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village il appartenait à des Bulgares, et les héros
abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers
des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son
bissac, et n'oubliant jamais Mlle Cunégonde.
Candide (chapitre troisième) Voltaire
Les Misérables
Alors on vit un spectacle formidable.
Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonne par
division, descendit d'un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de
bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle-Alliance, s'enfonça dans le fond redoutable où
tant d'hommes déjà étaient tombés, y disparut dans la fumée, puis, sortant de cette ombre, reparut
de l'autre côté du vallon, toujours compacte et serrée, montant au grand trot, à travers un nuage
de mitraille crevant sur elle, l'épouvantable pente de boue du plateau de Mont- Saint-Jean ; ils
montaient, graves, menaçants, imperturbables ; dans les intervalles de la mousqueterie et de
l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant deux divisions, ils étaient deux colonnes
; la division Wathier avait la droite, la division Delord avait la gauche. On croyait voir de loin
s'allonger vers la crête du plateau deux immenses couleuvres d'acier. Cela traversa la bataille
comme un prodige.
Rien de semblable ne s'était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moskowa par la grosse
cavalerie ; Murat y manquait, mais Ney s'y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue
monstre et n'eût qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On
les apercevait à travers une vaste fumée déchirée ça et là. Pêle-mêle de casques, de cris, de
sabres, bondissement orageux des croupes des chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte
discipliné et terrible ; là- dessus les cuirasses, comme les écailles de l'hydre.
Les Misérables (Deuxième partie- Cosette ; livre premier, Waterloo, IX) Victor Hugo
Portrait de Madame Saint - Estève
Victorin fut saisi d'un frisson intérieur, pour ainsi dire, à l'aspect de l'affreuse vieille.
Quoique richement mise, elle épouvantait par les signes de méchanceté froide que présentait sa
plate figure horriblement ridée, blanche et musculeuse. Marat, en femme et à cet âge, eût été,
comme la Saint-Estève, une image vivante de la Terreur. Cette vieille sinistre offrait dans ses
petits yeux clairs la cupidité sanguinaire des tigres. Son nez épaté, dont les narines agrandies en
trous ovales soufflaient le feu de l'enfer, rappelait le bec des plus mauvais oiseaux de proie. Le
génie de l'intrigue siégeait sur son front bas et cruel. Ses longs poils de barbe poussés au
hasard dans tous les creux de son visage annonçaient la virilité de ses projets. Quiconque eût vu
cette femme aurait pensé que tous les peintres avaient manqué la figure de Méphistophélès…
Honoré de Balzac, La cousine Bette (1846)
La famille Vervelle
[Fougères, un jeune peintre pauvre, attend des clients]
En entendant le bruit de plusieurs pas dans l'escalier, Fougères se rehaussa le toupet, boutonna sa
veste de velours vert bouteille, et ne fut pas médiocrement surpris de voir une figure vulgairement
appelée un melon dans les ateliers. Ce fruit surmontait une citrouille, vêtue de drap bleu, ornée
d'un paquet de breloques
tintinnabulant. Le melon soufflait comme un marsouin, la citrouille marchait sur des navets,
improprement appelés des jambes. Un vrai peintre aurait ainsi fait la charge du petit marchand de
bouteilles, et l'eût mis immédiatement à la porte en
lui disant qu'il ne peignait pas les légumes. Fougères regarda la pratique sans rire, car monsieur
Vervelle présentait un diamant de mille écus à sa chemise.
(...)
Ce bourgeois attirait à lui une autre complication de légumes dans la personne de sa femme et de sa
fille. La femme avait sur la figure un acajou répandu, elle ressemblait à une noix de coco
surmontée d'une tête et serrée par une ceinture. Elle pivotait sur ses pieds, sa robe était jaune,
à raies noires. Elle produisait orgueilleusement des mitaines extravagantes sur des mains enflées
comme les gants d'une enseigne. Les plumes du convoi de première classe flottaient sur un chapeau
extravasé. Des dentelles paraient des épaules aussi bombées par derrière que par devant : ainsi la
forme du coco était parfaite. Les pieds du genre de ceux que les peintres appellent des abattis,
étaient ornés de six lignes au- dessus du cuir verni des souliers. Comment les pieds y étaient-ils
entrés ? On ne sait.
Suivait une jeune asperge, verte et jaune par sa robe, et qui montrait une petite tête couronnée
d'une chevelure en bandeau, d'un jaune carotte qu'un Romain eût adoré, des bras filamenteux, des
taches de rousseur sur un teint assez blanc, des grands yeux innocents à cils blancs, peu de
sourcils, un chapeau de paille
d'Italie avec deux honnêtes coques de satin bordé d'un liseré de satin blanc, les
mains vertueusement rouges, et les pieds de sa mère. Ces trois êtres avaient, en regardant
l'atelier, un air de bonheur qui annonçait en eux un respectable enthousiasme pour les Arts.
Honoré de Balzac (1799 - 1850), Pierre Grassou (1839)
Portrait de Madame Jeanrenaud
Le lendemain, à quatre heures après midi, une grosse dame, qui ressemblait assez à une futaille à
laquelle
on aurait mis une robe et une ceinture, suait et soufflait en montant l'escalier du juge Popinot.
Elle était à
grand-peine sortie d'un landau vert qui lui seyait à
merveille : la femme ne se concevait pas sans le landau, ni le landau sans la femme.
- C'est moi, mon cher monsieur, dit-elle en se présentant à la porte du cabinet du juge, madame
Jeanrenaud (…).
Le juge resta tout ébahi à l'aspect de cette prétendue maréchale d'Ancre. Madame Jeanrenaud avait
une figure percée d'une infinité de trous, très colorée, à front bas, un nez retroussé, une figure
ronde comme une boule; car chez la bonne femme tout était rond. Elle avait les yeux vifs d'une
campagnarde, l'air franc, la parole joviale, des cheveux châtains retenus par un faux bonnet sous
un chapeau vert orné d'un vieux bouquet d'oreilles-d'ours. Ses seins volumineux excitaient le rire
en faisant craindre une grotesque explosion à chaque tousserie. Ses grosses jambes étaient de
celles qui font dire d'une femme, par les gamins de Paris, qu'elle est bâtie sur pilotis. La veuve
avait une robe verte garnie de chinchilla, qui lui allait comme une tache de cambouis à une robe
de mariée.
Honoré de Balzac, L'Interdiction (1836)
Portrait de Scrooge
[Le portrait qui suit se trouve dans les premières pages d'un récit de Dickens, Un Chant de Noël.]
Oh ! il tenait bien le poing fermé sur la meule, le bonhomme Scrooge ! […] Le froid qui était
au-dedans de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa
démarche raide et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au-dehors par le
son aigre de sa voix. Une gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils et son menton
fin et nerveux. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de zéro ; il
glaçait son bureau aux jours caniculaires et ne le dégelait pas d'un degré à Noël.
La chaleur et le froid extérieurs avaient peu d'influence sur Scrooge. Les ardeurs de l'été ne
pouvaient le réchauffer, et l'hiver le plus rigoureux ne parvenait pas à le refroidir. Aucun
souffle de vent n'était plus âpre que lui. Jamais neige en tombant n'alla plus droit à son but,
jamais pluie battante ne fut plus inexorable. Le mauvais temps ne savait par où trouver prise sur
lui ; les plus fortes averses, la neige, la grêle, les giboulées ne pouvaient se vanter d'avoir sur
lui qu'un avantage : elles tombaient souvent \"avec profusion\". Scrooge ne connut jamais ce mot.
Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait : \"Mon cher Scrooge,
comment vous portez-vous ? quand viendrez-vous me voir ?\" Aucun mendiant n'implorait de lui le plus
léger secours, aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit
femme, prier Scrooge, une seule fois dans toute sa vie, de lui indiquer le chemin de tel ou tel
endroit. Les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître, et, quand ils le voyaient venir,
ils entraînaient leurs maîtres sous les portes cochères et dans les ruelles, puis remuaient la
queue comme pour dire : \"Mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas d'œil du tout qu'un mauvais œil
!\"
Mais qu'importait à Scrooge ? C'était là précisément
ce qu'il voulait. Se faire un chemin solitaire le long des
grands chemins de la vie fréquentés par la foule, en avertissant les passants par un écriteau
qu'ils eussent à se tenir à distance...
Charles Dickens - Un Chant de Noël
Portrait de monsieur de Nemours
Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang
n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la
galanterie. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral ; toutes
ces bonnes qualités étaient vives et éclatantes ; enfin il était seul digne d'être comparé au duc
de Nemours, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la
nature ; ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme le mieux fait et le plus beau.
Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable, et un agrément dans son
esprit, dans son visage et dans ses actions que
l'on n'a jamais vu qu'à lui seul ; il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux
femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était
toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imitée, et enfin un air dans toute sa personne
qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait
aucune femme dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle ; peu de
celles à qui il s'était attaché, se pouvaient vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui
il n'avait point témoigné de passion, n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de
douceur et tant de disposition
à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui tâchaient de lui plaire :
ainsi il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de savoir celle qu'il aimait
véritablement.
Madame de la Fayette - La Princesse de Clèves, tome premier
Argumenter par l’Énonciation : Éprouver ou susciter un sentiment violent
(s’indigner, s’émouvoir ou émouvoir, choquer, scandaliser, ironiser)
Homère - Iliade, chant XXIV
[Les Achéens font, depuis dix ans, le siège de la ville de Troie. L'un de leurs chefs, le divin
Achille, a tué en combat singulier, avec l'aide de la déesse Athéna, le futur roi de Troie, le fils
du roi Priam,
Hector. Il refuse au cadavre de son ennemi une sépulture, lui interdisant par là l'accès au monde
des morts. Les dieux qui ont permis la mort d'Hector, parce qu'ils avaient résolu la chute de
Troie, ne veulent pas pour ce héros l'effroyable destinée que lui prépare Achille. Ils avertissent
ce dernier qu'il devra rendre le corps d'Hector à son père, et ils envoient Hermès pour conduire
Priam, sans dommage pour sa vie, à travers le camp des Grecs, jusqu'au quartier où se
tient Achille, le fils de Pélée.]
Il [Priam] s'arrête près d'Achille, il lui embrasse les genoux,* il lui baise les mains - ces mains
terribles, meurtrières, qui lui ont tué tant de fils. (…) Et Priam supplie Achille en disant :
\"Souviens-toi de ton père, Achille pareil aux dieux. Il a mon âge, il est, tout comme moi, au seuil
maudit de la vieillesse. Des voisins l'entourent, qui le tourmentent sans doute, et personne près
de lui, pour écarter le malheur, la détresse ! Mais il a, du moins, lui, cette joie au cœur, qu'on
lui parle de toi comme d'un vivant, et il compte chaque jour voir revenir son fils de Troie. Mon
malheur, à moi, est complet. J'ai donné le jour à des fils, qui étaient des braves, dans la vaste
Troie : et je songe que d'eux aucun ne m'est resté. Ils étaient cinquante, le jour où sont venus
les Achéens ; dix-neuf sortaient du même sein, le reste m'était né d'autres femmes en mon palais.
La plupart ont eu les genoux rompus par l'ardent Arès. Le seul
qui me restait, pour protéger la ville et ses habitants, tu me l'as tué hier, défendant son pays -
Hector. C'est pour lui que je viens aux nefs des Achéens, pour te le racheter. Je t'apporte une
immense rançon. Va, respecte les dieux, Achille, et, songeant à ton père, prends pitié de moi. Plus
que lui encore, j'ai droit à la pitié ; j'ai osé, moi, ce que jamais encore n'a osé
mortel ici-bas : j'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui m'a tué mes enfants.\"
Il dit, et chez Achille il fait naître un désir de pleurer sur son père. Il prend la main du vieux
et doucement l'écarte. Tous les deux se souviennent : l'un pleure longuement sur Hector meurtrier,
tapi aux
pieds d'Achille ; Achille cependant pleure sur son père
(…).
Homère - Iliade, chant XXIV, vers 477 à 507 (traduction Paul Mazon ; édition \"Les Belles Lettres\")
* c'est l'attitude du suppliant
Hernani, Acte II, scène IV
[Hernani, qui est en réalité Jean d'Aragon \"fils proscrit d'un père assassiné\", poursuit de sa
haine Don Carlos, le futur Charles Quint, dont le père est responsable de la mort du sien. Hernani
se veut le vengeur. Mais il est dominé par un autre sentiment, l'amour qu'il éprouve pour Doña Sol,
amour partagé. Cependant cette jeune femme, fille d'une des premières familles espagnoles, n'est
pas libre de ses sentiments. Elle dépend d'un tuteur, Don Ruy Gomez de Silva, qui malgré ses
soixante ans, la veut
prendre pour épouse. Elle est aussi convoitée par Don Carlos. Elle ignore, enfin, l'identité réelle
d'Hernani
; elle sait seulement qu'il est mis au ban du royaume, que sa tête est menacée.
Dans la scène suivante, les deux héros se retrouvent seuls, la nuit, devant le palais de Silva ;
Hernani, qui vient d'avoir une occasion de tuer Carlos, l'a laissé volontairement s'échapper. Il
sait que, d'un
moment à l'autre, des soldats vont venir pour se saisir de lui.]
Doña Sol, saisissant la main d'Hernani. Maintenant, fuyons vite.
Hernani, la repoussant avec une douceur grave. Il vous sied, mon amie,
630 D'être dans mon malheur toujours plus raffermie,
De n'y point renoncer, et de vouloir toujours,
Jusqu'au fond, jusqu'au bout, accompagner mes jours. C'est un noble destin, digne d'un cœur fidèle
!
Mais, tu le vois, mon Dieu, pour tant accepter d'elle,
635 Pour emporter joyeux dans mon antre avec moi
Ce trésor de beauté qui rend jaloux un roi,
Pour que ma doña Sol me suive et m'appartienne, Pour lui prendre sa vie et la joindre à la mienne,
Pour l'entraîner sans honte encore et sans regrets,
640 Il n'est plus temps ; je vois l'échafaud de trop près.
Doña Sol
Que dites-vous ?
Hernani
Ce roi que je bravais en face
Va me punir d'avoir osé lui faire grâce.
Il fuit ; déjà peut-être il est dans son palais, Il appelle ses gens, ses gardes, ses valets,
645 Ses seigneurs, ses bourreaux… Doña Sol
Hernani ! Dieu ! Je tremble !
Eh bien ! hâtons-nous donc alors ! fuyons ensemble !
Hernani
Ensemble ! non, non. L'heure en est passée. Hélas !
Doña Sol, à mes yeux quand tu te révélas,
Bonne et daignant m'aimer d'un amour secourable,
650 J'ai bien pu vous offrir, moi, pauvre misérable, Ma montagne, mon bois, mon torrent, - ta
pitié M'enhardissait,- mon pain de proscrit, la moitié Du lit vert et touffu que la forêt me donne
; Mais t'offrir la moitié de l'échafaud ! pardonne,
655 Doña Sol ! l'échafaud, c'est à moi seul !
Doña Sol
Pourtant
Vous me l'aviez promis !
Hernani, tombant à ses genoux. Ange ! ah ! dans cet instant
Où la mort vient peut-être, où s'approche, dans l'ombre, Un sombre dénouement pour un destin bien
sombre,
Je le déclare ici, proscrit, traînant au flanc
660 Un souci profond, né dans un berceau sanglant, Si noir que soit le deuil qui s'épand sur ma
vie,
Je suis un homme heureux et je veux qu'on m'envie ; Car vous m'avez aimé ! car vous me l'avez dit !
Car vous avez tout bas béni mon front maudit !
Doña Sol, penchée sur sa tête.
665 Hernani !
Hernani
Loué soit le sort doux et propice
Qui me mit cette fleur au bord du précipice ! (Il se relève)
Et ce n'est pas pour vous que je parle en ce lieu, Je parle pour le ciel qui m'écoute, et pour
Dieu.
Doña Sol
Souffre que je te suive.
Hernani
Ah ! ce serait un crime
670 Que d'arracher la fleur en tombant dans l'abîme.
Va, j'en ai respiré le parfum, c'est assez !
Renoue à d'autres jours tes jours par moi froissés. Épouse ce vieillard. C'est moi qui te délie.
Je rentre dans ma nuit. Toi, sois heureuse, oublie !
Hernani, Acte II, scène IV, V. Hugo
Le Baptême
[L'action se situe en Bretagne, dans les années 1880. Le narrateur, un médecin, doit assister au
baptême d'un nouveau né dont il sera le parrain, le fils de son jardinier. La cérémonie a lieu le 2
janvier ; le pays est, depuis huit jours, recouvert de neige.]
À neuf heures du matin, le père Kérandec arriva devant ma porte avec sa belle-sœur, la grande
Kermagan, et la garde qui portait l'enfant dans une couverture.
Et nous voilà partis vers l'église. Il faisait un froid à fendre les dolmens, un de ces froids
déchirants qui cassent la peau et font souffrir horriblement de leur brûlure de glace. Moi je
pensais au pauvre petit être qu'on portait devant nous, et je me disais que cette race bretonne
était de fer, vraiment, pour que ses enfants fussent capables, dès leur naissance, de supporter de
pareilles promenades.
Nous arrivâmes devant l'Église, mais la porte en demeurait fermée. M. le curé était en retard.
Alors la garde, s'étant assise sur une des bornes, près du seuil, se mit à dévêtir l'enfant. Je
crus d'abord qu'il avait mouillé ses linges, mais je vis qu'on le mettait nu, tout nu, le
misérable, tout nu dans l'air gelé. Je m'avançai, révolté d'une telle imprudence.
\"Mais vous êtes folle ! Vous allez le tuer !\"
La femme répondit placidement : \"Oh non, m'sieur not' maître, faut qu'il attende l'bon Dieu tout
nu.\"
Le père et la tante regardaient cela avec tranquillité. C'était l'usage. Si on ne l'avait pas
suivi, il serait arrivé malheur au petit.
Je me fâchai, j'injuriai l'homme, je menaçai de m'en aller, je voulus couvrir de force la frêle
créature. Ce fut en vain. La garde se sauvait devant en courant dans la neige, et le corps du
mioche devenait violet.
J'allais quitter ces brutes quand j'aperçus le curé arrivant par la campagne suivi du sacristain et
d'un gamin du pays.
Le Baptême - Mau
Une Famille
[Le narrateur, un Parisien aux goûts raffinés, se rend en province chez un ami, M. Radevin, qui
était autrefois son meilleur ami, qui était en tout en communion de pensée avec lui, et qu'il n'a
pas revu depuis son mariage, depuis quinze ans. La délicatesse de ses sentiments le rend,
naturellement, soucieux devant ces retrouvailles ; son ami sera-t-il toujours aussi riche de cœur
et d'esprit ; la province et le mariage ne l'auront-ils pas engourdi dans des habitudes
bourgeoises et médiocres ?
Sur le quai de la gare l'attend un gros homme, totalement dépourvu des scrupules qui le tourmentent
lui, un homme arrivé, un notable de petite ville, un homme satisfait de lui et de son estomac, fier
de son logis, fier de sa femme, fier de s'être reproduit cinq fois.
On vient de le présenter le narrateur aux différents membres de la famille, en terminant par le
grand-père de la femme, un vieillard âgé de quatre-vingt- sept ans.]
Simon [l'ami de province, M. Radevin] venait d'entrer ; il riait :
\"Ah ! ah ! tu as fait la connaissance de bon papa. Il est impayable ce vieux ; c'est la distraction
des enfants. Il est gourmand, mon cher, à se faire mourir à tous les repas. Tu ne te figures point
ce qu'il mangerait si on le laissait libre. Mais tu verras, tu verras. Il fait de l'œil aux plats
sucrés comme si c'étaient des demoiselles. Tu n'as jamais rien rencontré de plus drôle, tu verras
tout à l'heure.\"
[ …]
Mme Radevin prit mon bras d'un air cérémonieux et on passa dans la salle à manger. Un domestique
roulait le fauteuil du vieux, qui, à peine placé devant son assiette, promena sur la dessert un
regard avide et curieux en tournant avec peine, d'un plat vers l'autre, sa tête branlante.
Alors Simon se frotta les mains : \"Tu vas t'amuser\", me dit-il. Et tous les enfants, comprenant
qu'on allait me donner le spectacle de grand-papa gourmand, se mirent à rire en même temps, tandis
que leur mère souriait seulement en haussant les épaules.
Radevin se mit à hurler vers le vieillard en formant porte-voix de ses mains : \"Nous avons ce soir
de la crème au riz sucré.\"
La face ridée de l'aïeul s'illumina et il trembla plus fort de haut en bas pour indiquer qu'il
avait compris et qu'il était content.
Et on commença à dîner.
\"Regarde\", murmura Simon. Le grand-père n'aimait pas la soupe et refusait d'en manger. On l'y
forçait, pour sa santé ; et le domestique lui enfonçait de force dans la bouche la cuiller pleine,
tandis qu'il soufflait avec énergie, pour ne pas avaler le bouillon rejeté ainsi en jets d'eau sur
la table et sur les voisins.
Les petits enfants se tordaient de joie, tandis que leur père, très content, répétait : \"Est-il
drôle, ce vieux ?\"
Et tout le long du repas on ne s'occupa que de lui. Il dévorait du regard les
plats posés sur la table ; et de sa main follement agitée essayait de les attirer à lui. On les
posait presque à portée pour voir ses efforts éperdus, son élan tremblotant vers eux, l'appel
désolé de tout son être, de son œil de sa bouche, de son nez qui
les flairait. Et il bavait d'envie sur sa serviette en poussant des grognements inarticulés. Et
toute la famille se réjouissait de ce supplice odieux et grotesque.
Puis on lui servait sur son assiette un tout petit morceau qu'il mangeait avec une gloutonnerie
fiévreuse, pour avoir plus vite autre chose.
Quand arriva le riz sucré, il eut presque une convulsion. Il gémissait de désir. Gontran lui cria :
\"Vous avez trop mangé, vous n'en aurez pas.\" Et on fit semblant
de ne lui en point donner.
Alors il se mit à pleurer. Il pleurait en tremblant plus fort, tandis que tous les enfants riaient.
On lui apporta enfin sa part, une toute petite part ; (…)
Puis, quand il eut fini, il se mit à trépigner pour en obtenir encore.
Pris de pitié (…) j'implorai pour lui : \"Voyons, donne-lui encore un peu de riz ?\" Simon répondit :
\"Oh ! non, mon cher, s'il mangeait trop, à son âge, ça pourrait lui faire mal.\"
Guy de Maupassant, Une Famille, nouvelle parue dans Gil Blas en 1886.
Hernani, Acte III, scène I
[L'action se situe dans l'heure qui précède le mariage de Don Ruy Gomez de Silva, un homme âgé de
soixante ans, avec une jeune femme dont il est le tuteur, Doña Sol, qui aime ailleurs.]
Don Ruy Gomez
Mais, va, crois-moi, ces cavaliers frivoles,
N'ont pas d'amour si grand qu'il ne s'use en paroles.
755 Qu'une fille aime et croie un de ces jouvenceaux, Elle en meurt, il en rit. Tous ces jeunes
oiseaux,
À l'aile vive et peinte, au langoureux ramage, Ont un amour qui mue ainsi que leur plumage.
Les vieux, dont l'âge éteint la voix et les couleurs,
760 Ont l'aile plus fidèle, et, moins beaux, sont meilleurs.
Nous aimons bien. Nos pas sont lourds? nos yeux arides? Nos fronts ridés ? Au cœur on n'a jamais de
rides.
Hélas ! quand un vieillard aime, il faut l'épargner.
Le cœur est toujours jeune et peut toujours saigner.
765 Oh ! mon amour n'est point comme un jouet de verre
Qui brille et tremble ; oh ! non, c'est un amour sévère, Profond, solide, sûr, paternel, amical,
De bois de chêne ainsi que mon fauteuil ducal ! Voilà comme je t'aime, et puis je t'aime encore
770 De cent autres façons, comme on aime l'aurore, Comme on aime les fleurs, comme on aime les
cieux !
[…]
775 Et puis, vois-tu, le monde trouve beau
Lorsqu'un homme s'éteint et, lambeau par lambeau, S'en va, lorsqu'il trébuche au marbre de la
tombe, Qu'une femme, ange pur, innocente colombe,
Veille sur lui, l'abrite, et daigne encor souffrir
780 L'inutile vieillard qui n'est bon qu'à mourir.
C'est une œuvre sacrée et qu'à bon droit on loue Que ce suprême effort d'un cœur qui se dévoue, Qui
console un mourant jusqu'à la fin du jour,
Et, sans aimer peut-être, a des semblants d'amour !
785 Ah ! tu seras pour moi cet ange au cœur de femme
Qui du pauvre vieillard réjouit encor l'âme, Et de ses derniers ans lui porte la moitié, Fille par
le respect et sœur par la pitié.
Hernani, Acte III, scène I - (V. Hugo)
La Tête des Autres - Acte I, scène 1
[\"L'action se passe en Poldavie\", dans le salon du procureur Maillard dont la femme et des amis
attendent impatiemment de connaître le verdict d'un procès très important pour la suite de sa
carrière.]
JULIETTE
Il y a tant d'aléas, tant d'éléments imprévisibles qui peuvent jouer contre lui ! L'atmosphère de
la salle, la composition du jury, l'humeur du président, l'hésitation d'un témoin, que sais-je ?
RENÉE
Je ne suis pas inquiète. Ton mari sait profiter de tout, même de l'imprévu. C'est une tête bien
organisée.
JULIETTE
C'est lui… J'entends son pas… Mon Dieu, pourvu qu'il apporte une bonne nouvelle, jamais je n'ai été
aussi anxieuse.
SCÈNE II
Par la porte côté cour entre Frédéric Maillard portant une serviette de cuir. C'est un
homme de trente-huit ans. Juliette, Renée et Louis s'avancent à sa rencontre.
LOUIS Alors ?
Maillard a un hochement de tête mélancolique.
RENÉE
Ça y est. Cet animal de Valorin s'en est tiré !
JULIETTE
J'en avais le pressentiment.
LOUIS
Mon pauvre vieux. Alors, non ? Ça n'a pas marché ?
MAILLARD, il éclate de rire et, l'air triomphant, vient à Juliette.
Mais si ! Ça a très bien marché puisque j'ai fait condamner mon bonhomme.
LOUIS
C'est vrai ? Les travaux forcés ? À perpétuité ?
MAILLARD
Pas du tout ! Il est bel et bien condamné à mort !
RENÉE et LOUIS, battant des mains. Bravo ! Bravo ! C'est épatant !
JULIETTE, se jetant au cou de son mari.
Mon chéri ! Comme je suis heureuse ! Non, tu ne peux pas savoir quel bonheur c'est pour moi ! J'ai
passé par de telles angoisses ! Je n'osais plus espérer la bonne nouvelle. Tu ne rentrais pas… tu
ne téléphonais pas…
[…]
LOUIS
J'avoue que je ne m'attendais pas à une condamnation à mort.
MAILLARD
Très franchement, je n'y croyais pas non plus. Bien sûr, il s'agissait d'un crime crapuleux. Mon
bonhomme avait assassiné une vieille dame pour la voler, mais, après tout, il n'y avait pas de
preuve décisive. En somme il existait un faisceau de très graves présomptions, mais qui n'étaient
tout de même que des présomptions. Les empreintes digitales, qui étaient d'ailleurs bien les
siennes, ne constituaient pas non plus une charge suffisante. La défense avait beau jeu. Vous
n'avez qu'une certitude morale, plaidait Maître Lancry. Et, au bout du compte, c'était vrai.
LOUIS
Évidemment sa position était forte. Vous avez dû vous démener comme un diable.
MAILLARD
C'est bien simple, je suis claqué. Vingt fois, j'ai cru que l'accusé sauvait sa tête. Je le sentais
m'échapper, me filer entre les doigts. Chaque fois, j'ai réussi à donner le coup de barre qui le
faisait rentrer dans l'ornière.
[…]
JULIETTE, se tournant vers le vestibule.
Oui, mes enfants, papa est rentré… Je ne sais pas… C'est lui qui vous le dira. (À Maillard.) Ce
sont les enfants. Ils n'arrivent pas à s'endormir. Va les embrasser, tu leur apprendras la bonne
nouvelle. Ils vont être si contents !
MAILLARD, se dirigeant vers le vestibule.
Chers mignons. À midi, Alain m'a fait promettre de lui apporter la tête de l'accusé. Rire général.
Maillard monte les deux marches accédant au vestibule.
JULIETTE, à Maillard.
Toute la soirée, ils ont joué à se condamner à mort. Rire attendri de Maillard qui disparaît dans
le vestibule.
La Tête des Autres - Acte I, scène 1 - Marcel Aymé (Théâtre)
Pensées
L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut
pas
que l'univers entier s'arme pour l'écraser ; une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais
quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait
qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien.
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de
l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le
principe de la morale.
Pensée 200 - 347
La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable ; un arbre ne se connaît pas
misérable.
C'est donc être misérable que de (se) connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître
qu'on est misérable.
Pensée 114 – 397
Pensées 200 - 347 et 114 - 397. B. Pascal
[Le premier chiffre est celui de l'édition Brunschvicg, le second de l'édition Lafuma]
Souvenir de la nuit du 4
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ; On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand'mère était là qui pleurait.
05 Nous le déshabillions en silence. Sa bouche,
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
10 Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant : - Comme il est blanc ! approchez donc la lampe ! Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés
sur sa tempe ! -
15 Et quand se fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
-- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer.
20 L'aïeule cependant l'approchait du foyer,
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,
25 Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une
lettre,
30 C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être !
35 Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte
; Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
40 Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
-- Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas
! je n'avais plus de sa mère que lui.
45 Pourquoi l'a-t-on tué ? je veux qu'on me l'explique.
L'enfant n'a pas crié vive la République. -
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.
Vous ne compreniez point, mère, la politique.
50 Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique,
Est pauvre et même prince ; il aime les palais ; Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
55 La Famille, l'Église et la Société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères, De leurs pauvres doigts gris que fait
trembler le temps,
60 Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 décembre 1852
V. Hugo - Les Châtiments
De l'esprit des lois
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre des nègres esclaves, voici ce que je
dirais :
Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de
l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.
Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé,
qu'il est presque impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout
une âme bonne, dans un corps tout noir.
Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les
peuples d'Asie qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous
d'une façon plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les
meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous
les hommes roux qui leur tombaient entre les mains.
Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de
verre que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les
supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle
qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant
de conventions inutiles, d'en
faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?
Montesquieu - De l'esprit des lois - XV, 5
Andromaque, Acte III, scène VII
[L'action se situe en Épire, dans le palais de Pyrrhus. Les personnages sont des héros de la guerre
de Troie. Andromaque est la veuve d'Hector, le fils du roi de Troie Priam, le futur roi de la cité.
Hector est tué, en combat singulier, par Achille que protège la déesse Athéna. Plus tard Achille, à
son tour, est tué ; mais les Grecs sont finalement victorieux selon le vouloir des dieux. Le fils
d'Achille, Pyrrhus obtient comme part de butin Andromaque et le fils qu'elle a d'Hector, Astyanax.
Pyrrhus tombe amoureux d'Andromaque qui se refuse à lui ; mais les Grecs ayant pris la décision de
faire périr Astyanax, seul rejeton de Priam et de Troie, et ayant fait savoir à Pyrrhus qu'il
devait le leur livrer, ce dernier tient alors le moyen qui va contraindre Andromaque à lui céder :
ou bien elle l'épouse, et il protège Astyanax, ou bien elle lui résiste, et il le livre pour qu'il
périsse.
La suivante d'Andromaque, Céphise, lui conseille de céder à Pyrrhus ; elle le montre prêt à
soutenir, pour l'amour d'elle et pour sauver Astyanax, une guerre contre les Grecs ; prêt à renier
sa gloire passée, celle de son père.]
ANDROMAQUE
Dois-je les [les exploits de Pyrrhus] oublier, s'il ne s'en souvient plus ? Dois-je oublier Hector
privé de funérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos murailles ?
995 Dois-je oublier son père à mes pieds renversé,
Ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle Qui fut
pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,
1000 Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage, Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, Dans la flamme étouffés, sous le fer
expirants.
1005 Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue : Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue ;
Voilà par quels exploits il sut se couronner ; Enfin voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je
ne serai point complice de ses crimes ;
1010 Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernières victimes.
Tous mes ressentiments lui seraient asservis.
CÉPHISE
Hé bien ! allons donc voir expirer votre fils :
On n'attend plus que vous. Vous frémissez, Madame !
ANDROMAQUE
Ah ! de quel souvenir viens-tu frapper mon âme !
1015 Quoi ? Céphise, j'irai voir expirer encor
Ce fils, ma seule joie, et l'image d'Hector :
Ce fils, que de sa flamme il me laissa pour gage ! Hélas ! je m'en souviens, le jour que son
courage Lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas,
1020 Il demanda son fils, et le prit dans ses bras : \"Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes,
J'ignore quel succès le sort garde à mes armes ; Je te laisse mon fils pour gage de ma foi ;
S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi.
1025 Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère,
Montre au fils à quel point tu chérissais le père.\"
Et je puis voir répandre un sang si précieux ? Et je laisse avec lui périr tous ses aïeux ?
Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne ?
1030 Si je te hais, est-il coupable de ma haine ?
T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas ?
S'est-il plaint à tes yeux des maux qu'il ne sent pas ? Mais cependant, mon fils, tu meurs si je
n'arrête
Le fer que le cruel tient levé sur ta tête.
1035 Je l'en puis détourner, et je vais t'y offrir ?
Non, tu ne mourras pas : je ne puis le souffrir.
Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère Céphise, Va le trouver pour moi.
CÉPHISE
Que faut-il que je dise ?
ANDROMAQUE
Dis-lui que de mon fils l'amour est assez fort…
Andromaque, Acte III, scène VIII, vers 992 à 1040 - Racine
De l'Art de persuader
\"L'art de persuader a un rapport nécessaire à la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur
propose, et aux conditions des choses qu'on veut faire croire.
Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, celle de
l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées ; mais la plus
ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la volonté ; car tout ce qu'il y a d'hommes sont
presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, mais par l'agrément\".
Pascal, sans vouloir explorer une méthode conduisant à cet art d'agréer, qu'il considère une \"voie
basse, indigne, étrangère\", dégage cependant quelques principes :
- connaître le cœur de celui que l'on veut toucher ; il écrit (opus cité) : quoi qu'on veuille
persuader, il faut avoir égard à la personne à qui on en veut, dont il faut connaître l'esprit et
le cœur, quels principes il accorde, quelles choses il aime ;
- tenir également compte de celui à qui l'on s'adresse : \"Ceux qui sont accoutumés à juger par le
sentiment ne comprennent rien aux choses de raisonnement.\" [Pensées 751-3]
- l'amener à découvrir lui-même ce qu'on veut lui faire adopter : \"Quand un discours naturel peint
une passion ou un effet on trouve dans soi-même la vérité de ce qu'on entend, laquelle on ne savait
pas qu'elle y fût, de sorte qu'on est porté à aimer celui qui nous la fait sentir, car il ne nous
a point fait montre de son bien mais du nôtre. Et ainsi ce bien fait nous le rend aimable, outre
que cette communauté d'intelligence que nous avons avec lui incline nécessairement le cœur à
l'aimer\". [Pensées 652-14] \"On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même
trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres\". [ Pensées 737-10]
- ménager sa susceptibilité : \"Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un autre qu'il se
trompe il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce
côté-là et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par lequel elle est fausse. Il se
contente de cela car il voit qu'il ne se trompait pas et qu'il y manquait seulement à voir tous les
côtés. Or on ne se fâche pas de ne pas tout voir, mais on ne veut pas être trompé…\" [Pensées 701-9]
- conduire l'esprit insensiblement vers ce qu'il doit admettre (métaphore de l'eau) : \"Les rivières
sont des chemins qui marchent et qui portent où l'on veut.\"
Blaise Pascal - De l'Art de persuader :
Argumenter par l’autorité du discours
C'est l'achat des nègres que font les Européens sur les côtes d'Afrique, pour employer ces
malheureux dans leurs colonies en qualité d'esclaves. Cet achat de nègres, pour les réduire en
esclavage, est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles, et tous les droits
de la nature humaine.
Les nègres, dit un Anglais moderne, plein de lumières et d'humanité, ne sont point devenus esclaves
par le droit de la guerre ; ils ne se dévouent pas non plus volontairement eux-mêmes à la
servitude, et par conséquent leurs enfants ne naissent pas esclaves. Personne n'ignore qu'on les
achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer de leur liberté, et que les
négociants les font transporter de la même manière que leurs autres marchandises, soit dans leurs
colonies, soit en Amérique où ils les exposent en vente.
Si un commerce de ce genre peut être justifié par un principe de morale, il n'y a point de crime,
quelque atroce qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les magistrats ne sont
point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté
et de les vendre pour esclaves.
D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître
; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus ni
achetés, ni payés à aucun prix. Il faut conclure de là qu'un homme dont l'esclave prend la fuite,
ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il avait acquis à prix d'argent une marchandise
illicite, et dont l'acquisition lui était interdite par toutes les lois de l'humanité et de
l'équité.
Il n'y a donc pas un seul de ces infortunés que l'on prétend n'être que des esclaves, qui n'ait
droit d'être déclaré libre, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté ; qu'il ne pouvait pas la perdre
; et que son prince, son père, et qui que ce soit dans le monde n'avait le pouvoir d'en disposer ;
par conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle-même ; ce nègre ne se dépouille, et ne
peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel ; il le porte partout avec lui, et il peut
exiger partout qu'on l'en laisse jouir. C'est donc une inhumanité manifeste de la part des juges
des pays libres où il est transporté, de ne pas l'affranchir à l'instant en le déclarant libre,
puisque c'est leur semblable, ayant une âme comme eux.
de l'article Traite des nègres
(Commerce d'Afrique) - Encyclopédie.
L’Éloge et le Blâme
Vive le Solex !
Alléluia ! C’était exactement il y a cinquante ans, au printemps 1946, une curieuse petite machine
voyait le jour dans une usine de Courbevoie. Au rythme de quinze par jour, puis cent, puis mille -
il en sera construit jusqu’à quatre cent mille en 1964 ! - l’engin fabuleux, \"la 2 CV à deux
roues\", comme le surnommeront vite ses amoureux ludiques, envahira la France du baby-boom et des
Trente Glorieuses. Une trouvaille ? Non, une révolution ! Le moteur plus petit que le casque ;
l’essieu à peine moins gros que le ventre et le réservoir guère plus gourmand qu’un Zippo
; on n’avait jamais vu ça. Le plein à dix francs (aujourd’hui) un litre aux cent en ville - mais
peut-on l’entraîner ailleurs ! -, le parking dans le hall de l’immeuble et les \"pévés\" incollables
-\"Monsieur l’agent, voyez mes pédales, je ne suis qu’un pauvre vélo !\" : un rêve. Sans oublier bien
sûr les quelques centimètres carrés d’authentique bonheur, la \"semelle\" du repose-pied - appui
unique au monde ! qui plie élégamment le corps en Z et
transforme, s’il ne pleut pas, la monture en belvédère, nid d’aigle au-dessus des carrosseries
captives, terrasse de brasserie ou passerelle de commandant. Sans oublier surtout, sa vocation
immédiate à devenir l’objet fétiche des années lycée. Ah, celle-là ! Duffle- coats et mini-jupes,
juste la hauteur qu’il faut, assis, pour embrasser les filles. Juste la vitesse idoine, debout pour
sauter les caniveaux. [...] Je n’étais pas \"remonté\" depuis bien vingt-cinq ans. Il y a quelques
mois, j’en ai retrouvé \"un vieux\" à la campagne. On est très sérieux quand on a presque trois fois
dix-sept ans. Miracle ! Il est reparti ! Et comme dans la chanson, ça a été comme si tout
recommençait ! Le même bourdonnement - vinaigrette sous la chère petite
cloche noire, le cocktail magique \"à quatre pour cent\", la même allégresse et la même liberté !
Aujourd’hui, les voitures bouchonnent, les motos suffoquent et les vélos transpirent... Youpii ! A
cheval sur l’insecte noir, je butine Paris. Piéton assis, je montre mes chaussettes ! Et je suis
heureux.
Philippe DUFAY
Le FIGARO MAGAZINE du 22 juin 1996
Éloge du voyage à pied
Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied.
On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait
tant et si peu d'exercice qu'on veut. On observe tout le
pays ; on se détourne à droite, à gauche ; on examine tout ce qui nous flatte ; on s'arrête à tous
les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie ; un bois touffu, je vais sous son ombre ;
une grotte, je la visite ; une carrière, j'examine les minéraux. Partout où je me plais , j'y
reste. A l'instant que je m'ennuie, je m'en
vais. Je ne dépends ni des chevaux ni du postillon. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout
faits, des routes commodes ; je passe partout où un homme peut passer ; je vois tout ce qu'un homme
peut voir ; et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir
...
J'ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement, et s'arracher à
l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Qui est-ce qui,
aimant un peu l'agriculture, ne veut pas connaître les productions particulières aux climats des
lieux qu'il traverse, et la manière de les cultiver ? Qui est-ce qui, ayant un peu de goût pour
l'histoire naturelle, peut se résoudre à passer un terrain sans l'examiner, un rocher sans
l'écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles ?
Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager ! sans compter la
santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaie. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes
voitures bien douces, rêveurs, tristes, grondants, ou souffrants et les piétons toujours gais,
légers et contents de tout . Combien le cœur rit quand on approche du gîte ! combien un repas
grossier paraît savoureux ! avec quel plaisir on se repose à table ! Quel bon sommeil
on fait dans un mauvais lit ! Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais
quand on veut voyager, il faut aller à pied.
Rousseau
Voyages réels ou voyages virtuels ?
L'a-t-on assez dit et répété à satiété que le siècle à venir (le nôtre, celui qui vient de
commencer) serait religieux ou pas. Ou, selon une autre version, serait spirituel ou ne serait pas.
Il sera peut-être l'un ou l'autre, encore que le chemin pris depuis quelque temps en matière
religieuse, avec les affrontements et les massacres perpétrés un peu partout, mène plutôt vers
l'Enfer que vers le Paradis. Mais je n'ai pas l'intention de jouer à mon tour au prophète. Puisque
ce monde existe encore, en dépit de toutes les prédictions apocalyptiques des faux prophètes, on
peut espérer, j'en suis même certain, que le siècle à venir sera aussi et surtout le siècle des
voyages. Mais de quels voyages ?
La question eût semblé incongrue il y a encore quelques années, mais elle a son sens aujourd'hui :
voyages réels ou voyages virtuels ? Jusqu'alors, en matière de choix, ce dernier était simple :
voyage réel ou voyage rêvé. Colomb, Magellan, Cook, Bougainville ou Homère, Swift et Jules Verne.
Aujourd'hui l'apparition du virtuel vient ajouter au voyage une troisième dimension, virtuel ne se
confondant avec imaginaire. Ce monde virtuel devient de plus en plus présent, devient même la
substance la plus novatrice des ondes et des programmes de nos télévisions. Mais il opère aussi
partout ailleurs, sur l'écran de l'ordinateur ou les réseaux de l'Internet. Le virtuel est en train
tout simplement de construire jour après jour, image après image, un monde parallèle au nôtre.
Alors, on peut poser la question autrement : voyages réels ou voyages parallèles ?
Ne nous affolons pas néanmoins : il est toujours possible de partir sur les routes, sur les rails,
sur les mers, dans les airs et même, si l'on y tient absolument sous les mers et sous la terre. Il
est toujours aussi possible de voyager aussi chez soi dans les livres et dans les gravures. Mais on
peut aussi désormais voyager chez soi sur écran. C'est là l'apport de ce siècle. Je ne sais ce
qu'en auraient pensé Rimbaud et Baudelaire, mais comme il serait hasardeux de leur demander leur
avis, je propose très modestement le mien : j'espère, je souhaite de tout cœur que l'écran de
voyage s'ajoute au livre de voyage, s'ajoute même au vrai voyage, mais sans jamais le remplacer.
Vœu pieux ou spirituel ? On le saura très vite. En tout cas nulle déploration n'est de mise,
surtout quand il s'agit d'exploration (dont je rappelle que l'étymologie vient du latin ex-plorare,
\"pleurer hors de chez soi\".) On désignait ainsi, à Rome, quand un siège s'éternisait devant une
ville à conquérir, des volontaires, en général des esclaves, auxquels on coupait le nez et les
oreilles et qui allaient pleurer sous les remparts de la ville. En les voyant dans cet état, on
leur ouvrait les portes et, une fois à l'intérieur, ils s'arrangeaient pour livrer la ville aux
assaillants. Je propose néanmoins sous toute réserve cette curieuse explication.
Mais revenons à nos virtualités. Tout voyage virtuel est un voyage par procuration. Comme le
deviennent de plus en plus les actes courants de notre vie : voyager, mais aussi voter, acheter,
jouer en Bourse, vivre même. Tout sauf mourir, ce qu eût été le seul et précieux avantage. Voyager
par procuration présente aussi quelques avantages : une tempête en mer sur écran ne risque pas de
vous mouiller ni un naufrage virtuel de vous engloutir. Pourtant, en matière de voyage, pour ma
part, je préfèrerai toujours les ondes naturelles aux ondes électroniques ; je préfèrerai toujours
le vent, fût-il violent, avec ses bouffées d'iode et ses paquets d'embruns, aux tempêtes sur écran
; oui, je préfèrerai toujours l'odeur des vrais voyages ou l'odeur vraie des voyages.
Il n'y a, au terme de ces réflexions, aucune moralité apparente ou impérieuse à en tirer. Si ce
n'est peut- être ces souhaits, voire ces résolutions, émises en ce début de siècle : ne lâchons pas
la proie des routes et des rivages, la proie des mers et des montagnes, la proie du soleil et des
sables pour l'ombre de l'écran et de l'ordinateur. J'ai eu beau regarder récemment les bords de mon
écran très attentivement, juste
après un voyage mouvementé aux îles de l'Atlantique, en images réelles celles-là, oui, j'ai eu beau
le regarder attentivement, je n'y ai décelé ni trace de sel ni débris d'algues. Ne lâchons pas la
proie du réel - fût-il dur et rugueux à étreindre - pour l'ombre - fût-elle séduisante - du
virtuel. Ou du moins ne la lâchons pas tout entière. Réel et virtuel ne s'opposent pas à la façon
du réel et de l'imaginaire - car des deux nous en avons besoin -, mais à la façon du réel et de
l'illusion. Nuance. Que le siècle à venir ne soit pas au moins celui des voyages illusoires.
Jacques Lacarrière
Éditorial paru dans la revue Ulysse (mars - avril 2000)
Les artistes contre la Tour Eiffel
Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté,
jusqu'ici intacte, de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du
goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en
plein coeur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique,
souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de \" Tour de Babel \".
Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris
est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, du milieu
de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le genre humain ait
enfantés. L'âme de la France, créatrice de chefs-d'oeuvre, resplendit parmi cette floraison auguste
de pierres. L'Italie, l'Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de leur héritage
artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre, et de tous les coins de l'univers Paris
attire les curiosités et les admirations.
Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus
longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir
irréparablement et se déshonorer ?
Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez
point, le déshonneur de Paris. Chacun le sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément, et
nous ne sommes qu'un faible écho de l'opinion universelle, si légitimement alarmée. Enfin lorsque
les étrangers viendront visiter notre Exposition, ils s'écrieront, étonnés : \" Quoi ? C'est cette
horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? \" Et
ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes,
le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., sera devenu le Paris
de M. Eiffel.
Il suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une
tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque cheminée d'usine, écrasant
de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le dôme des Invalides, l'Arc de triomphe, tous
nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve
stupéfiant. Et pendant vingt ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissante encore
du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de
l'odieuse colonne de tôle boulonnée...
Les artistes contre la Tour Eiffel, journal Le Temps, 14 fév.1887
Argumenter par la logique
Extrait de l'article Traite des nègres
C'est l'achat des nègres que font les Européens sur les côtes d'Afrique, pour employer ces
malheureux dans leurs colonies en qualité d'esclaves. Cet achat de nègres, pour les réduire en
esclavage, est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles, et tous les droits
de la nature humaine.
Les nègres, dit un Anglais moderne, plein de lumières et d'humanité, ne sont point devenus esclaves
par le droit de la guerre ; ils ne se dévouent pas non plus volontairement eux-mêmes à la
servitude, et par conséquent leurs enfants ne naissent pas esclaves. Personne n'ignore qu'on les
achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer de leur liberté, et que les
négociants les font transporter de la même manière que leurs autres marchandises, soit dans leurs
colonies, soit en Amérique où ils les exposent en vente.
Si un commerce de ce genre peut être justifié par un principe de morale, il n'y a point de crime,
quelque atroce qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les magistrats ne sont
point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté
et de les vendre pour esclaves.
D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître
; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus ni
achetés, ni payés à aucun prix. Il faut conclure de là qu'un homme dont l'esclave prend la fuite,
ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il avait acquis à prix d'argent une marchandise
illicite, et dont l'acquisition lui était interdite par toutes les lois de l'humanité et de
l'équité.
Il n'y a donc pas un seul de ces infortunés que l'on prétend n'être que des esclaves, qui n'ait
droit d'être déclaré libre, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté ; qu'il ne pouvait pas la perdre
; et que son prince, son père, et qui que ce soit dans le monde n'avait le pouvoir d'en disposer ;
par conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle-même ; ce nègre ne se dépouille, et ne
peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel ; il le porte partout avec lui, et il peut
exiger partout qu'on l'en laisse jouir. C'est donc une inhumanité manifeste de la part des juges
des pays libres où il est transporté, de ne pas l'affranchir à l'instant en le déclarant libre,
puisque c'est leur semblable, ayant une âme comme eux.
Extrait de l'article Traite des nègres (Commerce d'Afrique) - Encyclopédie.
Argumenter par la composition
Madame Bovary
[Emma, épouse de Charles Bovary, s'ennuie dans le mariage. Elle aurait souhaité être un homme pour
être libre de ses décisions et de ses actions. Elle rêve d'une grande passion. Un hobereau du
voisinage, Rodolphe, a des vues sur elle. À l'occasion des comices agricoles (voir le chapitre
Commentaire), il manœuvre afin de se trouver seul avec elle ; du premier étage de la salle de la
mairie, ils
écoutent, assis devant la fenêtre, le discours de M. le Conseiller. La superposition des propos de
Rodolphe et de ceux du conseiller attire l'attention sur le caractère artificiel de ce qui est dit,
sur les idées reçues, sur l'absence totale de sincérité. Le discours officiel est rempli des
métaphores et des clichés ordinaires à ce type de propos ; et Rodolphe joue à Emma la grande scène
qu'elle attend ; il lui parle des âmes incomprises, des âmes destinées à se rencontrer malgré les
obstacles que dresse entre elles une société trop médiocre pour seulement percevoir l'élan qui les
anime. Voici un court extrait de ce passage.]
- Je devrais, dit Rodolphe, me reculer un peu.
- Pourquoi ? dit Emma.
Mais, à ce moment, la voix du Conseiller s'éleva d'un ton extraordinaire. Il déclamait :
\"Le temps n'est plus, messieurs, où la discorde civile ensanglantait nos places publiques, où le
propriétaire, le négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le soir d'un sommeil paisible,
tremblaient de se voir réveillés tout à coup au bruit des tocsins incendiaires, où les maximes les
plus subversives sapaient audacieusement les bases…\"
- C'est qu'on pourrait, reprit Rodolphe, m'apercevoir d'en bas ; et puis j'en aurais pour quinze
jours à donner des excuses, et, avec ma mauvaise réputation…
- Oh ! vous vous calomniez, dit Emma.
- Non, non, elle est exécrable, je vous jure.
\"Mais, messieurs, poursuivait le Conseiller, que si, écartant de mon souvenir ces sombres tableaux,
je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle
patrie : qu'y vois-je ? Partout fleurissent le commerce et les arts ; partout des voies nouvelles
de communication, comme autant d'artères nouvelles dans le corps de l'État , y établissent des
rapports nouveaux ; (…)
- Du reste, ajouta Rodolphe, peut-être, au point de vue du monde, a-t-on raison
?
- Comment cela ? fit-elle.
- Eh quoi ! dit-il, ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées
? Il leur faut tour à tour le rêve et l'action, les passions les plus pures, les jouissances les
plus furieuses, et l'on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies.
Alors elle le regarda comme on contemple un voyageur qui a passé par des pays extraordinaires, et
elle reprit :
- Nous n'avons pas même cette distraction, nous autres pauvres femmes !
- Triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur.
- Mais le trouve-t-on jamais ? demanda-t-elle.
- Oui, il se rencontre un jour, répondit-il.
\"Et c'est là ce que vous avez compris, disait le Conseiller. Vous, agriculteurs et ouvriers des
campagnes ; vous, pionniers pacifiques d'une œuvre toute de civilisation ! vous, hommes de progrès
et de moralité ! vous avez compris, dis-je, que les orages politiques sont encore plus redoutables
vraiment que les désordres de l'atmosphère…\"
- Il se rencontre un jour, répéta Rodolphe, un jour, tout à coup, et quand on désespérait. Alors
des horizons s'entrouvrent, c'est comme une voix qui crie : \"Le voilà !\" Vous sentez le besoin de
faire à cette personne la confidence de votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout ! On
ne s'explique pas, on se devine. On s'est entrevu dans ses rêves. (Et il la regardait.) Enfin, il
est là, ce trésor que l'on a tant cherché, là, devant vous ; il brille, il étincelle. Cependant on
en doute encore, on n'ose y croire ; on en reste ébloui, comme si l'on sortait des ténèbres à la
lumière.
Et, en achevant ces mots, Rodolphe ajouta la pantomime à sa phrase. Il se passa la main sur le
visage, tel qu'un homme pris d'étourdissement ; puis il la laissa retomber sur celle d'Emma. Elle
retira la sienne. Mais le Conseiller lisait toujours :
\"Et qui s'en étonnerait, messieurs ? Celui-là seul qui serait assez aveugle, assez plongé (je ne
crains pas de le dire), assez plongé dans les préjugés d'un autre âge pour méconnaître encore
l'esprit des populations agricoles. (…)
Madame Bovary, G. Flaubert - Deuxième partie (chapitre VIII)
Études détaillées
Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments )
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ;
On voyait un rameau bénit sur un portrait. Une vieille grand'mère était là qui pleurait.
05 Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil
farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
10 Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant : - Comme il est blanc ! approchez donc la lampe !
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! -
15 Et quand se fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
-- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer.
20 L'aïeule cependant l'approchait du foyer,
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,
25 Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une
lettre,
30 C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu, Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être !
35 Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus.
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ; Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
40 Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
-- Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas
! je n'avais plus de sa mère que lui.
45 Pourquoi l'a-t-on tué ? je veux qu'on me l'explique.
L'enfant n'a pas crié vive la République. -
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.
Vous ne compreniez point, mère, la politique.
50 Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, Est pauvre et même prince ; il aime les
palais ; Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, De l'argent pour son jeu, sa table, son
alcôve, Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
55 La Famille, l'Église et la Société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été, Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères, De leurs pauvres doigts gris que fait
trembler le temps,
60 Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 décembre 1852
V. Hugo - Les Châtiments
L’argumentation dans l’apologue
Préambule aux fables Le Lion et le Rat / La Colombe et la Fourmi (La Fontaine)
Il faut, autant qu'on peut, obliger* tout le monde : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux fables* feront foi, Tant la chose en preuves abonde.
*Obliger : rendre service à, secourir.
*La seconde fable est La Colombe et la Fourmi.
La Fontaine, Le Lion et le Rat (livre II, fable 11, vers 1 à 4).
Se construire une opinion personnelle – Thème : La Condition féminine
La confrontation de points de vue littéraires et politiques
Physiologie du mariage - Extrait 1
[Le narrateur s'adresse à un homme qui désire se marier]
Arrière la civilisation ! arrière la pensée !… voilà votre cri. Vous devez avoir horreur de
l'instruction chez les femmes, par cette raison, si bien sentie en Espagne, qu'il est plus facile
de gouverner un peuple d'idiots qu'un peuple de savants. Une nation abrutie est heureuse : si elle
n'a pas le sentiment de la liberté, elle n'en a ni les inquiétudes ni les orages ; elle vit comme
vivent les polypiers ; comme eux, elle peut se scinder en deux ou trois fragments ; chaque fragment
est toujours une nation complète et végétant, propre à être gouvernée par le premier aveugle armé
du bâton pastoral. Qui produit cette merveille humaine ? L'ignorance
: c'est par elle seule que se maintient le despotisme ; il lui faut des ténèbres et le silence. Or,
le bonheur en ménage est, comme en politique, un bonheur négatif.
Balzac, Physiologie du mariage (Méditation IX, De l'instruction en ménage) Paris, 1824 - 1829.
Physiologie du mariage - Extrait 2
[Le narrateur s'adresse à un homme qui désire se marier]
Laisser une femme libre de lire les livres que la nature de son esprit la porte à choisir !… Mais
c'est introduire l'étincelle dans une sainte-barbe* ; c'est pis que cela, c'est apprendre à votre
femme à se passer de vous, à vivre dans un monde imaginaire, dans un paradis. Car que lisent les
femmes ? Des ouvrages passionnés, les Confessions de Jean-Jacques, des romans, et toutes ces
compositions qui agissent le plus puissamment sur leur sensibilité. Elles n'aiment ni la raison ni
les fruits mûrs. Or, avez-vous jamais songé aux phénomènes produits par ces poétiques lectures ?
Les romans, et même tous les livres, peignent les sentiments et les choses avec des couleurs
autrement brillantes que celles qui sont offertes par la nature ! (…)
Aussi, en lisant des drames et des romans, la femme, créature encore plus susceptible que nous de
s'exalter, doit-elle éprouver d'enivrantes extases. Elle se crée une existence idéale auprès de
laquelle tout pâlit ; elle ne tarde pas à tenter de réaliser cette vie voluptueuse à essayer d'en
transporter la magie en elle. Involontairement, elle passe de l'esprit à la lettre, et de l'âme aux
sens.
Et vous auriez la bonhomie de croire que les manières, les sentiments d'un homme comme vous, qui,
la plupart du temps, s'habille, se déshabille et… etc., devant sa femme, lutteront avec avantage
devant les sentiments de ces livres, et en présence de leurs amants factices à la toilette desquels
cette belle lectrice ne voit ni trous ni taches ?… Pauvre sot ! trop tard, hélas ! pour son malheur
et le vôtre, votre femme expérimenterait que les héros de la poésie sont aussi rares que les
Apollons de la sculpture !…
*sainte-barbe : cale du bateau où l'on conserve la poudre
Note : Les deux derniers paragraphes vous expliquent le caractère de Madame Bovary de Flaubert.
Balzac, Physiologie du mariage (Méditation IX, De l'instruction en ménage) Paris, 1824 - 1829.
Physiologie du mariage - Extrait 3
[Le narrateur s'adresse à un homme qui désire se marier]
Et, d'abord, voyez les ressources immenses que vous a préparées l'éducation des femmes pour
détourner la vôtre de son coup passager pour la science. Examinez avec quelle admirable stupidité
les filles se sont prêtées aux résultats de l'enseignement qu'on leur a imposé en France ; nous
les livrons à des bonnes, à des demoiselles de compagnie, à des gouvernantes qui ont vingt
mensonges de coquetterie et de fausse pudeur à leur apprendre contre une idée noble et vraie à leur
inculquer. Les filles sont élevées en esclaves et s'habituent à l'idée qu'elles sont au monde pour
imiter leurs grand-mères, et faire couver des serins de Canarie, composer des herbiers, arroser de
petits rosiers de Bengale, remplir de
la tapisserie ou se monter des cols. Aussi, à dix ans, si une petite fille a eu plus de finesse
qu'un garçon, à vingt est-elle timide, gauche. Elle aura peur d'une araignée, dira des riens,
pensera aux chiffons, parlera modes, et n'aura le courage d'être ni mère, ni chaste épouse .
Voici quelle marche on a suivi : on leur a montré à colorier des roses, à broder des fichus de
manière à gagner huit sous par jour. Elles auront appris (…) le tout ,dans le but de ne rien
présenter de dangereux à leur cœur. Mais en même temps leurs mères, leurs institutrices, répétaient
d'une voix infatigable que toute la science d'une femme est dans la manière dont elle sait arranger
cette feuille de figuier que prit notre mère Éve *. Elles n'ont entendu pendant quinze ans, disait
Diderot, rien autre chose que : \"Ma fille, votre de figuier va mal ; ma fille, votre feuille de
figuier va bien ; ma fille , ne serait-elle pas mieux ainsi ?\"
*feuille de figuier : cette amusante métaphore désigne ici le vêtement .
Balzac, Physiologie du mariage (Méditation IX, De l'instruction en ménage) Paris, 1824 - 1829.
L'École des femmes - (vers 87 à 96, et 100 à102)
L'École des Femmes traite du mariage, et de l'infidélité conjugale, surtout du fait de la femme.
Arnolphe, un homme d'un âge plus que mûr, depuis des années prend pour cible de ses moqueries les
maris trompés ; cependant, lui-même tente l'aventure du mariage, mais avec une jeune fille qu'il a
formée pour qu'elle soit une femme selon ses vœux.
ARNOLPHE
Moi, j'irais me charger d'une spirituelle
Qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, Qui de prose et de vers ferait de doux écrits,
90 Et que visiteraient marquis et beaux esprits, Tandis que, sous le nom du mari de Madame,
Je serais comme un saint que pas un ne réclame ? Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit
haut, Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut.
95 Je prétends que la mienne, en clartés peu sublime, Même ne sache pas ce que c'est qu'une
rime,
(…)
100 En un mot qu'elle soit d'une ignorance extrême ; Et c'est assez pour elle, à vous en bien
parler, De savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer.
L'École des femmes - (vers 123 à 146)
ARNOLPHE
Chacun a sa méthode.
En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode.
125 Je me vois riche assez, pour pouvoir, que je crois, Choisir une moitié qui tienne tout de
moi
Et de qui la soumise et pleine dépendance N'ait à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux
et posé, parmi d'autres enfants,
130 M'inspira de l'amour pour elle dès quatre ans : Sa mère se trouvant de pauvreté pressée,
De la lui demander il me vint la pensée,
Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, À s'ôter cette charge beaucoup de plaisir.
135 Dans un petit couvent, loin de toute pratique,
Je la fis élever selon ma politique,
C'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait
Pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente.
140 Et, grande, je l'ai vue à tel point innocente
Que j'ai béni le Ciel d'avoir trouvé mon fait,
Pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et, comme ma demeure
À cent sortes de monde est ouverte à toute heure,
145 Je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, Dans cette autre maison, où nul ne me
vient voir ;
Molière, l'École des femmes (Acte I, scène 1)
L'École des femmes (III, 2 - vers 747 à 801)
[ Agnès lit à voix haute, à la demande d'Arnolphe, un écrit traitant des maximes du mariage. Nous
n'avons conservé du texte que les maximes, et enlevé les commentaires d'Arnolphe.]
Ière Maxime,
Celle qu'un lien honnête Fait entrer au lit d'autrui Doit se mettre dans la tête,
Malgré le train d'aujourd'hui,
Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui.
IIème Maxime,
Elle ne se doit parer Qu'autant que peut désirer Le mari qui la possède.
C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, Et pour rien ne doit être compté
Que les autres la trouvent laide
IIIème Maxime.
Loin ces études d'œillades,
Ces eaux, ces blancs, ces pommades,
Et mille ingrédients qui font des teints fleuris !
À l'honneur tous les jours ce sont drogues mortelles, Et les soins de paraître belles
Se prennent peu pour les maris.
IVème Maxime.
Sous sa coiffe, en sortant, comme l'honneur l'ordonne, Il faut que de ses yeux elle étouffe les
coups :
Car, pour bien plaire à son époux, Elle ne doit plaire à personne.
Vème Maxime.
Hors ceux dont au mari la visite se rend, La bonne règle défend
De recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, N'ont affaire qu'à Madame, N'accommodent pas
Monsieur.
VIème Maxime.
Il faut des présents des hommes
Qu'elle se défende bien :
Car, dans le siècle où nous sommes, On ne donne rien pour rien.
VIIème Maxime.
Dans ses meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, Il ne faut écritoire, encre, papier ni plumes.
Le mari doit, dans les bonnes coutumes, Écrire tout ce qui s'écrit chez lui.
VIIIème Maxime.
Ces sociétés déréglées,
Qu'on nomme belles assemblées,
Des femmes, tous les jours, corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire,
Car c'est là que l'on conspire
Contre les pauvres maris.
IXème Maxime
Toute femme qui veut à l'honneur se vouer
Doit se défendre de jouer, Comme d'une chose funeste : Car ce jeu fort décevant, Pousse une femme
souvent
À jouer de tout son reste.
Xème Maxime.
Des promenades du temps,
Ou repas qu'on donne aux champs, Il ne faut pas qu'elle essaye ;
Selon les prudents cerveaux, Le mari, dans ces cadeaux, Est toujours celui qui paye.
Molière, L'École des femmes (vers 747 à 801)
Les femmes savantes - Extrait 1 - vers 26 à 52.
[Armande répond à sa sœur Henriette dont le seul but est le mariage.] Mon Dieu, que votre esprit
est d'un étage bas !
Que vous jouez au monde un petit personnage, De vous claquemurer aux choses du ménage,
Et de n'entrevoir point des plaisirs plus touchants Qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants !
Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, Les bas amusements de ces sortes d'affaires.
À de plus hauts objets élevez vos désirs,
Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, Et, traitant de mépris les sens et la matière,
À l'esprit, comme nous, donnez-vous toute entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux,
Que du nom de savante on honore en tous lieux ; Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille,
Aspirez aux clartés qui sont dans la famille,
Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs
Que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs.
Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservie, Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie,
Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, Et donne à la raison l'empire souverain ,
Soumettant à ses lois la partie animale,
Dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale.
Ce sont là les beaux feux, les doux attachements, Qui doivent de la vie occuper les moments ;
Et les soins où je vois tant de femmes sensibles
Me paraissent aux yeux des pauvretés horribles.
Les femmes savantes - Extrait 2 - vers 15 à 25.
Molière, Les femmes savantes (Acte I, scène 1)
[Henriette défend le mariage auprès de sa sœur Armande.] HENRIETTE
Les suites de ce mot [mariage], quand je les envisage, Me font voir un mari, des enfants , un
ménage ;
Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner,
Qui blesse la pensée et fasse frissonner.
ARMANDE
De tels attachements, ô Ciel ! sont pour vous plaire !
HENRIETTE
Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire, Que d'attacher à soi, par le titre d'époux,
Un homme qui vous aime et soit aimé de vous, Et de cette union, de tendresse suivie,
Se faire les douceurs d'une innocente vie ?
Ce nœud, bien assorti, n'a-t-il pas des appas ?
Molière, Les femmes savantes (Acte I, scène 1)
Modeste Mignon
[Au XIX° siècle, une jeune fille se révolte contre la façon dont se concluent ordinairement les
mariages.]
…Ordinairement les mariages se font au rebours du sens commun. Une famille prend des renseignements
sur un jeune homme. Si le Léandre* fourni par la voisine ou pêché dans un bal n'a pas volé, s'il
n'a pas de tare visible, s'il a la fortune qu'on lui désire, s'il sort d'un collège ou d'une école
de droit, ayant satisfait aux idées vulgaires sur l'éducation, et s'il porte bien ses vêtements, on
lui permet de voir une jeune personne, lacée dès le matin, à qui sa mère ordonne de bien veiller
sur sa langue et recommande de ne rien laisser passer de son âme, de son cœur sur sa physionomie,
en y gravant un sourire de danseuse achevant une pirouette, armée des instructions les plus
positives de montrer son vrai caractère, et à qui l'on recommande de ne pas paraître d'une
instruction inquiétante. Les parents, quand les affaires d'intérêt sont bien convenues entre eux,
ont la bonhomie d'engager les prétendus à se connaître l'un l'autre, pendant des moments assez
fugitifs où ils sont seuls, où ils
causent, où ils se promènent, sans aucune espèce de liberté, car ils se savent déjà liés. Un jeune
homme se costume alors aussi bien l'âme que le corps, et la jeune fille en fait autant de son côté.
Cette pitoyable comédie, entremêlée de bouquets, de parures, de parties de spectacle, s'appelle
\"faire sa cour à sa prétendue\". Voilà ce qui m'a révoltée, et je veux faire succéder le mariage
légitime à quelque long mariage des âmes. Une jeune fille n'a, dans toute sa vie, que ce moment où
la réflexion, la seconde vue,
l'expérience lui soient nécessaires. Elle joue sa liberté, son bonheur, et vous ne lui laissez ni
le cornet, ni les dés ; elle parie, elle fait galerie.
* Léandre : antonomase pour prétendu, pour fiancé.
Balzac, Modeste Mignon (Lettre IX à monsieur de Canalis) (1844)
Premièr e neige
Elle se souvient. On l'a mariée, voici quatre ans, avec un gentilhomme normand. C'était un fort
garçon barbu, coloré, large d'épaules, d'esprit court et de joyeuse humeur.
On les accoupla pour des raisons de fortune qu'elle ne connut point. Elle aurait volontiers dit
\"non\". Elle fit \"oui\" d'un mouvement de tête, pour ne point contrarier père et mère.
Maupassant, Première neige (nouvelle parue dans le
Gaulois, en décembre 1883)
L'Assommoir
[Gervaise, une jeune femme que son amant a abandonnée en lui laissant deux enfants, travaille comme
blanchisseuse. Un ouvrier zingueur, Coupeau, désire l'épouser. Gervaise lui dit ce à quoi elle
aspire dans l'existence ]
\"Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose… Mon idéal, ce serait de
travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir, vous
savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants,
en faire de bons sujets, si c'était possible… Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être
battue, si je me remettais jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d'être battue…\"
[Gervaise ne réalisera pas cet idéal ; autour d'elle, dans les foyers détruits par l'ivrognerie du
mari, les femmes, les enfants sont les victimes de la brutalité des hommes. Ainsi cet exemple du
chapitre X]
Dans son coin de misère, au milieu de ses soucis et de ceux des autres, Gervaise trouvait pourtant
un bel exemple de courage chez les Bijard. La petite Lalie, cette gamine de huit ans, grosse comme
deux sous de beurre, soignait le ménage avec une propreté de grande personne ; et la besogne était
rude, elle avait
la charge de deux mioches, son frère Jules et sa sœur Henriette, des mômes de trois ans et de cinq
ans, sur lesquels elle devait veiller toute la journée, même en balayant et en lavant la vaisselle
. Depuis que le père Bijard avait tué sa bourgeoise d'un coup de pied dans le ventre, Lalie
s'était faite la petite mère de tout ce monde.
Zola, L'Assommoir ( II et X)
Les Lettres de mon moulin
À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux (…). Il aimait du meilleur de son
âme une petite femme blonde, qui l'aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les
plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des
bottines.
Entre les mains de cette mignonne créature - moitié oiseau, moitié poupée, - les piécettes d'or
fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices ; (…)
- Mon mari, qui êtes si riche ! achetez-moi quelque chose de bien cher…
Et il lui achetait quelque chose de bien cher.
Daudet, Les Lettres de mon moulin (La Légende de l'homme à la cervelle d'or) (1869)
Les Femmes et le Secret
Rien ne pèse tant qu'un secret :
Le porter loin est difficile aux dames : Et je sais même sur ce fait
Bon nombre d'hommes qui sont des femmes.
Pour éprouver la sienne un Mari s'écria,
La nuit, étant près d'elle : \"Ô Dieux ! qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus ! on me déchire !
Quoi ? j'accouche d'un œuf ! - D'un œuf ? - Oui, le voilà, Frais et nouveau pondu. Gardez bien de
le dire :
On m'appellerait poule ; enfin n'en parlez pas.\" La Femme, neuve sur ce cas,
Ainsi que sur mainte autre affaire,
Crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire ; Mais ce serment s'évanouit
Avec les ombres de la nuit. L'Épouse, indiscrète et peu fine,
Sort du lit quand le jour fut à peine levé ; Et de courir chez sa voisine.
\"Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé ;
N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre :
Mon Mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien
D'aller publier ce mystère.
- Vous moquez-vous ? dit l'autre : ah ! vous ne savez guère
Quelle je suis. Allez, ne craignez rien.\"
La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle ;
Elle va la répandre en plus de dix endroits : Au lieu d'un œuf, elle en dit trois.
Ce n'est pas encor tout ; car une autre commère En dit quatre, et raconte à l'oreille le fait :
Précaution peu nécessaire,
Car ce n'était plus un secret.
Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, De bouche en bouche allait croissant,
Avant la fin de la journée
Ils se montaient à plus d'un cent.
La Fontaine, Fables (Les Femmes et le Secret, livre VIII, fable VI)
Hernani, Acte II, scène IV, - Extrait 1
[Hernani, qui est en réalité Jean d'Aragon \"fils proscrit d'un père assassiné\", poursuit de sa
haine Don Carlos, le futur Charles Quint, dont le père est responsable de la mort du sien. Hernani
se veut le vengeur. Mais il est dominé par un autre sentiment, l'amour qu'il éprouve pour Doña Sol,
amour partagé. Cependant cette jeune femme, fille d'une des premières familles espagnoles, n'est
pas libre de ses sentiments. Elle dépend d'un tuteur, Don Ruy Gomez de Silva, qui malgré ses
soixante ans, la veut prendre pour épouse. Elle est aussi convoitée par Don Carlos. Elle ignore,
enfin, l'identité réelle d'Hernani ; elle sait seulement qu'il est mis au ban du royaume, que sa
tête est menacée.
Dans la scène suivante, les deux héros se retrouvent seuls, la nuit, devant le palais de Silva ;
Hernani, qui vient d'avoir une occasion de tuer Carlos, l'a laissé volontairement s'échapper. Il
sait que, d'un moment à l'autre, des soldats vont venir pour se saisir de lui.]
Doña Sol, saisissant la main d'Hernani. Maintenant, fuyons vite.
Hernani, la repoussant avec une douceur grave. Il vous sied, mon amie,
630 D'être dans mon malheur toujours plus raffermie, De n'y point renoncer, et de vouloir
toujours,
Jusqu'au fond, jusqu'au bout, accompagner mes jours. C'est un noble destin, digne d'un cœur fidèle
!
Mais, tu le vois, mon Dieu, pour tant accepter d'elle,
635 Pour emporter joyeux dans mon antre avec moi
Ce trésor de beauté qui rend jaloux un roi,
Pour que ma doña Sol me suive et m'appartienne, Pour lui prendre sa vie et la joindre à la mienne,
Pour l'entraîner sans honte encore et sans regrets,
640 Il n'est plus temps ; je vois l'échafaud de trop près.
Doña Sol
Que dites-vous ? Hernani
Ce roi que je bravais en face
Va me punir d'avoir osé lui faire grâce.
Il fuit ; déjà peut-être il est dans son palais, Il appelle ses gens, ses gardes, ses valets,
645 Ses seigneurs, ses bourreaux… Doña Sol
Hernani ! Dieu ! Je tremble !
Eh bien ! hâtons-nous donc alors ! fuyons ensemble ! Hernani
Ensemble ! non, non. L'heure en est passée. Hélas ! Doña Sol, à mes yeux quand tu te révélas,
Bonne et daignant m'aimer d'un amour secourable,
650 J'ai bien pu vous offrir, moi, pauvre misérable, Ma montagne, mon bois, mon torrent, - ta
pitié M'enhardissait,- mon pain de proscrit, la moitié Du lit vert et touffu que la forêt me donne
; Mais t'offrir la moitié de l'échafaud ! pardonne,
655 Doña Sol ! l'échafaud, c'est à moi seul !
Doña Sol
Pourtant
Vous me l'aviez promis !
Hernani, tombant à ses genoux. Ange ! ah ! dans cet instant
Où la mort vient peut-être, où s'approche, dans l'ombre, Un sombre dénouement pour un destin bien
sombre,
Je le déclare ici, proscrit, traînant au flanc
660 Un souci profond, né dans un berceau sanglant, Si noir que soit le deuil qui s'épand sur ma
vie,
Je suis un homme heureux et je veux qu'on m'envie ; Car vous m'avez aimé ! car vous me l'avez dit !
Car vous avez tout bas béni mon front maudit !
Doña Sol, penchée sur sa tête.
665 Hernani !
Hernani
Loué soit le sort doux et propice
Qui me mit cette fleur au bord du précipice ! (Il se relève)
Et ce n'est pas pour vous que je parle en ce lieu, Je parle pour le ciel qui m'écoute, et pour
Dieu. Doña Sol
Souffre que je te suive. Hernani
Ah ! ce serait un crime
670 Que d'arracher la fleur en tombant dans l'abîme.
Va, j'en ai respiré le parfum, c'est assez !
Renoue à d'autres jours tes jours par moi froissés. Épouse ce vieillard. C'est moi qui te délie.
Je rentre dans ma nuit. Toi, sois heureuse, oublie !
V. Hugo
Hernani, Acte III, scène I - Extrait 2
[L'action se situe dans l'heure qui précède le mariage de Don Ruy Gomez de Silva, un homme âgé de
soixante ans, avec une jeune femme dont il est le tuteur, Doña Sol, qui aime ailleurs.]
Don Ruy Gomez
Mais, va, crois-moi, ces cavaliers frivoles,
N'ont pas d'amour si grand qu'il ne s'use en paroles.
755 Qu'une fille aime et croie un de ces jouvenceaux, Elle en meurt, il en rit. Tous ces jeunes
oiseaux,
À l'aile vive et peinte, au langoureux ramage, Ont un amour qui mue ainsi que leur plumage.
Les vieux, dont l'âge éteint la voix et les couleurs,
760 Ont l'aile plus fidèle, et, moins beaux, sont meilleurs.
Nous aimons bien. Nos pas sont lourds? nos yeux arides? Nos fronts ridés ? Au cœur on n'a jamais de
rides.
Hélas ! quand un vieillard aime, il faut l'épargner.
Le cœur est toujours jeune et peut toujours saigner.
765 Oh ! mon amour n'est point comme un jouet de verre
Qui brille et tremble ; oh ! non, c'est un amour sévère, Profond, solide, sûr, paternel, amical,
De bois de chêne ainsi que mon fauteuil ducal ! Voilà comme je t'aime, et puis je t'aime encore
770 De cent autres façons, comme on aime l'aurore, Comme on aime les fleurs, comme on aime les
cieux !
[…]
775 Et puis, vois-tu, le monde trouve beau
Lorsqu'un homme s'éteint et, lambeau par lambeau, S'en va, lorsqu'il trébuche au marbre de la
tombe, Qu'une femme, ange pur, innocente colombe,
Veille sur lui, l'abrite, et daigne encor souffrir
780 L'inutile vieillard qui n'est bon qu'à mourir.
C'est une œuvre sacrée et qu'à bon droit on loue Que ce suprême effort d'un cœur qui se dévoue, Qui
console un mourant jusqu'à la fin du jour,
Et, sans aimer peut-être, a des semblants d'amour !
785 Ah ! tu seras pour moi cet ange au cœur de femme
Qui du pauvre vieillard réjouit encor l'âme, Et de ses derniers ans lui porte la moitié, Fille par
le respect et sœur par la pitié.
Madame Bovary (deuxième partie, chapitre 3)
[Madame Bovary dont l'esprit a été faussé par l'éducation reçue (éducation dont la lecture des
extraits de la Physiologie du mariage vous donnera un aperçu) se trouve profondément déçu par son
mariage avec Charles Bovary, un homme dont elle ne perçoit pas l'extrême amour, mais dont elle voit
parfaitement tous les défauts. Ses amants, par leur médiocrité, leur esprit petit-bourgeois, la
décevront tout autant ; accablée de dettes, dégoûté de la vie, elle se suicide à l'arsenic.
Dans l'extrait qui suit, Madame Bovary est enceinte, et elle songe à son enfant. Naturellement, il
lui naîtra une fille.]
Elle souhaitait un fils ; il serait fort et brun, elle l'appellerait Georges ; et cette idée
d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées.
Un homme, au moins, est libre; il peut parcourir les passions et les pays, traverser les
obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée
continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec
les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par le cordon, palpite
à tous les vents ; il y a toujours quelque désir qui l'entraîne, quelque convenance qui la retient.
Flaubert, Madame Bovary (deuxième partie, chapitre 3)
Amar, un convention nel,
Discours à la Convention de novembre 1793
[Ce discours traite ces deux questions :
\"1. Les femmes peuvent-elles exercer les droits politiques et prendre une vie active au
gouvernement ?
\"2. Peuvent-elles délibérer réunies en associations politiques ou sociétés populaires ?]
\"…L'homme est fort, robuste, né avec une grande énergie, de l'audace et du courage ; il brave les
périls, l'intempérie des saisons ; il résiste à tous les éléments
; il est propre aux arts, aux travaux pénibles ; et comme il est presque exclusivement destiné à
l'agriculture, au commerce, à la navigation, aux voyages, à la guerre, à tout ce qui exige de la
force, de l'intelligence, de la capacité, de même il paraît seul propre aux méditations profondes
et sérieuses qui exigent une grande contention d'esprit et de longues études qu'il n'est pas donné
aux femmes de suivre .
\"Quel est le caractère propre de la femme ? Les mœurs et la nature même lui ont assigné ses
fonctions :… après les soins du ménage, la femme est naturellement destinée à faire aimer la vertu.
\"… Faites pour adoucir les mœurs des hommes, doivent-elles prendre une part active à des
discussions dont la chaleur est incompatible avec la douceur et la modération qui font le charme de
leur sexe ?…
\"L'honnêteté d'une femme permet-elle qu'elle se montre en public et qu'elle lutte avec les hommes
?… En général, les femmes sont peu capables de conceptions hautes et de méditations sérieuses… Les
femmes… sont disposées par leur organisation à une exaltation qui serait funeste dans les affaires
publiques, et les intérêts de l'État seraient bientôt sacrifiés à tout ce que la vivacité des
passions peut produire d'égarement et de désordre…\"
cité par madame Françoise Parturier, dans Intellectuelles et femmes socialistes de Daumier,
Éditions Michèle Trinckvel.
Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène 16).
[L'action se situe vers 1770. Au cours d'un procès, les débats révèlent que la plaignante,
Marceline, est en fait la mère de l'accusé, Figaro, ce qu'elle ignorait comme chacun, car son
enfant, alors qu'il était encore dans les langes, lui avait été enlevé par des bohémiens. La
conduite de Marceline est alors critiquée ; c'est une fille-mère. Elle répond à ses censeurs.]
BARTHOLO
Des fautes si connues ! une jeunesse déplorable.
MARCELINE, s'échauffant par degrés.
Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit ! Je n'entends pas nier mes fautes ; ce jour les a trop
bien prouvées ! mais qu'il est dur de les expier après trente ans d'une
vie modeste ! J'étais née, moi, pour être sage, et je le suis devenue sitôt qu'on m'a permis d'user
de ma raison. Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les séducteurs
nous assiègent pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis
rassemblés ? Tel nous juge ici sévèrement, qui, peut-être, en sa vie a perdu dix infortunées !
FIGARO
Les plus coupables sont les moins généreux ; c'est la règle.
Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène XVI)
[Ce texte fait suite à l'extrait de cette pièce qui a déjà été donné]
Beaumarchais
MARCELINE, vivement.
Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes !
c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; vous et vos magistrats, si vains du
droit de nous juger, et qui nous laissent enlever, par leur coupable négligence, tout moyen honnête
de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel à
toute la parure des femmes
: on y laisse former mille ouvriers de l'autre sexe. (…)
Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire ;
leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle
; traitées en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos fautes ! Ah !
sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié !
Beaumarchais
Le Barbier de Séville
[Rosine, une jeune femme est sous la dépendance de son tuteur, le docteur Bartholo, un homme
beaucoup plus âgé qu'elle, qui veut l'épouser. Elle réussit à faire parvenir un message à un jeune
homme qui lui donne la sérénade sous ses fenêtres. Elle remarque, en aparté :]
Mon excuse est dans mon malheur : seule, enfermée, en butte à la persécution d'un homme odieux,
est-ce un crime de tenter à sortir d'esclavage ?
Beaumarchais
Jacques le fataliste
[Madame de La Pommeraye s'est vengée de son amant le marquis des Arcis qui n'éprouve plus pour elle
que de l'amitié, en faisant en sorte qu'il rencontre une jeune femme qu'elle tient en son pouvoir ;
car son dessein est que le marquis tombe amoureux de cette femme, qui est en fait une prostituée,
et qu'il l'épouse. Elle lui dévoile ensuite l'identité de celle qui est maintenant la marquise des
Arcis.
À la fin du récit, l'auteur s'adresse à son lecteur.]
Vous entrez en fureur au nom de Mme de La Pommeraye, et vous vous écriez
: \"Ah ! la femme horrible ! ah ! l'hypocrite ! ah ! la scélérate !…\" Point d'exclamation, point de
courroux, point de partialité : raisonnons. (…) Vous pouvez haïr ; vous pouvez redouter Mme de La
Pommeraye : mais vous ne la mépriserez pas. Sa vengeance est atroce ; mais elle n'est souillée
d'aucun motif d'intérêt. (…) Il ne s'agit ni d'augmenter sa fortune, ni d'acquérir quelques titres
d'honneur. Quoi ! si cette femme en avait fait autant, pour obtenir à un mari la récompense de ses
services ; si elle s'était prostituée à un ministre ou même à un premier commis pour un cordon ou
pour une colonelle* ; au dépositeur de la feuille des Bénéfices*, pour une riche abbaye, cela vous
paraîtrait tout simple, l'usage serait pour vous ; et lorsqu'elle se venge d'une perfidie, vous
vous révoltez contre elle au lieu de voir que son ressentiment ne vous indigne (…) que parce que
vous ne faites presque aucun cas de la vertu des femmes. Avez-vous un peu réfléchi sur les
sacrifices que Mme de La Pommeraye avait faits au marquis ? Je ne vous dirai pas que sa bourse lui
avait été ouverte en toute occasion (…) ; mais elle s'était assujettie à toutes ses fantaisies, à
tous ses goûts ; pour lui plaire elle avait renversé le plan de sa vie. Elle jouissait de la plus
haute considération dans le monde, par la pureté de ses mœurs : et elle s'était rabaissée sur la
ligne commune. On dit d'elle, lorsqu'elle eut agréé l'hommage du marquis des Arcis : \"Enfin cette
merveilleuse Madame de La Pommeraye s'est donc faite comme une d'entre nous…\" (…) Elle avait avalé
tout le calice de l'amertume préparé aux femmes dont la conduite réglée a fait trop longtemps la
satire des mauvaises mœurs de celles qui les entourent (…) ; et elle serait morte de douleur
plutôt que de promener dans le monde, après la honte de la vertu abandonnée, le ridicule d'une
délaissée. Elle touchait au moment où la perte d'un amant ne se répare plus. Tel était son
caractère, que cet événement la condamnait à l'ennui et à la solitude. Un homme en poignarde un
autre pour un geste, pour un démenti ; et il ne sera pas permis à une honnête femme perdue,
déshonorée, trahie, de jeter le traître entre les bras d'une courtisane ? Ah ! lecteur, vous êtes
bien légal dans vos éloges et bien sévère dans votre blâme. (…) ; et j'approuverais fort une loi
qui condamnerait aux courtisanes celui qui aurait séduit et abandonné une honnête femme : l'homme
commun aux femmes communes.
*colonelle : la première compagnie d'un régiment d'infanterie
*feuille des Bénéfices : registre sur lequel sont inscrits les patrimoines et dignités
ecclésiastiques (assurant un certain revenu) que le roi peut accorder.
Diderot, Jacques le fataliste (œuvre posthume de 1796)
Préambule de l'article 1124 du Code Napoléonien
La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme
l'arbre à fruits est celle du jardinier.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne - 1791
Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question ; tu ne lui ôteras
pas du moins ce droit. Dis-moi ? qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? ta force ?
tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont
tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique.
Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur
toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre
les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la
nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce
chef- d'œuvre immortel.
L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences
et dégénéré, dans ce siècles de lumières et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut
commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir
de la révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus.
Préambule
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent à être constituées en
Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme,
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la
femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et
ceux du pouvoir, des hommes pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute, institution politique, en soient plus respectés, afin que les
réclamation des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles,
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les Droits suivants de
la Femmes et de la Citoyenne.
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne -1791
«
ADM Communication Baccalauréat de français
Page 2 sur 174 Étude de quarante sonnets.............................................................................................................51
Vers dorés..................................................................................................................................51
Bataille navale...........................................................................................................................52
Midi............................................................................................................................................53
Fleur des Ruines........................................................................................................................54
Pâles esprits...............................................................................................................................55
L'Abreuvoir.................................................................................................................................56
Comme on passe en été.............................................................................................................57
Pipée..........................................................................................................................................58
Il a plu........................................................................................................................................59
Je n'ai plus que les os.................................................................................................................60
Portraits de mains.......................................................................................................................61
Le Tombeau d'Egard Poe...........................................................................................................62
Comme on voit sur la branche….................................................................................................63
Monsieur Prudhomme.................................................................................................................64
Les Colombes.............................................................................................................................65
Mon âme a son secret................................................................................................................66
Misère........................................................................................................................................67
Ce souvenir meurt et renaît.........................................................................................................68
Espace et Temps........................................................................................................................69
Et la mer et l'amour.....................................................................................................................70
La Capitale.................................................................................................................................71
Les Pins.....................................................................................................................................72
La Reine de Saba.......................................................................................................................73
Résignation................................................................................................................................74
Je suis le champ sanglant...........................................................................................................75
Némée........................................................................................................................................76
Les Grenades.............................................................................................................................77
Médiocrité...................................................................................................................................78
Qui addit scientiam, addit et laborem*.........................................................................................79
Le Crapaud.................................................................................................................................80
Obsession..................................................................................................................................81
Pour bien chanter de paix...........................................................................................................82
Le Mal........................................................................................................................................83
Heureux qui, comme Ulysse,......................................................................................................84
La Belle Matineuse.....................................................................................................................85
Les Danaïdes.............................................................................................................................86
Sur le Tasse en Prison d'Eugène Delacroix.................................................................................87
Soir de Bataille...........................................................................................................................88
À Sextius....................................................................................................................................89
La mort simple............................................................................................................................90
Premier récit de la création.........................................................................................................91
Le dormeur du val.......................................................................................................................92
Un recueil poétique............................................................................................................................93
Étude détaillée des Châtiments......................................................................................................93
Les châtiments - Nox 1e
extrait....................................................................................................93
Les châtiments - Nox 21e
extrait..................................................................................................94
Les châtiments - Extrait de À un martyr (I - VIII)..........................................................................95
France ! à l'heure où tu te prosternes - Livre I, 1.........................................................................96
Souvenir de la nuit du 4 (V.
Hugo - Les Châtiments)...................................................................97
Stella - Livre VI, 15.....................................................................................................................99
L'art et le peuple - Livre I, 9.......................................................................................................100
Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée.
Livre VII, 1..............................................101
Le Roman...............................................................................................................................102
Le roman naturaliste.........................................................................................................................102
Bel-Ami.....................................................................................................................................102.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Zone d'Apollinaire texte bac: modernité
- Analyse linéaire "le soleil" de Baudelaire (façon texte du bac)
- Séquence 1 BAC – Texte 1 : Dom Juan (1665), Molière, Acte V, scènes 4 à 6.
- Explication de texte bac 2012 S
- BAC 2016 : Texte de Merleau-Ponty : Une œuvre d’art a-t-elle pour but de représenter la réalité ?