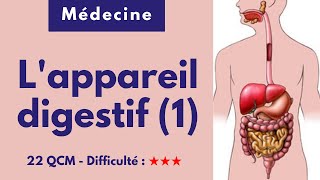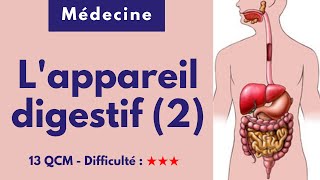Michelet, Histoire de la Révolution française (extrait 2)
Publié le 13/04/2013
Extrait du document

Tiré de l’Histoire de la Révolution française de Jules Michelet, cet extrait est très représentatif du style du grand historien du XIXe siècle qui a le souci de déceler les causes profondes des événements. Écrivant avec imagination et vigueur — ce qui donne une allure prophétique et poétique à son œuvre —, Michelet n’en cherche pas moins à établir la vérité, en discutant par exemple les sources sur le dépôt des armes de la garde suisse du roi lors de la prise du château des Tuileries, le 10 août 1792.
La chute de la monarchie vue par Michelet
[...] Au moment où les fédérés passèrent du Carrousel dans la cour, les baraques alignées parallèlement au château [des Tuileries] firent feu sur eux par-derrière, ne doutant pas d’obtenir le même succès qu’elles avaient eu une heure plus tôt. Mais dès la première décharge, les Marseillais se jetèrent avec furie sur les ouvertures des baraques, et, ne pouvant les forcer, ils y lancèrent des gargousses d’artillerie dont l’explosion fit sauter les toits, renversa les murs, incendia tout. Le feu courut en un clin d’œil d’un bout à l’autre, enveloppa toute la ligne, et tout disparut dans des tourbillons de flamme et de fumée, scène effroyable dont les assaillants eux-mêmes détournèrent les yeux avec horreur.
Est-ce alors, ou beaucoup plus tôt, qu’un capitaine suisse, Turler, vint demander au roi s’il fallait déposer les armes ? Grave question historique qui, résolue dans un sens ou dans l’autre, doit modifier nos idées sur le caractère de Louis XVI.
Selon une tradition royaliste, les Suisses, un moment vainqueurs, allaient marcher sur l’Assemblée ; un député les arrêta, les somma de poser les armes, et le capitaine, s’adressant au roi, n’en tira nulle réponse, sinon qu’il fallait les rendre à la garde nationale.
Selon une version plus sûre, puisqu’elle est constatée par le procès-verbal de l’Assemblée, ce fut après que le roi eut entendu le rapport du procureur général Rœderer annonçant à l’Assemblée que le château était forcé, ce fut alors, et même après une vive terreur panique, répandue dans l’Assemblée, que le roi avertit le président qu’il venait de faire donner ordre aux Suisses de ne point tirer.
Ceci éclaircit la question qu’on a essayé d’obscurcir. Le roi voulut éviter une plus longue effusion du sang, lorsqu’il sut que le château était forcé, lorsqu’il n’eut plus d’espoir. Cet ordre pouvait avoir le double avantage de diminuer l’exaspération des vainqueurs et de couvrir l’honneur des vaincus, de sorte que ceux-ci pussent dire, comme ils n’ont pas manqué de le faire, que l’ordre du roi avait pu seul leur arracher la victoire.
À cette heure, le château était forcé ; les Suisses, qui avaient défendu pied à pied l’escalier, la chapelle, les galeries, étaient partout enfoncés, poursuivis, mis à mort. Les plus heureux étaient les gentilshommes qui, maîtres de la grande galerie du Louvre, avaient toujours une issue prête pour échapper. Ils s’y jetèrent et trouvèrent à l’extrémité l’escalier de Catherine de Médicis, qui les mit dans un lieu désert. Tous, ou presque tous échappèrent : on n’en vit point parmi les morts. Les corps qui portaient du linge fin portaient aussi l’habit rouge ; c’étaient les faux Suisses, anciens gardes constitutionnels, et non pas les gentilshommes.
Les habits rouges étaient fort nombreux, bien au-delà des mille trois cent trente véritables Suisses qu’accuse leur capitaine. Suisses ou non, tous furent admirables. Ils se retirèrent lentement par le jardin, attendant, ralliant leurs camarades avec le sang-froid et l’aplomb de vieilles troupes manœuvrant comme à la parade, serrant tranquillement leurs rangs à mesure que la fusillade les éclaircissait. Ils firent dix haltes peut-être dans la traversée du jardin (dit un témoin oculaire) pour repousser les assaillants, chaque fois avec des feux de file parfaitement exécutés. Une chose dut les étonner fort, ce fut la prodigieuse multitude de gardes nationaux qui remplissait le jardin et allait toujours croissant. À huit heures, avant le combat, il y avait eu à la Grève huit ou dix mille gardes nationaux armés de fusils ; entre midi et une heure, immédiatement après le combat, le même témoin en vit aux Tuileries jusqu’à trente ou quarante mille. En faisant la part, ordinairement nombreuse, des hommes qui volent toujours au secours de la victoire, il reste néanmoins bien évident que le 10 août fut fait ou consenti, ratifié en quelque sorte par l’ensemble de la population, non par une partie du peuple, et nullement la partie infime, comme on l’a tant répété. Il y avait un grand nombre d’hommes en uniforme parmi ceux qui prirent le château. Ces uniformes même causèrent une fatale méprise. Les fédérés bretons, portant des habits rouges, furent pris par les officiers du château pour des Suisses qui auraient passé à l’ennemi, et tirés de préférence ; huit tombèrent du premier coup. [...]
Source : Michelet (Jules), Histoire de la Révolution française, Paris, Robert Laffont, 1979.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Liens utiles
- Michelet, Histoire de la Révolution française (extrait 1)
- Histoire de la Révolution française de Michelet (résumé & analyse)
- HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE de Michelet.
- Histoire (Partie 1) La Révolution Française Partie I 1774/1789 1774 : avènement de Louis 16 I) L'influence des révolutions d'atlantiques.
- HISTOIRE POLITIQUE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.