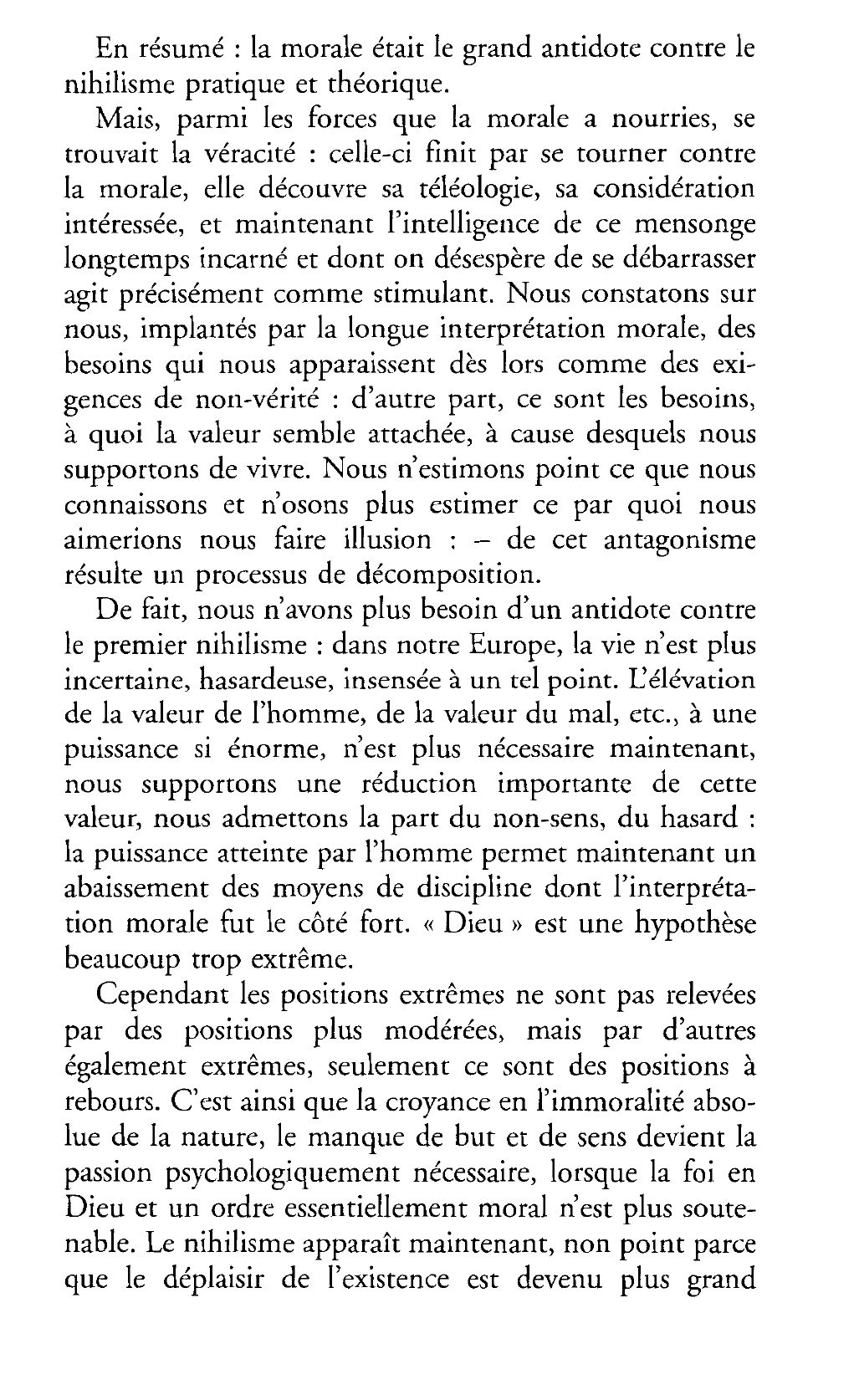Anthologie: Nietzsche
Publié le 26/03/2015

Extrait du document
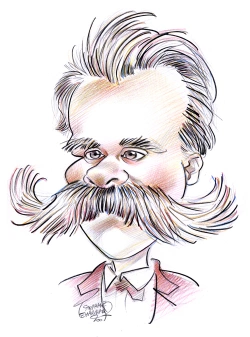
EXTRAITS
1. Nihilisme et religion
Nietzsche, La Volonté de puissance, trad. Henri
Albert, Mercure de France, I, « Le nihilisme
européen «, § 1 0- 1 1 .
10.
Le nihilisme européen
Quels avantages offrait l'hypothèse de la morale chrétienne ?
1) elle prêtait à l'homme une valeur absolue, en oppo-sition avec sa petitesse et son accidence dans le fleuve du devenir et de la disparition ;
2) elle servait les avocats de Dieu, en ce sens qu'elle laissait au monde, malgré la misère et le mal, le caractère de la perfection — y compris la fameuse « Liberté « : le mal apparaissait plein de sens ;
3) elle admettait que l'homme possède un savoir par¬ticulier au sujet des valeurs absolues et lui donnait ainsi, pour ce qui importait le plus, une connaissance adéquate ;
4) elle évitait à l'homme de se mépriser, en tant qu'homme, de prendre parti contre la vie, de désespérer de la connaissance : elle était un moyen de conservation.
En résumé : la morale était le grand antidote contre le nihilisme pratique et théorique.
Mais, parmi les forces que la morale a nourries, se trouvait la véracité : celle-ci finit par se tourner contre la morale, elle découvre sa téléologie, sa considération intéressée, et maintenant l'intelligence de ce mensonge longtemps incarné et dont on désespère de se débarrasser agit précisément comme stimulant. Nous constatons sur nous, implantés par la longue interprétation morale, des besoins qui nous apparaissent dès lors comme des exi¬gences de non-vérité : d'autre part, ce sont les besoins, à quoi la valeur semble attachée, à cause desquels nous supportons de vivre. Nous n'estimons point ce que nous connaissons et n'osons plus estimer ce par quoi nous aimerions nous faire illusion : — de cet antagonisme résulte un processus de décomposition.
De fait, nous n'avons plus besoin d'un antidote contre le premier nihilisme : dans notre Europe, la vie n'est plus incertaine, hasardeuse, insensée à un tel point. L'élévation de la valeur de l'homme, de la valeur du mal, etc., à une puissance si énorme, n'est plus nécessaire maintenant, nous supportons une réduction importante de cette valeur, nous admettons la part du non-sens, du hasard : la puissance atteinte par l'homme permet maintenant un abaissement des moyens de discipline dont l'interpréta¬tion morale fut le côté fort. « Dieu « est une hypothèse beaucoup trop extrême.
Cependant les positions extrêmes ne sont pas relevées par des positions plus modérées, mais par d'autres également extrêmes, seulement ce sont des positions à rebours. C'est ainsi que la croyance en l'immoralité abso¬lue de la nature, le manque de but et de sens devient la passion psychologiquement nécessaire, lorsque la foi en Dieu et un ordre essentiellement moral n'est plus soute¬nable. Le nihilisme apparaît maintenant, non point parce que le déplaisir de l'existence est devenu plus grand
qu'autrefois, mais parce que, d'une façon générale, on est devenu méfiant à l'égard de la « signification « qu'il peut y avoir dans le mal, ou même dans l'existence. Une seule interprétation a été ruinée : mais comme elle passait pour la seule interprétation, il pourrait sembler que l'existence n'eût aucune signification et que tout fût en vain.
Il reste à démontrer que cet « en vain « est le caractère de notre nihilisme actuel. La méfiance de nos évaluations antérieures s'accentue jusqu'à oser la question : « Toutes les "valeurs" ne sont-elles pas des moyens de séduction, pour faire traîner la comédie en longueur, mais sans que le dénouement approche ? « Cette durée, avec un « en vain «, sans but ni raison, paralysante, surtout lorsque l'on comprend que l'on est dupé, sans avoir la force de ne pas se laisser duper.
Imaginons cette idée sous la forme la plus terrible : l'existence telle qu'elle est, sans signification et sans but, mais revenant sans cesse d'une façon inévitable, sans un dénouement dans le néant : « l'Éternel Retour «.
C'est là la forme extrême du nihilisme : le néant (le « non-sens «) éternel !
Forme européenne du bouddhisme : l'énergie du savoir et de la force contraint à une pareille croyance. C'est la plus scientifique de toutes les hypothèses pos¬sibles. Nous nions les causes finales : si l'existence tendait à un but ce but serait atteint.
On comprend que ce à quoi on vise ici est en contra¬diction avec le panthéisme : car l'affirmation que « tout est parfait, divin, éternel «, force également à admettre « l'éternel retour «. Question : cette position affirmative et panthéiste en face de toutes choses est-elle rendue impossible par la morale ? En somme, c'est seulement le Dieu moral qui a été surmonté. Cela a-t-il un sens d'ima¬giner un Dieu « par-delà le bien et le mal « ? Un panthé¬isme dirigé dans ce sens serait-il imaginable ? Supprimons-nous l'idée de but dans le processus et affir
mons-nous le processus malgré cela ? — Ce serait le cas si, dans le cercle de ce processus, à chaque moment de celui-ci, quelque chose était atteint — et que ce soit tou¬jours la même chose. Spinoza a conquis une pareille posi¬tion affirmative, en ce sens que, pour lui, chaque moment a une nécessité logique : et il triomphe d'une pareille conformation du monde au moyen de son instinct logique fondamental.
Mais le cas de Spinoza n'est qu'un cas particulier. Tout trait de caractère fondamental, formant la base de tous les faits, s'exprimant dans tous les faits, chaque fois qu'il serait considéré par un individu comme son trait fonda¬mental à lui, devrait pousser cet individu à approuver triomphalement chaque moment de l'existence univer¬selle. Il importerait précisément que ce trait de caractère fondamental produisît chez soi-même une impression de plaisir, qu'on le ressentit comme bon et précieux.
Or, la morale a protégé l'existence contre le désespoir et le saut dans le néant chez les hommes et les classes qui étaient violentés et opprimés par d'autres hommes : car c'est l'impuissance en face des hommes et non pas l'impuissance en face de la nature qui produit l'amer dés¬espoir de vivre. La morale a traité en ennemis les hommes autoritaires et violents, les « maîtres « en général, contre lesquels le simple devrait être protégé, c'est-à-dire avant tout encouragé et fortifié. Par conséquent la morale a enseigné à haïr et à mépriser ce qui forme le trait de caractère fondamental des dominateurs : leur volonté de puissance. Supprimer, nier, décomposer cette morale : ce serait regarder l'instinct le plus haï avec un sentiment et une évaluation contraires. Si l'opprimé, celui qui souffre, perdait la croyance en son droit à mépriser la volonté de puissance, sa situation serait désespérée. Pour qu'il en soit ainsi il faudrait que ce trait fût essentiel à la vie et que l'on pût démontrer que, dans la volonté morale, cette « volonté de puissance « n'était que dissimulée, cette
haine et ce mépris n'étant eux-mêmes qu'une manifesta¬tion de celle-ci. L'oppressé se rendrait alors compte qu'il se trouve sur le même terrain que l'oppresseur et qu'il ne possède pas de privilège, pas de rang supérieur sur celui-ci.
Bien au contraire ! Il n'y a rien dans la vie qui puisse avoir de la valeur, si ce n'est le degré de puissance — à condition bien entendu que la vie elle-même soit la volonté de puissance. La morale préservait les déshérités contre le nihilisme, en prêtant à chacun une valeur infi¬nie, une valeur métaphysique, en le rangeant dans un ordre qui ne correspondait pas à la puissance terrestre, à la hiérarchie du monde : elle enseignait la soumission, l'humilité, etc. En admettant que la croyance en cette morale soit détruite, il s'ensuivrait que les déshérités seraient privés des consolations de cette morale — et qu'ils périraient.
Cette tendance d'aller à sa perte se présente comme la volonté de se perdre, comme le choix instinctif de ce qui détruit nécessairement. Le symptôme de cette auto¬destruction des déshérités c'est l'auto-vivisection, l'empoisonnement, l'enivrement, le romantisme, avant tout la contrainte instinctive à des actes, par quoi l'on fait des puissants ses ennemis mortels (se dressant pour ainsi dire ses propres bourreaux), la volonté de destruc¬tion comme volonté d'un instinct plus profond encore, l'instinct de l'auto-destruction, la volonté du néant.
Le nihilisme est un symptôme : il indique que les déshérités n'ont plus de consolation ; qu'ils détruisent pour être détruits, que, détachés de la morale, ils n'ont plus de raison de « se résigner « — qu'ils se placent sur le terrain du principe opposé, et qu'ils veulent aussi de la puissance de leur côté, en forçant les puissants à être leurs bourreaux. C'est là la forme européenne du bouddhisme, la négation active, par quoi la vie tout entière a perdu son « sens «.
Il ne faudrait pas croire que la « détresse « soit devenue plus grande : bien au contraire ! « Dieu, la morale, la résignation « étaient des remèdes sur des degrés de misère excessivement bas : le nihilisme actif se présente dans des conditions relativement bien plus favorables. Le fait même de considérer la morale comme surmontée implique un certain degré de culture intellectuelle ; celle-ci de son côté un bien-être relatif. Une certaine fatigue intellectuelle, poussée, par une longue lutte d'opinions philosophiques, jusqu'au scepticisme désespéré en face de toute philosophie, caractérise également le niveau, nulle¬ment inférieur, de ces nihilistes. Que l'on songe dans quelles conditions Bouddha entra en scène. La doctrine de l'Éternel Retour reposerait des hypothèses savantes (telles qu'en possédait la doctrine de Bouddha, par exemple l'idée de causalité, etc.).
Que signifie maintenant « déshérité « ? Il faut envisa¬ger la question avant tout au point de vue physiologique et non pas au point de vue politique. L'espèce d'hommes la plus malsaine en Europe (dans toutes les classes) forme le terrain de ce nihilisme : elle considérera la croyance à l'Éternel Retour comme une malédiction — lorsque l'on est frappé on ne recule plus devant aucune action. Elle voudra effacer, non seulement d'une façon passive, mais encore faire effacer tout ce qui est à ce point dépourvu de sens et de but. Bien que ce ne soit chez elle qu'un spasme, une fureur aveugle devant la certitude que tout cela existait de toute éternité — même ce moment de nihilisme et de destruction. La valeur d'une pareille crise, c'est qu'elle purifie, qu'elle réunit les éléments semblables et les fait se détruire les uns les autres, qu'elle assigne à des hommes d'idées opposées des tâches communes, met¬tant aussi en lumière, parmi eux, les faibles et les hési¬tants, et provoquant ainsi une hiérarchie des forces au point de vue de la santé ; qu'elle reconnaît pour ce qu'ils sont ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Natu
rellement en dehors de toutes les conventions sociales existantes.
Quels sont ceux qui s'y montreront les plus forts ? Les plus modérés, ceux qui n'ont pas besoin de dogmes extrêmes, ceux qui non seulement admettent, mais aiment aussi une bonne part de hasard, de non-sens. Ceux qui peuvent songer à l'homme, en réduisant quelque peu sa valeur, sans qu'ils se sentent par là dimi¬nués et affaiblis : les plus riches par rapport à la santé, ceux qui sont à la hauteur du plus grand malheur et qui, à cause de cela, ne craignent pas le malheur — des hommes qui sont certains de leur puissance et qui, avec une fierté consciente, représentent la force à laquelle l'homme est parvenu.
Comment de pareils hommes songeraient-ils à l'Éter¬nel Retour ?
11.
Les valeurs supérieures au service desquelles l'homme devrait vivre, surtout lorsqu'elles étendaient sur lui leurs lourdes mains : ces valeurs sociales, pour en renforcer le ton, comme si elles étaient des commandements de Dieu, on les a adressées au-dessus des hommes, telles des « réali¬tés «, comme si elles étaient le « vrai « monde, l'espérance d'un monde à venir.
Maintenant que l'origine mesquine de ces valeurs nous apparaît clairement, l'univers par là nous semble dépré¬cié, nous semble avoir perdu son « sens «... mais cela n'est qu'un état intermédiaire.
Point de vue principal. Il ne faut pas voir la tâche de l'espèce supérieure dans la direction de l'espèce inférieure, comme fit par exemple Comte, mais il faut considérer l'espèce inférieure comme une base sur laquelle une espèce supérieure peut édifier sa propre tâche — une base nécessaire à sa croissance.
Les conditions qui permettent à une espèce forte et noble de se conserver (par rapport à la discipline intellec
tuelle) sont à l'opposé des conditions qui régissent la « masse industrielle «, les épiciers à la Spencer.
Ce qui n'est permis qu'aux natures les plus fortes et les plus fécondes, pour rendre leur existence possible — les loisirs, les aventures, l'incrédulité, les débauches même —, si c'était permis aux natures moyennes, les ferait périr nécessairement — et il en est ainsi en effet. L'activité, la règle, la modération, les « convictions « sont de mise, en un mot les « vertus du troupeau « : avec elles cette espèce d'hommes moyens atteint sa perfection.
Causes du nihilisme : 1) l'espèce supérieure fait défaut, c'est-à-dire celle dont la fécondité et la puissance inépui¬sables maintiennent la croyance en l'homme. (Que l'on songe à ce que l'on doit à Napoléon : presque tous les espoirs supérieurs de ce siècle.)
2) L'espèce inférieure, — « troupeau «, « masse «, « société « — désapprend la modestie et enfle ses besoins jusqu'à en faire des valeurs cosmiques et métaphysiques. Par là l'existence tout entière est vulgarisée : car, en tant que la masse gouverne, elle tyrannise les hommes d'exception, ce qui fait perdre à ceux-ci la foi en eux-mêmes et les pousse au nihilisme.
Toutes les tentatives pour imaginer des types supé¬rieurs ont échoué (le « romantisme « ; l'artiste, le philo¬sophe ; — contre la tentative de Carlyle de leur prêter des valeurs morales supérieures).
La résistance contre les types supérieurs comme résultat.
Abaissement et incertitude de tous les types supérieurs. La lutte contre le génie (« poésie populaire «, etc.). La compassion pour les humbles et ceux qui souffrent, comme étalon pour l'élévation de l'âme.
Le philosophe fait défaut, l'interprète de l'action, et non pas seulement celui qui transforme en poésie.
2. 12 amor fati
Nietzsche, Le Crépuscule des idoles,
trad. Éric Blondel et Patrick Wotling,
« Maximes et flèches «, § 8-12.
8.
Tiré de l'école de guerre de la vie. — Tout ce qui ne me
tue pas me rend plus fort.
9.
Aide-toi, tout le monde t'aidera. Principe de l'amour
du prochain.
10.
Qu'on ne commette pas de lâcheté à l'égard de ses actions ! que l'on ne les laisse pas tomber après coup ! —Le remords est inconvenant.
11
Un âne peut-il être tragique ? — Périr sous une charge qu'on ne peut ni porter, ni rejeter ?... Le cas du philosophe.
12.
Si l'on a son pourquoi ? relativement à la vie, on s'entend avec presque tous les comment ? — L'homme n'aspire pas au bonheur ; l'Anglais seul le fait.
3. « Comment on philosophe
avec un marteau «
Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, ibid., «Préface «.
Conserver sa gaieté d'esprit au beau milieu d'une téné¬breuse affaire, à la responsabilité écrasante, ce n'est pas un mince tour de force : et que pourrait-il pourtant y
avoir de plus nécessaire que la gaieté d'esprit ? Nulle chose ne réussit si l'exubérance n'y participe. L'excès de force prouve seul la force. — Un renversement de toutes les valeurs, ce point d'interrogation si noir, si formidable qu'il étend son ombre sur celui qui le pose — une tâche qui est un tel destin contraint à chaque instant à se préci¬piter au soleil, à se délester d'un sérieux devenu pesant, trop pesant. Tout moyen est bon à cet effet, tout « cas « est un cadeau de la fortune. Et d'abord la guerre. La guerre fut toujours la grande sagesse de tous les esprits devenus trop intérieurs, trop profonds ; même la blessure recèle encore un pouvoir curatif. Une maxime dont je dissimulerai la provenance à la curiosité érudite fut de longue date ma maxime de prédilection :
Increscunt animi, virescit volnere virtus1
Une autre guérison, plus conforme à mes voeux en certaines circonstances, est d'ausculter des idoles... Il y a plus d'idoles que de réalités dans le monde : tel est le « mauvais oeil « que je jette sur ce monde, telle est aussi ma « mauvaise oreille «... Lui poser ici, pour une fois, des questions en usant du marteau et, peut-être, entendre en guise de réponse ce célèbre son creux qui parle d'entrailles flatulentes — quel ravissement pour qui a encore des oreilles derrière les oreilles — pour moi vieux psychologue et ensorceleur, en présence de qui se trouve contraint de parler ce qui justement aimerait bien garder le silence...
Cet écrit aussi — le titre le trahit — est avant tout un divertissement, un petit coin de soleil, une petite aven¬ture du côté du loisir d'un psychologue. Peut-être aussi une nouvelle guerre ? Et l'on ausculte de nouvelles idoles ?... Ce petit écrit est une grande déclaration de
1. « La blessure augmente le courage, intensifie la vaillance « (Furius Antias). [Note du traducteur.]
guerre ; et pour ce qui est d'ausculter des idoles, ce ne sont pas cette fois des idoles du moment, mais au contraire des idoles éternelles que l'on frappe ici du mar¬teau comme d'un diapason — on ne saurait trouver d'idoles plus anciennes, plus convaincues, plus boursouflées... Pas non plus de plus creuses... Cela n'empêche pas qu'elles soient celles auxquelles on croit le plus ; aussi bien ne dit-on certes pas, surtout dans le cas le plus éminent, idole...
Turin, le 30 septembre 1888, jour de l'achèvement du premier livre du Renversement de toutes les valeurs. FRIEDRICH NIETZSCHE
4. Dieu est mort
Nietzsche, Le Gai Savoir, trad. Patrick Wotling,
GF-Flammarion, 2006, § 125.
Le dément. — N'avez-vous pas entendu parler de ce dément qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer : « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! « — Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. S'est-il donc perdu ? disait l'un. S'est-il égaré comme un enfant ? disait l'autre. Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ? — ainsi criaient-ils en riant dans une grande pagaille. Le dément se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est passé Dieu ? lança-t-il, je vais vous le dire ! Nous l'avons tué —vous et moi ! Nous sommes tous ses assassins ! Mais comment avons-nous fait cela ? Comment pûmes-nous
boire la mer jusqu'à la dernière goutte ? Qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon ? Que fîmes-nous en détachant cette terre de son soleil ? Où l'emporte sa course désormais ? Où nous emporte notre course ? Loin de tous les soleils ? Ne nous abîmons-nous pas dans une chute permanente ? Et ce en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini ? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous ? Ne s'est-il pas mis à faire plus froid ? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement, et toujours plus de nuit ? Ne faut-il pas allumer des lanternes à midi ? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine ? — les dieux aussi se décomposent ! Dieu est mort ! Dieu demeure mort ! Et nous l'avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous, assassins entre les assassins ? Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang — qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier ? Quelles cérémonies expia¬toires, quels jeux sacrés nous faudra-t-il inventer ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour apparaître seulement dignes de lui ? Jamais il n'y eut acte plus grand — et quiconque naît après nous appar¬tient du fait de cet acte à une histoire supérieure à ce que fut jusqu'alors toute histoire ! « — Le dément se tut alors et considéra de nouveau ses auditeurs : eux aussi se tai-saient et le regardaient déconcertés. Il jeta enfin sa lan¬terne à terre : elle se brisa et s'éteignit. « Je viens trop tôt, dit-il alors, ce n'est pas encore mon heure. Cet événement formidable est encore en route et voyage — il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière des astres a besoin de temps, les actes ont besoin de temps, même
après qu'ils ont été accomplis, pour être vus et entendus. Cet acte est encore plus éloigné d'eux que les plus éloi¬gnés des astres — et pourtant ce sont eux qui l'ont accom¬pli. « — On raconte encore que ce même jour, le dément aurait fait irruption dans différentes églises et y aurait entonné son Requiem teternam deo. Expulsé et interrogé, il se serait contenté de rétorquer constamment ceci : « Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? «
5. « Pourquoi je suis si sage «
Nietzsche, Ecce homo, «Pourquoi je suis si sage «,
trad. Éric Blondel, GF-Flammarion, 1992, § 1.
La chance de mon existence, voire ce qu'elle a d'unique, tient à sa destinée : pour l'exprimer sous forme d'énigme, je suis déjà mort en la personne de mon père ; dans celle de ma mère, je vis encore et je vieillis. Cette double origine, en quelque sorte au premier et au dernier barreau de l'échelle de la vie, à la fois décadent et commen¬cement, voilà qui, mieux que tout, explique cette neutra¬lité, cette absence de parti pris à l'égard du problème de la vie dans son ensemble qui me caractérise peut-être. Je possède, pour les signes de montée et de déclin, un flair plus sensible que quiconque ait jamais eu, je suis là-dessus le maître par excellence — je connais les deux, je suis les deux. —
6. L'homme « souterrain «
Nietzsche, Aurore, trad. Éric Blondel,
Ole Hansen-Love et Théo Leydenbach,
GF-Flammarion, 2012, « Préface «, § 1-2.
1
Dans ce livre, on assiste au travail d'un « être souter-rain «, qui perce, qui creuse, qui sape. À condition d'avoir des yeux pour scruter un tel travail de fond, on voit comme il avance lentement, avec circonspection, avec une douceur impitoyable, sans trahir trop manifestement la détresse que provoque toute longue privation d'air et de lumière ; on pourrait même le dire satisfait de son travail des ténèbres. Ne dirait-on pas qu'il est guidé par une sorte de foi et qu'une consolation le dédommage ? Que peut-être il revendique comme sienne cette longue obscurité, cet objet incompréhensible, caché, énigma¬tique, car il sait ce qu'il aura de surcroît : son matin, son salut, son aurore à lui ?... Certes, il va remonter : ne lui demandez pas ce qu'il va chercher en bas, il vous le dira bien lui-même, cet homme à l'aspect de Trophonios et d'être souterrain, une fois qu'il sera « redevenu homme «. On perd radicalement l'habitude de se taire lorsqu'on s'est fait comme lui, depuis si longtemps, taupe et solitaire...
2
En fait, mes patients amis, dans cette préface qui aurait pu aisément tourner à la nécrologie, à l'oraison funèbre, je tiens à vous dire ce que j'ai cherché là en bas, car je suis ressorti... et je m'en suis sorti. N'allez surtout pas croire que je vais vous inciter à prendre le même risque ! Ou même seulement à affronter la même solitude ! Celui qui fraie seul de tels chemins ne rencontre personne : c'est ce qu'impliquent de tels « chemins solitaires «. Personne ne
survient pour l'aider ; il doit venir seul à bout des obstacles comme le danger, le hasard, la méchanceté, le mauvais temps. Il a son amertume, à l'occasion son dépit, qui s'attachent justement à ce chemin solitaire : il en ressort, par exemple, qu'il sait que ses amis eux-mêmes ne peuvent pas deviner où il se trouve, vers quoi il se dirige, au point qu'ils se demanderont parfois : « Eh bien ? Est-il seulement en marche ? A-t-il encore... un chemin ? «... Ce que j'ai entrepris à l'époque n'est sans doute pas à la portée de tout le monde : je suis descendu dans les profondeurs, j'ai foré le fond, j'ai commencé d'examiner à fond et de miner une ancienne confiance sur laquelle nous autres philosophes avions coutume, depuis quelques millénaires, de construire comme sur le fondement le plus assuré, sans relâche, bien que tous les édifices se soient jusqu'ici effon¬drés : j'ai commencé de saper notre confiance en la morale. Mais vous ne me comprenez pas ?
7. La solitude de Nietzsche
Nietzsche, Ecce Homo, op. cit., « Préface «, § 3.
Qui sait respirer l'air de mes écrits sait que c'est un air des hauteurs, un air vif: Il faut être fait pour lui, sinon il y a grand risque d'y prendre froid. Les glaces sont proches, la solitude est immense — mais quelle paix enve¬loppe les choses dans la lumière ! comme on y respire librement ! que de choses on sent au-dessous de soi ! — La philosophie, telle que je l'ai comprise et vécue jusqu'à présent, consiste à vivre volontairement dans les glaces et les sommets — c'est la recherche de tout ce que l'existence a d'étrange et de douteux, de tout ce qui a été jusqu'à présent mis au ban par la morale. La longue expérience
que m'a donnée une telle errance dans l'Interdit m'a appris à voir tout autrement qu'on pourrait le souhaiter les raisons pour lesquelles on a jusqu'à présent moralisé et idéalisé : l'histoire cachée des philosophes, la psycholo¬gie de leurs grands noms s'est manifestée à mes yeux. Quelle quantité de vérité peut supporter, voire oser un esprit ? tel a été, de plus en plus, pour moi le vrai critère de la valeur. L'erreur (— la foi en l'Idéal —), ce n'est pas de l'aveuglement, l'erreur, c'est de la lâcheté... Toute conquête, tout pas en avant dans la connaissance résulte du courage, de la dureté envers soi, de la netteté envers soi... Je ne réfute pas les idéaux, je me contente de mettre des gants... Nitimur in vetituml : par ce signe un jour vaincra ma philosophie, car ce qu'on a jusqu'à pré¬sent par principe interdit, c'est seulement la vérité.
8. Le philosophe solitaire
Nietzsche, Par-delà bien et mal,
trad. Patrick Wotling, GF-Flammarion, 2000, § 289.
Les écrits d'un ermite font toujours entendre aussi un peu de l'écho du désert, un peu du chuchotement et du coup d'oeil inquiet propres à la solitude ; ses paroles les plus fortes, son cri même, font encore résonner une manière nouvelle et plus dangereuse de se taire, de taire quelque chose. Celui qui est demeuré assis année après année, jour et nuit, seul avec son âme, à partager une discorde et un entretien en tête à tête, celui qui, au fond de sa caverne —ce peut être un labyrinthe, mais aussi une mine d'or —, s'est
1. « Nous recherchons ce qui est interdit « (Ovide, Amours). Note du traducteur.]
transformé en ours des cavernes ou en chercheur de trésor, ou en gardien de trésor et en dragon : ses concepts eux-mêmes finissent par prendre une coloration crépusculaire propre, un parfum de profondeur tout autant que de moi-sissure, quelque chose d'incommunicable et de réticent qui enveloppe d'un souffle froid quiconque passe à proximité. L'ermite ne croit pas qu'un philosophe — à supposer que tout philosophe ait d'abord été ermite — ait jamais exprimé ses opinions véritables et ultimes dans des livres : n'écrit-on pas des livres précisément pour cacher ce que l'on porte en soi — il doutera même qu'un philosophe puisse avoir de manière générale des opinions « ultimes et véritables «, qu'il n'y ait pas de toute nécessité en lui, derrière toute caverne, une autre caverne plus profonde — un monde plus vaste, plus étranger, plus riche, par-delà une surface, un arrière-fond d'abîme derrière tout fond, derrière toute « fondation «. Toute philosophie est une philosophie de surface — c'est là un jugement d'ermite : « Il y a de l'arbi¬traire dans le fait qu'il se soit arrêté ici, ait regardé en arrière, et alentour, qu'il n'ait pas creusé plus profondé¬ment ici et ait remisé sa bêche, — il y a aussi de la méfiance là-dedans. « Toute philosophie cache aussi une philoso¬phie ; toute opinion est aussi une cachette, toute parole est aussi un masque.
9. La « volonté de puissance «
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra,
trad. Geneviève Bianquis, GF-Flammarion, 2006, II,
« De la victoire sur soi «, p. 158-162.
La volonté de trouver le vrai : tel est le nom que vous donnez, ô sages insignes, à la force qui vous meut et vous met en rut.
La volonté de rendre concevable tout ce qui est : c'est le nom que je donne à votre volonté.
Vous voulez d'abord rendre concevable tout ce qui est ; car vous doutez à juste titre que ce soit concevable a priori.
Mais il faut que tout se soumette et se ploie à votre gré. C'est ce qu'exige votre vouloir ; que tout s'assouplisse et se soumette à l'esprit, que tout se réduise à en être le miroir et le reflet.
C'est là tout ce que vous voulez, sages insignes, et c'est un désir de puissance, même quand vous avez à la bouche les mots de bien et de mal et de jugements de valeur. Vous voulez d'abord créer un monde tel que vous puissiez l'adorer à genoux ; c'est votre dernier espoir, votre suprême ivresse.
Les simples, cependant, la foule, sont pareils au fleuve sur lequel la barque s'en va à la dérive, et dans la barque trônent, solennels et emmitouflés, les jugements de valeur.
Votre vouloir et vos valeurs, vous les avez fondés sur le flot du devenir. Ces croyances de la foule au sujet du bien et du mal trahissent un très ancien vouloir de puissance.
C'est vous, sages insignes, qui avez installé ces voya¬geurs dans la barque après les avoir décorés de parures et de noms ronflants — c'est vous, et votre vouloir dominateur.
Maintenant le fleuve entraîne votre barque : il lui faut l'entraîner. Qu'importe si elle fait écumer le flot qu'elle fend et qui se rebelle contre l'étrave ? Ce n'est pas le courant qui vous menace, ni la mort de votre notion du bien et du mal, sages insignes ; c'est votre vouloir lui-même, votre vouloir de puissance, le vouloir vivre inépui¬sable et créateur.
Mais afin que vous compreniez ce que j'ai à vous dire au sujet du bien et du mal, je vais ajouter encore un mot au sujet de la vie et de la nature des vivants.
Les vivants, je les ai suivis à la trace, sur les grands et les petits chemins, afin de connaître leur nature.
Alors que leur bouche était close, j'ai capté leur regard dans mes cent miroirs, afin que ce regard me parlât, et ce regard m'a parlé.
Or partout où j'ai trouvé de la vie, j'ai entendu parler d'obéissance. Tout ce qui vit obéit.
Et voici le deuxième point : on commande à celui qui ne sait pas s'obéir. Tel est l'usage parmi les vivants.
Ce que j'ai appris en troisième lieu, c'est que comman¬der est plus difficile qu'obéir. Non seulement parce que celui qui commande assume la charge de tous ceux qui lui obéissent, et que cette charge risque de l'écraser, mais parce que j'ai reconnu que commander comporte une chance et un risque, et chaque fois qu'il commande, le vivant risque sa vie au jeu.
Et même quand c'est à lui-même qu'il commande, il n'échappe pas à l'expiation. Il devient fatalement juge, vengeur et victime de sa propre loi.
Comment est-ce possible ? me demandai-je. Qu'est-ce qui persuade le vivant d'obéir et de commander, et d'obéir même en commandant ?
Écoutez à présent mes paroles, sages insignes. Exami¬nez si j'ai bien fouillé la vie jusqu'à l'âme et jusque dans les derniers replis de son coeur. Où j'ai trouvé de la vie, j'ai trouvé la volonté de dominer, et jusque dans la volonté du serviteur, j'ai trouvé la volonté d'être le maître.
Si le faible sert le fort, c'est qu'il y est incliné par sa volonté, qui veut à son tour se rendre maîtresse de plus faibles qu'elle ; c'est le seul plaisir auquel elle ne puisse renoncer.
Et de même que l'inférieur se soumet au supérieur afin d'avoir à son tour le plaisir de régenter le plus infime, de même le plus grand de tous se dévoue à son tour et risque au jeu sa vie elle-même.
Quand le plus grand de tous entre en lice à son tour, il prend sur lui risque et péril, c'est une partie de dés avec la mort.
Et sacrifices, et services rendus, et regards amoureux, ce sont encore des manifestations du vouloir de puis¬sance. Par des chemins détournés, le plus faible s'insinue dans la place forte et gagne jusqu'au coeur du puissant ; et là il lui dérobe sa puissance.
Et voilà le secret que la vie m'a confié : « Vois, m'a-t-elle dit, je suis ce qui est contraint de se surmonter soi-même à l'infini.
Que vous appeliez ce besoin instinct génésique ou instinct de finalité ou tendance ascensionnelle vers ce qui est plus haut, plus lointain, plus complexe, tout cela revient au même, c'est un seul et même secret.
Je périrais plutôt que de renoncer à cette unique aspira¬tion ; et en vérité, quand on voit mourir les êtres et tomber les feuilles, c'est que la vie se sacrifie — pour l'amour de la puissance.
Pourquoi faut-il que je sois lutte, et devenir, et finalité, et contradiction ? Hélas ! quiconque devine ma volonté devine aussi combien sont tortueux les chemins qu'il lui faut prendre.
J'ai beau créer, et aimer ce que je crée, il me faut aussi¬tôt devenir l'ennemie de ma créature et l'adversaire de mon amour ; ainsi le veut mon vouloir.
Et toi aussi, chercheur du vrai, tu n'es qu'un des sen¬tiers, une des pistes de mon vouloir ; en vérité, ma volonté de puissance marche elle aussi dans les empreintes de ton vouloir de trouver le vrai. Certes, il n'a pas atteint la vérité, celui qui a mis en circulation cette formule, le « vouloir vivre « ; ce vouloir-là n'existe pas.
Car ce qui n'existe pas ne peut pas vouloir exister ; et comment ce qui existe pourrait-il encore vouloir exister ?
Il n'y a de volonté que dans la vie ; mais cette volonté n'est pas vouloir vivre ; en vérité, elle est volonté de dominer.
Il y a pour le vivant bien des choses qu'il estime plus haut que la vie elle-même, mais dans cette estime même, ce qui parle, c'est la volonté de dominer. «
Voilà ce que la vie m'a enseigné naguère ; c'est ce qui m'a permis, sages insignes, de résoudre par surcroît l'énigme de vos coeurs.
En vérité, je vous le dis, bien et mal, notions immuables, n'ont pas d'existence. Tout travaille à se sur¬passer sans cesse.
Vos jugements de valeur et vos théories du bien et du mal sont des moyens d'exercer la puissance. Évaluateurs, c'est là l'amour secret dont vos coeurs brillent, frémissent et débordent.
Mais il y a une force plus grande qui tire de vos valeurs sa croissance, et un nouveau dépassement qui brise l'oeuf et la coquille.
Et quiconque a la vocation d'innover en matière de bien et de mal commencera nécessairement par détruire et par briser des valeurs.
Ainsi la pire méchanceté est partie intégrante de la bonté suprême, je veux dire de celle qui crée.
Parlons de ces choses, sages insignes, quelque peine que cela vous fasse. Le silence est pire. Les vérités que l'on tait s'enveniment.
Et qu'importe si tout ce qui est fragile vient à se briser contre vos vérités ? Il y a tant de demeures à construire encore !
Ainsi parlait Zarathoustra.
10. Socrate et le syllogisme au couteau
Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit.,
« Le problème de Socrate «, § 6-11.
6
On ne choisit la dialectique que lorsque l'on n'a pas d'autres moyens. On sait qu'avec elle, on suscite la méfiance, qu'elle convainc peu. Rien n'est plus aisé à balayer qu'un effet de dialecticien : l'expérience de toute assemblée où l'on débat le prouve. Elle ne peut être que légitime défense entre les mains de ceux qui n'ont plus d'autres armes. Il faut que l'on ait à arracher son droit par la force : avant d'en être là, on n'en fait pas usage. C'est pour cela que les Juifs furent dialecticiens ; Maître Renart l'était : comment ? et Socrate l'était aussi ? —
7
— L'ironie de Socrate est-elle une expression de révolte ? du ressentiment de la plèbe ? jouit-il en opprimé de sa propre férocité à travers les coups de poignard du syllogisme ? se venge-t-il des nobles qu'il fascine ? — Dia-lecticien, on a en main un instrument sans merci ; grâce à lui, on peut jouer au tyran ; on compromet en l'empor¬tant. Le dialecticien abandonne à son adversaire la charge de prouver qu'il n'est pas un idiot : il fait entrer en fureur, et en même temps laisse désemparé. Le dialecticien neutralise l'intellect de son adversaire. — Comment ? La dialectique n'est-elle chez Socrate qu'une forme de vengeance ?
8
J'ai fait comprendre en quoi Socrate repoussait : il n'en reste que davantage à expliquer qu'il fascinait. — Qu'il ait découvert une nouvelle espèce or agon, qu'il en ait été le premier maître d'armes pour les cercles nobles d'Athènes, c'est le premier point. Il fascinait en ce qu'il faisait vibrer
l'instinct agonal des Hellènes, — il apportait une variante à la lutte entre les hommes jeunes et les éphèbes. Socrate fut aussi un grand érotique.
9
Mais Socrate devina plus encore. Il vit clair dans ses Athéniens nobles ; il saisit que son cas, l'idiosyncrasie de son cas n'était déjà plus une exception. La même espèce de dégénérescence se préparait partout en silence : la vieille Athènes était en train de périr. — Et Socrate com¬prit que tout le monde avait besoin de lui — de son moyen, de son traitement, de son astuce personnelle d'auto-conservation... Partout les instincts étaient dans l'anarchie ; partout, on était à deux doigts de l'excès : le monstrum in animo était le danger général. « Les pulsions veulent jouer les tyrans ; il faut inventer un contre-tyran qui soit plus fort «... Quand ce physiognomoniste eut dévoilé à Socrate qui il était, un antre recelant tous les désirs ignobles, le grand ironique laissa encore filtrer une parole qui livre la clé de sa personne. « C'est vrai, dit-il, mais je me suis rendu maître de tous. « Comment Socrate se rendit-il maître de lui-même ? — Son cas n'était en fin de compte que le cas extrême, simplement le plus aveu-glant de ce qui commençait alors à devenir la misère générale : à savoir que plus personne n'était maître de soi, que les instincts se retournaient les uns contre les autres. Il fascinait pour être ce cas extrême — sa laideur terrifiante l'exprimait aux yeux de tous : il fascinait plus vivement encore, comme cela va de soi, en tant que réponse, en tant que solution, en tant qu'apparence de traitement de ce cas. —
10
Quand on a besoin de transformer la raison en tyran, comme le fit Socrate, il faut que le danger ne soit pas mince que quelque chose d'autre joue les tyrans. Dans la rationalité, on devina alors l'instance salvatrice, ni Socrate
ni ses « malades « ne furent libres d'être rationnels —c'était de rigueur, c'était leur ultime moyen. Le fanatisme avec lequel toute la réflexion grecque se jette sur la ratio¬nalité trahit une situation d'urgence : on était en danger, on n'avait qu'un seul choix : périr ou — être rationnel jusqu'à l'absurdité... Le moralisme des philosophes grecs à partir de Platon est conditionné pathologiquement ; de même leur appréciation de la dialectique. « Raison = Vertu = Bonheur « veut dire en tout et pour tout : il faut copier Socrate et, contre les sombres désirs, instaurer en permanence un grand jour — le grand jour de la raison. On doit être sage, clair, lumineux à tout prix : toute concession aux instincts, à l'inconscient, fait sombrer...
11.
J'ai fait comprendre en quoi Socrate fascinait : il sem-blait être un médecin, un sauveur. Est-il encore besoin de démontrer l'erreur sur laquelle reposait sa croyance à la « rationalité à tout prix « ? — C'est une tromperie de soi, de la part des philosophes et des moralistes, que d'échapper à la décadence en lui faisant la guerre. En sortir est au-delà de leurs forces : ce qu'ils choisissent comme moyen, comme recours salvateur, n'est à son tour de nouveau qu'une expression de la décadence — ils en altèrent l'expression, ils ne s'en débarrassent pas. Socrate fut un malentendu ; toute la morale de l'amélioration, la chrétienne aussi, fut un malentendu... Le jour le plus éblouissant, la rationalité à tout prix, la vie claire, froide, prudente, consciente, sans instinct, en résistance contre les instincts, cela même ne fut qu'une maladie, une autre maladie — et nullement un retour à la « vertu «, à la « santé «, au bonheur... Devoir combattre les instincts —c'est la formule de la décadence : tant que la vie est ascen¬dante, le bonheur est la même chose que l'instinct. —
11. L'anarchisme selon Nietzsche
Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit.,
« Incursions d'un inactuel «, § 34.
Chrétien et anarchiste. — Lorsque l'anarchiste, en tant que porte-voix de couches déclinantes de la société, exige avec une belle indignation « droit «, « justice «, « droits égaux «, il ne fait en cela que subir la pression de son acculturation qui n'arrive pas à saisir pourquoi au juste il souffre — de quoi il est pauvre, de vie... Il est au pouvoir d'une pulsion causale : ce doit être la faute de quelqu'un s'il se sent mal... Pareillement, la « belle indignation « elle-même lui fait déjà du bien, pour tous les pauvres diables, c'est un plaisir de fulminer — cela procure une petite ivresse de puissance. La plainte, le fait de se plaindre peut déjà fournir à la vie un attrait pour l'amour duquel on la supporte : toute plainte contient un soup-çon de vengeance, on reproche son état de malaise, éven¬tuellement même sa méchanceté, à ceux qui sont différents, comme une injustice, un privilège indu. «Si je suis une canaille, tu dois l'être aussi « : c'est suivant cette logique que l'on fait la révolution. — Se plaindre n'est jamais bon à rien : cela provient de la faiblesse. Que l'on impute son état de malaise à autrui ou à soi-même —la première attitude est celle du socialiste, la seconde par exemple celle du chrétien —, ne fait pas véritablement de différence. Ce qu'il y a de commun à ces attitudes, et ajoutons d'indigne, c'est que ce doive être la faute de quelqu'un si l'on souffre — bref, que le souffrant se pres¬crive contre sa souffrance le miel de la vengeance. Les objets de ce besoin de vengeance, en tant qu'il est besoin de plaisir, sont des causes occasionnelles : le souffrant trouve partout des causes propres à assouvir sa petite ven¬geance — s'il est chrétien, pour le dire une fois encore, il les trouve en lui... Le chrétien et l'anarchiste — tous deux
sont des décadents. — Mais lorsque le chrétien condamne, calomnie, souille le « monde «, il le fait aussi en suivant le même instinct que celui qui incite l'ouvrier socialiste à condamner, à calomnier, à souiller la société : le « Jugement dernier « lui-même est encore la douce consolation de la vengeance — la révolution, telle que l'attend aussi l'ouvrier socialiste, simplement reportée à un peu plus tard par la pensée... E« au-delà « lui-même — pour quoi faire un au-delà si ce n'était un moyen de souiller l'ici-bas ?...
12. L'intérêt qu'il y a à avoir des ennemis
Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, op. cit.,
« La morale comme contre-nature «, § 3.
La spiritualisation de la sensualité a pour nom amour : c'est un grand triomphe sur le christianisme. Un autre triomphe est notre spiritualisation de l'hostilité. Elle consiste à comprendre profondément la valeur que pos¬sède le fait d'avoir des ennemis : bref, d'agir et de raison¬ner exactement à l'inverse de la manière dont on agissait et raisonnait autrefois. L'Église voulut de tout temps l'anéantissement de ses ennemis : nous, les immoralistes et antichrétiens, voyons notre avantage dans le fait que l'Église existe... En politique aussi, l'hostilité s'est faite désormais plus spirituelle — bien plus intelligente, bien plus réfléchie, bien plus précautionneuse. Presque chaque parti saisit qu'il est dans l'intérêt de sa propre conserva¬tion que le parti adverse ne s'effondre pas ; la même chose vaut pour la grande politique. Une création nou¬velle surtout, par exemple le nouveau Reich, a plus besoin d'ennemis que d'amis : c'est seulement dans l'opposition qu'il se sent nécessaire, c'est seulement dans l'opposition
qu'il devient nécessaire... Notre attitude n'est pas diffé¬rente à l'égard de l'« ennemi intérieur « : là aussi, nous avons spiritualisé l'hostilité, là aussi nous avons saisi sa valeur. On n'est fécond qu'à ce prix : être riche en opposi¬tions ; on ne demeure jeune que sous la présupposition que l'âme ne se vautre pas, ne désire pas la paix... Rien ne nous est devenu plus étranger que cette aspiration d'autrefois, celle de la « paix de l'âme «, l'aspiration chré¬tienne ; rien ne nous fait moins envie que la vache de la morale et le bonheur obèse de la bonne conscience. On a renoncé à la vie dans sa grandeur quand on a renoncé à la guerre... Il est vrai que dans de nombreux cas, la « paix de l'âme « est purement et simplement un malen-tendu — quelque chose d'autre, qui ne sait simplement pas se désigner d'un nom plus honnête. Sans détour ni préjugé, quelques cas. La « paix de l'âme « peut être par exemple le doux rayonnement d'une riche animalité pénétrant dans le champ moral (ou religieux). Ou le début de la lassitude, la première ombre que projette le soir, tout genre de soir. Ou le signe que l'air est humide, qu'approchent des vents du sud. Ou la reconnaissance qui s'ignore envers une bonne digestion (parfois nommée « amour de l'humanité «). Ou l'apaisement de l'homme qui guérit, qui trouve une saveur nouvelle à toutes choses et qui attend... Ou l'état qui résulte d'une vive satisfaction de notre passion dominante, le bien-être d'une satiété hors du commun. Ou la faiblesse sénile de notre volonté, de nos désirs, de nos vices. Ou la paresse, convaincue par la vanité de se mettre sur son trente et un moral. Ou l'irruption d'une certitude, même d'une certitude ter¬rible, après une longue tension et un long martyre infli¬gés par l'incertitude. Ou l'expression de la maturité et de la maîtrise dans le feu du faire, du créer, de l'agir, du vouloir, la respiration calme, l'accession à la « liberté de la volonté «... Crépuscule des idoles : qui sait ? peut-être aussi un simple genre de « paix de l'âme «...
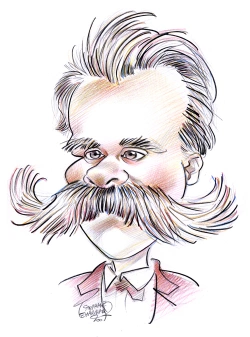
«
64 1 NIETZSCHE : LA MORT DE DIEU
En résumé : la morale était le grand antidote contre le
nihilisme pratique et théorique.
Mais, parmi
les forces que la morale a nourries, se
trouvait la véracité : celle-ci finit par se tourner contre
la morale, elle découvre sa téléologie, sa considération
intéressée, et
maintenant l'intelligence de ce mensonge
longtemps incarné et
dont on désespère de se débarrasser
agit précisément
comme stimulant.
Nous constatons sur
nous, implantés par la longue interprétation morale, des
besoins qui nous apparaissent dès lors comme des exi
gences de non-vérité : d'autre part,
ce sont les besoins,
à quoi la valeur semble attachée, à cause desquels nous
supportons de vivre.
Nous n'estimons
point ce que nous
connaissons et n'osons plus estimer ce par quoi nous
aimerions nous faire illusion : -de cet antagonisme
résulte
un processus de décomposition.
De fait, nous n'avons plus besoin d'un antidote contre
le premier nihilisme : dans notre Europe, la vie n'est plus
incertaine, hasardeuse, insensée
à un tel point.
rélévation
de la valeur de l'homme, de la valeur du mal, etc., à une
puissance si énorme, n'est plus nécessaire maintenant,
nous supportons une réduction importante de cette
valeur, nous admettons la
part du non-sens, du hasard :
la puissance atteinte
par l'homme permet maintenant un
abaissement des moyens de discipline dont l'interpréta
tion morale fut le côté fort.
« Dieu » est une hypothèse
beaucoup trop extrême.
Cependant les positions extrêmes ne sont pas relevées
par des positions plus modérées, mais par d'autres
également extrêmes, seulement ce sont des positions
à
rebours.
C'est ainsi que la croyance en l'immoralité abso
lue de la nature, le
manque de but et de sens devient la
passion psychologiquement nécessaire, lorsque la foi en
Dieu et un ordre essentiellement moral n'est plus soute
nable.
Le nihilisme apparaît maintenant, non point parce
que le déplaisir de l'existence est devenu plus grand.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches - Anthologie.
- Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse - Anthologie.
- Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra - Anthologie.
- Nietzsche, Généalogie de la morale (extrait) - anthologie.
- L'homme est un pont, non une fin. Nietzsche.