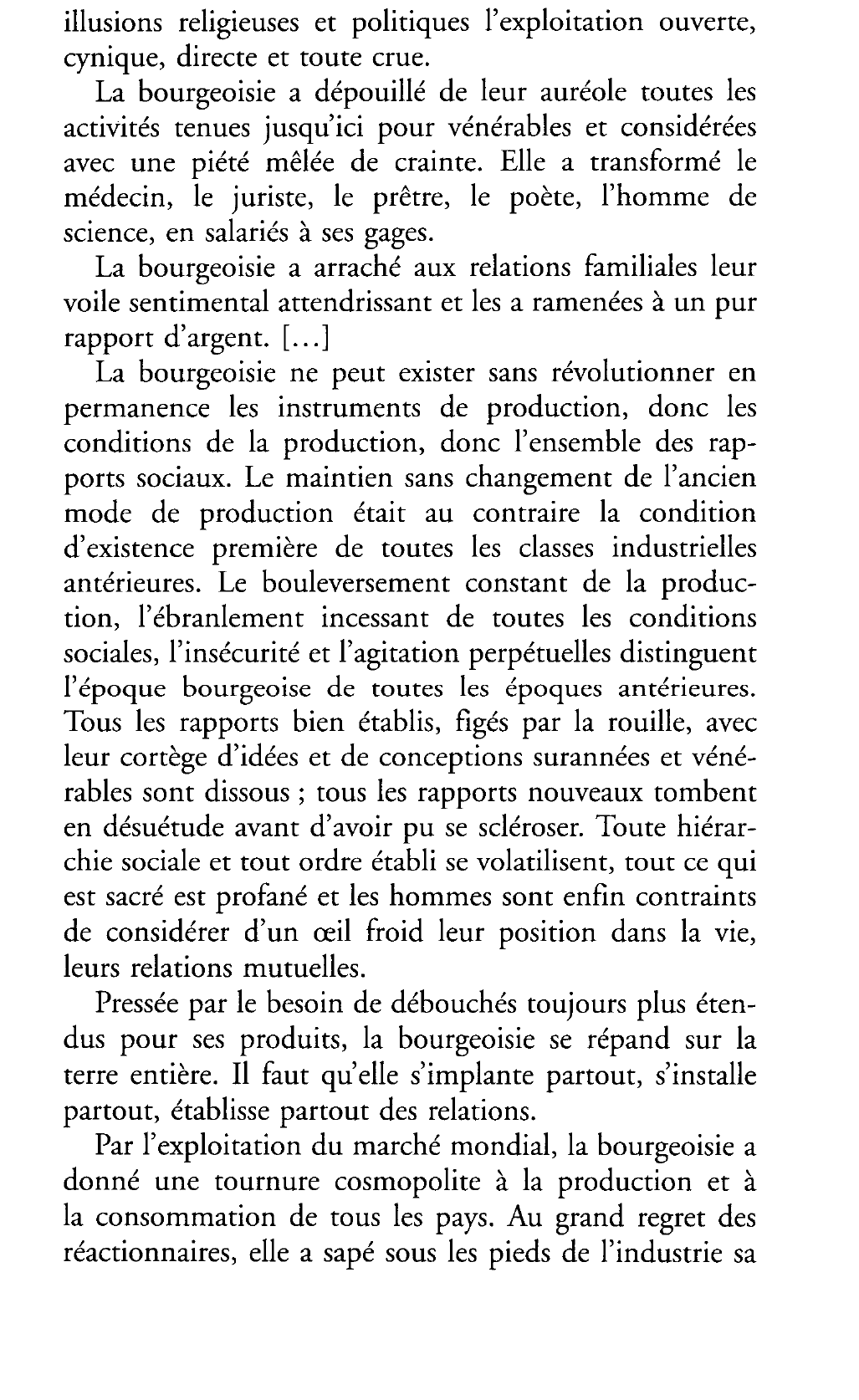Anthologie philosophique: MARX
Publié le 25/03/2015

Extrait du document
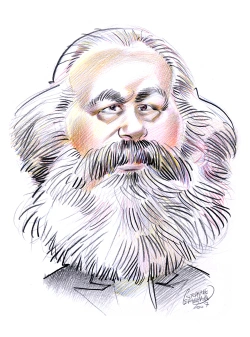
EXTRAITS
1. Le caractère révolutionnaire du capitalisme
bourgeois et sa traduction
dans la « mondialisation « (1890)
Marx et Engels, Manifeste du Parti communiste, trad. Émile Bottigelli, GF-Flammarion, 1998, I,
p. 76-79.
La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle hautement révolutionnaire.
Là où elle est arrivée au pouvoir, la bourgeoisie a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a impitoyablement déchiré la variété bariolée des liens féodaux qui unissaient l'homme à ses supérieurs naturels et n'a laissé subsister d'autre lien entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le « paiement comptant «. Elle a noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste les frissons sacrés de l'exaltation religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la mélancolie sentimentale des petits-bourgeois. Elle a dissous la dignité personnelle dans la valeur d'échange et substitué aux innombrables libertés reconnues par lettres patentes et chèrement acquises la seule liberté sans scrupules du commerce. En un mot, elle a substitué à l'exploitation que voilaient les
illusions religieuses et politiques l'exploitation ouverte, cynique, directe et toute crue.
La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités tenues jusqu'ici pour vénérables et considérées avec une piété mêlée de crainte. Elle a transformé le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de science, en salariés à ses gages.
La bourgeoisie a arraché aux relations familiales leur voile sentimental attendrissant et les a ramenées à un pur rapport d'argent. [...]
La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en permanence les instruments de production, donc les conditions de la production, donc l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était au contraire la condition d'existence première de toutes les classes industrielles antérieures. Le bouleversement constant de la production, l'ébranlement incessant de toutes les conditions sociales, l'insécurité et l'agitation perpétuelles distinguent l'époque bourgeoise de toutes les époques antérieures. Tous les rapports bien établis, figés par la rouille, avec leur cortège d'idées et de conceptions surannées et vénérables sont dissous ; tous les rapports nouveaux tombent en désuétude avant d'avoir pu se scléroser. Toute hiérarchie sociale et tout ordre établi se volatilisent, tout ce qui est sacré est profané et les hommes sont enfin contraints de considérer d'un oeil froid leur position dans la vie, leurs relations mutuelles.
Pressée par le besoin de débouchés toujours plus étendus pour ses produits, la bourgeoisie se répand sur la terre entière. Il faut qu'elle s'implante partout, s'installe partout, établisse partout des relations.
Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a donné une tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a sapé sous les pieds de l'industrie sa
base nationale. Les antiques industries nationales ont été anéanties et continuent à l'être chaque jour. Elles sont évincées par des industries nouvelles, dont l'introduction devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, des industries qui ne transforment plus des matières premières du pays, mais des matières premières en provenance des zones les plus reculées et dont les produits sont consommés non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde à la fois. Les anciens besoins que satisfaisaient les produits nationaux sont remplacés par des besoins nouveaux qui exigent pour leur satisfaction des contrées et des climats plus lointains. L'ancien isolement de localités et de nations fait place à des relations universelles, à une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle l'est tout autant de la production intellectuelle. Les produits de l'esprit des diverses nations deviennent bien commun. L'exclusivisme et l'étroitesse nationaux deviennent de plus en plus impossibles, et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature mondiale.
Grâce au perfectionnement rapide de tous les instruments de production, grâce aux communications rendues infiniment plus faciles, la bourgeoisie entraîne brutalement dans la civilisation toutes les nations, même les plus barbares. Le bon marché de ses marchandises est l'artillerie lourde avec laquelle elle abat toutes les murailles de Chine et contraint à capituler les barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de l'étranger. Elle oblige toutes les nations à faire leur, si elles ne veulent pas disparaître, le mode de production de la bourgeoisie ; elle les contraint à introduire chez elles ce qu'elle appelle la civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle se crée un monde à son image.
2. Le destin d'autodestruction du système capitaliste : « Tendance historique
de l'accumulation capitaliste « (1867)
Karl Marx, Le Capital, trad. Joseph Roy, t. II, Livre premier, Huitième section, chap. XXXII, Champs-Flammarion, 1985, p. 206-207.
Dès que ce procès de transformation a décomposé suffisamment et de fond en comble la vieille société, que les producteurs sont changés en prolétaires et leurs conditions de travail en capital, qu'enfin le régime capitaliste se soutient par la seule force économique des choses, alors la socialisation ultérieure du travail, ainsi que la métamorphose progressive du sol et des autres moyens de production en instruments socialement exploités, communs, en un mot, l'élimination ultérieure des propriétés privées — va revêtir une nouvelle forme. Ce qui est maintenant à exproprier, ce n'est plus le travailleur indépendant, mais le capitaliste, le chef d'une armée ou d'une escouade de salariés.
Cette expropriation s'accomplit par le jeu des lois immanentes de la production capitaliste, lesquelles aboutissent à la concentration des capitaux. Corrélativement à cette centralisation, à l'expropriation du grand nombre des capitalistes par le petit, se développent sur une échelle toujours croissante l'application de la science à la technique, l'exploitation de la terre avec méthode et ensemble, la transformation de l'outil en instruments puissants seulement par l'usage commun, partant l'économie des moyens de production, l'entrelacement de tous les peuples dans le réseau du marché universel, d'où le caractère international imprimé au régime capitaliste. À mesure que diminue le nombre des potentats du capital qui usurpent et monopolisent tous les avantages de
cette période d'évolution sociale s'accroît la misère, l'oppression, l'esclavage, la dégradation, l'exploitation, mais aussi la résistance de la classe ouvrière sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme même de la production capitaliste. Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés.
L'appropriation capitaliste, conforme au mode de production capitaliste, constitue la première négation de cette propriété privée qui n'est que le corollaire du travail indépendant et individuel. Mais la production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature. C'est la négation de la négation. Elle rétablit non la propriété privée du travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée sur les acquêts de l'ère capitaliste, sur la coopération et la possession commune de tous les moyens de production, y compris le sol.
Pour transformer la propriété privée et morcelée, objet du travail individuel, en propriété capitaliste, il a naturellement fallu plus de temps, d'efforts et de peine que n'en exigera la métamorphose en propriété sociale de la propriété capitaliste, qui de fait repose déjà sur un mode de production collectif. Là il s'agissait de l'expropriation de la masse par quelques usurpateurs ; ici il s'agit de l'expropriation de quelques usurpateurs par la masse.
croissante de la richesse abstraite est le seul motif déterminant de ses opérations, qu'il fonctionne en capitaliste ou, si l'on veut, comme capital personnifié, doué de conscience et de volonté. La valeur d'usage ne doit donc jamais être considérée comme le but immédiat du capitaliste, pas plus que le gain isolé, mais bien le mouvement incessant du gain toujours renouvelé. [...]
Dans la circulation A-M-A' [...], marchandise et argent ne fonctionnent l'une et l'autre que comme des formes différentes de la valeur elle-même, de manière que l'un en est la forme générale, l'autre la forme particulière, et, pour ainsi dire, dissimulée. La valeur passe constamment d'une forme à l'autre sans se perdre dans ce mouvement. Si l'on arrête soit à l'une soit à l'autre de ces formes, dans lesquelles elle se manifeste tour à tour, on arrive aux deux définitions : le capital est argent, le capital est marchandise ; mais en fait la valeur se présente ici comme une substance automatique, douée d'une vie propre et qui, tout en échangeant ses formes sans cesse, change aussi de grandeur, et spontanément, en tant que valeur mère, produit une pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter de la valeur parce qu'elle est valeur, de faire des petits ou du moins de pondre des œufs d'or.
On en vient donc à ce résultat que l'homme (l'ouvrier) se sent agir librement seulement dans ses fonctions animales : manger, boire et procréer, ou encore, tout au plus, dans le choix de sa maison, de son habillement, etc. ; en revanche, il se sent animal dans ses fonctions proprement humaines. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain devient animal.
7. Des droits de l'homme à l'émancipation humaine réelle (1843)
Karl Marx, La Question juive, trad. Lucien Sève, in Marx. Écrits philosophiques, Champs-Flammarion,
2011, p. 129-132.
La révolution politique a aboli le caractère politique de la société civile-bourgeoise. Elle fit éclater cette société en ses éléments simples, d'un côté les individus, de l'autre les éléments matériels et spirituels qui forment le contenu de vie, la situation civile de ces individus. Elle dégagea de ses chaînes l'esprit politique qui était en quelque sorte débité, démembré, défait dans les diverses impasses de la société féodale ; contre cette dispersion elle le rassembla, le libéra de sa confusion avec la vie civile et le constitua en sphère de la communauté, de la cause générale du peuple dans une indépendance idéale envers ces éléments particuliers de la vie civile. L'activité déterminée, la situation déterminée dans l'existence furent rabaissées au niveau d'une signification simplement individuelle. Elles ne formèrent plus la relation générale de l'individu au tout de l'État. C'est bien plutôt la cause publique comme telle qui devint la cause générale de chaque individu, et la fonction politique sa fonction générale.
Cependant l'accomplissement de l'idéalisme de l'État était en même temps l'accomplissement du matérialisme de la société civile-bourgeoise. Secouer le joug politique, c'était en même temps secouer les liens qui tenaient enchaîné l'esprit égoïste de cette société. L'émancipation politique était en même temps l'émancipation de la société civile-bourgeoise à l'égard de la politique, de l'apparence même d'un contenu général.
La société féodale était réduite à son fondement, à l'homme. Mais à l'homme qui était son fondement effectif, à l'homme égoïste.
Cet homme, le membre de la société civile-bourgeoise, est maintenant la base, la présupposition de l'État
Mais la liberté de l'homme égoïste et la reconnaissance de cette liberté est bien davantage la reconnaissance du mouvement
C'est pourquoi l'homme n'a pas été libéré de la religion, il a obtenu la liberté de religion. Il n'a pas été libéré de la propriété, il a obtenu la liberté de posséder. Il n'a pas été libéré de l'égoïsme de métier, il a obtenu la liberté d'exercer un métier.
La
En fin de compte, l'homme tel qu'il est comme membre de la société bourgeoise passe pour l'homme
8. Tocqueville, porte-parole de la peur libérale du communisme et du socialisme (1848)
Alexis de Tocqueville, Discours prononcé devant la Chambre sur le « droit au travail «, 12 septembre 1848, in Œuvres complètes, Lévy frères, 1866, t. IX, p. 537-539.
Par sa dernière rédaction, la Commission se borne à imposer à la société le devoir de venir en aide, soit par le travail, soit par le secours proprement dit et dans les mesures de ses ressources, à toutes les misères ; en disant cela, la Commission a voulu, sans doute, imposer à l'État un devoir plus étendu, plus sacré que celui qu'il s'était imposé jusqu'à présent ; mais elle n'a pas voulu faire une chose absolument nouvelle : elle a voulu accroître, consacrer, régulariser la charité publique, elle n'a pas voulu faire autre chose que la charité publique. L'amendement, au contraire, fait autre chose, et bien plus ; l'amendement, avec le sens que les paroles qui ont été prononcées et surtout les faits récents lui donnent, l'amendement qui accorde à chaque homme en particulier le droit général, absolu, irrésistible, au travail, cet amendement mène nécessairement à l'une de ces conséquences : ou l'État entreprendra de donner à tous les travailleurs qui se présenteront à lui l'emploi qui leur manque, et alors il est entraîné peu à peu à se faire industriel ; et comme il est l'entrepreneur d'industrie qu'on rencontre partout, le seul qui ne puisse refuser le travail, et celui qui d'ordinaire impose la moindre tâche, il est invinciblement conduit à se faire le principal, et bientôt, en quelque sorte, l'unique entrepreneur de l'industrie. Une fois arrivé là, l'impôt n'est plus le moyen de faire fonctionner la machine du gouvernement, mais le grand moyen d'alimenter l'industrie. Accumulant ainsi dans ses mains tous les capitaux
jusqu'à présent, n'ose traiter, arrive enfin à cette tribune ; il faut que cette Assemblée la tranche, il faut que nous déchargions le pays du poids que cette pensée du socialisme fait peser, pour ainsi dite, sur sa poitrine ; il faut que, à propos de cet amendement, et c'est principalement pour cela, je le confesse, que je suis monté à cette tribune, la question du socialisme soit tranchée ; il faut qu'on sache, que l'Assemblée nationale sache, que la France tout entière sache si la révolution de Février est ou non une révolution socialiste. (Très bien !)
9. Lutte des classes et révolution communiste : vers la dictature du prolétariat (1890)
Marx et Engels, Manifeste du parti communiste, op. cit., II, trad. Émile Bottigelli, p. 100-102.
La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec les rapports de propriété traditionnels ; rien d'étonnant à ce que la marche de son développement entraîne la rupture la plus radicale avec les idées traditionnelles.
Mais laissons là les objections de la bourgeoisie contre le communisme.
Nous avons déjà vu plus haut que le premier pas des ouvriers vers la révolution, c'est le prolétariat s'érigeant en classe dominante, la conquête de la démocratie.
Le prolétariat utilisera sa domination politique pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tout capital, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour accroître le plus vite possible la masse des forces de production.
Cela ne peut naturellement se faire tout d'abord qu'au moyen d'interventions despotiques dans le droit de propriété et dans les rapports de production bourgeois, donc grâce à des mesures qui apparaissent économiquement insuffisantes et insoutenables, mais qui, au cours du mouvement, tendent à se dépasser elles-mêmes et qui sont inévitables comme moyen de bouleverser tout le mode de production.
Ces mesures seront naturellement différentes selon les divers pays.
Pour les pays les plus développés toutefois, les mesures suivantes pourront être assez généralement appliquées :
Une fois que les différences de classes auront disparu au cours du développement et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, les pouvoirs publics perdront leur caractère politique. Le pouvoir politique au sens propre est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Lorsque dans la lutte contre la bourgeoisie le prolétariat s'unit nécessairement en une classe, qu'il s'érige en classe dirigeante par une révolution et que, classe dirigeante, il abolit par la violence les anciens rapports de production, il abolit du même coup les conditions d'existence de l'opposition des classes, des classes en général et par suite sa propre domination de classe.
À la vieille société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classes se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
EXTRAITS
1. Résumé de la théorie de la libido (1924)
Sigmund Freud, Trois Essais sur la théorie sexuelle,
trad. Fernand Cambon, Flammarion,
« Champs classiques «, 2011, p. 218-221.
Nous avons fixé pour notre usage le concept de libido au sens d'une force quantitativement variable, susceptible de mesurer des processus et les transpositions dans le domaine de l'excitation sexuelle. Cette libido, nous la distinguons de l'énergie qu'il convient de supposer généralement aux processus psychiques, compte tenu de son origine particulière ; et nous lui conférons ainsi également un caractère qualitatif. En distinguant entre énergie libidinale et énergie psychique autre, nous exprimons la présupposition que les processus sexuels de l'organisme différent des processus nutritifs par un chimisme particulier. L'analyse des perversions et des psychonévroses nous a permis d'apercevoir que cette excitation sexuelle n'est pas fournie par les seules parties dites sexuelles, mais par tous les organes du corps. Nous formons donc pour nous la représentation d'un quantum de libido, dont nous appelons la représentation libido moïque [tournée vers le moi], dont la production, l'augmentation ou la diminution, la répartition et le déplacement sont censés nous
2. La culpabilité et l'emprise du surmoi (1930)
Sigmund Freud, Le Malaise dans la culture, trad. Dorian Astor, 2010, GF-Flammarion, p. 152-153.
Nous connaissons donc deux origines au sentiment de culpabilité, celle qui naît de la peur de l'autorité et celle, plus tardive, qui naît de la peur du surmoi. Le premier contraint à renoncer aux satisfactions pulsionnelles, le second pousse en outre à la punition, puisqu'on ne peut cacher au surmoi la persistance de ses désirs interdits. Nous avons vu aussi comment on peut comprendre la sévérité du surmoi, donc l'exigence de la conscience morale. Elle prolonge simplement la sévérité de l'autorité extérieure relayée et en partie remplacée par elle. Nous voyons à présent quelle est la relation du renoncement pulsionnel à la conscience de culpabilité. À l'origine, le renoncement pulsionnel est en effet la conséquence de la peur de l'autorité extérieure [des parents] ; on renonce à des satisfactions afin de ne pas perdre son amour. Si l'on est parvenu à ce renoncement ; on est pour ainsi dire quitte avec elle, il ne devrait subsister aucun sentiment de culpabilité. Il en est autrement dans le cas de la peur du surmoi. Ici, le renoncement pulsionnel n'aide pas suffisamment, car le désir demeure et ne saurait se dissimuler devant le surmoi. Un sentiment de culpabilité surviendra malgré le succès du renoncement, et ceci est un grand inconvénient économique de l'instauration du surmoi, ou pour le dire autrement, de la formation de la conscience morale. Désormais, le renoncement pulsionnel n'a plus un plein effet libérateur, l'abstinence vertueuse n'est plus récompensée par l'assurance de l'amour ; contre un malheur extérieur menaçant — perte d'amour et punition de la part de l'autorité extérieure —, on a échangé un malheur intérieur permanent, la tension de la conscience de culpabilité.
blables. Ces petites choses, actes manqués comme actions symptomatiques et fortuites, ne sont pas autant dépourvues de signification qu'on est disposé à l'admettre par une sorte d'accord tacite. Elles sont tout à fait pleines de sens, la plupart du temps faciles à interpréter avec certitude à partir de la situation dans laquelle elles se produisent, et il apparaît qu'elles expriment à leur tour des impulsions et des intentions qui doivent être remisées, dissimulées à la conscience propre, ou qu'elles sont justement issues des mêmes motions de souhaits et complexes refoulés que ceux dont nous avons déjà fait connaissance en tant que créateurs des symptômes et façonneurs des rêves. Ils méritent donc d'être mis au rang de symptômes, et leur examen attentif peut, comme celui des rêves, conduire à mettre au jour ce qui est dissimulé dans la vie de l'âme. Grâce à eux, l'homme trahit en général les plus intimes de ses secrets. S'ils surgissent avec une facilité et une fréquence particulières, même chez la personne saine, qui a très bien réussi à refouler ses motions inconscientes, ils le doivent à leur caractère anodin et inapparent. Mais ils peuvent prétendre à une haute valeur théorique, dans la mesure où ils avèrent l'existence du refoulement et de la formation substitutive, même dans les conditions de la bonne santé.
4. La charge érotique des rêves (1901)
Sigmund Freud, Sur le rêve, trad. Fernand Cambon, Flammarion, « Champs classiques «, 2010, chap. xii, p. 157-162.
Quiconque se tient fermement au point de vue de la censure comme motif principal de la déformation du rêve
ne sera pas déconcerté en apprenant à partir des résultats de l'interprétation du rêve que la plupart des rêves des adultes sont ramenés par l'analyse à des souhaits érotiques. Cette affirmation ne vise pas les rêves à contenu sexuel non voilé, qui sont sans doute connus de tous les rêveurs à partir de leurs propres expériences vécues et qui sont habituellement les seuls à être décrits comme « rêves sexuels «. De tels rêves présentent encore pas mal d'aspects déconcertants, de par le choix des personnes dont ils font des objets sexuels, la mise au rancart de toutes les barrières face auxquelles le rêveur met le holà, dans la vie éveillée, à ses besoins sexuels, et de par bien des détails singuliers qui évoquent tout ce qu'on nomme pervers. Mais l'analyse montre que beaucoup d'autres rêves, qui ne laissent rien deviner d'érotique dans leur contenu manifeste, sont démasqués par le travail interprétatif comme étant des accomplissements de souhaits sexuels, et que, d'autre part, un très grand nombre de pensées que le travail du penser vigile laisse derrière lui au titre de « restes diurnes « ne parviennent à être présentées dans le rêve que moyennant le recours à des souhaits érotiques refoulés.
Afin d'élucider cet état de fait qui ne répond pas à un postulat théorique, il convient de rappeler qu'aucun groupe de pulsions autre que justement celui des pulsions sexuelles n'a subi une répression aussi ample de par les exigences de l'éducation à la culture, mais aussi que ce sont les pulsions sexuelles qui, chez la plupart des humains, s'entendent le mieux à se soustraire aux instances psychiques suprêmes. Depuis que nous avons fait la connaissance de la sexualité infantile, souvent si peu apparente dans ses manifestations, régulièrement inaperçue et sujette à méprise, nous sommes justifiés à dire que presque chaque homme civilisé a conservé sur un point quelconque la forme infantile de la vie sexuelle, et nous comprenons ainsi que les souhaits sexuels infan‑
tiles refoulés sont les forces pulsionnelles les plus fréquentes et les plus fortes qui contribuent à la formation des rêves.
Si le rêve qui exprime des souhaits érotiques peut réussir à avoir, dans son contenu manifeste, des allures innocemment asexuelles, cela ne peut devenir possible que d'une manière. Le matériel de représentations sexuelles n'est pas autorisé à être présenté comme tel ; il doit au contraire être remplacé dans le contenu du rêve par des suggestions, des allusions et autres modes de présentation indirecte ; cependant, à la différence d'autres cas de présentation indirecte, il faut que celle qui est utilisée dans le rêve soit soustraite à la compréhensibilité immédiate. On s'est habitué à qualifier les moyens de présentation qui répondent à ces conditions de symboles de ce qui est présenté par eux. On leur a porté un intérêt particulier depuis qu'on a remarqué que les dormeurs parlant la même langue se servent des mêmes symboles, voire que, dans des cas particuliers, la communauté symbolique outrepasse la communauté linguistique. Les rêveurs ne connaissant pas eux-mêmes les symboles qu'ils utilisent, cela demeure d'abord une énigme que de savoir d'où sort la relation de ceux-ci à ce qu'ils remplacent et désignent. Mais le fait lui-même est indubitable, et il prend de l'importance pour la technique de l'interprétation du rêve, car, grâce à la connaissance de la symbolique du rêve, il est possible de comprendre le sens d'éléments isolés du contenu du rêve, ou de fragments isolés du rêve, ou bien parfois même le sens de rêves entiers, sans être obligé d'interroger le rêveur quant à ses idées incidentes. Nous approchons ainsi l'idéal populaire d'une traduction du rêve et, d'autre part, nous revenons à la technique interprétative des peuples anciens, dont l'interprétation du rêve était identique à une interprétation par la symbolique.
Bien que les études sur les symboles du rêve soient encore fort éloignées de leur terme, nous pouvons toutefois défendre avec certitude à leur sujet une série d'affirmations universelles et d'indications spécifiques. Il y a des symboles qu'on peut presque universellement traduire de manière univoque ; ainsi, empereur et impératrice (roi et reine) signifient les parents ; les chambres représentent des femmes, les entrées et sorties des premières, les orifices corporels. Le plus grand nombre des symboles du rêve sert à représenter des personnes, des parties du corps et des besognes qui sont marquées d'un intérêt érotique ; en particulier, les organes génitaux peuvent être représentés par un certain nombre de symboles souvent très surprenants, et les objets les plus divers se trouvent utilisés aux fins de désignation symbolique des organes génitaux. Quand des armes tranchantes, des objets longs et raides tels que des troncs d'arbres et des bâtons représentent l'appareil génital masculin, quand des armoires, boîtes, voitures, poêles représentent l'abdomen féminin dans le rêve, nous pouvons comprendre sans plus de façons quel est le tertium comparationis, le trait commun de ces substituts ; mais ce n'est pas une tâche aussi facile avec tous les symboles que de saisir les relations qui font lien. Des symboles tels que l'escalier ou l'acte de monter pour le rapport sexuel, de la cravate pour le membre viril, du bois pour l'abdomen féminin provoquent l'incrédulité tant que nous n'avons pas obtenu l'aperception de la relation symbolique par d'autres voies. Bon nombre des symboles du rêve sont du reste bisexuels ; suivant le contexte, ils peuvent être rapportés à l'appareil génital masculin ou féminin.
5. Le « travail du rêve « (1901)
Sigmund Freud, Sur le rêve, ibid., chap. VIII, p. 135-137.
En réalité, le travail du rêve n'est que le premier repère dans une série de processus psychiques auxquels il convient de ramener la genèse des symptômes hystériques, des idées angoissantes, obsessionnelles et délirantes. La condensation et surtout le déplacement sont des caractères qu'on ne manque jamais de rencontrer non plus dans ces autres processus. En revanche, le remaniement en vue de l'intuition reste le propre du travail du rêve. Si cette élucidation met le rêve en série avec les formations de la pathologie psychique, il nous importera d'autant plus d'apprendre les conditions essentielles de processus tels que la formation du rêve. Nous serons probablement étonnés d'entendre que ni l'état de sommeil ni la maladie ne font partie de ces conditions indispensables. Il y a un nombre important de phénomènes de la vie quotidienne des personnes saines, l'oubli, le lapsus linguae, le geste manqué et une certaine classe d'erreurs, qui doivent leur genèse à un mécanisme psychique analogue à celui du rêve et des autres termes de la série.
Le noyau du problème se situe dans le déplacement, de loin la plus frappante parmi les diverses opérations du travail du rêve. On s'aperçoit, en se plongeant de manière approfondie dans l'objet, que la condition essentielle du déplacement est de nature purement psychologique ; elle est de l'ordre d'une motivation. On tombe sur sa trace en évaluant des expériences auxquelles on ne peut échapper quand on analyse des rêves. Lors de l'analyse de l'exemple du rêve [plus haut dans le texte original], j'ai dû interrompre la communication des pensées du rêve, parce que parmi elles se trouvaient, comme je l'ai avoué, certaines que je préfère garder secrètes devant des étrangers et dont
6. La sexualité infantile : une découverte cruciale (1910)
Sigmund Freud, Sur la psychanalyse.
Cinq Leçons données à la Clark University, op. cit.,
IV, p. 132-133 et 136-140.
Existe-t-il donc une sexualité infantile ? demanderez-vous. Est-ce que l'enfance n'est pas plutôt la période de la vie qui est caractérisée par le défaut de pulsion sexuelle ? Non, messieurs, les choses ne se passent certainement pas de telle manière que la pulsion sexuelle, à l'époque de la puberté, descend dans les enfants comme, dans l'Évangile, le démon dans les porcs. L'enfant a ses pulsions et activités sexuelles depuis le début ; il les apporte avec lui dans le monde ; et c'est d'elles qu'à travers un développement significatif, riche en étapes, procède ce qu'on appelle la sexualité normale de l'adulte. Il n'est même pas difficile d'observer les manifestations de cette activité sexuelle enfantine ; il faut bien plutôt déployer un art certain pour ne pas la voir ou pour s'en débarrasser par une interprétation. [...]
Laissez tomber vos doutes et accompagnez-moi dans une évaluation de la sexualité infantile à partir des premières années. La pulsion sexuelle de l'enfant s'avère être hautement composite ; elle se laisse dissocier en un grand nombre de composantes qui sont issues de diverses sources. Surtout, elle est encore indépendante de la fonction de procréation, au service de laquelle elle se mettra plus tard. Elle sert à l'obtention de diverses sortes de sensations de plaisir, que nous récapitulons, par le biais d'analogies et de mises en rapport, sous le chef de plaisir sexuel. La source principale du plaisir sexuel infantile est l'excitation appropriée d'endroits déterminés du corps particulièrement stimulables, en dehors des parties géni‑
considération de la pulsion d'autoconservation. Mais la différence sexuelle ne joue pas encore dans cette période enfantine un rôle décisif ; c'est ainsi que vous pouvez attribuer à chaque enfant, sans lui faire tort, un pan de disposition homosexuelle.
Cette vie sexuelle de l'enfant, dissolue, riche en contenu mais dissociée, dans laquelle les pulsions prises une par une vaquent à l'acquisition de plaisir indépendamment les unes des autres, est toutefois soumise à une récapitulation et une organisation selon deux directions principales, de sorte qu'au terme de l'époque de la puberté le caractère sexuel définitif de l'individu atteint la plupart du temps une constitution achevée. D'une part, les diverses pulsions se subordonnent à la suprématie de la zone génitale, de sorte que la vie sexuelle entière entre au service de la procréation et que leur satisfaction ne garde plus d'importance que comme préparation et facilitation de l'acte sexuel proprement dit. D'autre part, le choix d'objet repousse l'autoérotisme, de sorte qu'à présent, dans la vie amoureuse, toutes les composantes de la pulsion sexuelle aspirent à être satisfaites sur la personne aimée. Cependant, toutes les composantes pulsionnelles originaires ne sont pas admises à participer à cette mise en place définitive de la vie sexuelle. Dès avant l'époque de la puberté, sous l'influence de l'éducation, des refoulements extrêmement énergiques de certaines pulsions ont été imposés, et des puissances psychiques telles que la pudeur, le dégoût, la morale ont été instaurées, entretenant ces refoulements au titre de gardiens. Quand ensuite, à l'âge de la puberté, surviennent les vives eaux de l'appétence sexuelle, elles trouvent dans les formations de réaction ou de résistance psychiques dont nous venons de parler des digues qui leur prescrivent leur écoulement par les voies dites normales et leur rendent impossible de ranimer les pulsions soumises au refoulement. Ce sont surtout les motions de plaisir coprophiles
maladie, il transpose le contenu en symptômes. Moyennant certaines conditions favorables, il lui reste encore possible de trouver, à partir de ces fantasmes, un autre chemin conduisant dans la réalité, au lieu de devenir durablement étranger à celle-ci en régressant dans l'infantile. Quand la personne fâchée avec la réalité est en possession du don artistique, qui nous est encore psychologiquement énigmatique, elle peut transposer ses fantasmes, au lieu de symptômes, en créations artistiques, échapper ainsi au destin de la névrose et reconquérir par ce détour la relation à la réalité.
8. Se libérer du refoulement, assumer sa libido et sublimer ses pulsions (1910)
Sigmund Freud, Sur la psychanalyse.
Cinq Leçons données à la Clark University, ibid.,
y, p. 155-157.
Quels sont, de manière générale, les destins des souhaits inconscients mis au jour par la psychanalyse, par quelles voies nous entendons-nous à les rendre inoffensifs pour la vie de l'individu ? Ces voies, il y en a plusieurs. L'issue la plus fréquente est que ces souhaits sont absorbés, déjà pendant le travail, par l'activité psychique correcte des motions meilleures qui leur font face. Le refoulement est remplacé par la condamnation accomplie avec les meilleurs moyens. Cela est possible parce que nous n'avons en grande partie à éliminer que des conséquences de stades évolutifs antérieurs du moi. L'individu n'avait en son temps pu mettre sur pied qu'un refoulement parce qu'il était alors lui-même encore incomplètement organisé et faible ; avec sa maturité et sa force
cet excès de refoulement sexuel. Nous ne devrions pas nous forcer à l'élévation jusqu'au point de négliger complètement l'animalité originelle de notre nature ; nous ne devons pas non plus oublier que la satisfaction, source de bonheur pour l'individu, ne peut être rayée des buts de notre culture. La plasticité des composantes sexuelles, qui se manifeste dans leur aptitude à la sublimation, peut en effet produire la grande tentation d'atteindre des effets culturels plus grands en renchérissant sans cesse sur leur sublimation. Mais, de même qu'il ne faut pas trop compter transformer par nos machines plus qu'une certaine fraction de la chaleur dépensée en travail mécanique utile, de même nous ne devrions pas trop aspirer à aliéner la pulsion sexuelle à ses fins propres dans toute l'étendue de son énergie. Cela ne saurait réussir, et si la restriction de la sexualité doit être poussée trop loin, cela ne peut entraîner que tous les dommages d'une économie de pillage.
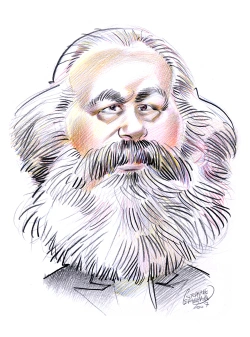
«
68 1 MARX ET LHYPOTHÈSE COMMUNISTE
illusions religieuses et politiques l'exploitation ouverte,
cynique, directe et toute crue.
La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes
les
activités tenues jusqu'ici pour vénérables et considérées
avec une piété mêlée de crainte.
Elle a transformé
le
médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de
science, en salariés
à ses gages.
La bourgeoisie a arraché aux relations familiales leur
voile sentimental attendrissant et
les a ramenées à un pur
rapport d'argent.
[ ...
]
La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en
permanence
les instruments de production, donc les
conditions de la production, donc l'ensemble des rap
ports sociaux.
Le maintien sans changement de l'ancien
mode de production était au contraire la condition
d'existence première de toutes
les classes industrielles
antérieures.
Le bouleversement constant de la produc
tion, l'ébranlement incessant de toutes
les conditions
sociales, l'insécurité et l'agitation perpétuelles distinguent
l'époque bourgeoise de toutes les époques antérieures.
Tous les rapports bien établis, figés par la rouille, avec
leur cortège d'idées et de conceptions surannées et véné
rables sont dissous ; tous
les rapports nouveaux tombent
en désuétude avant d'avoir
pu se scléroser.
Toute hiérar
chie sociale et
tout ordre établi se volatilisent, tout ce qui
est sacré est profané et
les hommes sont enfin contraints
de considérer
d'un œil froid leur position dans la vie,
leurs relations mutuelles.
Pressée par le besoin de débouchés toujours plus éten
dus
pour ses produits, la bourgeoisie se répand sur la
terre entière.
Il faut qu'elle s'implante partout, s'installe
partout, établisse partout des relations.
Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a
donné une tournure cosmopolite
à la production et à
la consommation de tous les pays.
Au grand regret des
réactionnaires, elle a sapé sous
les pieds de l'industrie sa.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
- Karl Marx: Das Kapital - Anthologie.
- Karl Marx: Bildung von Aktiengesellschaften - Anthologie.
- Marx, l'Idéologie allemande (extrait) - anthologie historique.
- Marx et Engels, Manifeste du Parti communiste (extrait) - anthologie historique.