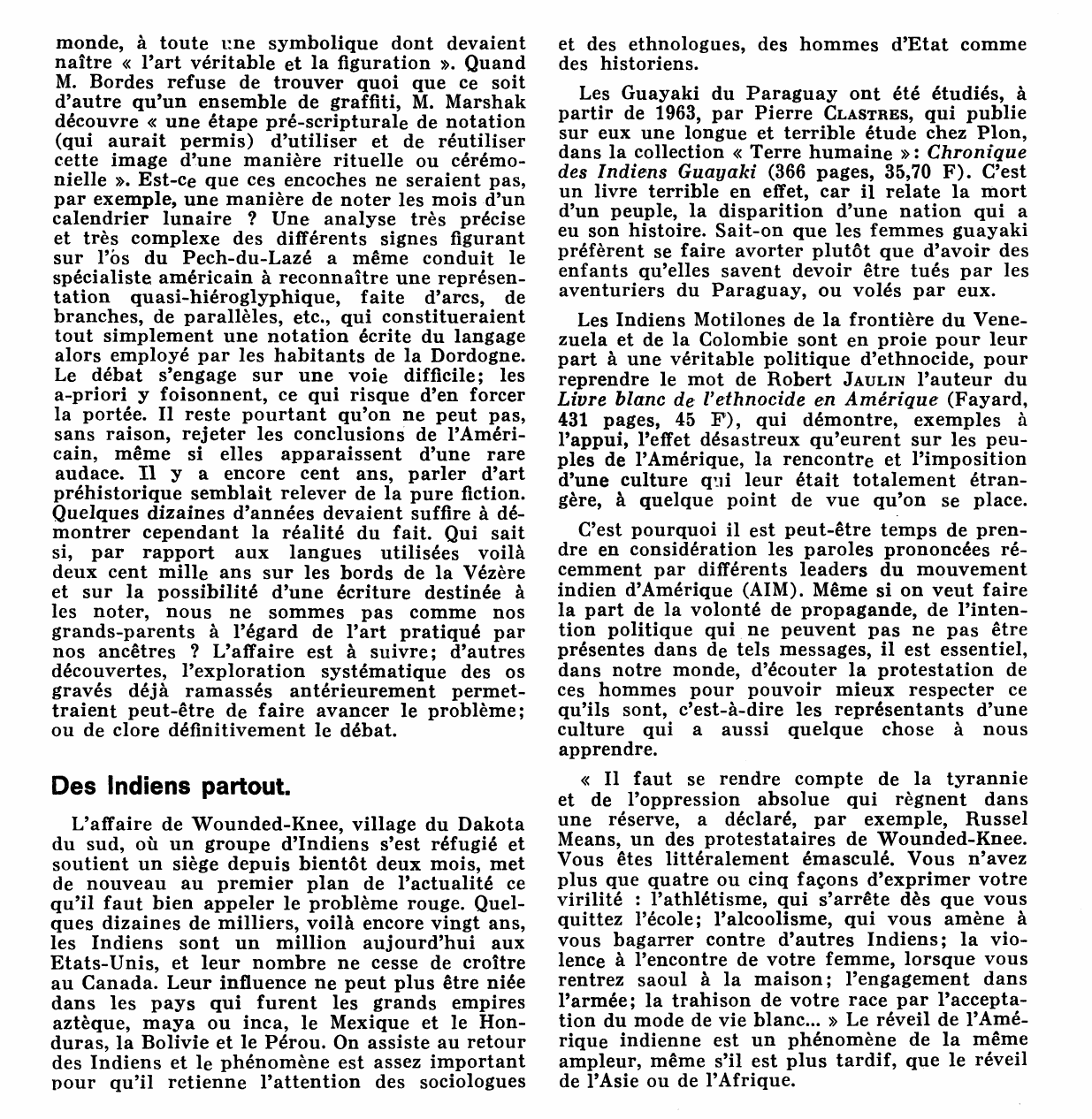Qui sont les Basques ?
Publié le 06/12/2011

Extrait du document
Il y a longtemps qu'on se pose des questions sur les Basques. Rien n'est très simple avec eux et toutes les recherches entreprises à leur sujet semblent avoir pour effet de multiplier les problèmes. Un des aspects les plus surprenants de cette population, c'est d'avoir su résister comme elle l'a fait, pendant des millénaires, à toutes les agressions extérieures, à la différence de ce qu'on observe à peu près partout ailleurs. On dirait que les Basques sont ce qu'ils sont pour la raison qu'ils l'ont ainsi voulu. Leur longue histoire est celle d'une défense volontaire, d'un refus d'abandon et d'une rare exigence à l'égard de soi-même. La langue, la culture et même l'originalité biologique des Basques ont été préservées malgré les invasions ou les conquêtes, malgré les pressions d'autres cultures
«
monde, à toute t:ne symbolique dont devaient naitre « l'art véritable et la figuration ».
Quand M.
Bordes refuse de trouver quoi que ce soit d'autre qu'un ensemble de graffiti, M.
Marshak découvre « une étape pré-scripturale de notation (qui aurait permis) d'utiliser et de réutiliser cette image d'une manière rituelle ou cérémo nielle ».
Est-ce que ces encoches ne seraient pas, par exemple, une manière de noter les mois d'un calendrier lunaire ? Une analyse très précise et très complexe des différents signes figurant sur l'os du Pech-du-Lazé a même conduit le spécialiste américain à reconnaître une représen tation quasi-hiéroglyphique, faite d'arcs, de branches, de parallèles, etc., qui constitueraient tout simplement une notation écrite du langage alors employé par les habitants de la Dordogne.
Le débat s'engage sur une voie difficile; les a-priori y foisonnent, ce qui risque d'en forcer la portée.
Il reste pourtant qu'on ne peut pas, sans raison, rejeter les conclusions de l'Améri cain, même si elles apparaissent d'une rare audace.
Il y a encore cent ans, parler d'art préhistorique semblait relever de la pure fiction.
Quelques dizaines d'années devaient suffire à dé montrer cependant la réalité du fait.
Qui sait si, par rapport aux langues utilisées voilà deux cent mille ans sur les bords de la Vézère et sur la possibilité d'une écriture destinée à les noter, nous ne sommes pas comme nos grands-parents à l'égard de l'art pratiqué par nos ancêtres ? L'affaire est à suivre; d'autres découvertes, l'exploration systématique des os gravés déjà ramassés antérieurement permet traient peut-être de faire avancer le problème; ou de clore définitivement le débat.
Des Indiens partout.
L'affaire de Wounded-Knee, village du Dakota du sud, où un groupe d'Indiens s'est réfugié et soutient un siège depuis bientôt deux mois, met de nouveau au premier plan de l'actualité ce qu'il faut bien appeler le problème rouge.
Quel ques dizaines de milliers, voilà encore vingt ans, les Indiens sont un million aujourd'hui aux Etats-Unis, et leur nombre ne cesse de croitre au Canada.
Leur influence ne peut plus être niée dans les pays qui furent les grands empires aztèque, maya ou inca, le Mexique et le Hon duras, la Bolivie et le Pérou.
On assiste au retour des Indiens et le phénomène est assez important pour qu'il retienne l'attention des sociologues
et des ethnologues, des hommes d'Etat comme des historiens.
Les Guayaki du Paraguay ont été étudiés, à partir de 1963, par Pierre CLASTRES, qui publie sur eux une longue et terrible étude chez Plon, dans la collection « Terre humaine »: Chronique des Indiens Guayaki (366 pages, 35,70 F).
C'est un livre terrible en effet, car il relate la mort d'un peuple, la disparition d'une nation qui a eu son histoire.
Sait-on que les femmes guayaki préfèrent se faire avorter plutôt que d'avoir des enfants qu'elles savent devoir être tués par les aventuriers du Paraguay, ou volés par eux.
Les Indiens Motilones de la frontière du Vene zuela et de la Colombie sont en proie pour leur part à une véritable politique d'ethnocide, pour reprendre le mot de Robert JAULIN l'auteur du Livre blanc de l'ethnocide en Amérique (Fayard, 431 pages, 45 F), qui démontre, exemples à l'appui, l'effet désastreux qu'eurent sur les peu ples de l'Amérique, la rencontre et l'imposition d'une culture qè1i leur était totalement étran gère, à quelque point de vue qu'on se place.
C'est pourquoi il est peut-être temps de pren dre en considération les paroles prononcées ré cemment par différents leaders du mouvement indien d'Amérique (AIM).
Même si on veut faire la part de la volonté de propagande, de l'inten tion politique qui ne peuvent pas ne pas être présentes dans de tels messages, il est essentiel, dans notre monde, d'écouter la protestation de ces hommes pour pouvoir mieux respecter ce qu'ils sont, c'est-à-dire les représentants d'une culture qui a aussi quelque chose à nous apprendre.
« Il faut se rendre compte de la tyrannie et de l'oppression absolue qui règnent dans une réserve, a déclaré, par exemple, Russel Means, un des protestataires de Wounded-Knee.
Vous êtes littéralement émasculé.
Vous n'avez plus que quatre ou cinq façons d'exprimer votre virilité : l'athlétisme, qui s'arrête dès que vous quittez l'école; l'alcoolisme, qui vous amène à vous bagarrer contre d'autres Indiens; la vio lence à l'encontre de votre femme, lorsque vous rentrez saoul à la maison; l'engagement dans l'armée; la trahison de votre race par l'accepta tion du mode de vie blanc ...
» Le réveil de l' Amé rique indienne est un phénomène de la même ampleur, même s'il est plus tardif, que le réveil de l'Asie ou de l'Afrique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓