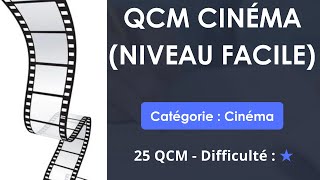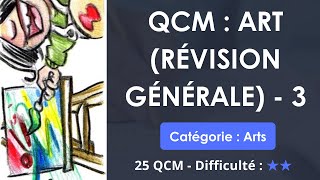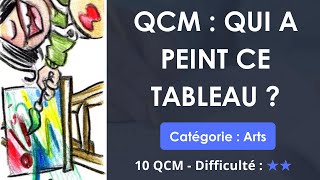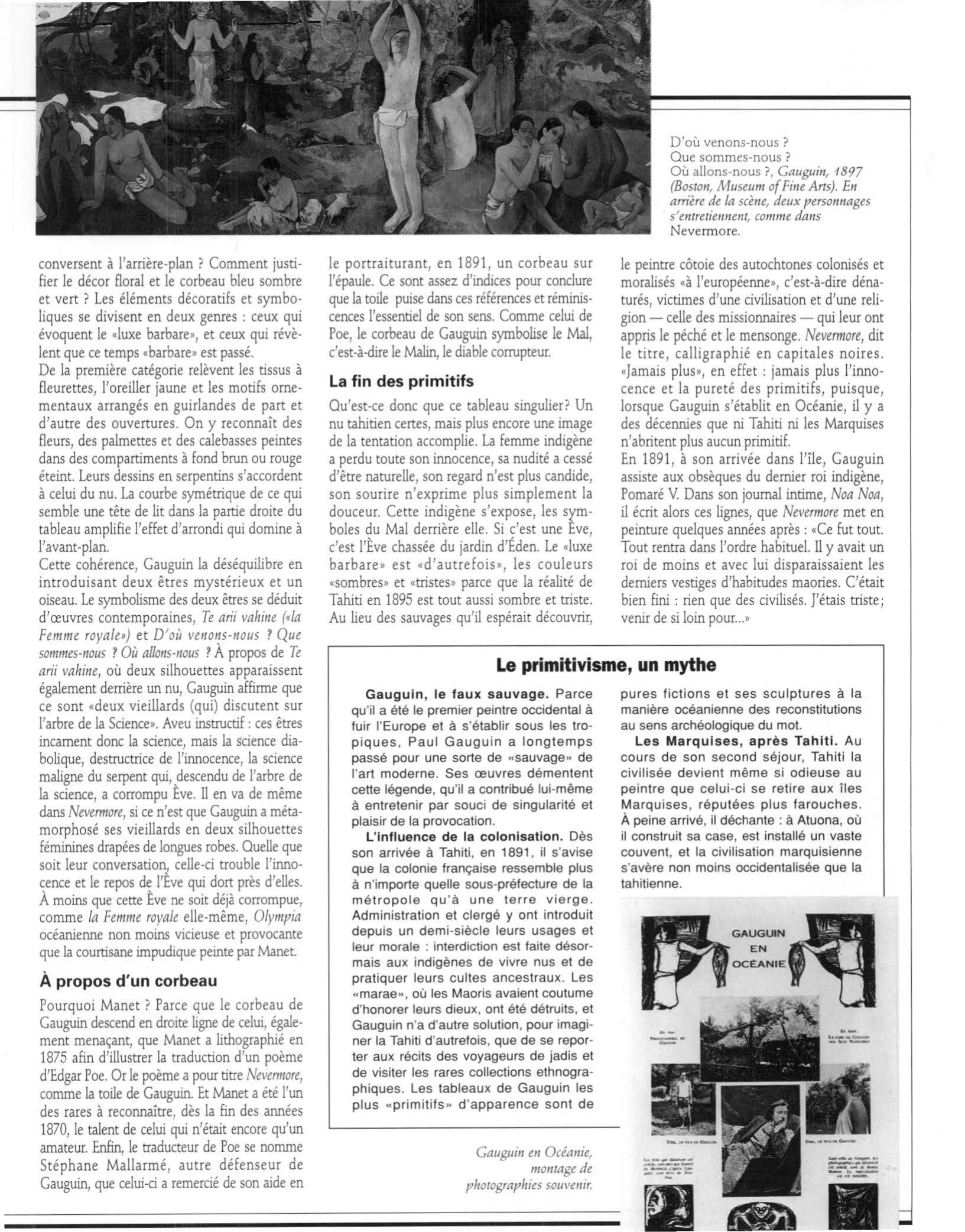Gauguin: NEVERMORE
Publié le 14/09/2014

Extrait du document
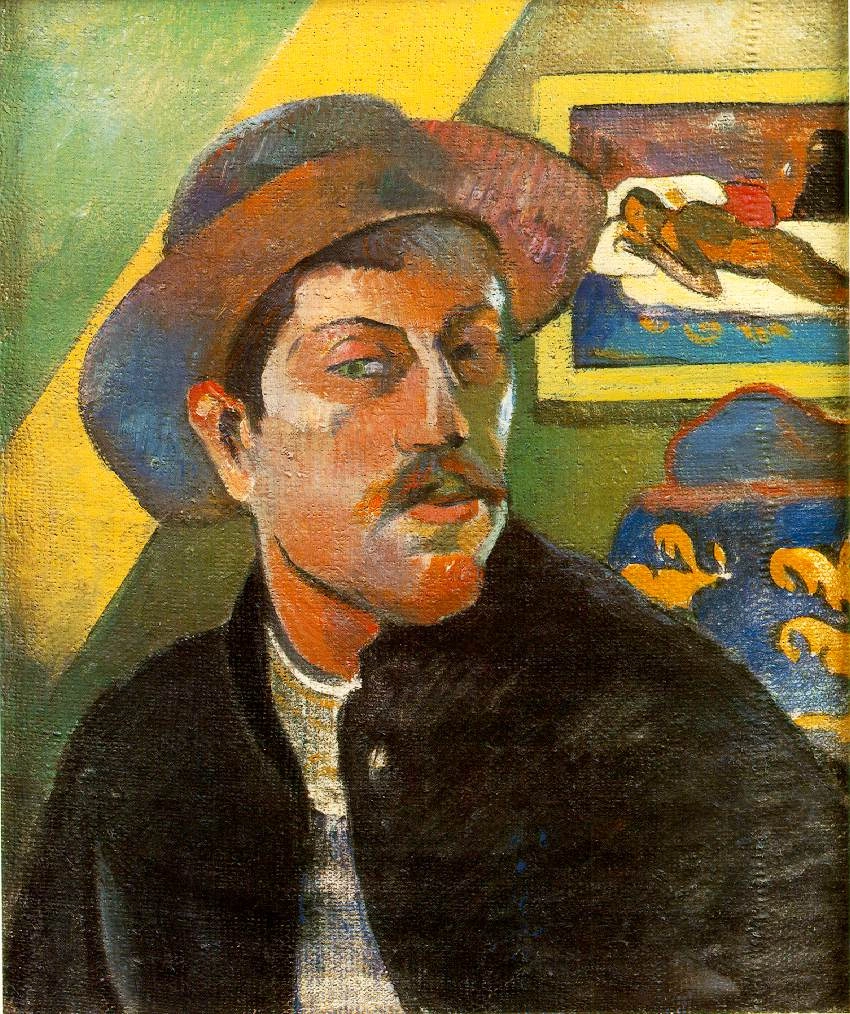
Qu'est-ce donc que ce tableau singulier? Un nu tahitien certes, mais plus encore une image de la tentation accomplie. La femme indigène a perdu toute son innocence, sa nudité a cessé d'être naturelle, son regard n'est plus candide, son sourire n'exprime plus simplement la douceur. Cette indigène s'expose, les symboles du Mai derrière elle. Si c'est une Eve, c'est l'Ève chassée du jardin d'Éden. Le «luxe barbare« est «d'autrefois«, les couleurs «sombres« et «tristes« parce que la réalité de Tahiti en 1895 est tout aussi sombre et triste. Au lieu des sauvages qu'il espérait découvrir,
le peintre côtoie des autochtones colonisés et moralisés «à l'européenne«, c'est-à-dire dénaturés, victimes d'une civilisation et d'une religion — celle des missionnaires — qui leur ont appris le péché et le mensonge.
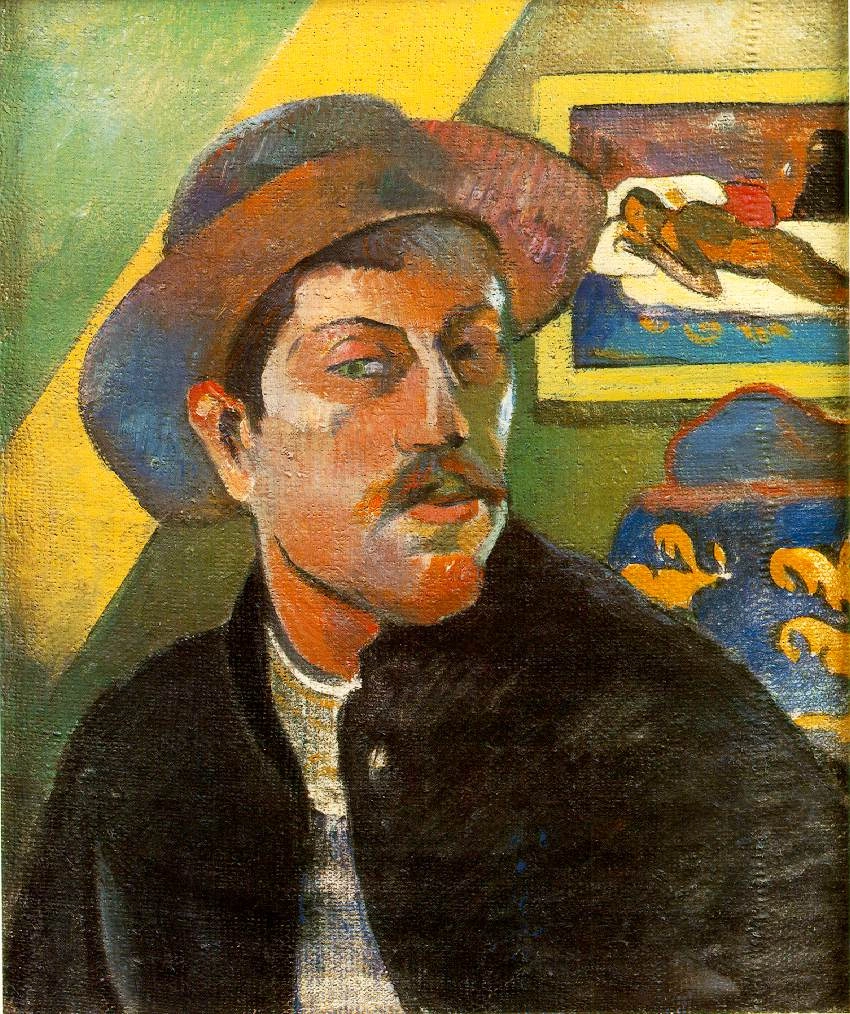
«
conversent à l'arrière-plan ? Comment justi
fier le décor floral et le corbeau bleu sombre
et vert ? Les éléments décoratifs et symbo
liques se divisent en deux genres : ceux qui
évoquent le •luxe barbare •, et ceux qui révè
lent que ce temps •barbare • est passé.
De la première catégorie relèvent les tissus à
fleurettes, l'oreiller jaune et les motifs orne
mentaux arrangés en guirlandes de part et
d'autre
des ouvertures.
On y reconnaît des
fleurs, des palmettes et des calebasses peintes
dans des compartiments à fond brun ou rouge
éteint.
Leurs dessins en serpentins s'accordent
à celui du nu.
La courbe symétrique de ce qui
semble une tête de lit dans la partie droite du
tableau amplifie l'effet d'arrondi qui domine à
l'avant-plan.
Cette cohérence, Gauguin la déséquilibre en
introduisant deux êtres mystérieux et un
oiseau.
Le symbolisme des deux êtres se déduit
d'œuvres contemporaines, Te anï vahine (•la
Femme royale •) et D'où venons-nous r Que
sommes-nous r Où allons-nous r À propos de Te
arii vahine, où deux silhouettes apparaissent
également derrière un nu, Gauguin affirme que
ce sont •deux vieillards (qui) discutent sur
l'arbre de la Science •.
Aveu instructif: ces êtres
incarnent donc la science, mais la science dia
bolique, destructrice de l'innocence, la science
maligne du serpent qui , descendu de l'arbre de
la science, a corrompu Ève.
Il en va de même
dans Nevermore, si ce n'est que Gauguin a méta
morphosé ses vieillards en deux silhouettes
féminines drapées de longues robes.
Quelle que
soit leur conversation, celle-ci trouble l'inno
cence et le repos de !'Ève qui dort près d'elles.
À moins que cette Ève ne soit déjà corrompue,
comme la Femme royale elle-même, Olympia
océarùenne non moins vicieuse et provocante
que la courtisane impudique peinte par Manet.
À propos d' un corbeau
Pourquoi Manet ? Parce que le corbeau de
Gauguin descend en droite ligne de celui, égale
ment menaçant, que Manet a lithographié en
1875 afin d'illustrer la traduction d'un poème
d'Edgar Poe.
Or le poème a pour titre Nevennore,
comme la toile de Gauguin.
Et Manet a été l'un
des rares à reconnaître , dès la fin des années
1870, le talent de celui qui n'était encore qu'un
amateur.
Enfin, le traducteur de Poe se nomme
Stéphane Mallarmé, autre défenseur de
Gauguin, que celui-ci a remercié de son aide en
le portraiturant, en 1891 , un corbeau sur
l'épaule.
Ce sont assez d'indices pour conclure
que la toile puise dans ces références et rémirùs
cences l'essentiel de son sens.
Comme celui de
Poe , le corbeau de Gauguin symbolise le Mal,
c'est-à-dire le Malin, le diable corrupteur.
La fin des primitifs
Qu'est-ce donc que ce tableau singulier? Un
nu tahitien certes, mais plus encore une image
de la tentation accomplie.
La femme indigène
a perdu toute son innocence, sa nudité a cessé
d'être naturelle, son regard n'est plus can dide ,
son sourire n'exprime
plus simplement la
douceur.
Cette indigène s'expose, les sym
boles du Mal derrière elle.
Si c'est une Eve,
c'est !'Ève chassée du jardin d'Éden.
Le •luxe
barbare • est •d'autrefois •, les couleurs
•sombres • et •tristes • parce que la réalité de
Tahiti en 1895 est tout aussi sombre et triste.
Au lieu des sauvages qu'il espérait découvrir,
D'où venons-nous?
Que sommes-nous ?
Où allon s-nous?, Gauguin, 1897 (Bos ton, Museum of Fin e Arts}.
En arrière de la scène, deux personnages s' entretie1111ent, comme dans Nevermore.
le peintre côtoie des autochtones colonisés et
moralisés •à l'européenne •, c'est-à-dire déna
turés, victimes d 'une civilisation et d'u ne reli
gion - celle des missionnaires - qui leur ont
appris le péché et le mens onge.
Nevermore, dit
l e titre, calligraphié
en capitales noires.
«Jamais plus•, en effet : jamais plus l'inno
cence et la pureté des primitifs, puisque,
l
orsque Gauguin s'établit en Océanie , il y a
des décennies que ni Tahiti ni les Marquises
n'abritent p lus aucun primitif.
En 1891 , à son arrivée dans l'île, Gauguin
assiste aux obsèques du dernier roi indigène,
Pomaré V.
Dans son journal intime, Noa Noa,
il écrit alors ces lignes, que Nevermore met en
peinture quelques années après : •Ce fut tout.
Tout rentra dans l'ordre habituel.
li y avait un
roi de moins et a vec lui disparaissaient les
dernie rs vestiges d 'habitudes maories.
C'était
bien fini : rien que des civil isés.
J'étais triste;
venir de si loin pour ...
•
Le primitivisme, un mythe
Gaugu in , le faux sauvage .
Parce qu 'il a été le premier peintre occidental à
fuir l ' Europe et à s'établir sous les tro piques , Paul Gauguin a longtemps passé pour une sorte de «Sauvage » de l'art moderne .
Ses œuvres démentent
cette légende, qu'il a cont ribué lui -même à entretenir par souci de singularité et plaisir de la provocation.
L'influence de la colonisation .
Dès
son arrivée à Tahiti , en 1891 , il s'avise
que la colonie française ressemble plus à n'importe quelle sous-préfecture de la métropole qu 'à une terre vierge.
Administration et clergé y ont introduit
depuis un demi-siècle leurs usages et leur morale : interdiction est faite désor mais aux indigè nes de vivre nus et de
pratiquer leurs cul tes ancest raux.
Les «marae », où les Maori s avaient coutume
d 'honorer leurs dieux , ont été détruit s, et Gaugu in n'a d'autre solution, pour imagi ner la Tahiti d'autrefois, que de se repor ter aux récits des voyageurs de jadis et
de visiter les rares collections ethnogra phiques.
Les tableaux de Gauguin les plus «primit ifs,, d'apparence sont de
Gauguin en Océanie,
montag e de
photographies souvenir.
pures fictions et ses sculp tures à la manière océanienne des reconstitutions
au sens archéologique du mot.
Les Marquises , après Tahiti.
Au cours de son second séjour, Tahi ti la
civilisée devient même si odieuse au pe intre que celui-ci se retire aux îles Marquises , réputées plus farouches .
À peine arrivé, il déchan te : à Atuona, où il construit sa case , est ins ta llé un vaste
couvent , et la civilisation marquisienne
s'avère non moins occidenta lisée que la tahitienne.
.,..
___ _
-.- ....
- ·-·-·--::·-
GA~~UIN~
OCÉANIE
~
____ ...
--~ -~-
•.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Paul Gauguin GAUGUIN Nevermore
- GAUGUIN, Paul : Nevermore, O. Tahiti
- THÉORIES. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique.
- PAUL GAUGUIN
- NOA-NOA de Paul Gauguin