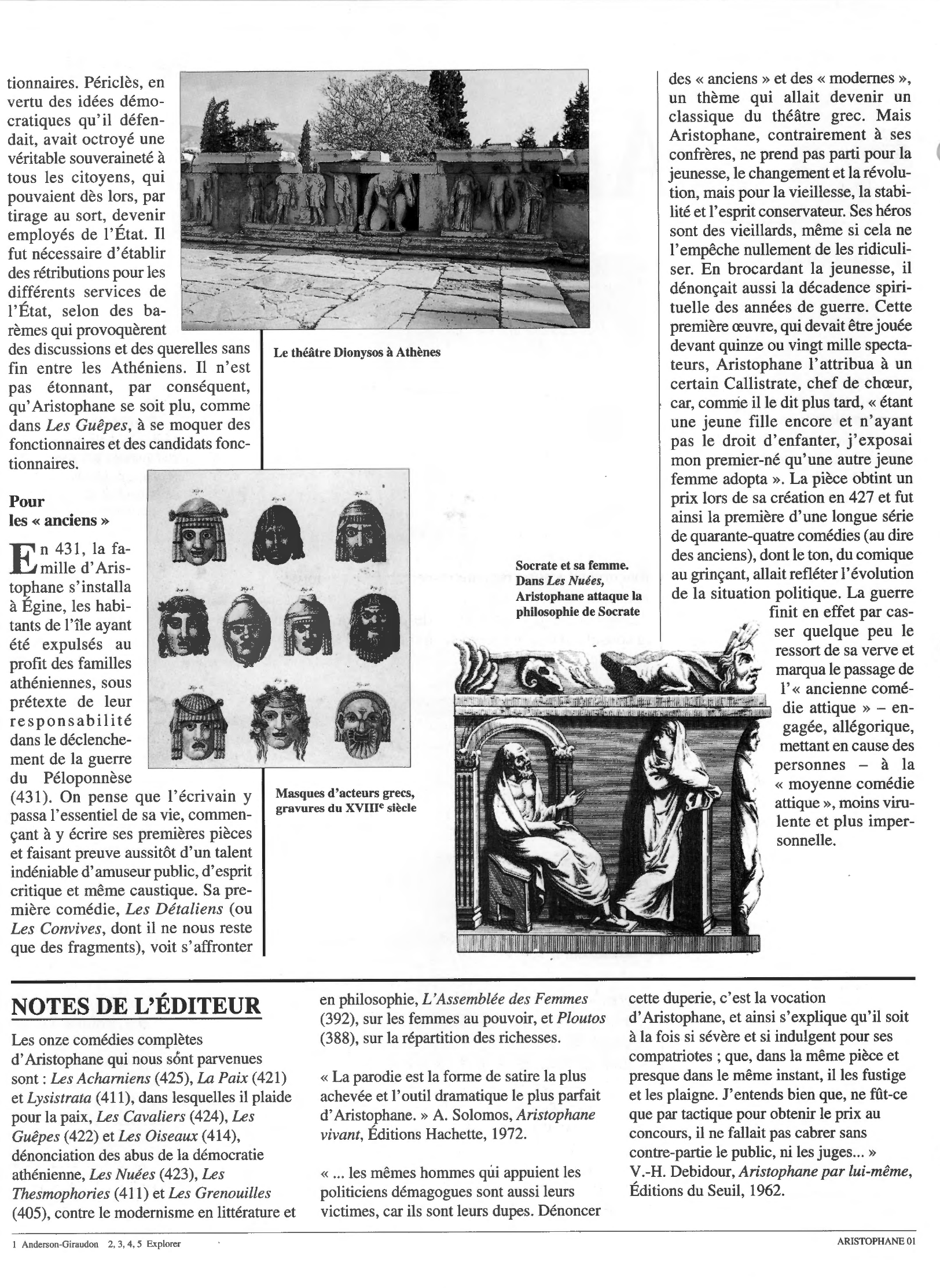ARISTOPHANE
Publié le 08/04/2013

Extrait du document
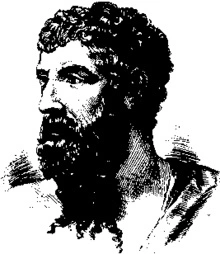
Le« siècle de Périclès«, qui marqua l'apogée d'Athènes, fut l'époque, parmi d'autres, de Phidias, d'Hérodote, d' Anaxagore, de Protagoras, de Socrate, de Sophocle et d'Euripide. Dans la Grèce ancienne, à partir du ye siècle avant J.-C., les représentations théâtrales (tragédie ou comédie) avaient lieu trois fois par année sous forme de concours : les lénéennes en janvier, les grandes dionysies en mars, les dionysies champêtres en décembre.
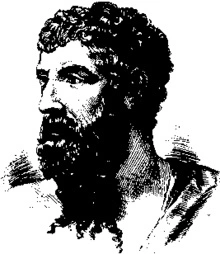
«
tionnaires.
Périclès, en
vertu des idées démo
cratiques qu 'il défen
dait , avait octroyé une
véritable souveraineté à
tous les citoyens, qui
pouvaient dès lors, par
tirage au sort, devenir
employés de l'État.
Il
fut nécessaire d'établir
des rétributions pour les
différents services de
l'État, selon des ba-
rèmes qui provoquèrent ·--- _.,_""
des discussions et des querelles sans Le théâtre Dionysos à Athènes
des« anciens» et des« modernes»,
un thème qui allait devenir un
classique du théâtre grec.
Mais
Aristophane, contrairement à ses
confrères, ne prend pas parti pour la
jeunesse, le changement et la révolu
tion, mais
pour la vieillesse, la stabi
lité
et l'esprit conservateur.
Ses héros
sont des vieillards, même si cela ne
l'empêche nullement de les ridiculi
ser.
En brocardant la jeunesse, il
dénonçait aussi la décadence spiri
tuelle des années de guerre.
Cette
première œuvre, qui devait être jouée
devant quinze ou vingt mille specta
teurs, Aristophane l'attribua à un
certain Callistrate, chef de chœur,
car, comnie il le dit plus tard, « étant
une jeune fille encore et n'ayant
pas le droit d'enfanter, j'exposai
mon premier-né qu'une autre jeune
femme adopta».
La pièce obtint un
prix lors de sa création en 427 et fut
ainsi
la première d'une longue série
de quarante-quatre comédies (au dire
des anciens) ,
dont le ton, du comique
au grinçant, allait refléter l'évolution
de la situation politique.
La guerre
fin entre les Athéniens.
Il n'est
pas étonnant, par conséquent,
qu' Aristophane se soit plu, comme
dans Les Guêpes, à se moquer des
fonctionnaires et des candidats fonc-
tionnaires.
Pour
les
« anciens »
E
n 431 , la fa
mille d' Aris
tophane s'installa
à Égine, les habi
tants de l'île ayant
été expulsés au
profit des familles
athéniennes, sous
prétexte de leur
responsabilité
dans le déclenche
ment de la guerre
du Péloponnèse
••
Socrate et sa femme.
Dans Les Nuées, Aristophane attaque la
philosophie de Socrate
(431).
On pense que }'écrivain y
passa l'essentiel de sa vie, commen
çant à y écrire ses premières pièces
et faisant preuve aussitôt d'un talent
indéniable
d'amuseur public, d'esprit
critique et même caustique.
Sa pre
mière comédie, Les Détaliens (ou
Les Convives, dont il ne nous reste
que des fragments) , voit s'affronter
Masques d'acteurs grecs,
gravures du xv111e siècle
NO TES DE L'ÉDITEUR
Les onze comédies complètes
d' Aristophane qui nous sônt parvenues
sont: Les Achamiens (425), La Paix (421)
et Lysistrata (411), dans lesquelles il plaide
pour la paix,
Les Cavaliers (424), Les
Guêpes
(422) et Les Oiseaux (414),
dénonciation des abus de la démocratie
athénienne,
Les Nuées (423), Les
Thesmophories (
411) et Les Grenouilles
( 405), contre le modernisme en littérature et
1 Anderson-Giraudon 2, 3, 4, 5 Exp lorer
en philosophie, L 'Assemblée des Femmes
(392) , sur les femmes au pouvoir, et Ploutos
(388), sur la répartition des richesses.
« La parodie est la forme de satire la plus
achevée
et l 'outil dramatique le plus parfait
d' Aristophane.
» A.
Solomos, Aristophane
vivant,
Éditions Hachette, 1972.
« ...
les mêmes hommes qui appuient les
politiciens démagogues sont aussi leurs
victimes, car ils sont leurs dupes.
Dénoncer finit
en effet par cas
ser quelque peu le
ressort de sa verve et
marqua le
passage de
l' « ancienne comé
die attique » -en
gagée, allégorique,
mettant
en cause des
personnes - à la
« moyenne comédie
attique» , moins viru
lente et plus imper
sonnelle.
cette duperie,
c'est la vocation
d'Aristophane,
et ainsi s'explique qu'il soit
à la fois si sévère et si indulgent pour ses
compatriotes ; que, dans
la même pièce et
presque dans le même instant, il les fustige
et les plaigne.
J'entends bien que, ne fût-ce
que par tactique pour obtenir le prix au
concours, il ne fallait pas cabrer sans
contre-partie le public, ni les juges ...
»
V .-H.
Debidour, Aristophane par lui-même,
Éditions du Seuil, 1962.
ARISTOPHANE 01.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le personnage de DICÉOPOLIS d'Aristophane
- ACHARNIENS (Les) (résumé & analyse) d’Aristophane
- Le personnage de STREPSIADE d’Aristophane
- Le personnage de DÊMOS d’Aristophane
- ARISTOPHANE Platon dans le Banquet