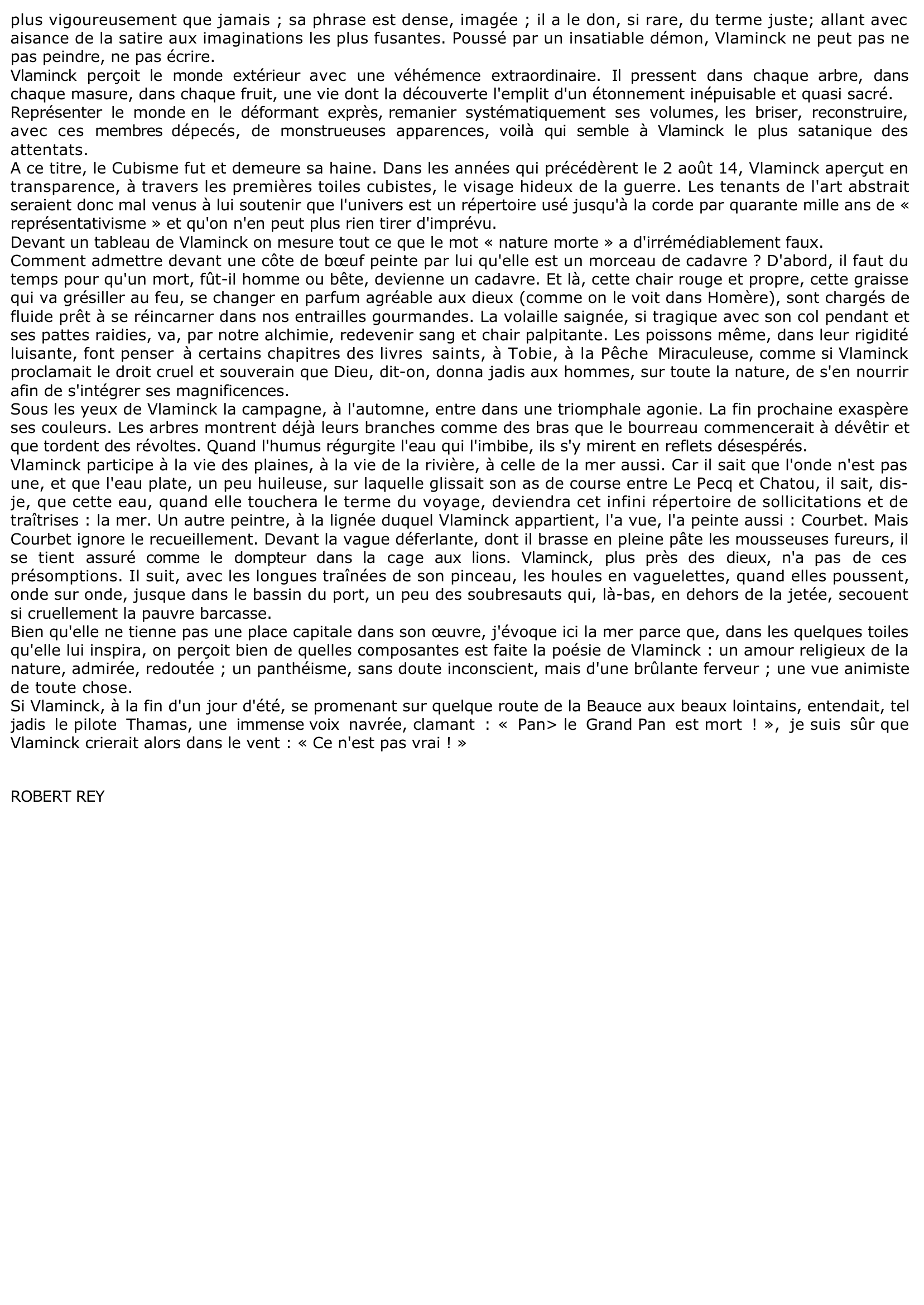Maurice de Vlaminck (Biographie)
Publié le 07/07/2011

Extrait du document

Jamais autant qu'avec Maurice de Vlaminck ne s'est affirmée l'identité d'une œuvre et de l'homme qui la créa. Le nom lui-même a la sonorité métallique du fer frappant l'enclume ; rien qu'à le prononcer, on est déjà dans les Flandres, celles des de Connink et des Philippe d'Artevelde. Vlaminck tient d'eux son besoin congénital d'indépendance. Anti-conformiste avant que de naître, il le sera bien au delà de sa mort. Au fond, ce retrait loin des conventions (fussent- elles de la vie bourgeoise ou de la bohème) n'est pas tant le fait d'un esprit agressif, que d'une instinctive pudeur. Devant certains aspects de la nature, les émois, les surprises de Vlaminck jaillissent irrésistiblement et vont se plaquer sur ses toiles. Il ne pourrait les retenir, les filtrer, les contrôler, les arranger, les «expliquer« sans qu'elles se refroidissent et n'en meurent. Elles perdraient leur éclat comme ces beaux poissons dont les irrisations s'éteignent en même temps que leur vie.

«
plus vigoureusement que jamais ; sa phrase est dense, imagée ; il a le don, si rare, du terme juste; allant avecaisance de la satire aux imaginations les plus fusantes.
Poussé par un insatiable démon, Vlaminck ne peut pas nepas peindre, ne pas écrire.Vlaminck perçoit le monde extérieur avec une véhémence extraordinaire.
Il pressent dans chaque arbre, danschaque masure, dans chaque fruit, une vie dont la découverte l'emplit d'un étonnement inépuisable et quasi sacré.Représenter le monde en le déformant exprès, remanier systématiquement ses volumes, les briser, reconstruire,avec ces membres dépecés, de monstrueuses apparences, voilà qui semble à Vlaminck le plus satanique desattentats.A ce titre, le Cubisme fut et demeure sa haine.
Dans les années qui précédèrent le 2 août 14, Vlaminck aperçut entransparence, à travers les premières toiles cubistes, le visage hideux de la guerre.
Les tenants de l'art abstraitseraient donc mal venus à lui soutenir que l'univers est un répertoire usé jusqu'à la corde par quarante mille ans de «représentativisme » et qu'on n'en peut plus rien tirer d'imprévu.Devant un tableau de Vlaminck on mesure tout ce que le mot « nature morte » a d'irrémédiablement faux.Comment admettre devant une côte de bœuf peinte par lui qu'elle est un morceau de cadavre ? D'abord, il faut dutemps pour qu'un mort, fût-il homme ou bête, devienne un cadavre.
Et là, cette chair rouge et propre, cette graissequi va grésiller au feu, se changer en parfum agréable aux dieux (comme on le voit dans Homère), sont chargés defluide prêt à se réincarner dans nos entrailles gourmandes.
La volaille saignée, si tragique avec son col pendant etses pattes raidies, va, par notre alchimie, redevenir sang et chair palpitante.
Les poissons même, dans leur rigiditéluisante, font penser à certains chapitres des livres saints, à Tobie, à la Pêche Miraculeuse, comme si Vlaminckproclamait le droit cruel et souverain que Dieu, dit-on, donna jadis aux hommes, sur toute la nature, de s'en nourrirafin de s'intégrer ses magnificences.Sous les yeux de Vlaminck la campagne, à l'automne, entre dans une triomphale agonie.
La fin prochaine exaspèreses couleurs.
Les arbres montrent déjà leurs branches comme des bras que le bourreau commencerait à dévêtir etque tordent des révoltes.
Quand l'humus régurgite l'eau qui l'imbibe, ils s'y mirent en reflets désespérés.Vlaminck participe à la vie des plaines, à la vie de la rivière, à celle de la mer aussi.
Car il sait que l'onde n'est pasune, et que l'eau plate, un peu huileuse, sur laquelle glissait son as de course entre Le Pecq et Chatou, il sait, dis-je, que cette eau, quand elle touchera le terme du voyage, deviendra cet infini répertoire de sollicitations et detraîtrises : la mer.
Un autre peintre, à la lignée duquel Vlaminck appartient, l'a vue, l'a peinte aussi : Courbet.
MaisCourbet ignore le recueillement.
Devant la vague déferlante, dont il brasse en pleine pâte les mousseuses fureurs, ilse tient assuré comme le dompteur dans la cage aux lions.
Vlaminck, plus près des dieux, n'a pas de cesprésomptions.
Il suit, avec les longues traînées de son pinceau, les houles en vaguelettes, quand elles poussent,onde sur onde, jusque dans le bassin du port, un peu des soubresauts qui, là-bas, en dehors de la jetée, secouentsi cruellement la pauvre barcasse.Bien qu'elle ne tienne pas une place capitale dans son œuvre, j'évoque ici la mer parce que, dans les quelques toilesqu'elle lui inspira, on perçoit bien de quelles composantes est faite la poésie de Vlaminck : un amour religieux de lanature, admirée, redoutée ; un panthéisme, sans doute inconscient, mais d'une brûlante ferveur ; une vue animistede toute chose.Si Vlaminck, à la fin d'un jour d'été, se promenant sur quelque route de la Beauce aux beaux lointains, entendait, teljadis le pilote Thamas, une immense voix navrée, clamant : « Pan> le Grand Pan est mort ! », je suis sûr queVlaminck crierait alors dans le vent : « Ce n'est pas vrai ! »
ROBERT REY.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Biographie Maurice Genevoix
- Maurice de VLAMINCK : LA PÉRISSOIRE À CHATOU
- Maurice de VLAMINCK : LA SEINE A CHATOU
- Maurice de VLAMINCK : LES RAMASSEURS DE POMMES DE TERRE
- Maurice de VLAMINCK : LE PONT DE CHATOU