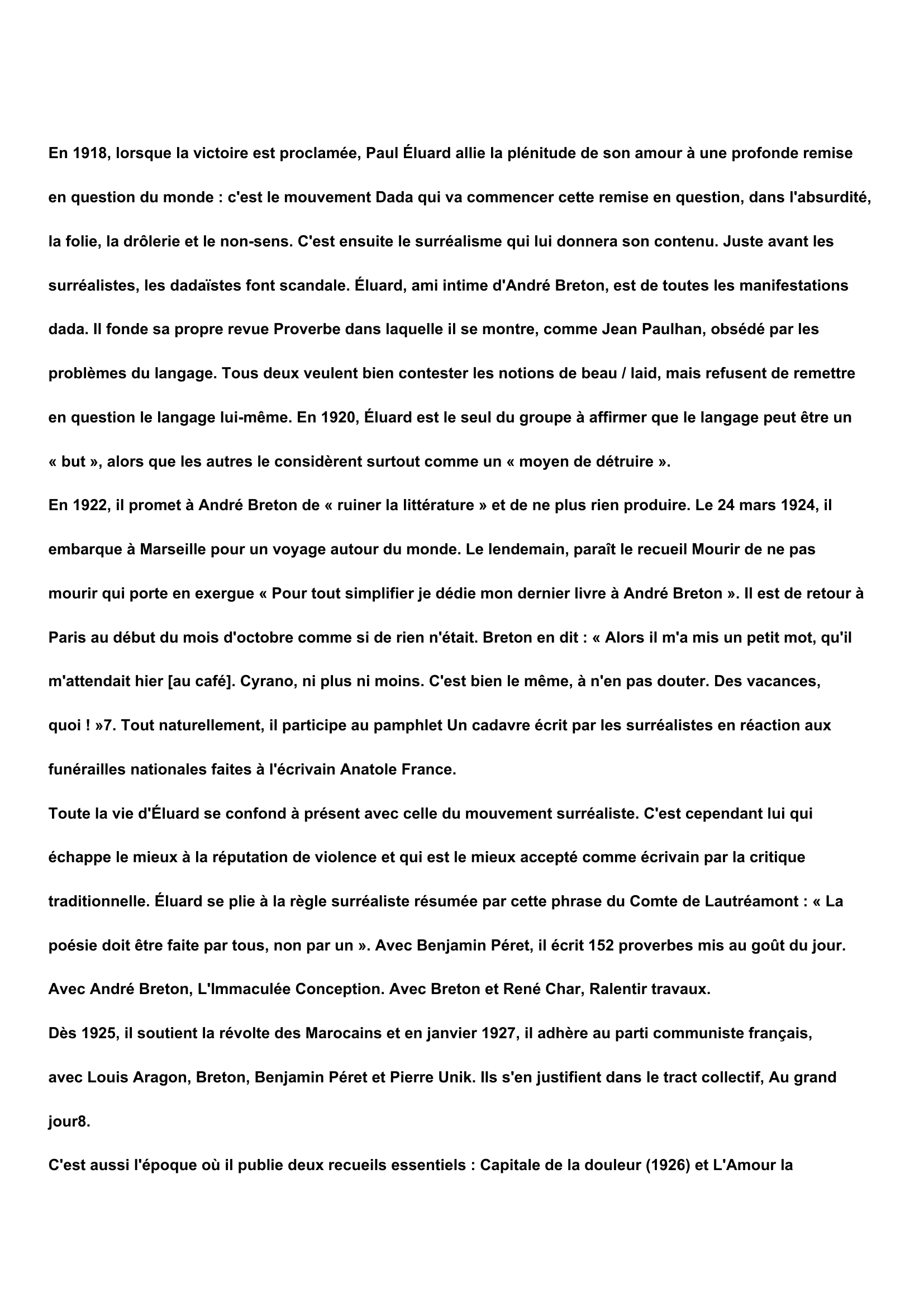Paul Eluard
Publié le 02/04/2014

Extrait du document
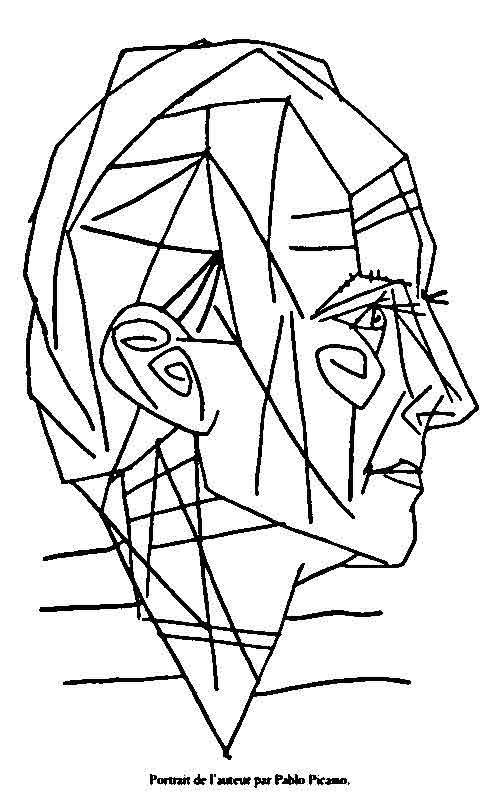
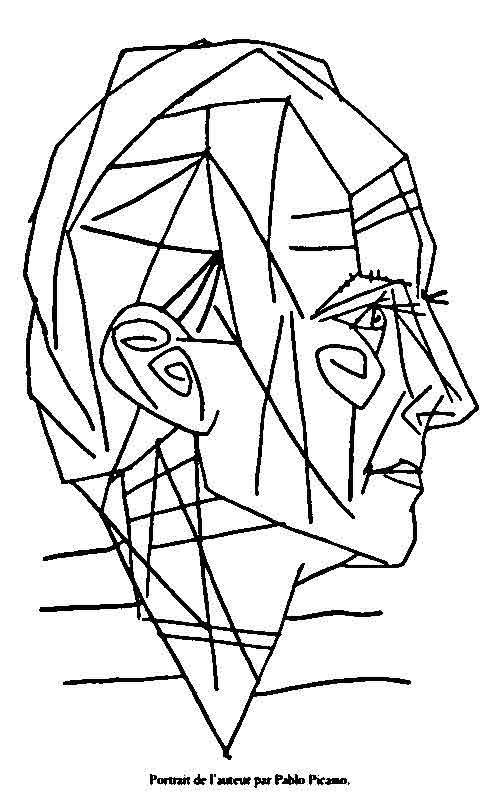
«
En 1918, lorsque la victoire est proclamée, Paul Éluard allie la plénitude de son amour à une profonde remise
en question du monde : c'est le mouvement Dada qui va commencer cette remise en question, dans l'absurdité,
la folie, la drôlerie et le non-sens.
C'est ensuite le surréalisme qui lui donnera son contenu.
Juste avant les
surréalistes, les dadaïstes font scandale.
Éluard, ami intime d'André Breton, est de toutes les manifestations
dada.
Il fonde sa propre revue Proverbe dans laquelle il se montre, comme Jean Paulhan, obsédé par les
problèmes du langage.
Tous deux veulent bien contester les notions de beau / laid, mais refusent de remettre
en question le langage lui-même.
En 1920, Éluard est le seul du groupe à affirmer que le langage peut être un
« but », alors que les autres le considèrent surtout comme un « moyen de détruire ».
En 1922, il promet à André Breton de « ruiner la littérature » et de ne plus rien produire.
Le 24 mars 1924, il
embarque à Marseille pour un voyage autour du monde.
Le lendemain, paraît le recueil Mourir de ne pas
mourir qui porte en exergue « Pour tout simplifier je dédie mon dernier livre à André Breton ».
Il est de retour à
Paris au début du mois d'octobre comme si de rien n'était.
Breton en dit : « Alors il m'a mis un petit mot, qu'il
m'attendait hier [au café].
Cyrano, ni plus ni moins.
C'est bien le même, à n'en pas douter.
Des vacances,
quoi ! »7.
Tout naturellement, il participe au pamphlet Un cadavre écrit par les surréalistes en réaction aux
funérailles nationales faites à l'écrivain Anatole France.
Toute la vie d'Éluard se confond à présent avec celle du mouvement surréaliste.
C'est cependant lui qui
échappe le mieux à la réputation de violence et qui est le mieux accepté comme écrivain par la critique
traditionnelle.
Éluard se plie à la règle surréaliste résumée par cette phrase du Comte de Lautréamont : « La
poésie doit être faite par tous, non par un ».
Avec Benjamin Péret, il écrit 152 proverbes mis au goût du jour.
Avec André Breton, L'Immaculée Conception.
Avec Breton et René Char, Ralentir travaux.
Dès 1925, il soutient la révolte des Marocains et en janvier 1927, il adhère au parti communiste français,
avec Louis Aragon, Breton, Benjamin Péret et Pierre Unik.
Ils s'en justifient dans le tract collectif, Au grand
jour8.
C'est aussi l'époque où il publie deux recueils essentiels : Capitale de la douleur (1926) et L'Amour la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la courbe de tes yeux de paul eluard
- PAUL ELUARD
- Dictionnaire abrégé du surréalisme, d'André Breton et Paul Eluard
- DERNIERS POÈMES D'AMOUR. (résumé & analyse) Paul Eluard
- Commentaire composé Le plus jeune Paul Eluard