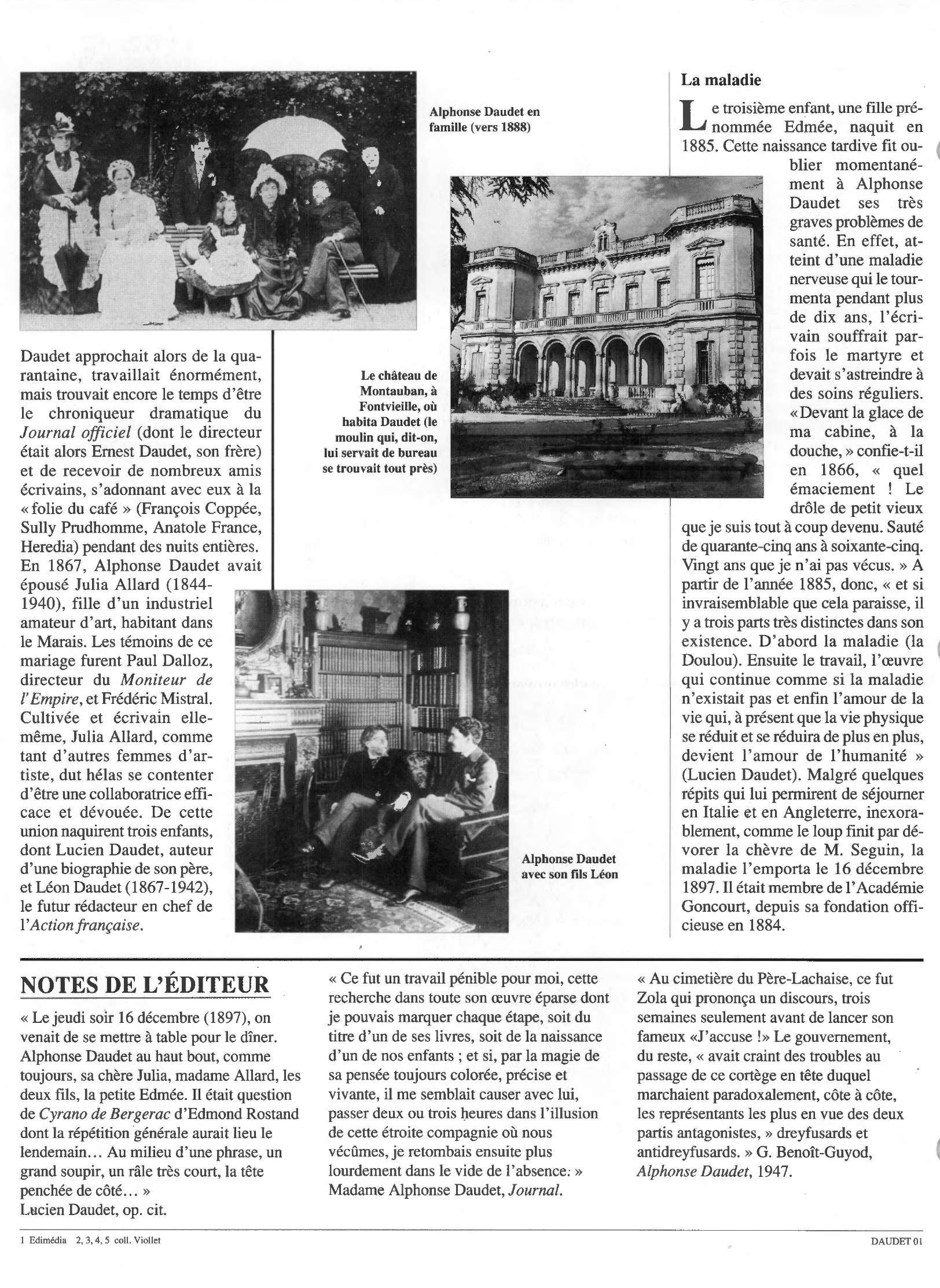Vie d'Alphonse Daudet
Publié le 08/04/2013

Extrait du document
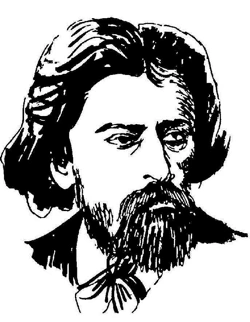
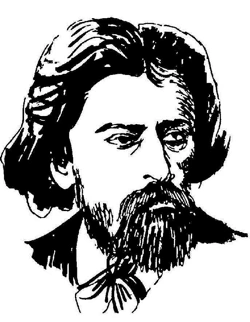
«
Daudet approchait alors de la qua
rantaine, travaillait énormément,
mais trouvait encore le temps d'être
le chroniqueur dramatique du
Journal officiel (dont le directeur
était alors Ernest Daudet, son frère)
et de recevoir de nombreux amis
écrivains, s'adonnant avec eux à la
« folie du café » (François Coppée,
Sully Prudhomme, Anatole France,
Heredia) pendant des nuits entières.
En 1867, Alphonse Daudet avait
épousé Julia Allard (1844-
1940), fille d'un industriel
amateur d'art, habitant dans
le Marais.
Les témoins de
ce
mariage furent Paul Dalloz,
directeur du Moniteur de
l'Empire,
et Frédéric Mistral.
Cultivée et écrivain elle
même, Julia Allard, comme
tant d'autres femmes d'ar
tiste, dut hélas se contenter
d'être une collaboratrice effi
cace et dévouée.
De cette
union naquirent trois enfants,
dont Lucien Daudet, auteur
d'une biographie de son père,
et Léon Daudet (1867-1942),
le futur rédacteur
en chef de
l'Action française.
NOTES DE L'ÉDITEUR
«Le jeudi soir 16 décembre (1897), on
venait de se mettre
à table pour le dîner.
Alphonse Daudet au haut bout, comme
toujours, sa chère Julia, madame Allard, les
deux fils, la petite Edmée.
Il était question
de
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand
dont la répétition générale aurait lieu le
lendemain
...
Au milieu d'une phrase, un
grand soupir, un râle très court, la tête
penchée de côté.
.
.
»
LNcien
Daudet, op.
cit.
1 Edimédia 2, 3, 4, 5 coll.
Viollet
Alphonse Daudet en
famille (vers 1888)
Le château de
Montauban,
à Fontvieille, où
habita Daudet (le
moulin qui, dit-on,
lui servait de bureau
se trouvait tout près)
Alphonse Daudet
avec son fils Léon
« Ce fut un travail pénible pour moi, cette
recherche dans toute son œuvre éparse dont
je pouvais marquer chaque étape, soit du
titre
d'un de ses livres, soit de la naissance
d'un de nos enfants; et si, par la magie de
sa pensée toujours colorée, précise et
vivante, il me semblait causer avec lui,
passer deux ou trois
J:ieures dans l'illusion
de cette étroite compagnie où nous
vécûmes,
je retombais ensuite plus
lourdement dans le vide de
l'absence;»
Madame Alphonse Daudet, Journal.
La maladie
L
e troisième enfant, une fille pré
nommée Edmée, naquit en
1885.
Cette naissance tardive fit ou-
blier momentané
ment à Alphonse
Daudet ses très
graves problèmes de
santé.
En effet, at
teint
d'une maladie
nerveuse qui le tour
menta pendant plus
de dix ans, !'écri
vain souffrait par
fois le martyre et
devait s'astreindre à
des soins réguliers.
«Devant la glace de
ma cabine, à la
douche,» confie-t-il
en 1866, « quel
émaciement ! Le
drôle de petit vieux
que je suis tout à coup devenu.
Sauté
de quarante-cinq ans à soixante-cinq.
Vingt ans que
je n'ai pas vécus.
»A
partir de l'année 1885, donc, « et si
invraisemblable que cela paraisse, il
y
a trois parts très distinctes dans son
existence.
D'abord la maladie (la
Doulou).
Ensuite le travail, l'œuvre
qui continue comme si la maladie
n'existait pas et enfin l'amour de la
vie qui, à présent que la vie physique
se réduit et se réduira de plus
en plus,
devient l'amour de l'humanité »
(Lucien Daudet).
Malgré quelques
répits qui lui permirent de séjourner
en Italie €t en Angleterre, inexora
blement,
comme le loup finit par dé
vorer la chèvre de M.
Seguin, la
maladie l'emporta le 16 décembre
1897.
Il était membre de l'Académie
Goncourt, depuis sa fondation offi
cieuse
en 1884.
«Au cimetière du Père-Lachaise, ce fut
Zola qui prononça un discours, trois
semaines seulement avant de lancer son
fameux
«J'accuse!» Le gouvernement,
du reste,
« avait craint des troubles au
passage de ce cortège en tête duquel
marchaient paradoxalement, côte à côte,
les représentants les plus en vue des deux
partis antagonistes,
» dreyfusards et
antidreyfusards.
» G.
Benoît-Guyod,
Alphonse Daudet, 1947.
DAUDETOI.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DAUDET Alphonse : sa vie et son oeuvre
- ALPHONSE DAUDET (1840-1897). Vie et oeuvre
- Vie d'Alphonse Daudet
- Numa ROUMESTAN d'Alphonse Daudet (analyse détaillée)
- PETIT Chose (le), d'Alphonse Daudet