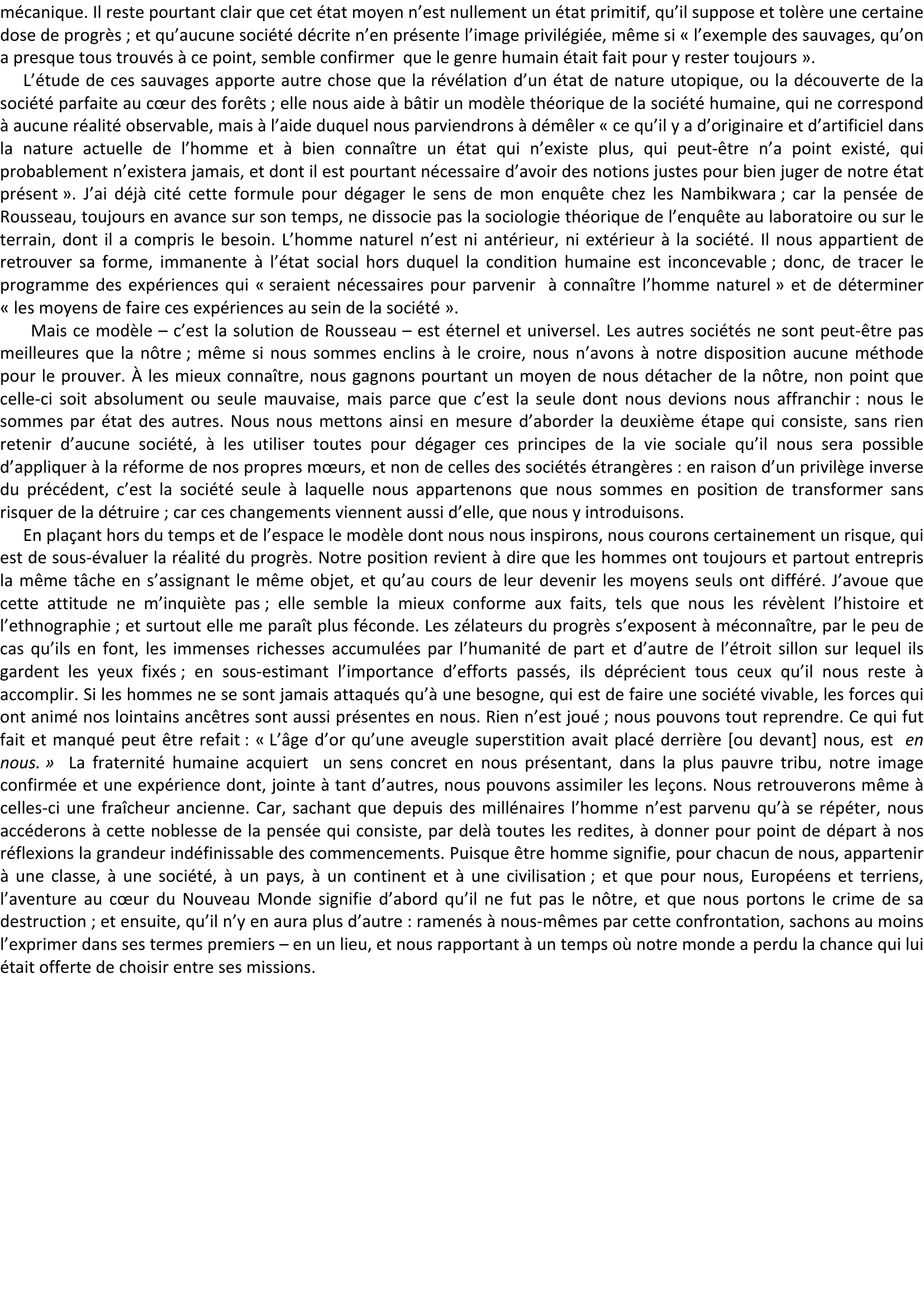Aztèques, plaie ouverte au flanc de l'américanisme, qu'une obsession maniaque
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
mécanique.
Ilreste pourtant clairquecetétat moyen n’estnullement unétat primitif, qu’ilsuppose ettolère unecertaine
dose deprogrès ; etqu’aucune sociétédécriten’enprésente l’imageprivilégiée, mêmesi« l’exemple dessauvages, qu’on
a presque toustrouvés àce point, semble confirmer quelegenre humain étaitfaitpour yrester toujours ».
L’étude deces sauvages apporteautrechose quelarévélation d’unétatdenature utopique, ouladécouverte dela
société parfaite aucœur desforêts ; ellenous aideàbâtir unmodèle théorique delasociété humaine, quinecorrespond
à aucune réalitéobservable, maisàl’aide duquel nousparviendrons àdémêler « cequ’il ya d’originaire etd’artificiel dans
la nature actuelle del’homme etàbien connaître unétat quin’existe plus,quipeut-être n’apoint existé, qui
probablement n’existerajamais,etdont ilest pourtant nécessaire d’avoirdesnotions justespourbienjuger denotre état
présent ».
J’aidéjà citécette formule pourdégager lesens demon enquête chezlesNambikwara ; carlapensée de
Rousseau, toujoursenavance surson temps, nedissocie paslasociologie théoriquedel’enquête aulaboratoire ousur le
terrain, dontila compris lebesoin.
L’homme natureln’estniantérieur, niextérieur àla société.
Ilnous appartient de
retrouver saforme, immanente àl’état social horsduquel lacondition humaineestinconcevable ; donc,detracer le
programme desexpériences qui« seraient nécessaires pourparvenir àconnaître l’hommenaturel » etde déterminer
« les moyens defaire cesexpériences ausein delasociété ».
Mais cemodèle –c’est lasolution deRousseau –est éternel etuniversel.
Lesautres sociétés nesont peut-être pas
meilleures quelanôtre ; mêmesinous sommes enclinsàle croire, nousn’avons ànotre disposition aucuneméthode
pour leprouver.
Àles mieux connaître, nousgagnons pourtant unmoyen denous détacher delanôtre, nonpoint que
celle-ci soitabsolument ouseule mauvaise, maisparce quec’est laseule dontnous devions nousaffranchir : nousle
sommes parétat desautres.
Nousnousmettons ainsienmesure d’aborder ladeuxième étapequiconsiste, sansrien
retenir d’aucune société,àles utiliser toutespourdégager cesprincipes delavie sociale qu’ilnous serapossible
d’appliquer àla réforme denos propres mœurs,etnon decelles dessociétés étrangères : enraison d’unprivilège inverse
du précédent, c’estlasociété seuleàlaquelle nousappartenons quenous sommes enposition detransformer sans
risquer deladétruire ; carces changements viennentaussid’elle, quenous yintroduisons.
En plaçant horsdutemps etde l’espace lemodèle dontnous nousinspirons, nouscourons certainement unrisque, qui
est desous-évaluer laréalité duprogrès.
Notreposition revientàdire queleshommes onttoujours etpartout entrepris
la même tâcheens’assignant lemême objet,etqu’au coursdeleur devenir lesmoyens seulsontdifféré.
J’avoue que
cette attitude nem’inquiète pas ;ellesemble lamieux conforme auxfaits, telsque nous lesrévèlent l’histoire et
l’ethnographie ; etsurtout ellemeparaît plusféconde.
Leszélateurs duprogrès s’exposent àméconnaître, parlepeu de
cas qu’ils enfont, lesimmenses richessesaccumulées parl’humanité depart etd’autre del’étroit sillonsurlequel ils
gardent lesyeux fixés ; ensous-estimant l’importanced’effortspassés,ilsdéprécient tousceux qu’ilnous reste à
accomplir.
Siles hommes nesesont jamais attaqués qu’àunebesogne, quiestdefaire unesociété vivable, lesforces qui
ont animé noslointains ancêtres sontaussi présentes ennous.
Rienn’est joué ; nouspouvons toutreprendre.
Cequi fut
fait etmanqué peutêtrerefait : « L’âge d’orqu’une aveugle superstition avaitplacé derrière [oudevant] nous,est en
nous. » La
fraternité humaineacquiert unsens concret ennous présentant, danslaplus pauvre tribu,notre image
confirmée etune expérience dont,jointe àtant d’autres, nouspouvons assimiler lesleçons.
Nousretrouverons mêmeà
celles-ci unefraîcheur ancienne.
Car,sachant quedepuis desmillénaires l’hommen’estparvenu qu’àserépéter, nous
accéderons àcette noblesse delapensée quiconsiste, pardelà toutes lesredites, àdonner pourpoint dedépart ànos
réflexions lagrandeur indéfinissable descommencements.
Puisqueêtrehomme signifie,pourchacun denous, appartenir
à une classe, àune société, àun pays, àun continent etàune civilisation ; etque pour nous, Européens etterriens,
l’aventure aucœur duNouveau Mondesignified’abord qu’ilnefut pas lenôtre, etque nous portons lecrime desa
destruction ; etensuite, qu’iln’yenaura plusd’autre : ramenés ànous-mêmes parcette confrontation, sachonsaumoins
l’exprimer danssestermes premiers –en un lieu, etnous rapportant àun temps oùnotre monde aperdu lachance quilui
était offerte dechoisir entresesmissions..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Prénom : Cycle 3 Savoir comment lutter contre les microbes Date : plaie sol de maison matériel de chirurgien mains aliment b.
- grotesque grotesque, style aérien et plein de fantaisie développé par Raphaël et ses élèves après que l'on eut redécouvert au XVIe siècle les peintures murales de la Domus Aurea de Néron dans les « grottes » du flanc méridional de l'Esquilin à Rome.
- Propylées Propylées, entrée principale et monumentale de l'Acropole d'Athènes, ouverte sur le flanc ouest fortifié du promontoire sacré.
- Michel Strogoff Un des chevaux de flanc du tarentass fut attelé à l'aide de cordes à la caisse de la télègue.
- plaie.