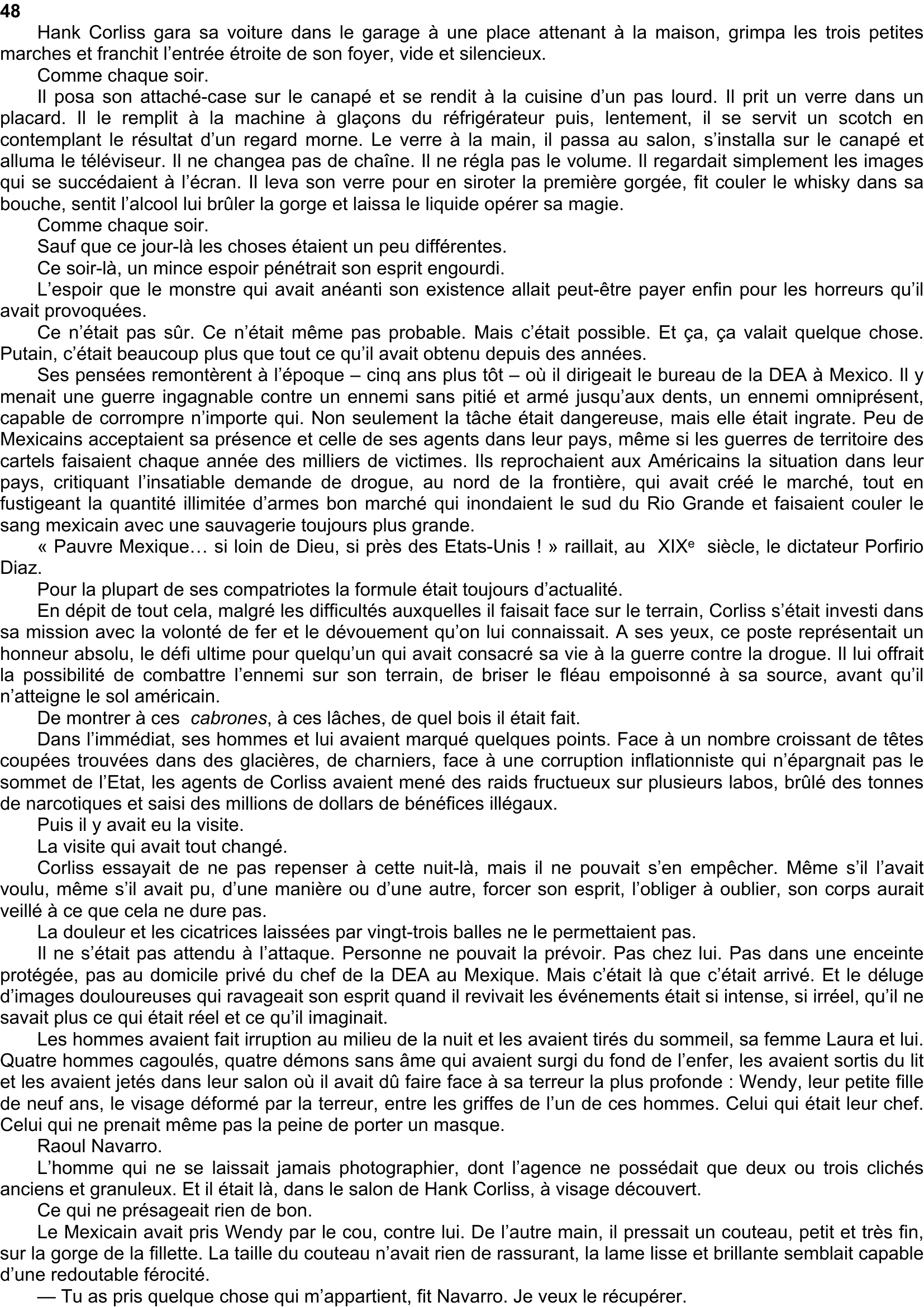-- D'accord... fit-elle d'un ton las.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
48
Hank
Corliss garasavoiture danslegarage àune place attenant àla maison, grimpalestrois petites
marches etfranchit l’entrée étroitedeson foyer, videetsilencieux.
Comme chaquesoir.
Il posa sonattaché-case surlecanapé etse rendit àla cuisine d’unpaslourd.
Ilprit unverre dansun
placard.
Ille remplit àla machine àglaçons duréfrigérateur puis,lentement, ilse servit unscotch en
contemplant lerésultat d’unregard morne.
Leverre àla main, ilpassa ausalon, s’installa surlecanapé et
alluma letéléviseur.
Ilne changea pasdechaîne.
Ilne régla paslevolume.
Ilregardait simplement lesimages
qui sesuccédaient àl’écran.
Illeva sonverre pourensiroter lapremière gorgée,fitcouler lewhisky danssa
bouche, sentitl’alcool luibrûler lagorge etlaissa leliquide opérersamagie.
Comme chaquesoir.
Sauf quecejour-là leschoses étaientunpeu différentes.
Ce soir-là, unmince espoir pénétrait sonesprit engourdi.
L’espoir quelemonstre quiavait anéanti sonexistence allaitpeut-être payerenfinpourleshorreurs qu’il
avait provoquées.
Ce n’était passûr.
Cen’était même pasprobable.
Maisc’était possible.
Etça, çavalait quelque chose.
Putain, c’étaitbeaucoup plusquetoutcequ’il avait obtenu depuisdesannées.
Ses pensées remontèrent àl’époque –cinq ansplus tôt–où ildirigeait lebureau delaDEA àMexico.
Ily
menait uneguerre ingagnable contreunennemi sanspitiéetarmé jusqu’aux dents,unennemi omniprésent,
capable decorrompre n’importequi.Non seulement latâche étaitdangereuse, maiselleétait ingrate.
Peude
Mexicains acceptaient saprésence etcelle deses agents dansleurpays, même siles guerres deterritoire des
cartels faisaient chaqueannéedesmilliers devictimes.
Ilsreprochaient auxAméricains lasituation dansleur
pays, critiquant l’insatiable demandededrogue, aunord delafrontière, quiavait créélemarché, touten
fustigeant laquantité illimitéed’armes bonmarché quiinondaient lesud duRio Grande etfaisaient coulerle
sang mexicain avecunesauvagerie toujoursplusgrande.
« Pauvre Mexique… siloin deDieu, siprès desEtats-Unis !» raillait, auXIXe
siècle, ledictateur Porfirio
Diaz.
Pour laplupart deses compatriotes laformule étaittoujours d’actualité.
En dépit detout cela, malgré lesdifficultés auxquelles ilfaisait facesurleterrain, Corlisss’étaitinvesti dans
sa mission aveclavolonté defer etledévouement qu’onluiconnaissait.
Ases yeux, ceposte représentait un
honneur absolu,ledéfi ultime pourquelqu’un quiavait consacré savie àla guerre contreladrogue.
Illui offrait
la possibilité decombattre l’ennemisurson terrain, debriser lefléau empoisonné àsa source, avantqu’il
n’atteigne lesol américain.
De montrer àces cabrones ,
à ces lâches, dequel boisilétait fait.
Dans l’immédiat, seshommes etlui avaient marqué quelques points.Faceàun nombre croissant detêtes
coupées trouvées dansdesglacières, decharniers, faceàune corruption inflationniste quin’épargnait pasle
sommet del’Etat, lesagents deCorliss avaient menédesraids fructueux surplusieurs labos,brûlédestonnes
de narcotiques etsaisi desmillions dedollars debénéfices illégaux.
Puis ily avait eulavisite.
La visite quiavait toutchangé.
Corliss essayait denepas repenser àcette nuit-là, maisilne pouvait s’enempêcher.
Mêmes’ill’avait
voulu, même s’ilavait pu,d’une manière oud’une autre, forcersonesprit, l’obliger àoublier, soncorps aurait
veillé àce que cela nedure pas.
La douleur etles cicatrices laisséesparvingt-trois ballesnelepermettaient pas.
Il ne s’était pasattendu àl’attaque.
Personne nepouvait laprévoir.
Paschez lui.Pas dans uneenceinte
protégée, pasaudomicile privéduchef delaDEA auMexique.
Maisc’était làque c’était arrivé.
Etledéluge
d’images douloureuses quiravageait sonesprit quand ilrevivait lesévénements étaitsiintense, siirréel, qu’ilne
savait pluscequi était réeletce qu’il imaginait.
Les hommes avaientfaitirruption aumilieu delanuit etles avaient tirésdusommeil, safemme Lauraetlui.
Quatre hommes cagoulés, quatredémons sansâmequiavaient surgidufond del’enfer, lesavaient sortisdulit
et les avaient jetésdans leursalon oùilavait dûfaire faceàsa terreur laplus profonde :Wendy, leurpetite fille
de neuf ans,levisage déformé parlaterreur, entrelesgriffes del’un deces hommes.
Celuiquiétait leurchef.
Celui quineprenait mêmepaslapeine deporter unmasque.
Raoul Navarro.
L’homme quineselaissait jamaisphotographier, dontl’agence nepossédait quedeux outrois clichés
anciens etgranuleux.
Etilétait là,dans lesalon deHank Corliss, àvisage découvert.
Ce qui neprésageait riendebon.
Le Mexicain avaitprisWendy parlecou, contre lui.Del’autre main,ilpressait uncouteau, petitettrès fin,
sur lagorge delafillette.
Lataille ducouteau n’avaitrienderassurant, lalame lisseetbrillante semblait capable
d’une redoutable férocité.
— Tu aspris quelque chosequim’appartient, fitNavarro.
Jeveux lerécupérer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Prima digestio fit in ore
- FRANÇAIS 3 groupes de verbes Accord des adjectifs de couleur Accord du participe passé.
- ACC ASV D ENU FA HG INU MMC MT NG OP OU P PF PHC PHI PP PPS REP VI VMC VPP Page 3 Faute d'accent Page 4 Accord sujet / verbe Page 6 Dialogue Page 6 Enumération Page 3 Faute
- ACCORD DU LIBRE ARBITRE AVEC LE DON DE LA GRÂCE, LA PRESCIENCE DIVINE, LA PROVIDENCE, LA PRÉDESTINATION ET LA RÉPROBATION,Luis Molina (résumé)
- (résumé & analyse) ACCORD DU LIBRE ARBITRE AVEC LES DONS DE LA GRACE, LA DIVINE PRESCIENCE, LA PROVIDENCE ET LA RÉPROBATION