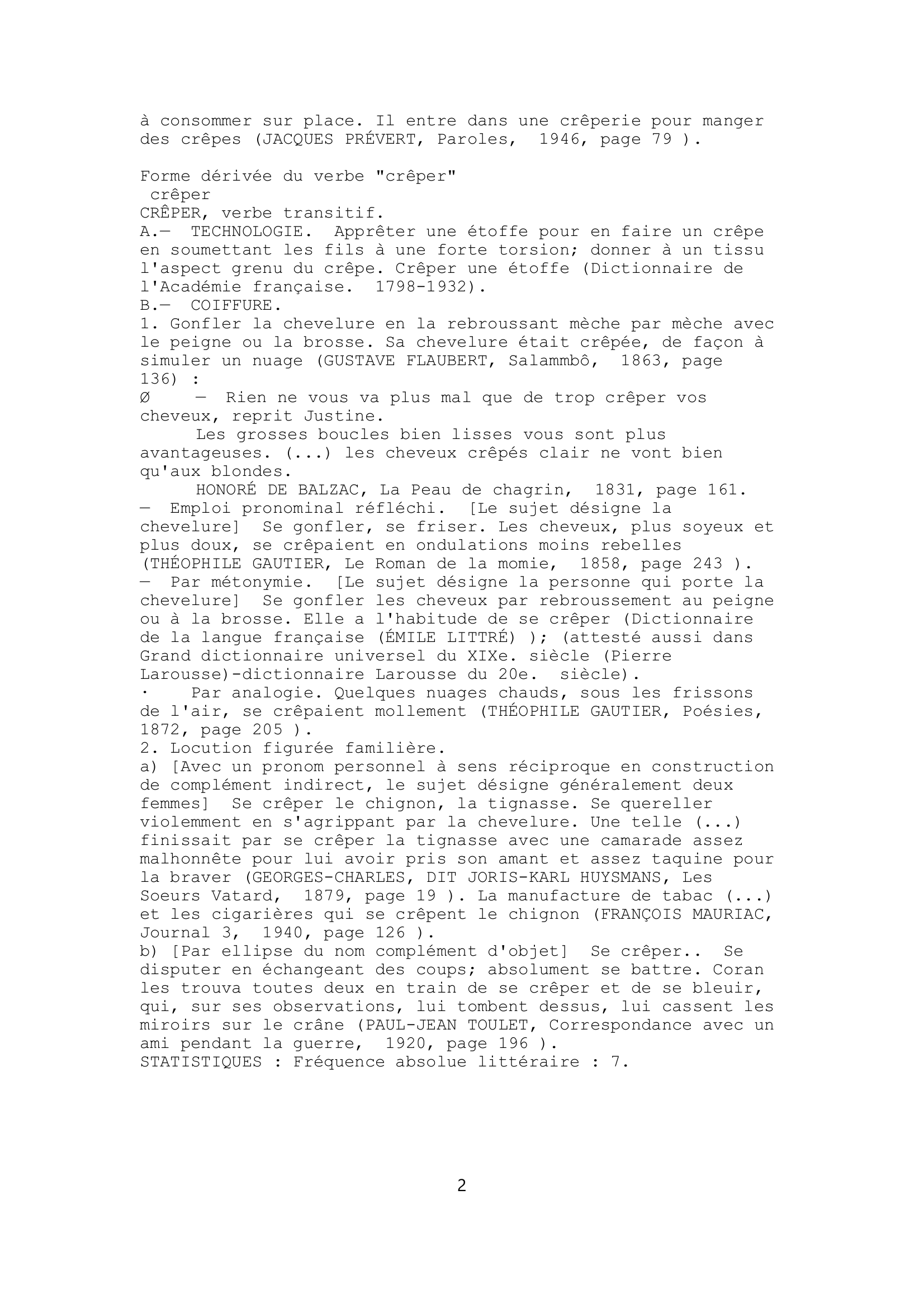Définition du terme: CRÊPE2, substantif féminin.
Publié le 04/12/2015

Extrait du document
«
à consommer sur place.
Il entre dans une crêperie pour manger
des crêpes (JACQUES PRÉVERT, Paroles, 1946, page 79 ).
Forme dérivée du verbe "crêper"
crêper
CRÊPER, verbe transitif.
A.— TECHNOLOGIE.
Apprêter une étoffe pour en faire un crêpe
en soumettant les fils à une forte torsion; donner à un tissu
l'aspect grenu du crêpe.
Crêper une étoffe (Dictionnaire de
l'Académie française.
1798-1932).
B.— COIFFURE.
1.
Gonfler la chevelure en la rebroussant mèche par mèche avec
le peigne ou la brosse.
Sa chevelure était crêpée, de façon à
simuler un nuage (GUSTAVE FLAUBERT, Salammbô, 1863, page
136) :
Ø — Rien ne vous va plus mal que de trop crêper vos
cheveux, reprit Justine.
Les grosses boucles bien lisses vous sont plus
avantageuses.
(...) les cheveux crêpés clair ne vont bien
qu'aux blondes.
HONORÉ DE BALZAC, La Peau de chagrin, 1831, page 161.
— Emploi pronominal réfléchi.
[Le sujet désigne la
chevelure] Se gonfler, se friser.
Les cheveux, plus soyeux et
plus doux, se crêpaient en ondulations moins rebelles
(THÉOPHILE GAUTIER, Le Roman de la momie, 1858, page 243 ).
— Par métonymie.
[Le sujet désigne la personne qui porte la
chevelure] Se gonfler les cheveux par rebroussement au peigne
ou à la brosse.
Elle a l'habitude de se crêper (Dictionnaire
de la langue française (ÉMILE LITTRÉ) ); (attesté aussi dans
Grand dictionnaire universel du XIXe.
siècle (Pierre
Larousse)-dictionnaire Larousse du 20e.
siècle).
· Par analogie.
Quelques nuages chauds, sous les frissons
de l'air, se crêpaient mollement (THÉOPHILE GAUTIER, Poésies,
1872, page 205 ).
2.
Locution figurée familière.
a) [Avec un pronom personnel à sens réciproque en construction
de complément indirect, le sujet désigne généralement deux
femmes] Se crêper le chignon, la tignasse.
Se quereller
violemment en s'agrippant par la chevelure.
Une telle (...)
finissait par se crêper la tignasse avec une camarade assez
malhonnête pour lui avoir pris son amant et assez taquine pour
la braver (GEORGES-CHARLES, DIT JORIS-KARL HUYSMANS, Les
Soeurs Vatard, 1879, page 19 ).
La manufacture de tabac (...)
et les cigarières qui se crêpent le chignon (FRANÇOIS MAURIAC,
Journal 3, 1940, page 126 ).
b) [Par ellipse du nom complément d'objet] Se crêper..
Se
disputer en échangeant des coups; absolument se battre.
Coran
les trouva toutes deux en train de se crêper et de se bleuir,
qui, sur ses observations, lui tombent dessus, lui cassent les
miroirs sur le crâne (PAUL-JEAN TOULET, Correspondance avec un
ami pendant la guerre, 1920, page 196 ).
STATISTIQUES : Fréquence absolue littéraire : 7.
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition du terme: CYPRINE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYPRIÈRE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYPRÉE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYNTHIE, CYNTHIA, substantif féminin.
- Définition du terme: CYNOGLOSSE, substantif féminin.