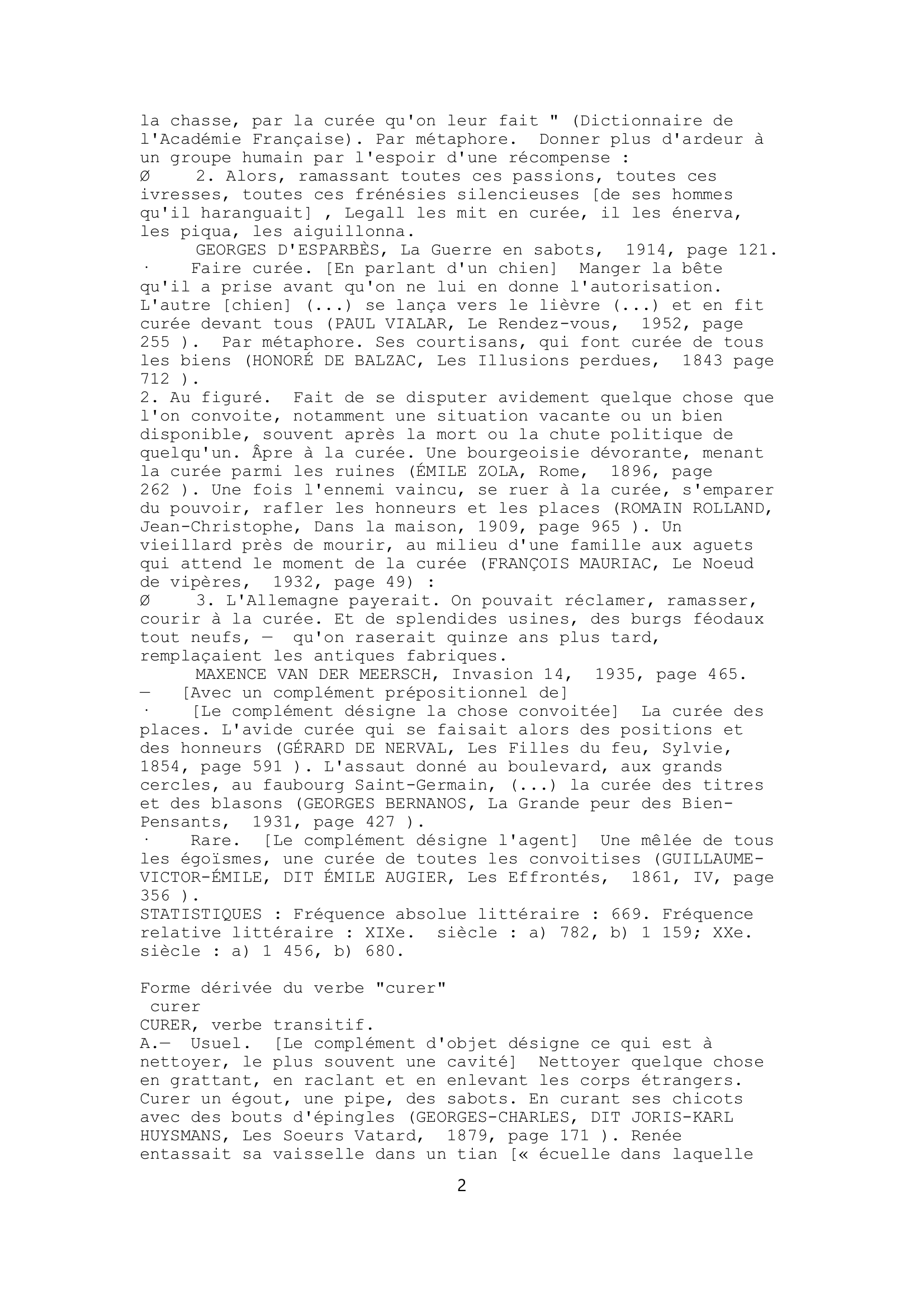Définition du terme: CURÉE, substantif féminin.
Publié le 04/12/2015

Extrait du document
«
la chasse, par la curée qu'on leur fait " (Dictionnaire de
l'Académie Française).
Par métaphore.
Donner plus d'ardeur à
un groupe humain par l'espoir d'une récompense :
Ø 2.
Alors, ramassant toutes ces passions, toutes ces
ivresses, toutes ces frénésies silencieuses [de ses hommes
qu'il haranguait] , Legall les mit en curée, il les énerva,
les piqua, les aiguillonna.
GEORGES D'ESPARBÈS, La Guerre en sabots, 1914, page 121.
· Faire curée.
[En parlant d'un chien] Manger la bête
qu'il a prise avant qu'on ne lui en donne l'autorisation.
L'autre [chien] (...) se lança vers le lièvre (...) et en fit
curée devant tous (PAUL VIALAR, Le Rendez-vous, 1952, page
255 ).
Par métaphore.
Ses courtisans, qui font curée de tous
les biens (HONORÉ DE BALZAC, Les Illusions perdues, 1843 page
712 ).
2.
Au figuré.
Fait de se disputer avidement quelque chose que
l'on convoite, notamment une situation vacante ou un bien
disponible, souvent après la mort ou la chute politique de
quelqu'un.
Âpre à la curée.
Une bourgeoisie dévorante, menant
la curée parmi les ruines (ÉMILE ZOLA, Rome, 1896, page
262 ).
Une fois l'ennemi vaincu, se ruer à la curée, s'emparer
du pouvoir, rafler les honneurs et les places (ROMAIN ROLLAND,
Jean-Christophe, Dans la maison, 1909, page 965 ).
Un
vieillard près de mourir, au milieu d'une famille aux aguets
qui attend le moment de la curée (FRANÇOIS MAURIAC, Le Noeud
de vipères, 1932, page 49) :
Ø 3.
L'Allemagne payerait.
On pouvait réclamer, ramasser,
courir à la curée.
Et de splendides usines, des burgs féodaux
tout neufs, — qu'on raserait quinze ans plus tard,
remplaçaient les antiques fabriques.
MAXENCE VAN DER MEERSCH, Invasion 14, 1935, page 465.
— [Avec un complément prépositionnel de]
· [Le complément désigne la chose convoitée] La curée des
places.
L'avide curée qui se faisait alors des positions et
des honneurs (GÉRARD DE NERVAL, Les Filles du feu, Sylvie,
1854, page 591 ).
L'assaut donné au boulevard, aux grands
cercles, au faubourg Saint-Germain, (...) la curée des titres
et des blasons (GEORGES BERNANOS, La Grande peur des Bien-
Pensants, 1931, page 427 ).
· Rare.
[Le complément désigne l'agent] Une mêlée de tous
les égoïsmes, une curée de toutes les convoitises (GUILLAUME-
VICTOR-ÉMILE, DIT ÉMILE AUGIER, Les Effrontés, 1861, IV, page
356 ).
STATISTIQUES : Fréquence absolue littéraire : 669.
Fréquence
relative littéraire : XIXe.
siècle : a) 782, b) 1 159; XXe.
siècle : a) 1 456, b) 680.
Forme dérivée du verbe "curer"
curer
CURER, verbe transitif.
A.— Usuel.
[Le complément d'objet désigne ce qui est à
nettoyer, le plus souvent une cavité] Nettoyer quelque chose
en grattant, en raclant et en enlevant les corps étrangers.
Curer un égout, une pipe, des sabots.
En curant ses chicots
avec des bouts d'épingles (GEORGES-CHARLES, DIT JORIS-KARL
HUYSMANS, Les Soeurs Vatard, 1879, page 171 ).
Renée
entassait sa vaisselle dans un tian [« écuelle dans laquelle
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition du terme: CYPRINE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYPRIÈRE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYPRÉE, substantif féminin.
- Définition du terme: CYNTHIE, CYNTHIA, substantif féminin.
- Définition du terme: CYNOGLOSSE, substantif féminin.