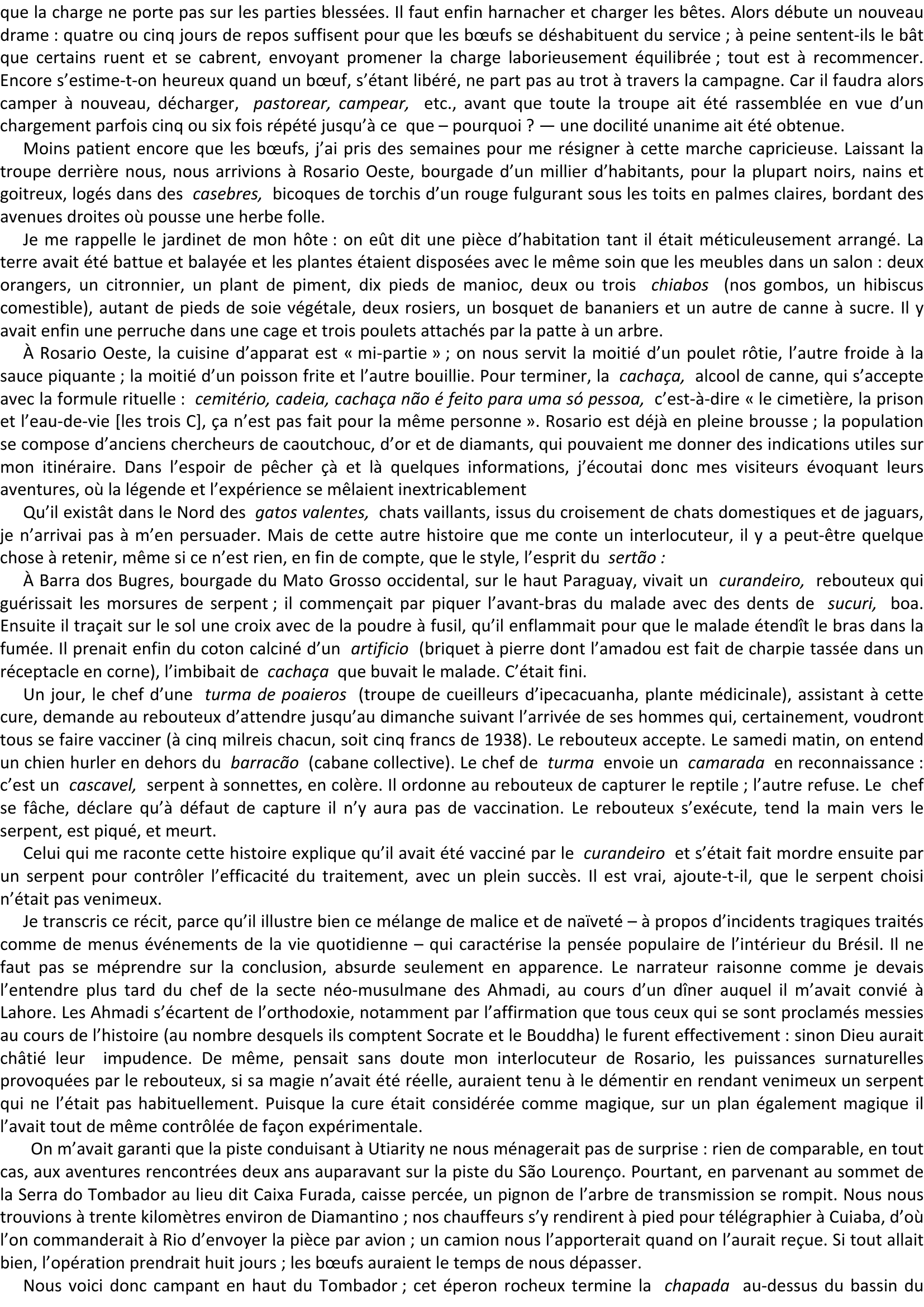grouillantes de vers et laissant apercevoir la colonne vertébrale.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
que
lacharge neporte passurlesparties blessées.
Ilfaut enfin harnacher etcharger lesbêtes.
Alorsdébute unnouveau
drame : quatreoucinq jours derepos suffisent pourquelesbœufs sedéshabituent duservice ; àpeine sentent-ils lebât
que certains ruentetse cabrent, envoyant promener lacharge laborieusement équilibrée ;toutestàrecommencer.
Encore s’estime-t-on heureuxquandunbœuf, s’étant libéré,nepart pasautrot àtravers lacampagne.
Carilfaudra alors
camper ànouveau, décharger, pastorear,
campear, etc.,
avant quetoute latroupe aitété rassemblée envue d’un
chargement parfoiscinqousix fois répété jusqu’à ceque –pourquoi ? — unedocilité unanime aitété obtenue.
Moins patient encorequelesbœufs, j’aipris dessemaines pourmerésigner àcette marche capricieuse.
Laissantla
troupe derrière nous,nousarrivions àRosario Oeste,bourgade d’unmillier d’habitants, pourlaplupart noirs,nainset
goitreux, logésdansdes casebres, bicoques
detorchis d’unrouge fulgurant souslestoits enpalmes claires,bordant des
avenues droitesoùpousse uneherbe folle.
Je me rappelle lejardinet demon hôte : oneût ditune pièce d’habitation tantilétait méticuleusement arrangé.La
terre avaitétébattue etbalayée etles plantes étaientdisposées aveclemême soinquelesmeubles dansunsalon : deux
orangers, uncitronnier, unplant depiment, dixpieds demanioc, deuxoutrois chiabos (nos
gombos, unhibiscus
comestible), autantdepieds desoie végétale, deuxrosiers, unbosquet debananiers etun autre decanne àsucre.
Ily
avait enfin uneperruche dansunecage ettrois poulets attachés parlapatte àun arbre.
À Rosario Oeste,lacuisine d’apparat est« mi-partie » ; onnous servit lamoitié d’unpoulet rôtie,l’autre froideàla
sauce piquante ; lamoitié d’unpoisson friteetl’autre bouillie.
Pourterminer, la cachaça, alcool
decanne, quis’accepte
avec laformule rituelle : cemitério,
cadeia,cachaça nãoéfeito para umasópessoa, c’est-à-dire
« lecimetière, laprison
et l’eau-de-vie [lestrois C],çan’est pasfaitpour lamême personne ».
Rosarioestdéjà enpleine brousse ; lapopulation
se compose d’anciens chercheurs decaoutchouc, d’oretde diamants, quipouvaient medonner desindications utilessur
mon itinéraire.
Dansl’espoir depêcher çàetlàquelques informations, j’écoutaidoncmesvisiteurs évoquant leurs
aventures, oùlalégende etl’expérience semêlaient inextricablement
Qu’il existât dansleNord des gatos
valentes, chats
vaillants, issusducroisement dechats domestiques etde jaguars,
je n’arrivai pasàm’en persuader.
Maisdecette autre histoire quemeconte uninterlocuteur, ilya peut-être quelque
chose àretenir, mêmesice n’est rien,enfin decompte, quelestyle, l’esprit du sertão :
À
Barra dosBugres, bourgade duMato Grosso occidental, surlehaut Paraguay, vivaitun curandeiro, rebouteux
qui
guérissait lesmorsures deserpent ; ilcommençait parpiquer l’avant-bras dumalade avecdesdents de sucuri, boa.
Ensuite iltraçait surlesol une croix avecdelapoudre àfusil, qu’ilenflammait pourquelemalade étendîtlebras dans la
fumée.
Ilprenait enfinducoton calciné d’un artificio (briquet
àpierre dontl’amadou estfait decharpie tasséedansun
réceptacle encorne), l’imbibait de cachaça que
buvait lemalade.
C’étaitfini.
Un jour, lechef d’une turma
depoaieros (troupe
decueilleurs d’ipecacuanha, plantemédicinale), assistantàcette
cure, demande aurebouteux d’attendre jusqu’audimanche suivantl’arrivée deses hommes qui,certainement, voudront
tous sefaire vacciner (àcinq milreis chacun, soitcinq francs de1938).
Lerebouteux accepte.Lesamedi matin,onentend
un chien hurler endehors du barracão (cabane
collective).
Lechef de turma envoie
un camarada en
reconnaissance :
c’est un cascavel, serpent
àsonnettes, encolère.
Ilordonne aurebouteux decapturer lereptile ; l’autrerefuse.
Lechef
se fâche, déclare qu’àdéfaut decapture iln’y aura pasdevaccination.
Lerebouteux s’exécute,tendlamain versle
serpent, estpiqué, etmeurt.
Celui quime raconte cettehistoire explique qu’ilavait étévacciné parle curandeiro et
s’était faitmordre ensuitepar
un serpent pourcontrôler l’efficacité dutraitement, avecunplein succès.
Ilest vrai, ajoute-t-il, queleserpent choisi
n’était pasvenimeux.
Je transcris cerécit, parce qu’ilillustre biencemélange demalice etde naïveté –àpropos d’incidents tragiquestraités
comme demenus événements delavie quotidienne –qui caractérise lapensée populaire del’intérieur duBrésil.
Ilne
faut passeméprendre surlaconclusion, absurdeseulement enapparence.
Lenarrateur raisonnecommejedevais
l’entendre plustard duchef delasecte néo-musulmane desAhmadi, aucours d’undner auquel ilm’avait conviéà
Lahore.
LesAhmadi s’écartent del’orthodoxie, notammentparl’affirmation quetous ceux quisesont proclamés messies
au cours del’histoire (aunombre desquels ilscomptent SocrateetleBouddha) lefurent effectivement : sinonDieuaurait
châtié leurimpudence.
Demême, pensait sansdoute moninterlocuteur deRosario, lespuissances surnaturelles
provoquées parlerebouteux, sisa magie n’avait étéréelle, auraient tenuàle démentir enrendant venimeux unserpent
qui nel’était pashabituellement.
Puisquelacure était considérée commemagique, surunplan également magiqueil
l’avait toutdemême contrôlée defaçon expérimentale.
On m’avait garantiquelapiste conduisant àUtiarity nenous ménagerait pasdesurprise : riendecomparable, entout
cas, auxaventures rencontrées deuxansauparavant surlapiste duSão Lourenço.
Pourtant,enparvenant ausommet de
la Serra doTombador aulieu ditCaixa Furada, caissepercée, unpignon del’arbre detransmission serompit.
Nousnous
trouvions àtrente kilomètres environdeDiamantino ; noschauffeurs s’yrendirent àpied pour télégraphier àCuiaba, d’où
l’on commanderait àRio d’envoyer lapièce paravion ; uncamion nousl’apporterait quandonl’aurait reçue.Sitout allait
bien, l’opération prendraithuitjours ; lesbœufs auraient letemps denous dépasser.
Nous voicidonc campant enhaut duTombador ; cetéperon rocheux terminela chapada au-dessus
dubassin du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les reins sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau des premières vertèbres lombaires.
- La position latérale de sécurité 1 Si une personne est inconsciente mais respire, et si l'on est sûr qu'elle n'a pas un traumatisme de la colonne vertébrale, on la couche sur le côté.
- Fracture de la colonne vertébrale.
- colonne vertébrale ou rachis.
- colonne vertébrale (Biologie et Anatomie).