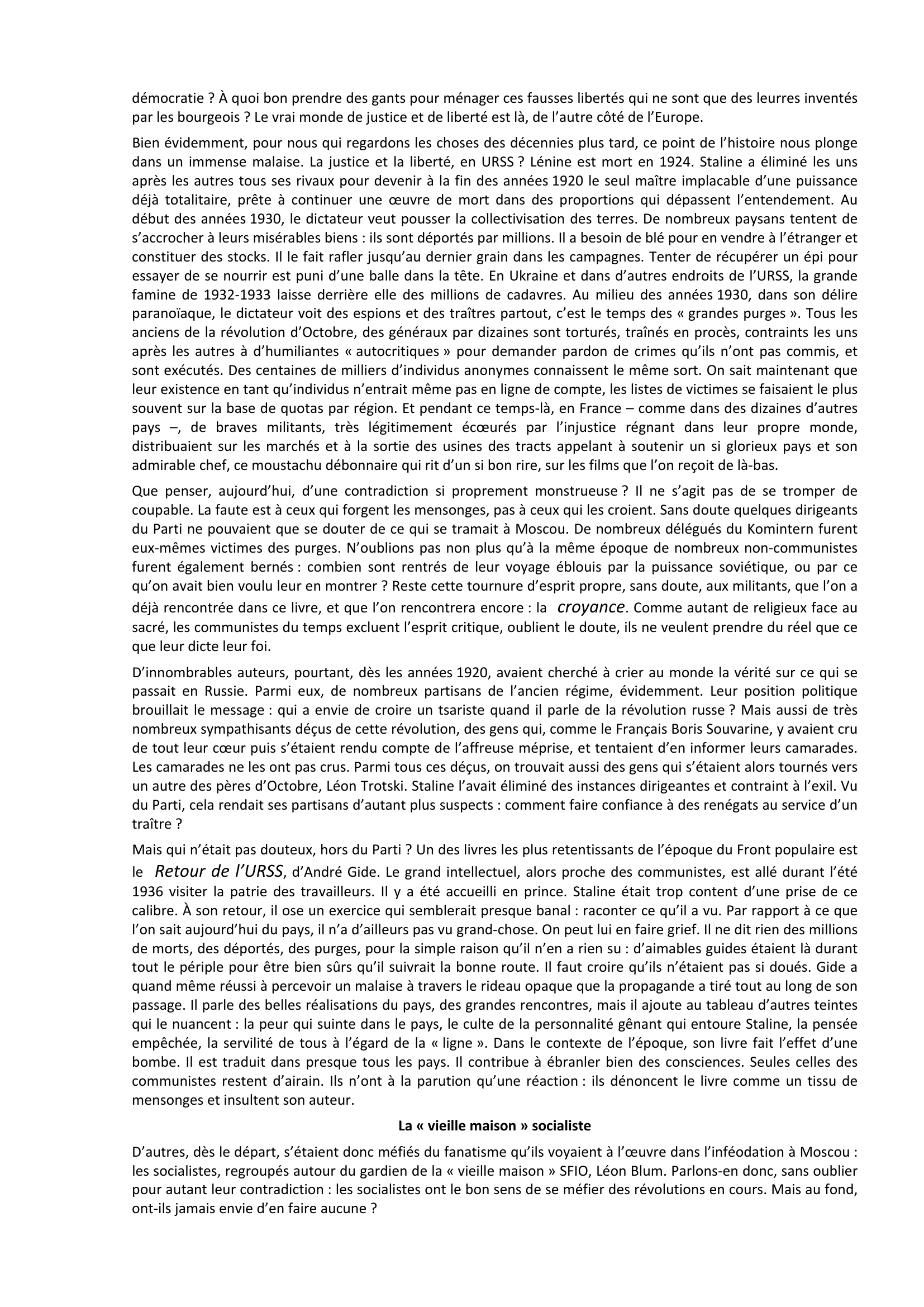Guesde arrivent à la fusion de leurs mouvements pour accoucher en 1905 de ce parti nouveau que nous avons croisé plus haut et dont le nom s'éclaire tout à coup : la SFIO, la « Section française de l'Internationale ouvrière ».
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
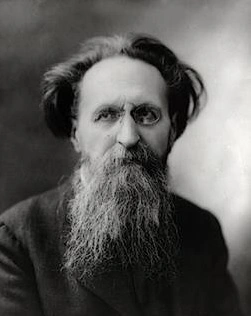
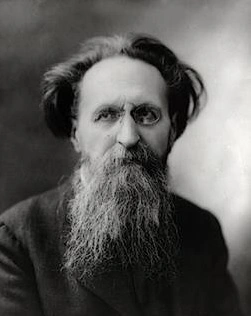
«
démocratie ?
Àquoi bonprendre desgants pourménager cesfausses libertés quinesont quedesleurres inventés
par lesbourgeois ? Levrai monde dejustice etde liberté estlà,de l’autre côtédel’Europe.
Bien évidemment, pournous quiregardons leschoses desdécennies plustard, cepoint del’histoire nousplonge
dans unimmense malaise.Lajustice etlaliberté, enURSS ? Lénineestmort en1924.
Staline aéliminé lesuns
après lesautres toussesrivaux pourdevenir àla fin des années 1920 leseul maître implacable d’unepuissance
déjà totalitaire, prêteàcontinuer uneœuvre demort dansdesproportions quidépassent l’entendement.
Au
début desannées 1930, ledictateur veutpousser lacollectivisation desterres.
Denombreux paysanstententde
s’accrocher àleurs misérables biens :ilssont déportés parmillions.
Ilabesoin deblé pour envendre àl’étranger et
constituer desstocks.
Ille fait rafler jusqu’au derniergraindanslescampagnes.
Tenterderécupérer unépi pour
essayer desenourrir estpuni d’une balledanslatête.
EnUkraine etdans d’autres endroits del’URSS, lagrande
famine de1932-1933 laissederrière elledesmillions decadavres.
Aumilieu desannées 1930, danssondélire
paranoïaque, ledictateur voitdesespions etdes traîtres partout, c’estletemps des« grandes purges ».Tousles
anciens delarévolution d’Octobre, desgénéraux pardizaines sonttorturés, traînésenprocès, contraints lesuns
après lesautres àd’humiliantes « autocritiques » pourdemander pardondecrimes qu’ilsn’ont pascommis, et
sont exécutés.
Descentaines demilliers d’individus anonymesconnaissent lemême sort.Onsait maintenant que
leur existence entant qu’individus n’entraitmêmepasenligne decompte, leslistes devictimes sefaisaient leplus
souvent surlabase dequotas parrégion.
Etpendant cetemps-là, enFrance –comme dansdesdizaines d’autres
pays –,de braves militants, trèslégitimement écœurésparl’injustice régnantdansleurpropre monde,
distribuaient surlesmarchés etàla sortie desusines destracts appelant àsoutenir unsiglorieux paysetson
admirable chef,cemoustachu débonnaire quiritd’un sibon rire, surlesfilms quel’onreçoit delà-bas.
Que penser, aujourd’hui, d’unecontradiction siproprement monstrueuse ? Ilne s’agit pasdesetromper de
coupable.
Lafaute estàceux quiforgent lesmensonges, pasàceux quilescroient.
Sansdoute quelques dirigeants
du Parti nepouvaient quesedouter decequi setramait àMoscou.
Denombreux déléguésduKomintern furent
eux-mêmes victimesdespurges.
N’oublions pasnon plus qu’à lamême époque denombreux non-communistes
furent également bernés :combien sontrentrés deleur voyage éblouis parlapuissance soviétique, oupar ce
qu’on avaitbienvoulu leurenmontrer ? Restecettetournure d’espritpropre,sansdoute, auxmilitants, quel’ona
déjà rencontrée danscelivre, etque l’onrencontrera encore :la croyance .
Comme autantdereligieux faceau
sacré, lescommunistes dutemps excluent l’espritcritique, oublient ledoute, ilsne veulent prendre duréel quece
que leur dicte leurfoi.
D’innombrables auteurs,pourtant, dèslesannées 1920, avaientcherché àcrier aumonde lavérité surcequi se
passait enRussie.
Parmieux,denombreux partisansdel’ancien régime,évidemment.
Leurposition politique
brouillait lemessage : quiaenvie decroire untsariste quandilparle delarévolution russe ?Maisaussi detrès
nombreux sympathisants déçusdecette révolution, desgens qui,comme leFrançais BorisSouvarine, yavaient cru
de tout leurcœur puiss’étaient renducompte del’affreuse méprise,ettentaient d’eninformer leurscamarades.
Les camarades neles ont pas crus.
Parmi touscesdéçus, ontrouvait aussidesgens quis’étaient alorstournés vers
un autre despères d’Octobre, LéonTrotski.
Stalinel’avaitéliminé desinstances dirigeantes etcontraint àl’exil.
Vu
du Parti, celarendait sespartisans d’autantplussuspects : commentfaireconfiance àdes renégats auservice d’un
traître ?
Mais quin’était pasdouteux, horsduParti ? Undes livres lesplus retentissants del’époque duFront populaire est
le Retour
del’URSS ,
d’André Gide.Legrand intellectuel, alorsproche descommunistes, estallé durant l’été
1936 visiter lapatrie destravailleurs.
Ilya été accueilli enprince.
Stalineétaittropcontent d’uneprisedece
calibre.
Àson retour, ilose unexercice quisemblerait presquebanal :raconter cequ’il avu.
Par rapport àce que
l’on saitaujourd’hui dupays, iln’a d’ailleurs pasvugrand-chose.
Onpeut luien faire grief.
Ilne dit rien desmillions
de morts, desdéportés, despurges, pourlasimple raisonqu’iln’en arien su :d’aimables guidesétaient làdurant
tout lepériple pourêtrebien sûrsqu’il suivrait labonne route.Ilfaut croire qu’ilsn’étaient passidoués.
Gidea
quand même réussiàpercevoir unmalaise àtravers lerideau opaque quelapropagande atiré tout aulong deson
passage.
Ilparle desbelles réalisations dupays, desgrandes rencontres, maisilajoute autableau d’autres teintes
qui lenuancent : lapeur quisuinte danslepays, leculte delapersonnalité gênantquientoure Staline,lapensée
empêchée, laservilité detous àl’égard dela« ligne ».
Danslecontexte del’époque, sonlivre faitl’effet d’une
bombe.
Ilest traduit danspresque touslespays.
Ilcontribue àébranler biendesconsciences.
Seulescellesdes
communistes restentd’airain.
Ilsn’ont àla parution qu’uneréaction : ilsdénoncent lelivre comme untissu de
mensonges etinsultent sonauteur.
La
« vieille maison » socialiste D’autres,
dèsledépart, s’étaient doncméfiés dufanatisme qu’ilsvoyaient àl’œuvre dansl’inféodation àMoscou :
les socialistes, regroupésautourdugardien dela« vieille maison » SFIO,LéonBlum.
Parlons-en donc,sansoublier
pour autant leurcontradiction : lessocialistes ontlebon sens deseméfier desrévolutions encours.
Maisaufond,
ont-ils jamais envied’enfaire aucune ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière).
- Section française de l'Internationale ouvrière [SFIO] (partis politiques).
- Étudiez ce bilan du surréalisme proposé par Gaétan Picon (Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1960) : «Qu'avons-nous conservé, qu'avons-nous rejeté du Surréalisme ? Dans une large mesure, il est encore et toujours notre poésie : la poésie moderne tout entière prenant conscience d'elle-même, et allant jusqu'au bout. Toute poésie, à l'heure actuelle, veut être autre chose que poème, fabrication rythmique, jeu inoffensif d'images et de mots : confusion ardente avec l
- 1868 : Dissolution de la section française de l'Internationale.
- 20 mars 1868 : Dissolution de la section française de l'Internationale.