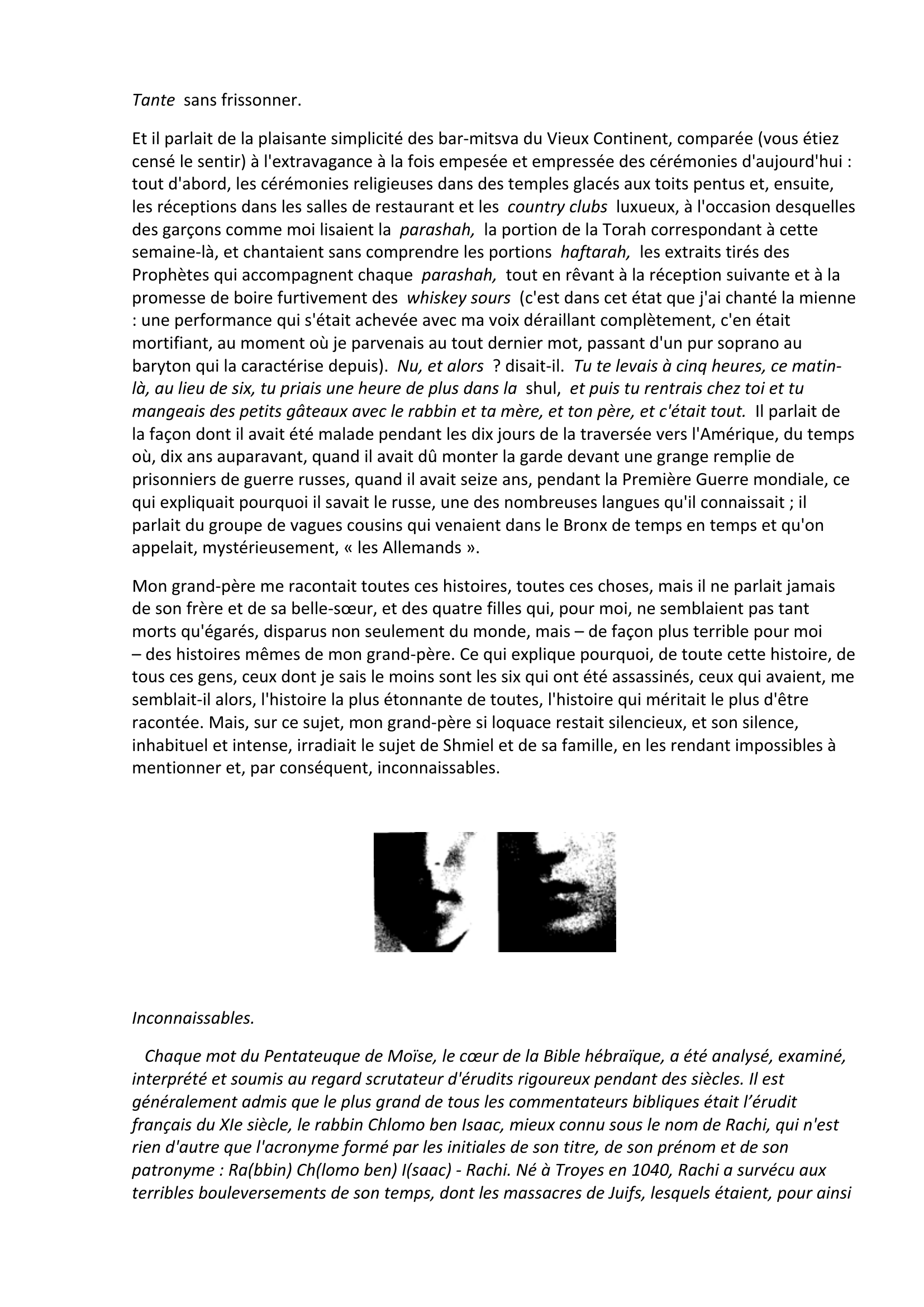Les petits enfants j'ai ri.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
Tante sans
frissonner.
Et ilparlait delaplaisante simplicité desbar-mitsva duVieux Continent, comparée(vousétiez
censé lesentir) àl'extravagance àla fois empesée etempressée descérémonies d'aujourd'hui :
tout d'abord, lescérémonies religieusesdansdestemples glacésauxtoits pentus et,ensuite,
les réceptions danslessalles derestaurant etles country
clubs luxueux,
àl'occasion desquelles
des garçons commemoilisaient la parashah, la
portion delaTorah correspondant àcette
semaine-là, etchantaient sanscomprendre lesportions haftarah, les
extraits tirésdes
Prophètes quiaccompagnent chaque parashah, tout
enrêvant àla réception suivanteetàla
promesse deboire furtivement des whiskey
sours (c'est
danscetétat quej'aichanté lamienne
: une performance quis'était achevée avecmavoix déraillant complètement, c'enétait
mortifiant, aumoment oùjeparvenais autout dernier mot,passant d'unpursoprano au
baryton quilacaractérise depuis).
Nu,
etalors ?
disait-il.
Tu
televais àcinq heures, cematin-
là, au lieu desix, tupriais uneheure deplus dans la shul, et
puis turentrais cheztoiettu
mangeais despetits gâteaux aveclerabbin etta mère, etton père, etc'était tout.
Il
parlait de
la façon dontilavait étémalade pendant lesdix jours delatraversée versl'Amérique, dutemps
où, dixans auparavant, quandilavait dûmonter lagarde devant unegrange remplie de
prisonniers deguerre russes, quandilavait seize ans,pendant laPremière Guerremondiale, ce
qui expliquait pourquoiilsavait lerusse, unedesnombreuses languesqu'ilconnaissait ;il
parlait dugroupe devagues cousins quivenaient dansleBronx detemps entemps etqu'on
appelait, mystérieusement, « lesAllemands ».
Mon grand-père meracontait toutesceshistoires, toutesceschoses, maisilne parlait jamais
de son frère etde sabelle-sœur, etdes quatre fillesqui,pour moi,nesemblaient pastant
morts qu'égarés, disparusnonseulement dumonde, mais– defaçon plusterrible pourmoi
– des histoires mêmesdemon grand-père.
Cequi explique pourquoi, detoute cettehistoire, de
tous cesgens, ceuxdont jesais lemoins sontlessixqui ont étéassassinés, ceuxquiavaient, me
semblait-il alors,l'histoire laplus étonnante detoutes, l'histoire quiméritait leplus d'être
racontée.
Mais,surcesujet, mongrand-père siloquace restaitsilencieux, etson silence,
inhabituel etintense, irradiaitlesujet deShmiel etde safamille, enles rendant impossibles à
mentionner et,par conséquent, inconnaissables.
Inconnaissables.
Chaque motduPentateuque deMoïse, lecœur delaBible hébraïque, aété analysé, examiné,
interprété etsoumis auregard scrutateur d'éruditsrigoureux pendantdessiècles.
Ilest
généralement admisqueleplus grand detous lescommentateurs bibliquesétaitl’érudit
français duXIe siècle, lerabbin Chlomo benIsaac, mieux connu souslenom deRachi, quin'est
rien d'autre quel'acronyme forméparlesinitiales deson titre, deson prénom etde son
patronyme :Ra(bbin) Ch(lomoben)I(saac) -Rachi.
NéàTroyes en1040, Rachiasurvécu aux
terribles bouleversements deson temps, dontlesmassacres deJuifs, lesquels étaient,pourainsi.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Un poète a écrit à propos des petits enfants : Leurs essais d'exister sont divinement gauches; On croit dans leur parole, où tremblent des ébauches, Voir un reste du ciel qui se dissipe et fuit... Car les petits enfants étaient hier encore Dans le ciel et savaient ce que la terre ignore... Leur front tourné vers nous nous éclaire et nous dore... Ils trébuchent encore, ivres du paradis. En vous inspirant de ces vers, et en y ajoutant tout ce que pourront vous suggérer vos impressions, v
- «Prénom», Il y a deux ans que tu nous as quittés ton mari, tes trois enfants, tes cinq petits-enfants.
- dans son testament, avait écrit, Si un de mes enfants ou de mes petits-enfants sortait de la confession juive, il ne toucherait pas un penny de mon argent durement gagné.
- Christiane Rochefort Les Petits Enfants du siècle - Sujet non corrigé
- Un poète a écrit à propos des petits enfants : Leurs essais d'exister sont divinement gauches; On croit dans leur parole, où tremblent des ébauches, Voir un reste du ciel qui se dissipe et fuit... Car les petits enfants étaient hier encore Dans le ciel et savaient ce que la terre ignore... Leur front tourné vers nous nous éclaire et nous dore... Ils trébuchent encore, ivres du paradis. En vous inspirant de ces vers, et en y ajoutant tout ce que pourront vous suggérer vos impressions, v