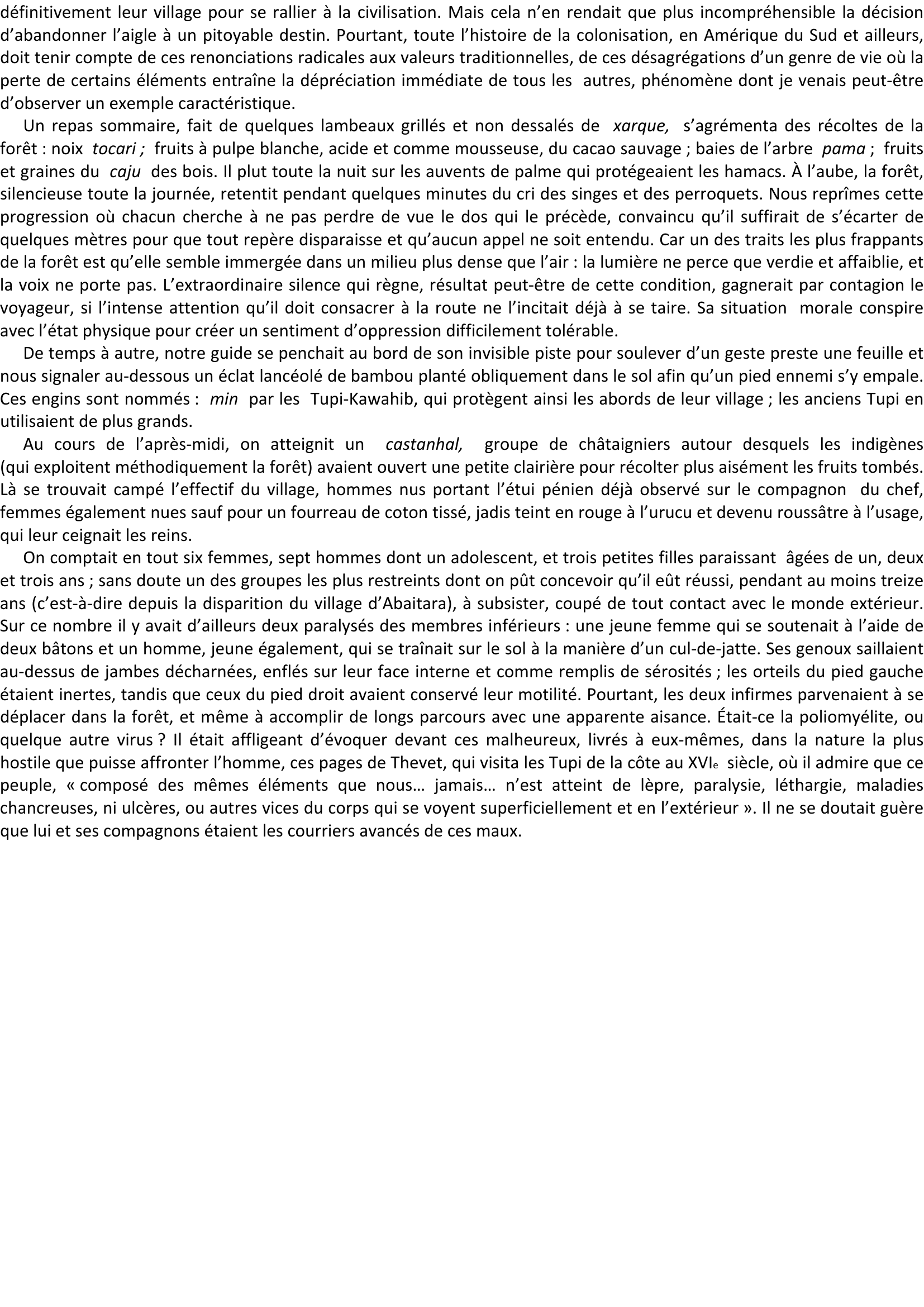pirogue.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
définitivement
leurvillage pourserallier àla civilisation.
Maiscelan’en rendait queplus incompréhensible ladécision
d’abandonner l’aigleàun pitoyable destin.Pourtant, toutel’histoire delacolonisation, enAmérique duSud etailleurs,
doit tenir compte deces renonciations radicalesauxvaleurs traditionnelles, deces désagrégations d’ungenre devie oùla
perte decertains éléments entraneladépréciation immédiatedetous lesautres, phénomène dontjevenais peut-être
d’observer unexemple caractéristique.
Un repas sommaire, faitdequelques lambeaux grillésetnon dessalés de xarque, s’agrémenta
desrécoltes dela
forêt : noix tocari ; fruits
àpulpe blanche, acideetcomme mousseuse, ducacao sauvage ; baiesdel’arbre pama ;
fruits
et graines du caju des
bois.
Ilplut toute lanuit surlesauvents depalme quiprotégeaient leshamacs.
Àl’aube, laforêt,
silencieuse toutelajournée, retentitpendant quelques minutesducrides singes etdes perroquets.
Nousreprîmes cette
progression oùchacun cherche àne pas perdre devue ledos quileprécède, convaincu qu’ilsuffirait des’écarter de
quelques mètrespourquetout repère disparaisse etqu’aucun appelnesoit entendu.
Carundes traits lesplus frappants
de laforêt estqu’elle semble immergée dansunmilieu plusdense quel’air : lalumière neperce queverdie etaffaiblie, et
la voix neporte pas.L’extraordinaire silencequirègne, résultat peut-être decette condition, gagneraitparcontagion le
voyageur, sil’intense attention qu’ildoitconsacrer àla route nel’incitait déjààse taire.
Sasituation moraleconspire
avec l’état physique pourcréer unsentiment d’oppression difficilementtolérable.
De temps àautre, notreguide sepenchait aubord deson invisible pistepoursoulever d’ungeste preste unefeuille et
nous signaler au-dessous unéclat lancéolé de bambou plantéobliquement danslesol afin qu’un piedennemi s’yempale.
Ces engins sontnommés : min par
les Tupi-Kawahib, quiprotègent ainsilesabords deleur village ; lesanciens Tupien
utilisaient deplus grands.
Au cours del’après-midi, onatteignit un castanhal, groupe
dechâtaigniers autourdesquels lesindigènes
(qui exploitent méthodiquement laforêt) avaient ouvertunepetite clairière pourrécolter plusaisément lesfruits tombés.
Là setrouvait campél’effectif duvillage, hommes nusportant l’étuipénien déjàobservé surlecompagnon duchef,
femmes également nuessaufpour unfourreau decoton tissé,jadisteint enrouge àl’urucu etdevenu roussâtre àl’usage,
qui leur ceignait lesreins.
On comptait entout sixfemmes, septhommes dontunadolescent, ettrois petites fillesparaissant âgéesdeun, deux
et trois ans ; sansdoute undes groupes lesplus restreints dontonpût concevoir qu’ileûtréussi, pendant aumoins treize
ans (c’est-à-dire depuisladisparition duvillage d’Abaitara), àsubsister, coupédetout contact aveclemonde extérieur.
Sur cenombre ilyavait d’ailleurs deuxparalysés desmembres inférieurs : unejeune femme quisesoutenait àl’aide de
deux bâtons etun homme, jeuneégalement, quisetranait surlesol àla manière d’uncul-de-jatte.
Sesgenoux saillaient
au-dessus dejambes décharnées, enfléssurleur face interne etcomme remplisdesérosités ; lesorteils dupied gauche
étaient inertes, tandisqueceux dupied droit avaient conservé leurmotilité.
Pourtant, lesdeux infirmes parvenaient àse
déplacer danslaforêt, etmême àaccomplir delongs parcours avecuneapparente aisance.Était-celapoliomyélite, ou
quelque autrevirus ? Ilétait affligeant d’évoquer devantcesmalheureux, livrésàeux-mêmes, danslanature laplus
hostile quepuisse affronter l’homme, cespages deThevet, quivisita lesTupi delacôte auXVI esiècle, oùiladmire quece
peuple, « composé desmêmes éléments quenous… jamais… n’estatteint delèpre, paralysie, léthargie,maladies
chancreuses, niulcères, ouautres vicesducorps quisevoyent superficiellement eten l’extérieur ».
Ilne sedoutait guère
que luietses compagnons étaientlescourriers avancésdeces maux..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓